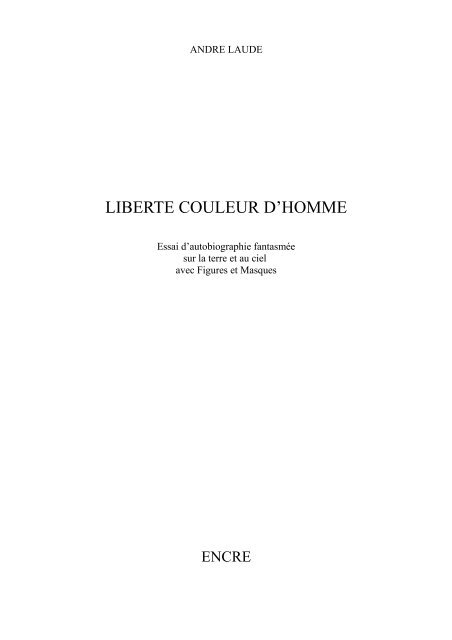LIBERTE COULEUR D'HOMME - Les amis d'André Laude
LIBERTE COULEUR D'HOMME - Les amis d'André Laude
LIBERTE COULEUR D'HOMME - Les amis d'André Laude
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ANDRE LAUDE<br />
<strong>LIBERTE</strong> <strong>COULEUR</strong> D’HOMME<br />
Essai d’autobiographie fantasmée<br />
sur la terre et au ciel<br />
avec Figures et Masques<br />
ENCRE
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
© ENCRE ÉDITIONS 1980 PARIS<br />
- 2 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
À la mémoire de Gabrielle Russier, qu’une société imbécile et criminelle accula, il y a dix ans, au<br />
suicide pour « crime d’amour<br />
illégal ».<br />
À Gabor Winter emprisonné en Allemagne fédérale, Abdellatif Laâbi<br />
emprisonné au Maroc, Breyten Breytenbach emprisonné en République<br />
sud–africaine, Armando Valladares emprisonné à Cuba.<br />
À<br />
Hélène et René<br />
Évelyne et Jean<br />
Anne–Marie et Paul<br />
en Arles.<br />
À Françoise Buisson et Romain Sylvain.<br />
Enfin, à tous ceux qui crèvent sur la planète, dans le silence et l’oubli, pour avoir pris parti pour la<br />
liberté « libre ».<br />
- 3 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Il faut changer le jeu et non pas les pièces du jeu.<br />
L’art a pour devoir social de donner issue aux angoisses de<br />
son époque.<br />
André Breton<br />
Antonin Artaud<br />
Nous sommes dix–sept sous une lune très petite. Ernesto « Che » Guevara, Journal de Bolivie<br />
L’humanité a besoin d’une cure de bouddhisme.<br />
Octavio Paz<br />
Toute tentative de rédaction d’une autobiographie est un crime contre l’Esprit tout–puissant, contre la<br />
vérité vraie.<br />
Li Fang – Livre de la Voie Unique<br />
Un rapport de l’ONU révèle la terrible réalité : 100 millions d’enfants–esclaves. En Asie, dans une<br />
fabrique d’allumettes, 20.000 enfants travaillent 16 heures par jour – LES PLUS<br />
JEUNES ONT 5 ANS !<br />
La Presse internationale – août 1979 – d’après un rapport du Bureau international du travail<br />
C’est la révolte même, la révolte seule qui est créatrice de<br />
lumière.<br />
- 4 -<br />
André Breton
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Il ne m’est pas indifférent d’être né le 3 mars 1936.<br />
3 mars : cela signifie d’abord pour moi que j’ai été conçu durant l’été. Je suis donc un fils du<br />
commencement de l’été 1935. Je vois là un signe des dieux d’autant que ma venue au jour m’a<br />
placé sous le signe des « poissons », signe qui annonce l’infini, l’inachevé, la fluidité, la tension<br />
intérieure, la rêverie fondamentale. 1936 : l’année du Front populaire mais aussi de ce qu’on appelle<br />
maladroitement la « guerre d’Espagne » alors qu’il conviendrait de parler d’une révolution<br />
espagnole en voie d’éclatement que le soulèvement militaire de l’infâme Francisco Franco se donna<br />
pour but d’écraser dans l’œuf. 1936. Comme le temps passe, j’ai, aujourd’hui, à quarante–trois ans<br />
passé, la douloureuse, l’énervante sensation d’être aussi vieux que le vieil océan célébré par Isidore<br />
Ducasse, comte de Lautréamont, auteur des Chants de Maldoror. Depuis des années je traîne une<br />
lassitude impitoyable. Fatigue du corps et de l’esprit blessés gravement par les épreuves, les quêtes,<br />
les errances, les nuits blanches, les questionnements farouches, les aventures de poussière et de<br />
vent. Ma mémoire est déjà un grand cimetière jonché de curieux éléphants : visages, lieux, jours,<br />
saisons d’amour ou de mélancolie, paysages d’eau ou de pierre, d’herbe ou de steppe qui parfois<br />
resurgissent avec une étonnante vérité devant mes yeux, et qui, très souvent, de plus en plus<br />
fréquemment, s’estompent dans une étrange brume. Des lambeaux de monde définitivement mort<br />
dansent dans ma tête. Je ne serai jamais un bon mémorialiste. C’est pourquoi, tout au long de ce<br />
livre dans lequel je vais me mettre à nu, à poils, je vais orgueilleusement me raconter, fantasmes,<br />
fantômes et réalités vont inextricablement se mêler pour le plaisir (je l’espère !) du lecteur qui aura<br />
eu la patience de me suivre jusqu’au bout.<br />
« Je suis un mensonge qui dit la vérité » : je n’ai jamais vraiment aimé le poète bricoleur<br />
d’Orphée et du Sang d’un poète. Pourtant, cet aveu qu’il jeta un jour n’a cessé de m’occuper, de me<br />
hanter. Qu’est–ce qui est vrai, qu’est–ce qui est faux ? Qu’importe si Blaise Cendrars le merveilleux<br />
voyageur de l’espace du dehors et de l’espace du dedans – frère en cela de Michaux, de Segalen et<br />
de quelques autres – n’a pas accompli tous les périples qu’il narre, qu’importe s’il n’a pas fait<br />
l’amour avec toutes les femmes qu’il évoque dans sa prose rythmée par les roues des express<br />
internationaux, qu’importe s’il n’a pas vraiment vu dans la forêt brésilienne une vieille locomotive<br />
des commencements de l’âge d’or du rail, envahie, mangée par les exubérantes fleurs tropicales, les<br />
serpents pythons et les fourmis rouges. La littérature n’est qu’un fantastique artifice pour dire<br />
quelque chose de vital, de l’ordre de la nécessité. L’écrivain n’a pas à rendre de comptes. Il donne<br />
des contes aux petits et grands enfants de la planète, ballottés entre étoiles énigmatiques et drames<br />
violents, quotidiens. À un certain degré d’intensité le rêve devient réalité irréfutable, vécue. Sans<br />
bouger de sa chaise, le poète, qui a l’étoile au front, a réellement traversé tel ou tel pays. Il peut en<br />
donner une description authentique, non pas une description en surface, mais une description en<br />
profondeur. Je vous le jure, la grande Garabagne existe. J’y ai séjourné, il y a quelques années,<br />
avec mon amie du moment qui s’appelait – s’appelle toujours je l’espère pour elle – Irina<br />
Vacaresco. Nous logeâmes alors au « Grand Hôtel des Postes et des Étrangers réunis »…<br />
Il en va tout autant pour moi. Vous me croirez, vous ne me croirez pas si je vous jure sur ce que<br />
j’ai de plus précieux au monde que j’ai chevauché à la gauche d’Attila déferlant sur l’Europe, que<br />
- 5 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
j’ai participé à la défense de Montségur que, assiégé par les armées de Simon de Montfort, j’étais<br />
dans la foule qui s’empara de la Bastille en 1789, que j’ai été lieutenant de Mandrin avant d’aller<br />
rejoindre au Mexique Pancho Villa et Emiliano Zapata…<br />
Si je vous dis que les vents de la Liberté soufflant aux quatre points cardinaux ont toujours<br />
réveillé ma carcasse épuisée, m’arrachant à l’immobilité des statues et des morts pour me jeter sur<br />
les chemins de l’aventure, du hasard, de la poésie en chair et en os.<br />
En son temps, Christophe Colomb pratiqua ce qu’André Breton, quelques siècles plus tard,<br />
devait nommer « l’écart absolu ». Je revendique, à mon tour, cette pratique. Par le fantasme vers la<br />
vérité profonde d’André <strong>Laude</strong>, ci–devant littérateur. Le mensonge sera tout au long de ce livre<br />
l’équipier fidèle de la relation authentique. Lecteur, je t’interdis donc, d’emblée, de me demander<br />
sur un ton inquisitorial de fournir des preuves. J’ai depuis longtemps tout brûlé : passeports,<br />
lettres,4 carnets intimes, photographies, objets divers, exotiques, pacotille rapportée des continents<br />
vierges.<br />
J’ai tous les droits, y compris celui justement de me cacher derrière de gros, énormes mensonges<br />
parce que je suis pudique, secret, et que malgré tout j’ai désir de vous entraîner jusqu’au cœur du<br />
réel absolu.<br />
Et, maintenant, s’il vous plaît, larguons les amarres. Et que ceux qui souffrent du mal de mer,<br />
demeurent à quai. Ils deviendront semblables à ces admirables idiots qu’autrefois Arthur Rimbaud<br />
pointait de son rire ravageur de voyou, de voyant…<br />
- 6 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
L’ENFANCE D’UN REBELLE<br />
- 7 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Naît–on rebelle ? Je ne possède pas la science de Louis Pauwels et de ces messieurs de la<br />
nouvelle droite pour fournir ici une réponse claire. Sans pour autant vouloir me perdre dans les<br />
arcanes de la biologie, de la génétique, je suis intimement persuadé qu’il y a dans ce domaine des<br />
prédispositions, antagonistes avec d’autres, celles qui peuvent conduire à accepter sans broncher<br />
l’asservissement, l’esclavage, la domination sur soi–même par un individu, un groupe d’individus,<br />
un État. Pour ce qui me concerne je crois que je suis né décisivement « différent ». Pourtant, aussi<br />
loin que je remonte dans mes souvenirs – tâche particulièrement épuisante étant donné, ainsi que je<br />
l’ai déjà avoué, que ma mémoire est pleine de trous comme une vieille casserole bosselée – je ne<br />
trouve guère d’épisodes qui auraient en leur temps préfiguré ma carrière de rebelle. Somme toute, je<br />
fus un enfant sage, relativement obéissant comme la plupart des enfants. Il me faut aujourd’hui<br />
fermer les yeux jusqu’à la douleur pour ressusciter l’enfant que je fus, pour déterrer de son tombeau<br />
d’air et d’oubli cet étranger qui portait mon nom. Il faut que je l’avoue : il y a en moi comme une<br />
secrète volonté d’être venu de nulle part, d’être mon propre géniteur. Comme une révolte diffuse<br />
contre tout ce qui constitua mon enfance. Et pourtant je n’ai pas été un enfant « malheureux »<br />
comme on dit. Je suis seulement né trois ans après la prise du pouvoir en Allemagne par Hitler et<br />
ses tueurs fanatiques.<br />
Il y a un temps qui m’obsède : celui qui s’étend entre ma naissance et la première image claire,<br />
enregistrée pour toujours dans ma mémoire : la boutique de ma grand–mère. Celle–ci tenait un<br />
magasin d’alimentation, une succursale de l’Union commerciale plus précisément, à Aulnay–sous–<br />
bois dans un département qui s’appelait encore Seine–et–Oise. La boutique était située rue Jean<br />
Charcot, à l’extrémité du pont de chemin de fer, à quelques centaines de mètres de la gare à laquelle<br />
on parvenait en parcourant la rue Pavillon. Une rue qui aurait pu donner son nom à toutes les rues<br />
de la cité. Durant ma jeunesse – et aujourd’hui encore d’ailleurs – Aulnay–sous–bois était une<br />
banlieue de Paris avec toutes les allures d’une ville–dortoir. Chaque matin, une population<br />
laborieuse mêlant hommes et femmes affluait vers la gare et s’entassait dans les nombreux trains<br />
qui rejoignaient Paris sans arrêt en une quinzaine de minutes : des ouvriers du bâtiment et de la<br />
métallurgie, des employés de bureau, des secrétaires–dactylos, des couturières, des femmes<br />
déménage… <strong>Les</strong> trains de l’aube étaient voués au menu fretin. <strong>Les</strong> trains qui partaient les derniers<br />
avant le grand trou de la matinée emportaient les cadres, des messieurs graves et sérieux lecteurs du<br />
Figaro. Entre six et huit heures du matin on lisait plus fréquemment Le Parisien Libéré, l’Aurore,<br />
l’Equipe. <strong>Les</strong> wagons étaient rugueux, ils rudoyaient les dos et les fesses. <strong>Les</strong> jeunes femmes se<br />
manucuraient soigneusement tandis que d’autres feuilletaient un magazine féminin – Boléro, A tout<br />
cœur, – tout en laissant glisser leurs regards sur le paysage triste, sordide aussi, des banlieues grises<br />
se succédant dans un alignement de fenêtres muettes, de béton gris. Ça sentait le tabac, les<br />
vêtements fripés, la sueur en été, la tristesse en hiver. Il y avait les joyeux lurons qui tapaient la<br />
belote avant d’affronter les cadences infernales. Des histoires vulgaires, des histoires de culs<br />
déclenchaient des rires gras, obèses, dégueulasses. C’est sans nul doute dans ces trains que ma<br />
révolte s’est confirmée, au temps où je n’avais pas encore quitté la maison familiale, alors que<br />
j’occupais le premier – et dernier – emploi « sérieux » de mon existence : employé au Crédit<br />
- 8 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Lyonnais.<br />
J’ai bien changé. À l’époque il suffisait d’un mot de mon père – levé toujours le premier – pour<br />
m’arracher au sommeil et à la douceur des draps lavés par Maman. Je bondissais hors du lit. Je<br />
savais que Papa avait préparé un grand bol de café noir et des tartines que j’engloutissais tout en<br />
enfilant mes vêtements, en me peignant. J’étais imberbe, j’échappais donc à la corvée quotidienne<br />
du rasage. <strong>Les</strong> speakers de Radio Luxembourg nous exhortaient à partir au labeur, le sourire aux<br />
lèvres. <strong>Les</strong> chansons diffusées sur l’antenne à cette heure parlaient toutes de joie de vivre, de plages,<br />
d’amours qui n’en finissaient jamais, de passions brûlantes, de pays exotiques, d’avenir radieux<br />
pour ceux qui s’aiment. Je commençais ma dissidence à moi. J’exécrais ces chansons, ces voix<br />
optimistes ou qui s’efforçaient de le paraître. Je haïssais mon métier. J’avais déjà attrapé un étrange<br />
virus. Je rêvais à une autre vie. Mes yeux traversaient les murs de ma banlieue et fuyaient vers des<br />
horizons inconnus. J’entendais des sirènes de navires s’arrachant aux quais avec fracas. J’étais<br />
propre, j’avais le ventre rempli comme il faut, j’étais malheureux.<br />
Mais ne brûlons pas les étapes. Revenons, si vous le permettez, cher lecteur, vers ce gosse que je<br />
fus. Soutenez ma marche, mon retour après tant de fuites et détours, tant de piétinements fourbus,<br />
vers la source originelle, vers l’obscur terreau. Alors qu’aujourd’hui j’ai en toute logique vécu plus<br />
de la moitié de la vie que Dieu – ou diable – m’a donnée –, la nette image fend soudain comme<br />
l’éclair mon sommeil agité et me redresse, le souffle court, la poitrine oppressée au cœur de la nuit,<br />
dans le fouillis des draps griffés par les ongles de l’angoisse.<br />
Oui, revenons à Aulnay-sous-Bois. À cette ville de merde que je n’ai pas revisitée depuis plus de<br />
quinze ans, qui est là toute ; proche, toujours semblable avec ses pavillons alignés le long des rues<br />
bordées de jardins potagers où quelques fleurs mettent des taches de poésie urbaine. À cette ville–<br />
ventre où j’ai grandi. À cette ville–cimetière où j’ai hurlé comme un orphelin, où chaque passage de<br />
train déchirait ma poitrine de gosse rêveur, où chaque talus m’apparaissait comme une ouverture sur<br />
un jardin des délices. Je n’avais pas encore l’âge de bien réaliser que tout jardin est jardin des<br />
supplices. L’enfance s’accroche, elle meurt avec une lenteur émouvante. <strong>Les</strong> épines dans les veines<br />
mettent du temps à parvenir jusqu’au cœur qu’elles transpercent et font saigner.<br />
C’est vrai, je ne suis jamais retourné à Aulnay-sous-Bois depuis plus d’une décennie de peur d’y<br />
croiser le long du canal de l’Ourcq le fantôme de ma jeunesse qui aurait forcément le teint blafard<br />
d’Alfred de Musset errant sous les lanternes du crépuscule. Parfois, l’envie folle me prend de bondir<br />
dans un train, un taxi, la voiture d’un ami, de pénétrer incognito la ville, de refaire le parcours de<br />
toutes ces années éteintes, de confronter l’homme adulte au gosse, à l’adolescent du début des<br />
années 50, d’aller traîner du côté du Prado, du Palace, du Français où mes premières amours<br />
avaient pour partenaires des stars de Hollywood : Bette Davis, Joan Crawford, Lauren Bacall,<br />
Ingrid Bergman, Jennifer Jones, Rita Hayworth…<br />
C’est donc à Aulnay–sous–bois que je fis mes premiers pas, entouré de femmes, très vite, car<br />
mon père partit quelques mois après ma naissance combattre en Espagne dans les rangs<br />
communistes. Mon père était né au Cateau dans le nord, une région triste, laborieuse, économe, dure<br />
à l’ouvrage où les fièvres et les passions contenues durant de longs mois éclataient à l’occasion des<br />
fameuses « ducasses », fêtes grasses couronnées de saucisses, de cornets de frites, de bocks de<br />
bière.<br />
Mon père descendit très tôt dans la mine comme la quasi totalité des enfants du pays. Il apprit à<br />
pousser jusqu’à l’épuisement les wagonnets chargés à ras, puis à extirper le charbon des parois. Il<br />
apprit à suer sang et eau, à ramper, à avoir peur du coup de grisou imprévisible, de l’effondrement<br />
des charpentes. En ce temps–là, comme aujourd’hui, la peau d’un travailleur ne valait pas cher et<br />
combien d’assassinats commis par des patrons furent gentiment camouflés en accidents du travail. Il<br />
apprit à encaisser les ordres, les commandements, les réprimandes, les coups de gueule des<br />
contremaîtres. Il apprit à fermer sa « gueule » et à serrer les poings de rage. Il apprit à devenir un<br />
- 9 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
humilié, un offensé. Il apprit à devenir une graine de rebelle. Son père, lui aussi, était descendu très<br />
tôt dans la mine. C’était un étrange homme. Certains l’appelaient le « grand Zapata ». Aujourd’hui<br />
encore, il y a de très vieilles gens au Cateau qui se souviennent du « Père <strong>Laude</strong> ». Je l’ai connu<br />
devenu vieillard irascible, quasiment abandonné par tous et d’abord par ses propres enfants, mon<br />
père et ma tante Jeanne.<br />
S’il y a de la douceur dans les mœurs des prolétaires il y a aussi de la rugueur, de la violence.<br />
Mon grand–père acheva ses jours dans une maison de vieux. Il déféquait dans le lit, ce qui lui valait<br />
les insultes et les gestes brutaux des infirmières accablées. Il était en perpétuel courroux, s’en<br />
prenait à chacun et chacune, faisait des colères de gosse, crachait à la face des pauvres types qui<br />
servaient les repas minables. Il crevait à petit feu, plein de la rage de ne plus pouvoir commander,<br />
de ne plus pouvoir imposer. Tout ce que je sais de lui c’est mon père qui me l’a dit du temps où<br />
nous nous parlions encore. Mon père se souvenait qu’enfant chacun à la table familiale serrait<br />
durement son couteau car mon grand–père avait terriblement peur des armes blanches. Il était<br />
buveur, violent, capable de brutalités inouïes. Il paraît qu’un jour il fit, d’une bourrade, traverser la<br />
pièce à ma grand–mère qui alla s’affaler contre le « mur » de leur bicoque qu’elle creva à moitié. Il<br />
faut reconnaître que cette dernière n’était pas construite en béton. Mais sans doute était–il, à sa<br />
façon, un homme « bon » qui devait regretter, comme mon père, les violences aussitôt qu’elles<br />
avaient été commises. D’une force assez surprenante – son apparence trompait – il était assez<br />
fréquent que dans un café, à cause du regard d’un autre homme trop longtemps fixé sur lui à son<br />
goût, il se levât, marchât dans sa direction, le provoquât. En général, l’autre, forcément macho,<br />
acceptait la provocation. Ils sortaient tous deux tandis que le cercle se formait. La bagarre<br />
commençait alors. Dans la plupart des cas ce fut mon grand–père qui l’emporta. Il rentrait, dans<br />
l’établissement, le nez ensanglanté, les lèvres plus ou moins boursouflées, mais fier comme un coq.<br />
La querelle s’éteignait alors au bord du zinc. Jusqu’à la suivante. On raconte même qu’un jour, pour<br />
je ne sais quelle peccadille, les gendarmes se présentèrent chez lui, à l’heure du dîner. Ils entrèrent<br />
sans frapper. C’étaient des <strong>amis</strong> avec lesquels il partageait les joies et les incertitudes des combats<br />
de coqs. Mon grand–père se dressa aussitôt et dit à peu près ceci : « quand on rentre chez les<br />
honnêtes gens, on cogne à la porte ». <strong>Les</strong> gendarmes ne se le firent pas dire deux fois. Ils sortirent<br />
de la maison et frappèrent respectueusement à la porte. Alors, d’une voix de stentor, mon grand–<br />
père claironna « Entrez ! ».<br />
Une autre fois, paraît–il, il voulut jeter dans le haut fourneau de la mine un ouvrier avec lequel il<br />
s’était querellé. Il s’avançait vers la gueule effrayante où le feu du diable rugissait, portant à bout de<br />
bras sa victime. Il fallut que quelques mineurs courageux viennent littéralement la lui arracher. Pour<br />
cet acte il fut, un long temps, « mis à pied ». Cet homme était né dans ce qu’on nomme aujourd’hui<br />
l’Occitanie, autrement dit le sud de la France, et plus précisément – O étrange hasard – dans le<br />
département dont nous portons le nom ou plutôt qui porte le nôtre car notre nom est très ancien. Par<br />
la suite il travailla dans les mines d’Alès et d’ailleurs. C’était l’époque où la classe ouvrière forgeait<br />
les instruments de son combat contre l’exploitation, l’arrogance des patrons abrités dans leurs<br />
somptueuses demeures : syndicats, bourses du travail. C’était le temps où Jean Jaurès, l’empereur<br />
« à la barbe fleurie », enflammait les foules avec des discours où roulaient les « R », où éclataient<br />
les fanfares des cigales et des herbes aromatiques. C’était l’époque où les gouvernants n’hésitaient<br />
pas à donner l’ordre aux gendarmes et autres « forces de l’ordre » de tirer sur la racaille. En ce<br />
temps–là, le rêve socialiste n’était pas devenu la chasse gardée de petits ou grands bourgeois « de<br />
gauche » formés dans les grandes écoles – ENA et autre Institut d’Études politiques – qui trouvent<br />
naturelle leur aisance et en vérité, se soucient comme de leur dernière chemise de ceux qui crèvent<br />
toujours dans les galetas infâmes, de ceux qui traînent leur carcasse usée jusqu’au pâle soleil des<br />
squares urbains, de tous ces vieux et vieilles qui ont heureusement des appétits de moineaux et<br />
assez de dignité pour proclamer que non vraiment ils ne rêvent jamais de caviar, de vraies vacances<br />
- 10 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
du côté de Nice ou de Cannes, d’affection, d’attention. En ce temps–là, des hommes dans ce pays<br />
pouvaient mourir pour la « cause ». Ils avaient le socialisme dans le sang. Le rêve primait tout,<br />
passait avant le bonheur individuel. Ils ne nourrissaient aucun songe de gloire. Ils n’éprouvaient<br />
alors qu’un désir : en finir avec l’horrible domination d’une poignée de cyniques enrichis sur le dos<br />
d’une masse maintenue dans l’ignorance, taillable et corvéable à merci, livrée à la misère, à<br />
l’angoisse, aux drames de l’alcoolisme, à l’horreur des jours gris, vides, privés de sens qui se<br />
succédaient en cadences infernales. Ceux–là savaient mourir pour la « gueuse ». Ceux–là pouvaient<br />
certes s’enivrer, se battre comme des chiens fous, se disputer un bout de terre, une femme, une<br />
sombre baraque, mais ils savaient aussi s’entraider, s’unir pour former une foule coléreuse,<br />
compacte, qui montait poings et poitrines nues à l’assaut des troupes de la République bourgeoise,<br />
sans peur, en silence, ce silence étonnant des humiliés quand ils surgissent de leur vermine, de leur<br />
affreux fatalisme, de leur noire résignation.<br />
Quelque part j’aime ce grand–père dont au fond j’ignore presque tout. Je songe à lui quand les<br />
écrans de TV m’offrent les visages et les propos lénifiants, démagogiques, de nos leaders de<br />
« gauche », quand ils m’imposent toute une crapule sûre de sa puissance, sûre de sa capacité à<br />
chloroformer ceux qui ne savent pas qu’ils n’auraient rien à perdre à abattre leurs chaînes. Alors, je<br />
m’appuie contre l’ombre blessée de mon grand–père pour mieux les haïr, les mépriser, les défier,<br />
pour mieux leur hurler aux oreilles que tout règne a une fin, qu’un jour peut–être les offensés, à la<br />
suite d’une prise de conscience fantastique, se lèveront et viendront enfin leur réclamer des<br />
comptes. Ce jour–là, s’il doit être, que Dieu me fasse l’honneur de me donner le privilège de le<br />
vivre. Enfin, mon grand–père, poussière, moins que poussière, pourra reposer.<br />
Requiescat in pace cher grand–père mort au champ d’horreur. Nous n’avons plus rien à nous<br />
dire. Et rendez–vous au ciel s’il en existe un.<br />
En fait, ce n’est que bien plus tard que j’appris mes racines occitanes. Enfant, je ne comprenais<br />
pas ce que cela voulait dire que d’appartenir à la civilisation du « sud ». D’autant que, comme je l’ai<br />
déjà avoué, mon père et moi n’avons guère parié ensemble. Si je me souviens bien, l’essentiel de<br />
nos échanges verbaux ne cessa de se situer sur le plan des rapports fils–père. « Fais ceci, ne fais pas<br />
cela », « je t’ordonne de… », « si tu n’obéis pas tu vas prendre une trempe. »…<br />
Mon père, c’est l’écharde au cœur. À quarante–quatre ans, je suis toujours jaloux quand je vois<br />
des pères et des fils ou filles entretenir des liens chaleureux tissés de confiance et d’aveux<br />
réciproques. Mon père à moi n’a jamais été un copain, un ami. Il n’aura été que cette figure<br />
historique qui possède le savoir, la force, à laquelle on obéit sans rechigner sous peine de<br />
répression. C’est peut–être pourquoi je n’ai jamais eu vraiment, jusqu’à ce jour, le sens de la<br />
famille, le goût du foyer. C’est peut–être pourquoi ma mémoire compte tant de zones obscures et<br />
que je me retrouve contraint de fabuler quand les souvenirs des « faits réels » se diluent dans un fog<br />
effroyable. Si d’une certaine façon, lecteur, j’invente la vie qui est censée avoir été la mienne, ce<br />
n’est pas par passion du mensonge. C’est parce que je suis persuadé que toute autobiographie est<br />
fausse, que toute tentative autobiographique est frappée de nullité, qu’elle brouille les pistes, qu’elle<br />
est l’arbre qui cache la forêt en quelque sorte. J’invente, oui, je fabule, certes, mais j’ai la vive<br />
conviction de vous conter ainsi ma véritable histoire, celle que jamais nulle étudiante en mal de<br />
thèse ne pourra reconstituer à partir de la misérable poussière d’écrits, de témoignages me<br />
concernant.<br />
Et si je vous disais, les yeux dans les yeux, que tout ce qui précède est pur mensonge, que je suis,<br />
selon mes vœux les plus sincères, « fils de mes œuvres », que je n’ai jamais eu ni père ni grand–<br />
père, que diriez–vous ? Me jetteriez–vous la pierre ? Me condamneriez–vous à la peine capitale ?<br />
Sachez quand même que je mens pour vous enchanter.<br />
Ma mère était très belle. C’est idiot. Je voudrais trouver des mots jamais utilisés pour parler<br />
d’elle jusqu’à ce que vous l’aimiez. Jusqu’à ce que vous éprouviez le désir irrépressible d’aller<br />
- 11 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
poser une fleur sur sa tombe. Sur sa tombe oui, car ma mère est morte depuis longtemps, très<br />
longtemps. Pour la prendre dans les mailles de mes mots il me faut faire un effort terrible, fermer<br />
les yeux, concentrer ma pensée, chasser les soucis et inquiétudes de l’heure. Il me faut ramer à<br />
travers un désordre de tragédies, de morts, de nuits blanches, de jours sans joie ni pain, de ruptures<br />
atroces.<br />
Il me faut creuser des labyrinthes silencieux à travers une glaise lourde, trempée de pluie, ahaner<br />
sous un ciel d’octobre, fouiller cent et mille cimetières aux feuillages d’ombre et de paix pour<br />
dégager de l’ombre ce visage vénéré, brisé il y a déjà plusieurs décennies.<br />
Oui ma mère était très belle. J’ai possédé jusqu’à il y a quelques années une photographie qui la<br />
représentait me tenant dans ses bras. Sur cette photo j’ai seulement quelques mois. Elle doit donc<br />
dater de l’été 1936. Ma mère porte une robe légère, un large béret. Elle a les yeux fixés sur moi. Elle me<br />
sourit. Peut–être même murmure–t–elle des mots d’amour que j’entends sans doute sans les<br />
comprendre. Une merveilleuse lumière d’été baigne l’image. Et pourtant déjà, à coup sûr, la bête<br />
fasciste a mordu au front la rude, la vieille, la populaire Espagne. Et pourtant déjà Hitler règne en<br />
Allemagne. <strong>Les</strong> camps de déportation s’emplissent chaque jour d’antifascistes qui ne sauraient<br />
confondre l’Ubu sanglant avec Goethe. Cette photographie, je l’ai perdue, un jour, au cours d’une<br />
sombre et triste beuverie. Un salaud profita de mon ivresse prononcée pour me délester de mon<br />
portefeuille. Ce salaud ne sut jamais qu’il m’avait du même coup arraché le cœur, planté un fer chaud<br />
dans les tripes. J’ai publié une annonce suppliant mon voleur, au cas où il aurait l’occasion de la lire par<br />
hasard et encore un reste d’humanité, de me dire où il avait jeté le portefeuille après l’avoir vidé de tout<br />
ce qui pouvait l’intéresser d’abord l’argent puisque les voleurs procèdent en général de cette façon. Je ne<br />
reçus jamais une réponse. Le souvenir de cette photo perdue bêtement m’obsède encore aujourd’hui. Il<br />
m’arrive parfois d’éprouver un sentiment obscur de culpabilité.<br />
Par contre, j’ai la chance de toujours posséder une autre photographie qui a été prise lorsque ma<br />
mère avait douze ou treize ans et qu’elle était écolière. La photo est très abîmée, ses bords sont<br />
élimés. La technique n’était pas excellente. Mais le visage de ma mère proprement habillée d’une<br />
blouse, assise devant sa table d’écolière, est parfaitement « lisible ». Parfois, en un moment de<br />
cafard, dans la rue ou le métro, j’extrais cette photo de mon portefeuille, que jamais plus quelqu’un<br />
a réussi à me voler, même au terme de mille beuveries, et je la contemple longuement, les yeux<br />
mouillés de larmes.<br />
Ma mère me manque. De ce manque j’ai fait une fable. Je me suis, depuis plus de trente ans,<br />
inventé une sorte de mère idéale, parée de toutes les beautés, de tous les charmes, de tous les talents.<br />
La seule vérité suffit. Ma mère était, m’a–t–on raconté, une personne très fine, très<br />
agréable,extrêmement intelligente et intuitive. Bien que n’ayant pas fait de longues études, elle avait<br />
acquis de nombreuses connaissances. C’était une parfaite couturière. Elle adorait, paraît–il, chanter<br />
des chansons populaires de l’époque, le répertoire de Damia, de Fréhel, de Lys Gauty. Des airs<br />
d’opérette aussi. Peut–être même a–t–elle rêvé de faire carrière dans le chant lyrique. Je n’en sais<br />
rien. J’avais six ans à sa mort. Et j’ai depuis si longtemps rompu avec ma famille qu’il ne reste<br />
personne pour me renseigner.<br />
Ma mère était d’origine juive polonaise. C’est pour cela qu’un certain matin, elle prit, avec un<br />
très maigre bagage, le chemin de l’Allemagne. Je ne devais plus jamais la revoir. Tout porte à<br />
penser qu’elle a été exécutée dans une chambre à gaz. Mais j’ignore en quel sinistre lieu. Une seule<br />
chose que je sais : un jour, au cours d’un dîner en ville, alors que je venais de publier un recueil de<br />
poèmes que la maîtresse de maison célébrait avec beaucoup de générosité et de lyrisme auprès de<br />
ses invités, le hasard voulut que je prenne place à table à côté d’une fort élégante dame,<br />
sympathique, volu–bile, à la cinquantaine radieuse. Cette femme me plut très vite car elle avait le<br />
rapport aisé et elle témoignait d’une ardeur de vivre, d’une gaieté assez rares. Nous commençâmes<br />
à parler de tout et de rien, de la pluie et du beau temps. Elle se montra passionnée de musique et de<br />
littérature épistolaire. Nous parlâmes Bach, Berg, Madame du Deffand, Madame de Sévigné…<br />
- 12 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Cette femme avait visiblement une culture soignée. De percutantes formules ponctuaient son<br />
propos. C’est au dessert, ou plus précisément aux fromages, qu’il se passa quelque chose qui devait<br />
graver à tout jamais cette soirée dans ma mémoire. Nous étions en pleine canicule de juillet. Malgré<br />
le ventilateur en fonction, le luxueux appartement du seizième arrondissement où nous étions<br />
accueillis restait une cloche de chaleur, en dépit de l’heure relativement avancée. Ma voisine<br />
demanda à la maîtresse de maison, qu’elle semblait par ailleurs parfaitement connaître, puisque son<br />
vouvoiement emprunta des tonalités intimes de tutoiement affectueux, la permission de se mettre<br />
quelque peu à l’aise. Ce qu’aussitôt accorda, avec un tendre sourire, notre hôtesse. C’est alors que<br />
mon regard accrocha le bras gauche, maintenant nu, de ma voisine. Un chiffre était tatoué sur la<br />
peau de l’avant–bras. Et ce chiffre, moi qui ai de plus en plus des « trous de mémoire », je ne l’ai<br />
jamais oublié : 27.747.<br />
Je n’ignorais pas ce que ce chiffre révélait. Ma voisine avait été déportée durant la sombre<br />
époque. Un désir profond de l’interroger à ce propos m’envahit aussitôt brusquement. Désir refréné<br />
par la conscience qu’il n’était pas de bon goût de troubler une rencontre amicale, entre gens affables<br />
et détendus, avec l’évocation d’horreurs sans nom. J’engloutissais ma part de fromage de corse en<br />
m’efforçant de ne penser à rien d’autre qu’aux propos légèrement décousus qui s’échangeaient<br />
autour de la table. Je me mis même à fixer outrageusement dans les yeux une jeune femme que<br />
j’avais, dès le départ, trouvée fort séduisante et qui était installée à l’autre extrémité de la table.<br />
Cette jeune femme n’était pas sans m’évoquer la grande actrice de cinéma que je vénère par dessus<br />
tout parce qu’elle fut autre chose qu’une mécanique sexuelle manipulée, qu’une star d’affiche<br />
hollywoodienne, parce qu’elle fut, en solitude et en malheur, une femme en lutte, je veux dire<br />
Louise Brooks. La jeune femme des années 60 avait donc quelque chose d'indiscernable qui me<br />
rappelait la beauté énigmatique de la merveilleuse « Lulu » de Pabst. Son mari s’entretenait avec<br />
l’époux de la maîtresse de maison. Aux rares mots qui me parvenaient, je comprenais qu’il<br />
s’agissait de très délicats problèmes de développement économique en Asie. Il ne pouvait donc voir<br />
mon jeu. À un moment, la jeune femme, « violée » par mon regard intense, fit un geste maladroit et<br />
renversa son verre. On jeta une petite poignée de sel sur la nappe. On ironisa gentiment sur sa<br />
maladresse. Elle eut à mon attention comme une lueur de reproche sans méchanceté dans les yeux.<br />
Puis elle s’intégra à une autre conversation, avec le couple qui lui faisait face, lui musicien de jazz<br />
né à Harlem, elle suédoise particulièrement « sexy ».<br />
Mon désir d’interpeller ma voisine n’avait pas diminué. N’y pouvant plus tenir, je bafouillais je<br />
ne sais trop quelle phrase idiote en désignant du doigt le matricule tatoué sur son avant–bras. Je<br />
m’attendais à être rabroué ou doucement évincé. Je fus assez étonné. Comme si elle se remémorait<br />
une ancienne partie de campagne ma voisine commença à évoquer le temps de la « nuit et du<br />
brouillard ». À ressusciter devrais–je plutôt dire. En phrases simples, nues, elle dressait le décor<br />
terrifiant du supplice. Elle parlait d’une voix douce, sans colère ni haine. J’étais abasourdi. J’avais<br />
quasiment fermé les yeux. <strong>Les</strong> conversations des convives ne me parvenaient plus que comme à<br />
travers un épais mur d’ouate. En vérité, j’étais à Treblinka, à Sodibor, à Bergen Belsen, au ravin de<br />
Babi Yar, à Maïdanek, à Ravensbrûck, j’étais dans chaque enfer bâti par des monstres à visage<br />
humain. Avec des enfants juifs, des tziganes, des vieillards épuisés, des mères affolées, avec des<br />
loques humaines, des lambeaux d’êtres aux jambes gonflées, aux poitrines rauques, aux estomacs<br />
désespérément délabrés, aux regards usés par les injures et les brutalités. Je piétinais dans la neige<br />
de décembre, la boue d’octobre. Avec tout ce peuple de l’ombre je frémissais parce qu’un oiseau<br />
avait lointainement sifflé, par–dessus la tête des bourreaux casqués. Avec tout ce peuple écorché vif<br />
je me traînais jusqu’aux travaux forcés, j’ahanais au fond des usines souterraines d’armement, je<br />
tremblais d’angoisse à la voix des geôliers, je tentais lamentablement de fuir les crocs des chiens–<br />
loups exacerbés. Avec tout ce peuple de silence et d’abîme j’essayais de chercher le sommeil, dans<br />
la pouillerie des baraquements, un sommeil déchiqueté par les lanières des schlagues. Avec tout ce<br />
- 13 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
peuple fantomatique, je croyais devenir fou devant un déporté condamné à mort pour le bon plaisir,<br />
exécuté publiquement. Ma voisine parlait. Elle feuilletait sans violence de ton un album<br />
photographique horrible. Elle s’efforçait de faire passer dans les mots toute la douleur indicible, tout<br />
le vertige vécu. Soudain, un nom me transperça littéralement. Ma voisine venait d’évoquer une de<br />
ses compagnes de camp dont elle gardait un souvenir ébloui à cause de la dignité, du courage, de la<br />
force d’âme, de la fraternité de cette mystérieuse compagne. « Olga, oui, elle s’appelait Olga… ».<br />
Je crus défaillir. À n’en pas douter il ne pouvait s’agir que de ma mère. Ma voisine s’aperçut de<br />
mon malaise. « Qu’avez–vous ? puis–je vous aider ». Je tentais de reprendre mon souffle mais tout<br />
vacillait dans mes yeux. <strong>Les</strong> autres ne s’étaient aperçus de rien. Enfin, un certain calme revint en<br />
moi. Je lui expliquai pourquoi le nom prononcé avait provoqué ce malaise. Son visage alors<br />
s’éclaira d’une incroyable lumière de tendresse, de bonté. J’étais le fils d’Olga. Nous avions donc<br />
comme un secret commun. C’est par sa bouche que j’appris que ma mère avait été transférée de<br />
Ravensbrück en un lieu inconnu où elle fut sans doute livrée à la chambre à gaz, à moins qu’elle ne<br />
soit morte d’épuisement car ma voisine m’affirma qu’à cette époque–là, l’état physique de ma mère<br />
était particulièrement grave. Par contre, une flamme d’acier la dévorait, la maintenait debout, face à<br />
la Bête à croix gammée. Ma voisine me dit encore qu’elle eut le bonheur d’échanger quelques mots<br />
avec Olga, avant le départ de celle–ci vers son tombeau définitif. Olga rayonnait de sérénité, de<br />
courage.<br />
Poussière dans le vent, moins que poussière aujourd’hui, Olga ! Du néant, rien que du néant. Ce<br />
soir–là commença avec ma voisine une amitié qui ne s’est plus jamais démentie. Nous nous<br />
rencontrons assez régulièrement. Je l’invite au théâtre, au cinéma, au restaurant. Nous évoquons très<br />
rarement le temps des camps. Mais derrière chacun de nos échanges, l’ombre des camps veille,<br />
immobile, muette, glacée. Yvonne est devenue pour moi comme une autre mère. Parfois,<br />
bouleversé, j’ai envie en plein restaurant de me lever, de la serrer très fort dans mes bras jusqu’à ce<br />
que les fantômes sanglants qui la hantent et qu’elle tient au secret par politesse inouïe, craquent. J’ai<br />
envie de jeter à la face des gros pleins de soupe, des nymphettes énervées, des commerçants aisés,<br />
des bourgeois en goguette qui festoient autour de nous, des injures, des coups de poings. Bien sûr, je<br />
ne le fais jamais. Je reste coi. Mais quelle rage en moi à l’idée que le beau visage d’Yvonne aurait<br />
pu aussi être broyé par quelque SS avide de célébrer son führer.<br />
Lorsque mon père partit combattre en Espagne – c’est beaucoup plus tard que je devais<br />
comprendre qu’il était plus qu’un simple combattant, qu’il était un de ces « soldats de l’ombre » du<br />
Parti – ma grand–mère maternelle tenait une « Union commerciale ». <strong>Les</strong> premières années de ma<br />
vie se passèrent donc au milieu des sacs de haricots, des amoncellements de carottes et de poireaux,<br />
des boîtes de sardines soigneusement alignées, des paquets de lessive, des rangées de plumeaux et<br />
de martinets…<br />
Ma grand–mère était une femme très robuste. Grande et maigre, les cheveux grisonnants<br />
rassemblés en chignon, elle manipulait les caisses pleines de bouteilles de vin avec une aisance<br />
toute remarquable. Autant que je me souvienne, elle était extrêmement gentille, et ses mines<br />
sévères, à l’occasion, ne me trompaient pas. Elle n’avait pas fait un mariage très heureux. Son mari<br />
mort, elle ne s’était jamais remariée. Elle lisait des magazines à l’eau–de–rose, écoutait à la radio<br />
des émissions de variétés faciles. On ne lisait pas la « littérature » chez moi, mais des journaux, des<br />
revues à sensation, des romans policiers classiques.<br />
Durant l’absence de mon père, ma mère et moi partagions le minuscule appartement attenant au<br />
magasin. Le soir, parfois, ma grand–mère et ma mère jouaient aux « petits chevaux », ou à quelque<br />
jeu de cartes. Parfois, ma mère avait la mine soucieuse, inquiète. D’autres fois, elle souriait mieux<br />
qu’à l’ordinaire. Elle venait de recevoir un message de mon père, rédigé là–bas au pays du grand<br />
soleil, de la guerre fratricide, de la violence fiévreuse. Mon père combattait les « ennemis de la<br />
révolution » : les anarchistes de la CNT–FAI, les militants du POUM (Parti Ouvrier d’Unification<br />
- 14 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
marxiste) dont le leader Andrès Nin allait être assassiné par les services spéciaux du Kremlin sur<br />
l’ordre de Staline. « Pas de Révolution non inféodée à Moscou », « pas de Révolution du tout »<br />
avait décidé le grand moustachu paranoïaque qui, entre Hitler et les démocraties occidentales<br />
« molles », ne savait sur quel pied danser. C’était l’époque du fanatisme, un fanatisme qui plus tard<br />
devait coûter cher à mon père. Moi, en ce temps où l’Espagne de Machado et d’Unamuno, de Lorca<br />
et du Quichotte agonisait, je vivais insouciant, sans trop quitter les robes de ma grand–mère et de<br />
ma mère. Je me souviens de la première comptine que j’appris par la bouche d’une vieille voisine.<br />
Elle disait à peu près ceci : « En passant par Saint-Denis j’ai rencontré une souris… » 1 Aujourd’hui,<br />
le reste m’échappe.<br />
En face de chez nous, il y avait un pont qui, à son extrémité, passait au–dessus des lignes de<br />
chemin de fer. La route était bordée d’assez profonds talus. Très tôt, j’eus l’envie d’aller y fouiner.<br />
Je ramassais des bouts de bois insignifiants des éclats de silex, des morceaux de chiffons sales, des<br />
pages déchirées de revues. Ce petit trésor hétéroclite suffisait à ma rêverie. L’affirmation de ma<br />
passion pour la liberté doit commencer là. Il paraît que, dès mon plus jeune âge, je fus un rêveur<br />
impénitent. On pouvait me laisser des heures assis sur une chaise, je ne bougeais pas, suivant sans<br />
doute quelque vol d’insecte, ou contemplant jusqu’à l’extase un quelconque objet que ma grand–<br />
mère vendait. À quelques dizaines de mètres de chez nous habitaient ma tante et mon oncle, un<br />
couple adorable. Ma tante, de forte corpulence, avait toujours le mot pour rire. Et mon oncle était<br />
expert en plaisanterie. J’ai beaucoup aimé ma tante qui devait mourir plus tard, foudroyée par un<br />
cancer. Ils avaient pris en charge une jeune franco-vietnamienne dont je devais devenir amoureux,<br />
au moment de l’adolescence inquiète et trouble. Ils tenaient à cet enfant comme si elle était un fruit<br />
de leur sang.<br />
Toutes ces premières années, qu’on dit essentielles pour le devenir et la compréhension d’un être,<br />
se perdent pour moi dans un brouillard d’où émergent seulement, selon les saisons et mon état, une<br />
poignée d’images. Ce sont des images postérieures, bien sûr, aux premiers congés payés. À ce qu’il<br />
paraît, j’ai vécu cette étonnante cohue de travailleurs maladroits, égarés, partant, pour la première<br />
fois de leur laborieuse existence, découvrir les charmes de la campagne et de la mer. Quand le<br />
hasard me met sous les yeux des photographies de cette époque, j’éprouve une émotion certaine. Je<br />
les interroge. La seule vue d’un bébé sur les genoux de sa mère ramène la question : « serait–ce<br />
moi ? »<br />
Une des images que je conserve assez nette de ce temps c’est celui de mon petit établi. Souvenir<br />
qui m’attendrit aujourd’hui et me fais sourire. Pour la bonne raison que je suis particulièrement<br />
incapable, depuis mon entrée dans « l’âge d’homme », de bricoler, d’arranger une table qui boite, de<br />
changer les plombs du compteur électrique, d’installer trois planches pour faire une bibliothèque,<br />
d’enfoncer normalement un clou. Mais il paraît que, j’étais passionné par le bricolage. C’était une<br />
joie pour moi que de raboter, scier, clouer avec des instruments à ma taille.<br />
Une autre image encore que le temps n’a pas effacée : celle du jour où je mangeais ma première<br />
banane. Là , il y a continuité. Tous ceux qui me connaissent, toutes les femmes qui ont – le temps<br />
d’une nuit, d’une saison, de quatre saisons – partagé mon existence savent ma passion pour ce fruit,<br />
quels sacrifices d’orgueil je suis prêt à accepter pour entrer en possession d’un de ces merveilleux<br />
fruits qu’on croque comme si l’on croquait un soleil de Martinique.<br />
1 En revenant de St Denis<br />
J’ai rencontré une souris<br />
Qui se promenait gentiment avec ses enfants,<br />
Un gros chat qui passait par là,<br />
lui dit gentiment: Halte là ! je n’ai pas encore dîné j’ai envie de te croquer<br />
Mais la souris répondit poliment:"je suis trop maigre assurément<br />
Laisse moi aller m’engraisser et je reviendrais"<br />
Mais le gros chat sans l’écouter la croqua comme un poulet…<br />
- 15 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Mon père revint de guerre un peu avant que l’Espagne du peuple, écrasée par Franco, Mussolini,<br />
la « non intervention » de nombreux partis socialistes, la « neutralité » bien orchestrée des<br />
démocraties occidentales apeurées par la perspective de la Révolution, enfin par les actions<br />
criminelles des mai très du Kremlin, rendit l’âme. Franco n’a pas triomphé d’une Espagne « noire et<br />
rouge » vaincue par la force des armes. Il a promené sa gueule d’assassin à travers une Espagne<br />
exsangue, à travers un cimetière. Il se proclama caudillo sur une terre brûlée, où se décomposaient<br />
les corps de dizaines de milliers de femmes et d’hommes dignes qui avaient décidé, une fois pour<br />
toutes, « La liberté (plus la Révolution sociale) ou la mort. »<br />
Mon père rentra donc avec sur les mains le sang des martyrs de la « semaine sanglante » de<br />
Barcelone, celui d’Andrès Nin, celui des camarades de la « Colonne Durruti ». Comme je regrette<br />
de n’avoir pas eu alors vingt ans, pour parler avec lui. Tout cela m’échappait évidemment.<br />
Aujourd’hui, j’incline à croire qu’il est revenu ébranlé, qu’une fissure se produisit en lui, que<br />
quelque chose s’éteignit définitivement dans son esprit.<br />
En ce qui me concerne j’étais tout naturellement heureux de retrouver – ou de trouver somme<br />
toute – un père qui m’avait quitté, juste après ma naissance. Je crois qu’on festoya en l’honneur de<br />
ce retour, que ma mère pleura à chaudes larmes, effondrée sur la poitrine de mon père qui était –<br />
une très vieille photo l’atteste – un fort beau séduisant garçon. Étrangement, ils ne me firent pas de<br />
petit frère ou de petite sœur. Était–ce dû à l’angoisse qui régnait en Europe ? Pour beaucoup, une<br />
guerre mondiale était prévisible. L’appétit démesuré du Führer allemand devait forcément le lancer<br />
à l’assaut de démocraties pourries, submergées de trafics, magouilles, prévarications, scandales<br />
financiers. On se souviendra de la première chaude alerte de février 1934. En France même, une<br />
certaine droite lorgnait du côté de Berlin. Des écrivains, des artistes ne cachaient pas leur<br />
admiration pour le régime nazi, musclé et efficace. Drieu La Rochelle et Céline tonitruaient,<br />
vitupéraient, s’abandonnaient à leurs fantasmes, à leurs délires. La « France moyenne » s’occupait à<br />
survivre au jour le jour, à s’enivrer de chansons la plupart du temps vulgaires, bébêtes. Charles<br />
Trénet s’époumonait : « y’a d’la joie ». Mais les camps français, à Argelès et ailleurs, retenaient<br />
prisonniers, dans des conditions atroces, les courageux combattants espagnols qui avaient, l’âme<br />
brisée, franchi les Pyrénées, mais le grand poète espagnol Antonio Machado venait mourir à<br />
Collioure, entrailles déchiquetées par une douleur inouïe, mais les camps allemands regorgeaient de<br />
militants socialistes, communistes, révolutionnaires de gauche. Mais, ici et là, on fourbissait les<br />
armes. Aujourd’hui encore, je tremble à l’idée d’avoir traversé, inconscient ou presque, tant de<br />
périls et d’avoir survécu.<br />
La guerre survint, comme prévu. Mon père, avec les autres hommes partit. Une seconde fois je<br />
me retrouvais en quelque sorte orphelin, à nouveau livré aux femmes, aux soins maniaques des<br />
vieilles femmes qui fréquentaient le magasin. Ce doit être à cette époque que j’attrapais la gale du<br />
pain. De cela aussi ma mémoire garde, l’image. Le traitement était terrifiant. Il fallait me donner<br />
plusieurs fois par jour des bains de soufre et me frotter le corps, de haut en bas, avec une brosse en<br />
chiendent. Je devins, malgré moi, champion de course à pied. C’était une cavalcade effrénée, des<br />
supplications de ma grand–mère et de ma mère, de ma tante et de mon oncle, du chœur des<br />
« vieilles », à chaque fois que l’heure du bain fatidique sonnait. Je me cachais, je me dérobais. Je<br />
n’écoutais pas les criailleries des femmes. J’étais terrorisé. Je souffrais à l’avance d’atroces<br />
douleurs. Mais, toujours, le clan des femmes l’emportait. J’étais traîné, manu militari, jusqu’à<br />
l’immense baquet. Et la torture commençait. Ma mère avait beau me couvrir de larmes brûlantes, je<br />
les haïssais toutes. J’aurais voulu les détruire. Je hurlais à chaque fois que la brosse faisait éclater<br />
les pustules. Je brûlais d’une épouvantable fièvre. Je suppliais, je jetais mes pauvres petits poings en<br />
direction des tortureuses. Enfin, épuisé, vaincu, je m’abandonnais. <strong>Les</strong> soins effectués on<br />
m’arrachait à l’affreux baquet, on m’enveloppait de serviettes, de pansements, on me couvrait de<br />
pommade douce, on me dorlotait, on me chantait des comptines, on me berçait. Toute révolte brisée,<br />
- 16 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
je me laissais saisir par la chaleur de ces poitrines féminines, par la lumière de ces seins doux<br />
comme des nids d’oiseaux. Ma grand–mère m’offrait une tablette de chocolat. Je pouvais retourner<br />
à mes jeux, à mes songeries. J’avais « quartier libre » jusqu’à la prochaine séance de supplice.<br />
La « débâcle » survint, elle aussi prévue par quelques esprits fins au rang desquels il convient de<br />
situer un jeune officier d’alors, Charles de Gaulle. Ma mère décida que je devais quitter Paris. Elle<br />
me confia à une voisine sûre qui avait de la famille du côté de Caen. Nous partîmes dans une vieille<br />
« traction avant » si je m’en souviens bien. La voiture était chargée de paquets. Elle débordait<br />
littéralement. Ma mère et ma grand–mère pleuraient. Moi, je trouvais tout cela plutôt excitant. Je<br />
connaissais bien la femme qui m’emmenait. J’avais confiance en elle. Je vivais l’exode comme une<br />
aventure qu’on lit dans les illustrés pour enfants. Enfin, nous nous arrachâmes aux étreintes<br />
familiales et nous prîmes la route. Nous roulâmes longtemps, un voyage entrecoupé de quelques<br />
haltes dans des villes et des bourgs où les gens discutaient des effets possibles de la débâcle sur le<br />
cours de leur train–train quotidien. À part les fameux premiers « congés payés », je n’avais jamais<br />
quitté Paris, tout au plus m’étais–je aventuré jusqu’aux bords de Marne pour pique–niquer à la<br />
façon de ces gens bonasses qu’on voit sur les photographies de mon cher ami Henri Cartier–<br />
Bresson.<br />
Je découvris les pommiers, la campagne, les chevaux, les vaches. Notre destination était un petit<br />
village proche de Caen. Nous y arrivâmes tard dans la soirée. <strong>Les</strong> paysans – cousins de la dame qui<br />
m’avait pris sous son aile protectrice – nous accueillirent avec bonhomie et rusticité. Lui, avait<br />
l’allure d’un grand escogriffe, maigre et noueux, avec une tignasse désordonnée. Elle, était plutôt<br />
courte sur pattes, avec des formes arrondies, une grosse figure rayonnante. Ils m’embrassèrent, me<br />
secouèrent comme un prunier, se lamentèrent quelque peu sur mon sort de gosse séparé de son papa<br />
et de sa maman, puis nous passâmes à table. Il y avait une bonne soupe chaude qui fumait dans les<br />
écuelles. Je l’avalais en faisant de gros bruits qui déplurent à la fille des paysans qui avait<br />
sensiblement mon âge. Son frère, légèrement plus âgé, me lorgnait du coin de l’œil, me<br />
« mesurait ». Je dormis cette première nuit dans une grande alcôve moelleuse, obscure, tiède. Il n’y<br />
eut pas besoin de me bercer. Toutes ces émotions m’avaient brisé.<br />
Le lendemain, le chant du coq m’arracha au sommeil. J’aurais bien refermé les yeux, je me serais<br />
abandonné à un demi–sommeil qui m’étourdissait, mais la curiosité l’emporta et je partis à la<br />
découverte du territoire qui allait être le mien durant plusieurs mois.<br />
La cousine s’affairait déjà aux cuisines et un grand bol de chocolat escorté de quelques larges<br />
tartines beurrées m’attendait. J’engloutis le tout sans me faire prier. Puis la cousine, se tournant vers<br />
sa fille, dit « Marie, emmène André se promener ». Elle prit ma main sans hésiter et m’entraîna<br />
tandis que son frère aîné me jetait un regard goguenard.<br />
La fillette, ou plutôt Marie, m’entraîna dans les chemins creux qui bordaient le village. Nous<br />
fîmes deux ou trois pirouettes dans l’herbe. Nous courûmes jusqu’à un ruisseau qui coulait sur<br />
quelques cailloux maigres au bout des champs du cousin, nous jetâmes des branches mortes dans<br />
l’eau. Quand nous rentrâmes, deux heures plus tard, j’étais amoureux fou de Marie. Je ne saurais<br />
plus la dépeindre aujourd’hui. Ses yeux étaient–ils gris–mauve, jaune–vert. Je n’en sais plus rien.<br />
Mais je me souviens de ses petites mains, douces, douces, et de son sourire quand elle me regardait.<br />
C’est dans ce village que j’appris à monter les chevaux à cru. Je vivais comme un sauvage.<br />
Presque nu car c’était déjà la belle saison. Le cal sous la plante des pieds me permettait de courir sur<br />
les chemins semés de cailloux. Pourtant, une fois, un drame arriva. Courant après Marie, dans une<br />
prairie, je posai le pied gauche sur un fil de fer barbelé enfoui dans l’herbe, donc invisible, la<br />
douleur subite me jeta à terre. Je hurlais. Marie, pétrifiée, ne bougeait pas. Mes cris parvinrent<br />
jusqu’au paysan qui accourut de toute la force de ses jambes. Délicatement mais impitoyablement,<br />
il arracha de ma chair le barbelé qui me torturait. J’en fus quitte pour une piqûre anti–infectieuse<br />
qu’une bonne sœur de la région me prodigua. Une autre fois ce fut pire. Le frère de Marie, sans<br />
- 17 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
doute obscurément jaloux de ma relation avec sa sœur, me provoqua. Il s’agissait de sauter, du haut<br />
de la grange, sur un immense tas de foin. Précautionneux, malgré mon jeune âge et mon peu<br />
d’expérience campagnarde, je vérifiai si quelque fourche n’avait pas été abandonnée sur cette<br />
meule. Je ne trouvai rien. Joseph sauta le premier. Un saut assez brillant. À mon tour, après un clin<br />
d’œil langoureux à Marie, je m’élançai… je m’enfonçai dans le foin odorant, presque sec… et<br />
poussai un hurlement. Une douleur atroce déchirait ma cuisse gauche. J’écartai, à demi évanoui, la<br />
masse de foin, et alors je crûs m’évanouir pour de bon. <strong>Les</strong> dents d’une fourche traversaient de part<br />
en part ma cuisse qui saignait abondamment. Cette fois–là, Marie ne resta pas pétrifiée. Elle courut<br />
en direction de la ferme, les yeux noyés de larmes, essoufflée. Quelques instants plus tard son père<br />
apparut dans mon champ de vision. En deux secondes il prit la mesure de l’affaire. Il n’hésita pas<br />
une seconde. Il me fixa droit dans les yeux : « Serre les dents mon garçon, ça va faire mal mais il le<br />
faut ». Je serrai les dents. D’un mouvement rapide, il referma sa main sur le manche de la fourche.<br />
En un éclair ma chair blessée rejeta les dents de l’outil. Je poussai un cri de souffrance et perdis<br />
connaissance. Quand je rouvris les yeux, j’étais couché dans l’immense alcôve. Le cousin tenait une<br />
bouteille d’alcool à la main dont il avait réussi à introduire le goulot entre mes mâchoires serrées.<br />
Ce fut mon premier contact avec l’alcool. Marie était là tout près de moi. Elle posa sur mon front un<br />
baiser parfumé. Joseph se taisait. Je ne regrettais rien.<br />
<strong>Les</strong> jours succédaient aux jours, les saisons aux saisons. J’étais devenu robuste et brun de peau.<br />
J’apprenais avec Joseph à dénicher les oiseaux, à battre la campagne en quête de quelque menu<br />
butin de chasse, à grimper aux arbres. Enfin, nous étions devenus compagnons inséparables. Avec<br />
Marie entre nous, fière de ses deux gaillards, de ses deux garnements. <strong>Les</strong> parents étaient vraiment<br />
gentils. Un jour, alors que j’étais seul, pénétrant dans la cuisine, je trouvai Tantine – j’avais pris<br />
l’habitude de la nommer ainsi – les yeux rouges, remplis de larmes. Je lui demandai ce qu’elle avait.<br />
Elle ne me répondit pas. Elle se contenta de me serrer très fort contre sa poitrine généreuse en<br />
m’embrassant sur le front, dans les cheveux. Ce n’est que beaucoup plus tard que je devais faire le<br />
lien entre cette scène et la fin horrible de ma mère. On me tint à l’écart de cette tragédie jusqu’au<br />
jour où à cause de mes demandes réitérées – je m’étonnais de ne pas recevoir de lettres de ma mère<br />
– on m’avoua précautionneusement la vérité, du moins une part de la vérité, car si l’on m’apprit que<br />
ma mère était morte, on ne me communiqua pas les circonstances exactes de cette mort. On évoqua<br />
devant moi une douloureuse maladie. La tendresse de Marie, l’amitié de Joseph jetèrent un baume<br />
sur ma douleur. Mais il y avait dorénavant une brèche définitive dans mon être. Il arrivait que le<br />
visage de ma mère – un visage fait de souvenirs un peu flous et d’imagination à cause de<br />
l’éloignement dans le temps – m’arrachât au sommeil, la chair couverte d’une sueur d’angoisse.<br />
De mon père, non plus, je n’avais guère de nouvelles, sinon à travers quelques messages que des<br />
membres de ma famille adressaient de temps à autre à Tantine et à son mari. Je ne pouvais pas<br />
savoir que mon père était entré, avant même l’appel du général de Gaulle, dans la Résistance, qu’il<br />
était devenu un important chef de réseau. Il allait d’ailleurs connaître à plusieurs reprises<br />
l’arrestation, la torture. Il allait, plusieurs fois, comme par miracle, échapper à l’exécution. À<br />
chaque évasion, il courut mille périls qu’il évoquait, des années plus tard, lors de nos rares moments<br />
d’intimité. Il y a un épisode que je n’ai jamais oublié. C’était sa deuxième ou troisième évasion<br />
d’Allemagne. À la sortie du territoire allemand, mon père fut pris en charge par une organisation<br />
d’aide aux évadés dont le responsable était un garde–chasse alsacien. Ce garde–chasse ne parlait<br />
pas un mot de français mais il était de tout cœur français. Son fils avait été engagé de force dans la<br />
Wehrmacht, il devait d’ailleurs mourir fusillé lors d’une tentative de désertion. Cet homme<br />
connaissait la forêt comme le fond de sa poche. Ses fonctions lui permettaient de se déplacer sans<br />
attirer, à priori, l’attention et la méfiance des occupants. Il avait un courage calme, une audace sans<br />
emphase. Il risquait sa peau sans rien dire. C’est donc lui qui, avec quelques compagnons résistants,<br />
récupéra mon père et deux ou trois autres évadés. Le groupe marchait en silence dans la forêt<br />
- 18 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
profonde. <strong>Les</strong> rayons du soleil trouaient difficilement les feuillages et venaient percer en silence les<br />
mousses et les troncs. Il n’y avait aucun bruit sinon les chants réguliers des oiseaux haut perchés.<br />
Mon père éprouvait quelque inquiétude, légitime somme toute. N’étaient–ils pas tous tombés dans<br />
un piège ? Cette mésaventure lui était déjà arrivée plus d’une fois. Certes, l’inconnu avait un visage<br />
franc, avenant, mais quand même. Soudain, le garde–chasse s’immobilisa, l’index sur la bouche.<br />
Mon père et les autres évadés entendirent alors, assez clairement, des sons espacés. Mon père<br />
songea à une hache cognant contre un tronc, à plusieurs haches. Le garde–chasse écoutait<br />
attentivement, l’oreille tendue vers les sons lointains. Au bout d’une petit minute les sons se turent<br />
mystérieusement. L’homme se retourna vers mon père et les autres, et faisant un immense effort il<br />
dit quelque chose comme : « Pas danger ». Alors mon père comprit. <strong>Les</strong> haches cognaient les troncs<br />
d’arbres pour transmettre un message. Une espèce de morse de bûcherons. Plus tard, il eut<br />
l’occasion de voir de visu les bûcherons–résistants en action. Ainsi se transmettaient les nouvelles,<br />
les annonces d’arrivées d’évadés à travers la grande forêt, au nez et à la barbe des patrouilles<br />
allemandes qui n’avaient aucune raison de craindre ces hommes si acharnés au labeur.<br />
Mon père se lia d’amitié avec ce garde–chasse. Après la guerre, il nous invita mon père, mon<br />
frère, ma Mère 2 – mon père s’était entre–temps remarié – dans son village. De l’avis de mon père,<br />
il n’avait guère changé. Il avait une santé de racine, de souche. Durant trois semaines nous fûmes<br />
gâtés, comblés. Le garde–chasse m’emmenait presque chaque matin, dès l’aube, dans la forêt. Il<br />
n’avait pas fait le moindre progrès dans la langue de Racine. Nos conversations étaient fondées sur<br />
un étrange espéranto fait de gestes, d’onomatopées, de dessins dans la poussière des sentiers. Le<br />
plus surprenant c’est que nous arrivions à nous comprendre. Mais il souffrait quand même de ne pas<br />
pouvoir me faire mieux entendre les mœurs de la forêt, son amour de la nature, de la liberté<br />
végétale. Il fut, ce brave vieil homme aujourd’hui défunt, un de mes premiers «professeurs de<br />
liberté». Il mourut, la conscience tranquille, ignorant les médailles qu’on lui avait décernées pour<br />
ses actes de résistance, avec le souvenir ineffaçable de son jeune fils cruellement fusillé à l’âge<br />
d’homme à peine.<br />
Quand nous revenions, rieurs et fourbus, la table de la salle à manger nous tendait les bras : sa<br />
femme avait, comme à l’accoutumée, préparé de grands bols de chocolat au lait, confectionné un de<br />
ces succulents gâteaux alsaciens composés de plusieurs couches de pâte et de confiture savoureuse.<br />
Au temps, donc, où mon père risquait chaque jour sa vie pour combattre l’hydre hitlérienne, je<br />
grandissais en enfant sauvage, quelque part dans un petit village de Normandie.<br />
Puis, un jour, on me fît savoir que la voisine qui m’avait amené, un peu plus de deux ans<br />
auparavant, allait venir me rechercher. Je rentrai à Paris chez mes oncles et tantes. Ma grand–mère<br />
souffrait quelque part dans un camp. Mais elle devait s’en sortir selon l’expression coutumière. Le<br />
jour dit, l’amie de la famille arriva. Mes bagages avaient été préparés par Tantine. Elle était très<br />
émue. Son mari aussi. Et aussi Joseph et Marie. Je promis à Marie de lui écrire souvent. Je lui<br />
expliquai qu’il fallait être patiente mais que, plus tard, nous nous maririons et qu’ainsi nous ne<br />
serions jamais séparés, elle, Joseph et moi. Ce furent de bien tristes adieux. Tantine pleurait à fendre<br />
l’âme. Son mari la disputait gentiment, mais il était tout aussi bouleversé qu’elle. Marie s’enfuit<br />
brusquement pour aller cacher ses pleurs dans quelque obscurité d’étable. Joseph ne disait rien mais<br />
il n’en pensait pas moins. Il perdait un copain, un camarade de jeux et ça n’était pas rien. Et puis, au<br />
fond, je crois qu’alors il m’aimait bien.<br />
Du côté de mon oncle et de ma tante il n’y avait pas trace dans leurs veines de la moindre goutte<br />
de sang juif. Mon oncle était un résistant passif. Il n’aimait pas du tout le Maréchal et trouvait que<br />
le général de Gaulle ne manquait pas de panache. Il écoutait un peu Radio–Londres en essayant de<br />
se faire oublier. Il survivait.<br />
Présenté comme leur fils, je retrouvais les chemins de l’école. Ceux des jeux aussi. Le sens de la<br />
tragédie universelle m’échappait. Je m’habituais à certains gestes, à certains silences obligés, je ne<br />
- 19 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
m’étonnais pas trop de la présence des uniformes allemands, des chars qui passaient devant chez<br />
nous.<br />
Avec quelques copains d’école, nous chapardions dans les trains stationnés dans la gare, chargés<br />
de ravitaillement pour les troupes allemandes. Nous n’étions pas conscients du danger. Nous<br />
jouions aux Indiens et aux cow-boys. Mes oncle et tante me morigénaient, me grondaient. Je jurais<br />
de ne plus recommencer… et dès le lendemain je récidivais de plus belle, insouciant et gai. Un jour<br />
cela faillit mal tourner. Une sentinelle allemande, voyant une poignée d’ombres glisser au<br />
crépuscule le long des wagons, aboya quelques sommations auxquelles nous ne prîmes pas garde.<br />
Alors, la sentinelle pointa son fusil vers nous et tira un ou deux coups de feu qui heureusement<br />
n’atteignirent personne. Nous déguerpîmes à toute allure avant que l’aventure ne tournât au tragique<br />
et au sanglant. Je me gardai bien d’évoquer devant mon oncle et ma tante cet épisode qui aurait pu<br />
déboucher sur le drame absolu.<br />
Un jour, ou plutôt un soir, très tard, quelqu’un cogna à la porte. On ouvrit. C’était mon père. Je<br />
fus abasourdi. Cet homme était depuis si longtemps éloigné de moi. Il m’enleva de terre, me couvrit<br />
de baisers, frotta sa joue mal rasée contre ma joue. Puis il me reposa après de longues minutes. On<br />
me coucha assez rapidement. Ce soir et cette nuit–là mon père eut un long entretien avec mon oncle<br />
et ma tante qu’il convainquit enfin d’agir en faveur de la Résistance. Et c’est sans doute à cause de<br />
cette longue discussion nocturne que je devais devenir un des plus jeunes résistants de France. Car,<br />
peu après, et à plusieurs reprises, on me fit transporter des messages importants, cachés dans un<br />
minuscule tube au fond de ma boîte à lait. Jamais nulle patrouille allemande n’eut l’idée de vérifier<br />
le contenu de ma boîte, toujours remplie de lait onctueux que j’étais censé aller porter à quelque<br />
connaissance plus ou moins éloignée, malade et dans le besoin. Qui oserait aujourd’hui, maintenant<br />
que nous savons ce que nous savons à propos de ce combat de titans contre la peste brune,<br />
condamner des « adultes » utilisant un gamin dans la lutte. Moi-même, tant d’années après, je pense<br />
profondément que ce fut peut-être utile et, allant plus loin, j’avouerais même qu’il ne me déplaît pas<br />
d’avoir représenté, en ces temps rouges et noirs, les « enfants » dans la résistance à Hitler. Des<br />
enfants juifs moururent par milliers dans les chambres à gaz, à la fleur de l’âge. Il est tout à fait<br />
logique que d’autres enfants figurassent dans les rangs des « combattants de l’ombre ».<br />
La vie était alors ce qu’elle était : bourreaux, victimes, dénonciateurs par désir de vengeance ou<br />
appât du gain, sinon par pur sadisme, riches et pauvres, joies et peines quotidiennes.<br />
La féerie recouvrait l’horreur murmurée de chaque jour, parfois. Un soir – c’était mon<br />
anniversaire – les avions anglais bombardèrent un dépôt de munitions allemand, à quelques<br />
kilomètres de notre maison. Le ciel s’embrasa de mille couleurs. La nuit se dilua brusquement. En<br />
effet, les équipages des bombardiers avaient jeté par milliers des ballons lumineux qui permettaient<br />
de mieux localiser les cibles. Nous nous jetâmes aux fenêtres. Mon oncle dit à haute voix « tu vois<br />
c’est la fête pour ton anniversaire ». Je n’avais aucune envie de le contredire. J’étais tellement fier<br />
qu’un petit bonhomme comme moi ait le privilège d’une pareille fête. C’est à peine si je n’ai pas<br />
applaudi frénétiquement. Un avion, touché par les tirs de DCA, se transforma brusquement en<br />
torche qui fila à travers les étoiles, avant d’aller s’écraser dans une gerbe fantastique de flammes et<br />
de lueurs. <strong>Les</strong> autres avions continuaient leur ballet dans le ciel, malgré les tirs intenses des batteries<br />
antiaériennes.<br />
Mais souvent la féerie laissait la place à l’horreur pure. Je me souviendrai toujours d’une nuit<br />
maudite. La Gestapo avait arrêté trois résistants qu’elle tortura atrocement. Cela avait lieu dans une<br />
villa située au cœur d’un parc d’ordinaire hanté par les vieillards, les mères et leurs enfants, les<br />
amoureux.<br />
Afin que cela servit d’exemple, la Gestapo fit rassembler plusieurs dizaines de personnes devant<br />
la villa. Le malheur voulut que ma tante et moi nous en fûmes, n’ayant pu nous échapper. Nous<br />
fûmes contraints d’entendre, debout, sans bouger, surveillés par les jeunes S.S. casqués, les<br />
- 20 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
hurlements, les gémissements des suppliciés qui refusèrent jusqu’au bout d’avouer ce qu’ils<br />
savaient. L’aveu aurait sans doute mis en péril de mort des dizaines d’individus. De longues heures<br />
passèrent, lentes, atroces, entrecoupées de longs silences brusquement rompus par de nouveaux<br />
hurlements. Désespérant sans doute d’arriver à leurs fins, les nazis nous firent éloigner et<br />
dynamitèrent la villa, qui explosa dans un vacarme épouvantable. Des gens s’évanouirent. D’autres<br />
livides serraient les poings. Des regards chargés de haine fusillaient en pensée les bourreaux<br />
arrogants. Quand la fumée se fut dissipée, quand ne resta plus qu’un amas de ruines vaguement<br />
fumantes, nous eûmes le droit de rentrer chez nous.<br />
Toutes ces images, immortelles, de sang, de cruauté impitoyable, ont très certainement travaillé<br />
mon être. Aussi loin que je remonte dans le temps la Liberté apparaît à mes yeux comme une<br />
femme, torse nu, aux seins coupés. C’est sans doute dans ce magma d’horreurs et de violences que<br />
les racines de ma révolte se développèrent, fiévreuses, instinctives, obscures. Qui pourra jamais le<br />
savoir. Cet enfant que je ressuscite ici me semble si étranger, si éloigné. J’ai la sensation de défaire<br />
les bandelettes d’un mort qui ne serait plus que poussière sans nom, de convoquer un fantôme<br />
définitivement enfoui au fond d’un puits profond, profond.<br />
Reparcourir les routes du passé c’est tenter absurdement de recomposer un puzzle dérisoire. Un<br />
puzzle dont à mesure que le temps de l’effort s’élargit, chaque pièce perd toute signification. <strong>Les</strong><br />
images défilent affolées sur l’écran de la mémoire. Laquelle retenir au passage ? Pourquoi celle-là<br />
plutôt qu’une autre. Laquelle est une « clé » ? Le récit d’une vie n’est jamais qu’une suite de « trous<br />
de mémoire » comblés hâtivement de mots pour conjurer le vertige, de fantasmes se portant au<br />
secours de l’oubli, plus ou moins volontaire de mensonges innocents accumulés parce que tout se<br />
mêle dans une confusion brûlante et glacée à la fois.<br />
Une jeune femme nommée Germaine fréquentait ma tante et mon oncle. Elle était originaire de<br />
Lorraine. Émigrée à Paris elle avait pratiqué nombre d’emplois : femme de ménage, ouvrière dans<br />
une poudrerie, vendeuse dans un magasin de la rue Mouffetard. À l’époque, elle avait un peu plus<br />
de trente ans. C’était un fruit du peuple des campagnes. Peu instruite, sa force résidait dans un<br />
instinct violent de survie. Pour elle, depuis l’enfance la vie n’avait été que combats et combats. Du<br />
peuple elle avait les mains dures à l’ouvrage, un respect certain des valeurs « établies », c’est–à–<br />
dire des valeurs bourgeoises. Du peuple elle avait encore la crainte du gendarme, de l’autorité.<br />
Femme humiliée, asservie, elle croyait que les hommes, seuls, avaient qualité pour commander le<br />
monde. La place de la femme se situait dans la cuisine. Elle avait un cœur d’or mais souffrait<br />
d’abominables migraines qui altéraient sa gentillesse. Cette femme se prit de tendresse pour moi.<br />
J’étais le réceptacle de toute une force d’amour gardée en réserve. Germaine devait devenir Mère 2.<br />
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, j’allais donc me retrouver avec deux mères :<br />
Olga, morte, partie en fumée, la mère mythique, celle que jusqu’à ce jour j’ai comblé sans cesse de<br />
dons naturels, celle que je n’ai jamais cessé d’embellir, celle qu’en secret j’ai souvent et purement<br />
caressée dans les moments difficiles, vers qui je me suis souvent réfugié quand une mésaventure<br />
trop grave venait faire saigner mon cœur, quand un amour me quittait, quand un ami me reprenait<br />
l’amitié, quand la ténèbre me terrorisait plus qu’il ne convenait, quand une mystérieuse nostalgie<br />
broyait mon âme.<br />
Germaine : la mère concrète, celle qui est présente en ces instants graves, essentiels de<br />
l’existence d’un enfant qui apprend à vivre, qui découvre et tente d’épeler les choses, qui se heurte<br />
aux mystères quotidiens, qui ne comprend pas pourquoi il faut soudain descendre à la cave,<br />
hâtivement, en ramassant dans l’ombre quelques habits, quelques objets, parce que des avions<br />
survolent les toits, parce que des mitrailleuses crachent un plomb mortel, parce que le feu de l’enfer<br />
mord les maisons, disloque les rues, cadavérise les jardins. Jusqu’au jour de mon envol, de la<br />
rupture violente, cette femme, en dépit de ses manques, de son ignorance, de ses limites, de son<br />
incompréhension devant certaines conduites et certains choix, malgré son front buté, son pauvre<br />
- 21 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
vocabulaire, aura été une « bonne » mère. Il m’est arrivé souvent, je l’avoue, durant ces années,<br />
d’établir son procès. M’adressant à Mère 1, comme si elle était tout près de moi, je formulais un<br />
réquisitoire impitoyable contre Mère 2. Je formulais les pires griefs contre ses réprimandes, ses<br />
fautes – du moins ce que moi je nommais ses fautes – ses cruautés. J’avais, en un sens, la partie<br />
belle : que pouvais-je reprocher à l’absente sinon justement son absence. Je m’accrochais<br />
furieusement à la conviction que si Mère 1 avait été présente dans la même circonstance elle aurait<br />
agi tout différemment de Mère 2. C’était sans doute illusion de gosse. Aujourd’hui, plus de trente<br />
ans après sa tragique disparition, Mère 1 me demeure toujours mystère opaque. Cette sensation, à<br />
certains moments, a même pris des proportions extravagantes, immenses. Il m’est arrivé à maintes<br />
reprises de me convaincre que j’étais né de ma propre volonté, de mon propre désir. Que j’étais le<br />
fruit tourmenté de ma seule liberté. C’est sans nul doute dans cette sensation répétitive qu’il faut<br />
chercher une part essentielle de mon refus d’obéissance, de ma rébellion, fut–elle cachée sous les<br />
oripeaux de l’apparente docilité. À l’intérieur j’étais lave et cratère en éruption. J’étais poings serrés<br />
et fièvres rouges. Vu de l’extérieur, je donnais l’impression d’un être « normal », semblable à tous<br />
les autres enfants qui ont plaisir à contourner l’ordre parental, mais sans prendre le risque de<br />
l’affrontement tragique.<br />
Mère 2 m’accompagna jusqu’au « retour de la paix ». Mon père comme toujours parvenait à<br />
envoyer, de temps à autre, un message. Un jour il était au combat, multipliant les missions<br />
dangereuses – soldat de l’ombre – sans uniforme ni galon, un autre il croupissait sur la paille noire<br />
de quelque geôle, attendant la venue du peloton d’exécution. Avait–il la « baraka » ? Certainement<br />
puisqu’il revint vivant.<br />
Mère 2, par sa tendresse, repoussait l’horreur vécue. C’était une femme forte. Un soir elle en fit<br />
la preuve. Nous approchions de la fin de la guerre, déjà, depuis Stalingrad, l’empire du III e Reich<br />
tremblait sur ses bases. Comme tous les jours depuis de longs mois, un char veillait, blotti dans<br />
l’ombre, contre la façade de notre maison, en bas du pont de chemin de fer. Mère 2 venait de faire<br />
une piqûre au fils d’une voisine qu’on soignait pour troubles de nervosité aiguë. Je ne sais plus qui<br />
se tenait à la fenêtre, observant, à travers le rideau légèrement écarté, le pont du chemin de fer. Nous<br />
étions au premier étage. Soudain, du sommet du pont surgirent deux silhouettes, juchées sur des<br />
bicyclettes, dont les porte–bagages semblaient surchargés. <strong>Les</strong> deux hommes pédalaient lentement,<br />
comme s’il étaient épuisés après une longue route. À n’en pas douter c’étaient des gens qui avaient<br />
été quérir quelque nourriture dans une campagne proche. Ils roulaient inconscients du danger. Ils<br />
n’avaient pas vu le char qui veillait, là tout près. Mère 2 et les autres personnes présentes ouvrirent<br />
la fenêtre en essayant de faire le moindre bruit, puis ils agitèrent les bras en direction des deux<br />
cyclistes, pour leur faire comprendre qu’il y avait du danger. De fait l’heure du couvre–feu avait<br />
sonné depuis longtemps. C’est au dernier moment, alors qu’ils ne se trouvaient plus qu’à une<br />
vingtaine de mètres du char, que les deux hommes comprirent. L’un d’eux vira brusquement sur la<br />
gauche et pédalant comme un forcené il s’engouffra dans une petite rue au fond de laquelle il<br />
disparut. L’autre, plus paniqué sans doute, moins maître de ses réflexes, sauta à bas de sa machine,<br />
et courut en direction du couloir de notre immeuble. Il n’avait toujours pas vu, semble-t-il, le char<br />
allemand. C’est alors qu’une rafale déchira la nuit. Un soldat venait de tirer sur l’inconnu. Ce<br />
dernier, ensanglanté, titubant, franchit la porte d’entrée, se traîna jusqu’au fond du corridor. Mais<br />
déjà Mère 2 dévalait l’escalier suivie d’un ami. Elle n’hésita pas une seconde. Ils saisirent aux<br />
épaules et aux jambes l’homme à demi évanoui et le traînèrent vers les escaliers. Exténués, ils<br />
montèrent au dernier étage, étonnés de ne pas voir surgir l’équipage du char. Aussi étrange que cela<br />
puisse paraître, seul le soldat qui avait tiré entra dans le couloir. Il contempla la large flaque de sang<br />
et il eut un geste qui semblait dire « il est foutu, je ne l’ai pas raté ».<br />
Empruntant les toits et les cours intérieures l’ami qui avait aidé Mère 2 alla chercher un médecin<br />
qui, tout en étant lié à la résistance, n’avait jamais été jusqu’alors inquiété. Il vint aussitôt. Le blessé<br />
- 22 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
fut évacué par le même chemin. La rafale l’avait traversé de part en part, mais elle n’avait touché, O<br />
miracle, aucun organe essentiel. Trois ans plus tard nous devions connaître d’ailleurs une<br />
émouvante rencontre. Ma grand-mère avait retrouvé sa boutique. Un midi, un homme, un de ces<br />
hommes qui justifient l’expression « signes particuliers : néant », se présenta devant elle et Mère 2.<br />
« Je viens vous remercier de m’avoir sauvé la vie ». Mère 2 ne comprenait pas. Mais l’homme<br />
d’ajouter « souvenez–vous, un soir, tac tac tac, je revenais avec un ami du ravitaillement ». Alors<br />
Mère 2 comprit. Grand-mère sortit du buffet un litre d’alcool de mirabelles. On trinqua à la paix<br />
revenue, à la santé de ceux qui avaient eu la chance de survivre.<br />
La paix s’incarna pour moi sous la forme d’un soldat américain qui m’offrit mon premier<br />
chewing-gum. Une obscure rumeur annonçait leur arrivée. Enfin, ils apparurent, chars en tête. Ils<br />
étaient rieurs, pareils à des gosses en balade. Ils baragouinaient quelques mots de français. J’eus<br />
tout de suite le béguin pour l’un de ces grands gaillards aux yeux clairs. Mais j’étais quand même<br />
craintif. Il m’amadoua en extirpant d’une des poches de son battle-dress le fameux paquet de<br />
chewing-gum qu’il m’incita, du geste et de la prunelle, à tester aussitôt. Ce que je fis. C’était<br />
étrange, nouveau, insolite. Une nouvelle vie commençait. Mais la guerre, la violence, la haine<br />
avaient pourri les cœurs et les esprits. <strong>Les</strong> foules en liesse ne pouvaient faire oublier le pauvre<br />
regard perdu des femmes tondues parce qu’elles avaient, très souvent par authentique sentiment,<br />
« couché » avec un soldat allemand. C’était une bonne occasion pour les « ouvriers de la onzième<br />
heure » de se donner des allures martiales, de parader comme des coqs de justice, de faire oublier<br />
leur lâcheté, leurs propres compromissions. La « Libération » ne fut pas seulement vécue par<br />
l’enfant de neuf ans, comme une fête à laquelle il se mêlait sans trop bien réaliser ce qui se passait,<br />
mais aussi comme un certain cauchemar ponctué par les dénonciations des uns par les autres. Telle<br />
mère dont le fils n’était pas revenu n’avait de cesse de faire la preuve que le fils du voisin qui avait<br />
tout au plus joué les « tire–au–flanc » dans tous les sens de l’expression, avait été un agent stipendié<br />
de la Gestapo, un indicateur des milices de Pétain. La France de Marcel Aymé, de la « Traversée de<br />
Paris » réglait ses comptes. « Que dansiez-vous en 1943 » pouvait devenir une accusation qui<br />
risquait de conduire aux prisons, aux tribunaux populaires. <strong>Les</strong> « Tartarin de Tarascon » peuplaient<br />
les rues, les cafés, les pleutres se paraient de curriculum vitae incendiaires, les lâches mettaient en<br />
cause les «justes», les «salauds» relevaient la trogne, les vrais héros se taisaient.<br />
Bien qu’étant encore très jeune, cette époque folle, floue, me marqua profondément. Elle laissa<br />
des marques indélébiles dans ma mémoire. Et lorsque, plus tard, je devais connaître Gabrielle<br />
Russier à Marseille, vivre sa tragédie, je ne pus m’empêcher de songer à ces mois où s’installait<br />
dans notre pays une « drôle de paix ». Alors, je découvris l’être humilié, livré à la vindicte sauvage,<br />
au sadisme irrationnel des foules. Je n’ai jamais cessé depuis de craindre les « foules », les<br />
« masses » échauffées par quelque tribun volubile, paranoïaque, emporté par son propre discours<br />
halluciné.<br />
Peu à peu, le vieil ordre se recomposa. <strong>Les</strong> affaires reprirent. Le général de Gaulle gouvernait<br />
avec des ministres communistes. Maurice Thorez peaufinait son maître-mot : « il faut savoir finir<br />
une grève ». <strong>Les</strong> criminels nazis, aidés par des organisations secrètes, certains protégés par le<br />
Vatican même, prenaient le chemin de l’Amérique du sud où ils allaient avoir la possibilité de<br />
mettre leurs talents, leur savoir-faire, au service de dictateurs impitoyables, du Proche Orient et de<br />
l’Afrique. Libérés, les Français voulaient jouir de l’existence. Pourtant de sombres signes<br />
s’amoncelaient à l’horizon : la guerre de Corée, les prémisses de la guerre froide, les<br />
commencements larvés de la 3 e guerre mondiale, cette fois entre l’URSS et les États-Unis. Pour<br />
nous, Français, quelque chose de grave s’était passé à Sétif en Algérie où la Légion Étrangère avait<br />
durement réprimé les manifestations des soldats algériens qui avaient combattu « pour la France »<br />
et qui réclamaient, non l’indépendance, – cela devait venir un peu plus tard – mais un statut moins<br />
injuste. La quatrième République ne trouva pas d’autre réponse que le recours aux armes et à la<br />
- 23 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
répression. Elle allait le payer cher ! Aujourd’hui encore, le drame n’est pas clos. Ces fusillades de<br />
Sétif furent la source d’une immense tragédie à laquelle ma génération devait se retrouver<br />
confronter à l’âge de vingt ans. De même, Madagascar n’allait pas tarder à entrer en turbulence.<br />
Pendant ce temps–là M. François Mitterrand, ministre de l’Intérieur, inaugurait le Festival du<br />
cinéma de Cannes.<br />
Moi, je « vivais ma vie », encore à l’écart. Mère 2 avait rencontré enfin, aimé, épousé mon père.<br />
Olga n’était plus qu’une lointaine blessure. Nous nous installâmes dans un petit appartement situé à<br />
un jet de pierre de la boutique de Grand-mère. C’était un logis modeste auquel on parvenait en<br />
traversant une minuscule cour, en longeant un court passage encastré entre nos murs et le mur de la<br />
maison voisine qui pouvait s’enorgueillir d’un grand jardin, un jardin qui aura joué un rôle<br />
important dans ma vie. Puis on parvenait à un escalier de bois qui débouchait sur un palier en plein<br />
air. Quatre appartements. Nous occupions le premier. Il était composé de trois pièces plutôt<br />
exiguës : une cuisine, une chambre–salle à manger que j’allais très vite partager avec mon demi–<br />
frère, enfin la chambre réservée aux parents.<br />
Mon père changea de vie. À la suite de désaccords politiques, de conflits obscurs, il quitta le<br />
« Parti » qu’il avait, de toutes ses convictions, servi. Au prix de sa propre dignité d’homme.<br />
L’appareil du Parti le broya, le rejeta comme on rejette un outil devenu inutilisable. Mon père<br />
redevint prolétaire anonyme, magasinier à la SNCF. Un travail sans joie, sans avenir. Une routine<br />
destructive. Mère 2 aidait Grand–mère au magasin d’alimentation. Comme il est de tradition, qu’on<br />
soit « rouge » ou non, je fis ma première communion. De cet événement il ne me reste que<br />
déceptions. La première, c’est que je portais des souliers qui me faisaient très mal, et j’étouffais<br />
dans mon habit raide. La seconde, plus terrible encore, c’est que lors des « répétitions » qui<br />
précédaient le jour solennel, le curé m’avait attribué, pour la sortie de l’église, une merveilleuse<br />
gamine dont j’étais aussitôt tombé amoureux. Très fier à l’idée de défiler dans l’église et dans la<br />
cour, devant les familles émues, aux côtés de cette charmante créature qui me faisait les yeux doux,<br />
je plaignais les autres garçons que le hasard, ou les choix du prêtre, n’avaient pas gâtés. Or, la veille<br />
du dimanche fatidique, une des communiantes tomba brusquement malade. <strong>Les</strong> garçons durent<br />
décaler d’un rang et je me retrouvai avec, comme partenaire, une fillette maigre, sèche, à lunettes,<br />
aux lèvres pincées qui ne daigna pas vérifier par le moindre mot si j’étais vivant ou si j’étais<br />
fantôme. Par-dessus l’épaule, je jetais des regards désespérés à mon amoureuse qui, visiblement,<br />
souffrait elle aussi. Le cadeau d’une belle montre – ma première – n’atténua même pas mon<br />
chagrin.<br />
Quelques temps plus tard, nous fîmes un voyage en Normandie. Une lointaine et vague petite<br />
cousine faisait sa première communion. Une table pantagruélique avait été dressée dans une grange.<br />
<strong>Les</strong> adultes festoyèrent. Ils firent ripaille. S’emplirent la panse. Vidèrent maintes chopines. Ils<br />
étaient encore à l’ouvrage alors que déjà la nuit tombait. Moi, peu soucieux de me mêler aux petits<br />
paysans moqueurs, agressifs, j’avais vidé subrepticement les fonds de verre. Pour tout dire et vu<br />
mon âge j’étais fin saoul. Je me glissai vers la grande chambre obscure où les adultes prévenants<br />
avaient regroupé les bambins. Je n’avais qu’une envie : dormir. Je m’effondrai sur l’immense lit<br />
peuplé de bébés… et tombai littéralement sur ma « lointaine et vague petite cousine » qui remua à<br />
peine. Elle semblait reposer, les yeux clos. Sa poitrine, mince, menue, battait très fort. J’étais<br />
énervé, je ne parvins pas à trouver le sommeil. Dans la pénombre, j’observais ma « cousine ». Je<br />
commençais à la trouver séduisante. Une bouffée obscure m’envahit. Une pulsion instinctive me fit<br />
soudain caresser d’une main que je voulais légère, quelque chose comme une aile d’oiseau, le tissu<br />
sous laquelle battait la jeune poitrine. J’étais quasiment inconscient. Je ne me rendais pas compte<br />
des gestes accomplis. Mes doigts glissèrent entre les boutons, s’infiltrèrent doucement sous le tissu,<br />
s’enfoncèrent. Elle ne bougeait pas. Enfin, mes doigts atteignirent un petit sein qu’ils pétrirent<br />
maladroitement. J’étais, au sens du terme, aux anges. Mais brusquement la porte s’ouvrit, un<br />
- 24 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
convive apparut dans l’embrasure, jetant un regard circulaire pour vérifier sans doute si tout allait<br />
bien. Je retirai précipitamment ma main. À cet instant précis s’achevèrent mes troubles amours avec<br />
ma « lointaine et brumeuse cousine ». Mais le sexe, sans que je le sache très bien, était entré dans<br />
ma vie. Je grandissais normalement si l’on peut dire. J’allais à l’école, rue Paul Bert, où mes<br />
condisciples m’avaient surnommé, mi–copains mi–moqueurs, « l’eau de Vichy ». Ils ne savaient<br />
pas, les bougres – et moi non plus d’ailleurs – que mon nom était très ancien, un très vieux nom<br />
latin qui veut dire « louange, célébration ». C’est bien plus tard, quand j’appris que dans les<br />
couvents on chantait, aux aurores « <strong>Laude</strong>s et matines », quand je découvris en profondeur mes<br />
racines occitanes, que je devins fier de mon nom. J’ai longtemps rêvé de m’appeler autrement,<br />
révolte banale et classique contre le Père, contre le patronyme imposé. Sans doute un désir de faire<br />
preuve de ma liberté. Cela dit, devenu une « grande personne » je recours toujours aux<br />
pseudonymes et pas seulement pour des raisons « utilitaires » (demeurer ignoré de la police parce<br />
qu’on rédige des textes violemment contestataires, véritables outrages aux bonnes mœurs et aux lois<br />
de l’État ; respecter la règle qui veut qu’on ne publie pas sous le même nom et dans deux journaux<br />
différents deux articles consacrés au même sujet). Non, je sais aujourd’hui que pour moi le recours<br />
aux pseudonymes a le même sens que pour le grand poète portugais – peut–être un des plus grands,<br />
sinon le plus grand – Fernando Pessoa, lequel dans une succession d’éclairs brefs s’inventa une<br />
série d’hétéronymes dont les trois principaux sont Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Alvaro de Campos.<br />
Chacun était un individu autonome, avec sa biographie propre, ses avatars personnels, ses propres<br />
influences, sa philosophie spécifique, son style unique. Pessoa, qui fut un étrange bonhomme, très<br />
souvent sans domicile fixe, qui, après une enfance en Afrique du Sud revint vivre à Lisbonne, au<br />
bord du Tage, où il exerça de modestes métiers, (essentiellement celui de correspondant étranger<br />
pour des firmes commerciales) était un homme très fin, très cultivé, très en avance sur son époque.<br />
Il avait sans doute assez étudié le bouddhisme pour savoir que le « moi » n’est qu’un agglomérat de<br />
sensations, de pulsions obscures et antagonistes, de pressentiments vagues. Par honnêteté<br />
intellectuelle, sans doute, Pessoa, hanté par une myriade de « moi », voulut donner la parole à<br />
chacun de ces locataires abusifs. Il en résulta une œuvre fort étrange, puissante, à laquelle il<br />
convient d’ajouter les textes tout simplement signés Pessoa. Au lecteur ignorant qui désirerait en<br />
savoir plus je recommande l’excellent « Poète d’aujourd’hui » dû à Armand Guibert. Je signalerai<br />
encore la récente parution d’une anthologie–dossier Masques sans visage, toujours due au fidèle<br />
Armand Guibert, ainsi qu’un remarquable essai écrit par le grand et perspicace poète mexicain<br />
Octavio Paz qui traduisit, il y a déjà longtemps, Pessoa en langue espagnole.<br />
Je grandissais donc, entre Père et Mère 2. Père était devenu muet, sombre. Il s’éloignait. Rares<br />
étaient déjà nos moments d’échanges. Il se passait en lui quelque chose comme une régression. Lui<br />
qui, durant sa jeunesse avait vécu un rêve collectif intense, se défaisait, maille après maille. Je<br />
notais chaque jour une révolte grandissante en lui, mais une révolte qui virait non au clair, mais à la<br />
nuit. L’humanité entière devenait peu à peu l’ennemi n° 1 de mon père. Cet homme qui s’était<br />
beaucoup battu, qui avait pris mille risques froidement, qui avait tué, torturé peut–être au nom de la<br />
« Cause » – avec un C majuscule –, qui avait connu le fouet, l’angoisse de l’aube quand on s’attend<br />
à être emmené au peloton d’exécution, qui n’avait jamais renoncé, qui avait vingt fois entendu les<br />
balles siffler à ses oreilles, qui avait vu tomber ses meilleurs compagnons de lutte, qui avait serré les<br />
mâchoires durant les nuits de l’oppression et du brouillard, qui avait délaissé ses enfants, son<br />
épouse pour partir affronter l’ennemi, cet homme se vidait, matin après matin, de sa substance. Il<br />
devenait de plus en plus violent, de plus en plus vindicatif, de plus en plus hargneux. Il se vautrait<br />
dans la médiocrité comme un porc se vautre dans sa bauge. Lui qui n’avait, il faut bien le<br />
reconnaître, jamais vraiment lu et qui ignorait tout de la théorie marxiste, lui qui ne fut guère qu’un<br />
homme d’action, ne savait plus se délecter qu’à la lecture de médiocres et vulgaires magazines tels<br />
Détective, A tout cœur. Radio–Luxembourg avec ses émissions de variétés, avec son inénarrable<br />
- 25 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Reine d’un Jour couronnée par Jean Nohain, avec son increvable Bise à Zappy qui avait remplacé<br />
Radio-Londres. On chante dans mon quartier susurrait Saint-Granier. Certes, on y chantait mais<br />
surtout pas l’air de la Liberté.<br />
Je ne savais pas exactement pourquoi mais je commençais à haïr tout cela. J’étais obscurément<br />
en marche. Chez nous, il n’y avait pas un seul livre de poèmes. Je ne savais encore rien de Balzac,<br />
de Proust, de Faulkner, de Sartre, de René Char. Par une espèce de sadisme à rebours je me<br />
délectais des sottises qui remplissaient les pages des romans photos et de Détective.<br />
À l’école, j’étais le premier ou le second en rédaction. Quand je n’étais pas le premier c’était<br />
mon copain André Kopf qui l’était. Un drôle de fusil celui–là. Taillé en athlète pour son âge, il<br />
inquiétait instituteurs et professeurs. Dans la cour de récréation, il faisait la loi et c’est très souvent à<br />
la force de ses poings, ou plutôt à la force de dissuasion de ses poings, que je dus de ne pas être<br />
rossé. Une amitié totale s’établit entre nous. Nous étions des complices parfaits. Quand nous<br />
changeâmes d’école pour entrer en cours complémentaire, nous nous retrouvâmes épaule contre<br />
épaule. Il ne cessait, physiquement, de prendre du large par rapport à nous. Des filles, plus âgées de<br />
plusieurs années, le lorgnaient d’un regard langoureux. Nous, nous n’étions encore que des<br />
mioches.<br />
Pour lui, j’étais le poète. Car, enfin j’écrivais. Tout avait commencé au début de notre rencontre.<br />
Cette année–là mes parents m’avaient placé dans une colonie de vacances organisée par la SNCF.<br />
Chaque enfant devait séjourner chez une famille de paysans en Auvergne.<br />
Une trentaine de gosses partirent un peu inquiets. Nous n’avions aucune idée du lieu où nous<br />
allions échouer. Le car roula toute la nuit, puis encore de longues heures, et enfin les premiers<br />
enfants furent remis entre les mains de leurs familles adoptives. J’étais triste parce que le moment<br />
approchait –je le devinais où il allait falloir me séparer de ma voisine de siège. Celle–ci était une<br />
petite fille très jolie, avec une longue chevelure et une robe couverte de fleurs imprimées. Elle avait<br />
durant la nuit partagé son petit panier de victuailles avec moi. J’avais appris qu’elle habitait une<br />
maison avec des arbres, près de Paris. Elle était « petit rat de l’opéra». À cette époque, je ne savais<br />
absolument pas ce que cette expression pouvait signifier. Le mot « rat » me disait bien quelque<br />
chose. J’en avais vu en Normandie, dans la ferme de Tantine. Mais le mot « opéra » ne déclenchait<br />
strictement rien en moi. Elle m’expliqua qu’elle apprenait la danse pour devenir plus tard une<br />
« étoile ». Personne ne m’avait dit que la danse était un métier. J’étais de plus en plus égaré, mais de<br />
plus en plus fasciné par ma petite camarade. Quand nous nous séparâmes, émus, nous nous<br />
promîmes de nous retrouver à la fin des vacances. Un couple qui avait l’air charmant l’attendait à<br />
l’arrêt du car. Elle s’éloigna en leur compagnie. Le car repartit. Lorsque mon nom fut prononcé par<br />
la monitrice, mon cœur battit d’appréhension. Je pris mon maigre baluchon. Un couple m’attendait.<br />
Au premier coup d’œil je détestais la femme qui avait une allure revêche. Elle frôla ma joue du bout<br />
des lèvres. Son mari avait l’air nettement plus aimable.<br />
Nous montâmes dans une vieille auto toute grinçante. Le monsieur m’interrogeait. Il parlait<br />
gentiment. La dame qui conduisait ne disait rien. Nous arrivâmes dans la cour d’une ferme où il y<br />
avait un gros tas de fumier qui me donna la nausée. Devant la porte, deux enfants, un garçon et une<br />
fille sensiblement moins âgés que moi, attendaient, accrochés à la robe d’une vieille femme racornie<br />
qui se trouvait être la mère de la dame qui conduisait l’auto. Ce soir–là on me servit une espèce de<br />
soupe épaisse. Ce fut tout le repas. Puis, on m’emmena dans ma « chambre » qui n’était qu’une<br />
sorte de pièce très exiguë avec un vieux lit branlant en fer sur lequel était jetée une couverture<br />
pleine de trous. Je compris très vite où j’étais tombé. Ces gens – du moins l’épouse – étaient des<br />
paysans de la race la plus fruste. Non contents d’être payés pour accueillir, héberger, nourrir un<br />
gosse de Paris durant trois semaines, ils estimaient que ce gosse devait trimer dur. L’homme ne<br />
pensait sans doute pas comme sa femme. Mais, indiscutablement c’est elle qui commandait, y<br />
compris à sa propre mère. C’était une créature qui n’arrêtait pas. Levée tôt, couchée tard, elle<br />
- 26 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
courait du champ à l’étable, de la cuisine au champ, de l’étable à la cuisine. Elle ne parlait pas sinon<br />
pour donner des ordres ou proférer des menaces. Ses enfants la craignaient. Le mari était<br />
littéralement esclave. Quand il partait le matin pour les travaux des champs, elle enfouissait dans la<br />
sacoche de toile, d’un air sévère, un maigre sandwich et une bouteille remplie d’eau. Un jour je<br />
surpris l’homme, l’œil aux aguets en train de farfouiller dans un bouquet d’orties. C’est là qu’il<br />
cachait la chopine de vin qu’il avait subrepticement tiré à la cave. J’étais totalement décontenancé.<br />
La première besogne qu’on me confia fut de décharger un chariot de foin. Le foin était humide et<br />
la tâche était d’autant plus ardue. Au bout d’un quart d’heure une violente migraine broyait mes<br />
tempes. Je titubais. Toutes les dix fourchées j’étais contraint de faire une pause. La dame me surprit<br />
lors d’une de ces pauses et me disputa. Je fus privé de soupe et ce soir–là je dus regagner la<br />
« chambre », où la nuit les souris festoyaient car la pièce servait aussi de dépôt de grain.<br />
Je ne savais à qui me plaindre. Je n’osais pas écrire à mes parents d’autant plus que la dame<br />
relisait mes lettres et cartes. Et puis avais–je le droit de me plaindre. Peut-être que tout cela était<br />
normal. Je m’étais lié très vite avec les voisins fermiers qui avaient des enfants sympathiques. Ils<br />
me regardaient avec des airs attendris. Souvent le soir, la dame me concédait une petite<br />
« récréation » avant d’aller dormir car on se lève tôt, quel que soit l’âge, chez les paysans<br />
besogneux et âpres au gain. Alors je bondissais chez les voisins où m’attendait une grosse part de<br />
tarte. Tarte qui permettait d’avaler moins tristement le grand bol de soupe. J’avais des habits troués,<br />
sales. J’appris que c’était la deuxième année que ces gens–là accueillaient un enfant. L’année<br />
précédente, l’enfant avait été le « chouchou » de la dame. Il avait été exempté de tous travaux,<br />
choyé comme un Jésus, brossé chaque matin, épouillé, lavé, coiffé. Un jour les voisins me dirent :<br />
« tu n’es pas bien ici il faut écrire à tes parents, nous posterons la lettre,ainsi elle n’en saura rien ».<br />
Aussitôt, ils me donnèrent une feuille de papier, une plume et j’écrivis une lettre dans laquelle je<br />
racontais ce que je vivais à mon père et à Mère 2. Deux jours à peine passèrent. Après le repas de<br />
midi, alors qu’ils s’apprêtaient à donner le signal du départ pour les champs, une petite auto s’arrêta<br />
devant le porche de la ferme. Un homme jeune, aux cheveux en brosse, à l’air souriant en descendit,<br />
et se dirigea vers la porte d’entrée. C’était l’inspecteur de la colonie de vacances. Après m’avoir<br />
gentiment tapoté la joue, il me pria de m’éloigner, de revenir lorsqu’il m’appellerait. Je m’éloignais<br />
de quelques mètres seulement. Je jouais avec des brindilles de bois, inquiet. Qu’allait–il se passer ?<br />
Dans la maison, l’inspecteur parlait très fort. La dame criait, elle aussi, très fort, mais sa voix<br />
dénonçait la peur. L’homme et sa belle–mère se taisaient. L’inspecteur réapparut sur le seuil. Il me<br />
fit signe de la main, je m’approchai. Il posa sa main sur mon épaule « mon garçon, tu ne vas pas<br />
rester ici. Ces gens–là ne sont pas des gens gentils. <strong>Les</strong> voisins m’ont fait savoir qu’ils sont prêts à<br />
t’accueillir jusqu’à la fin des vacances. Si tu es d’accord, je t’accompagne tout de suite chez eux. Tu<br />
n’auras rien à craindre. Ils t’aiment déjà beaucoup. »<br />
J’acquiesçai, après avoir demandé si mon père et Mère 2 avaient été consultés. Ils l’avaient été.<br />
Le cœur léger, ignorant les regards courroucés de la dame, j’emballais mes affaires et, conduit<br />
par l’inspecteur, je gagnais mon nouveau foyer. Il me restait un peu plus d’une semaine de vacances<br />
à vivre. Je vécus ce temps, dorloté, choyé. L’autre mégère, quand elle m’apercevait, tournait les<br />
talons ou s’éloignait précipitamment. Pourtant, un matin, son mari qui m’avait aperçu flânant près<br />
du champ où il ahanait, s’approcha de moi et, timidement, comme pour s’excuser, il murmura « ça<br />
n’est pas ma faute, moi je t’aime bien ». Je savais. C’était un faible mais pas un méchant homme. Je<br />
serrai la main qu’il me tendit. Il s’éloigna, l’épaule basse.<br />
Le jour où le car devait faire sa récolte de ferme en ferme approchait. J’étais sûr de retrouver<br />
mon petit rat de l’opéra. Je voulais lui faire un cadeau, un cadeau pas comme les autres, quelque<br />
chose de surprenant. Mais je ne savais quoi : un oiseau déniché dans son nid, un beau silex, un<br />
bouquet de fleurs des champs. Non, je désirais autre chose. Et c’est alors que la muse me visita, que<br />
l’inspiration me tomba sur les reins. J’étais assis en train de griffonner sur une feuille de papier.<br />
- 27 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
C’était l’heure de la pleine chaleur. <strong>Les</strong> chats ronronnaient doucement auprès de l’âtre éteint.<br />
Soudain surgit de ma tête vacillante, de mon ventre brûlant, de mon sang excité, un animal étrange :<br />
un poème, oui, un poème. Trente–cinq ans plus tard le souvenir de cet instant élu m’émeut toujours.<br />
À cet instant, d’une certaine façon, je suis né, vraiment. Que disait ce poème. Comme vous le<br />
pensez je suis bien incapable de le recomposer. Mais je sais ce qu’il disait. D’une façon maladroite,<br />
ridicule sans doute, il disait combien j’étais amoureux des yeux de mon petit rat de l’opéra, de sa<br />
chevelure, de ses mains. Mon premier poème aura été un poème d’amour. N’est–ce pas<br />
merveilleux ? Sur ma lancée, je continuai. L’idée me vint de réécrire l’histoire de Tristan et Yseult<br />
qu’on nous avait lue en classe quelques mois auparavant. J’avais été touché, certes, mais je n’avais<br />
pas accepté la conclusion de l’histoire : la mort de Tristan et Yseult. Je voulais que l’Amour gagne<br />
toujours. Alors, m’inspirant de mes souvenirs de Normandie, mêlés à ceux d’Auvergne, je rédigeais<br />
fièrement une nouvelle version. Dans mon histoire à moi, en fin de compte, Tristan et Yseult se<br />
retrouvaient. Yseult guérissait grâce au bons rayons de soleil campagnard. Elle devenait très grosse.<br />
Yseult et Tristan avaient cinq ou six enfants. Et ils coulaient des jours heureux en élevant des<br />
cochons rosés et gras. Régulièrement Oncle Marc leur rendait visite. Et ils mouraient très, très<br />
vieux. J’étais extrêmement satisfait de mon œuvre. Je recopiais le tout sur des feuilles blanches bien<br />
propres car je ne voulais pas offrir un manuscrit surchargé de corrections. J’enfouis le tout dans une<br />
grande enveloppe que je décorais aux crayons de couleurs; des arabesques autour du nom de la<br />
destinataire : « Virginie ». Je n’oublierai jamais le regard de Virginie quand je lui remis l’enveloppe<br />
dans le car. Elle me demanda de changer de place pendant le temps qu’elle lirait. Quand je revins,<br />
elle mit simplement ses bras autour de mon cou et m’embrassa sur la bouche. Ses lèvres étaient<br />
douces, tièdes, pures. Je n’ai jamais plus embrassé depuis des lèvres aussi pures, tièdes et douces. Je<br />
n’étais pas encore dans la ténèbre, le péché.<br />
Comme promis, rentrés à Paris, nous nous écrivîmes. Je fus reçu une fois ou deux chez elle, elle<br />
vint une fois ou deux chez moi. Puis les liens se distendirent. L’oubli commença son œuvre. Il<br />
m’arrive aujourd’hui encore de parcourir les programmes chorégraphiques et mon cœur bat lorsque,<br />
de temps en temps, mon regard tombe sur le prénom d’une danseuse « Virginie ». Où es–tu<br />
aujourd’hui Virginie, peut–être n’es–tu jamais devenue une « étoile » ni même peut–être une<br />
danseuse professionnelle. Peut–être t’es–tu mariée très jeune avec un beau garçon. Vous avez eu<br />
très vite deux ou trois enfants. Ton mari voyage beaucoup pour ses affaires. Toi, tu t’ennuies et tu ne<br />
t’ennuies pas. Es–tu épouse fidèle ou prends–tu des amants ? Je t’imagine très belle à quarante ans<br />
passés puisque tu avais, à quelques mois près, mon âge. Je t’imagine séduisante. Virginie, peut–être<br />
nous sommes–nous croisés sans nous reconnaître dans une rue de Paris, un bar de Los Angeles, une<br />
trattoria de Rome, un jardin d’hiver à Kyoto, une avenue illuminée à Broadway, un bistrot du port à<br />
Amsterdam, un palace climatisé à Rangoon ?<br />
Mais au fait Virginie, peut–être es–tu morte. Tuée par un voyou, écrasée par une avalanche,<br />
broyée par quelque maladie tropicale, déchiquetée par une automobile folle, ou simplement<br />
poignardée par la mélancolie du temps, la nostalgie de l’Eden, la perte irrémédiable de l’enfance.<br />
Où es–tu Virginie. Si tu me lis, si tu me reconnais, si tu te reconnais, écris–moi : « Poste Restante –<br />
Star City – Wonderland ».<br />
André Kopf avait un rêve, une vocation. Il s’était juré de devenir conducteur de trains. À<br />
l’époque nous n’avions pas encore lu, ni lui ni moi, La Bête humaine de Zola. Nous ne savions rien<br />
du Transsibérien de Blaise Cendrars, nous ignorions tout de l’Orient Express de Valéry Larbaud,<br />
Paul Morand, Maurice Dekobra et Pierre–Jean Rémy. Mais c’était ainsi. Il serait conducteur de<br />
trains. Il l’est devenu. Le hasard voulut que nous nous rencontrâmes sans l’avoir prémédité il y a<br />
quelques années. Nous étions passablement émus. Je lui lançai narquoisement : « alors, conducteur<br />
de trains ? ». « Bien sûr, » répondit–il à ma stupéfaction, avec un accent guttural de suisse de<br />
Zurich. Et il cligna de l’œil. Il avait compris le sens de ma petite provocation. En effet, il conduisait<br />
- 28 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
les trains helvétiques. En blouse blanche. Fini les temps héroïques des chauffeurs et mécaniciens<br />
balayés par les vents, noirs de charbon, pareils à des ombres de théâtre chinois face à la gueule du<br />
four. La technologie moderne avait renvoyé aux oubliettes ces images apocalyptiques. André<br />
exerçait une profession qui exigeait un vrai doigté de chirurgien. Plus la moindre escarbille dans<br />
l’œil. Mais des manettes électriques, des tableaux de bord luxuriants. Qu’importé si la fable en avait<br />
pris un coup. Il était heureux tant au travail qu’à la maison. Marié, père de famille, travailleur<br />
ponctuel, il pataugeait en plein dans ce « bonheur suisse » dont les cinéastes Tanner, Goretta et<br />
quelques autres se font un malin plaisir d’arracher les masques. Mais à chacun sa liberté !<br />
À l’École, André avait un succès fou. C’était un imitateur hors–pair. Mieux que cela même. Son<br />
numéro de bravoure consistait à restituer l’atmosphère de la gare de Zurich. Tout y était : l’arrivée,<br />
le départ des trains, les bribes de conversations saisies au vol, les annonces au micro, les bruits des<br />
véhicules charriant les bagages, les pleurs des enfants énervés, les appels des gens se cherchant dans<br />
la foule. Il y avait deux cours privilégiés durant lesquels André affectionnait de donner son<br />
« récital ». D’abord celui de Mademoiselle Nocturne. Elle s’appelait véritablement ainsi. Nous<br />
l’avions surnommée « Nocturne de Chopin ». Et pour cause. Elle était professeur de musique.<br />
C’était une « vieille fille » ainsi que l’on dit. Par conviction. Aujourd’hui encore, en y songeant,<br />
j’en doute fort. Je suis plus enclin à penser que simplement et tristement Mademoiselle Nocturne<br />
était restée célibataire parce que jamais un homme ne lui avait proposé de l’épouser, jamais elle<br />
n’avait eu la révélation de la passion humaine. Peut-être, tout au plus, avait-elle aimé quelque<br />
professeur, en silence et en cachant son jeu. <strong>Les</strong> années avaient succédé aux années. De plus,<br />
Mademoiselle Nocturne n’était pas une Rita Hayworth. Timide sans doute elle s’était enfoncée dans<br />
une espèce de « veuvage » sans époux mort à déplorer, à regretter. La solitude était devenue son<br />
royaume. Je crois qu’elle craignait assez la bande de garnements à laquelle elle était censée<br />
enseigner les rudiments du solfège et les beautés de Mozart, Bach, Haydn.<br />
Nous étions cruels à son égard. Car, de plus, elle était affectée d’une sorte « d’infirmité »,<br />
inexcusable selon nos jeunes esprits dévoyés. Elle portait «perruque». Alors, pour nous, il s’agissait<br />
de faire en sorte de la bousculer afin que sa perruque perdit l’équilibre et que le rouge de la honte<br />
envahisse ses joues maigres.<br />
Mais le pire ce fut, je crois le jour où nous cachâmes dans son harmonium portatif un orvet. Elle<br />
commença son cours normalement, faisant courir ses doigts le long des touches. Puis, soudain, elle<br />
poussa un hurlement d’effroi. Ses doigts venaient de rentrer en contact avec l’orvet. Elle s’écroula<br />
sur sa chaise, à demi–évanouie. Le directeur qui passait par là fut alerté par le vacarme. Il pénétra<br />
dans la classe, et en quelques secondes, prit la mesure de l’événement. <strong>Les</strong> punitions plurent comme<br />
feuilles mortes en automne.<br />
Le directeur était un homme très massif. Avec une grosse moustache grise, des yeux presque<br />
toujours tristes, sinon navrés. Il marchait légèrement voûté comme s’il avait voulu masquer sa haute<br />
silhouette. Mr D. s’était chargé du cours d’Éducation civique. Il tentait de nous inculquer les<br />
rudiments classiques du respect des vieilles gens, de l’obéissance aux autorités, de la grandeur qui<br />
résidait dans le fait de ne pas cracher par terre, de donner sa place dans le train à lune personne<br />
âgée, à une femme enceinte. Le malheur pour Mr D. voulait qu’il fut sourd comme un pot. On ne se<br />
gênait pas pour profiter de l’aubaine. C’est alors qu’André Kopf se déchaînait « Imite les trains<br />
dans la gare de Zurich » suppliaient les enfants de la classe. André ne se faisait pas prier. Et les<br />
enfants plies en deux, de pouffer de rire, de jeter par–dessus les tables des avions en papier. Mr D.<br />
n’était pas dupe. Il savait où situer les coupables. Et d’une voix monocorde il scandait son cours<br />
devenu inaudible de la sentence sempiternellement répétée :<br />
– <strong>Laude</strong>, cent lignes<br />
– Kopf, trois cents lignes<br />
– <strong>Laude</strong>, deux heures de « colle »<br />
- 29 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
– Kopf, un jour de renvoi de l’école.<br />
L’essentiel était pour André et pour moi que nous fussions mis à la porte de l’école en même<br />
temps et pour une durée équivalente. Ces jours–là nous les passions chez lui, à quelques centaines<br />
de mètres de ma maison, car sa mère était, c’est le moins qu’on puisse dire, compréhensive. Chez<br />
moi les choses se seraient passées tout autrement. Alors, je me réfugiais chez André. Nous faisions<br />
nos « pénitences » tout en savourant les délicieux quatre–heures de Madame Kopf et les<br />
savoureuses plaisanteries helvétiques de Mr Kopf, lequel, fort complaisamment, n’hésitait pas à<br />
imiter les signatures de mes parents.<br />
Nos punitions achevées, nous regagnions l’école. <strong>Les</strong> autres nous attendaient impatiemment :<br />
« Dis André quand est–ce que tu imiteras les trains dans la gare de Zurich ? » II leur suffisait d’être<br />
patients, d’attendre le prochain cours de morale. Et tout recommençait :<br />
– <strong>Laude</strong>, cent lignes<br />
– Kopf, deux cents lignes<br />
– <strong>Laude</strong>, au piquet<br />
Mais si André Kopf avait mon amitié, Françoise C. avait mon amour. Françoise habitait la<br />
maison entourée du grand jardin qui jouxtait notre modeste logis. Son père travaillait aussi à la<br />
SNCF. Sa mère était employée de bureau dans une quelconque administration. Ses parents et les<br />
miens lièrent très rapidement des relations. <strong>Les</strong> deux familles partageaient fréquemment le souper,<br />
se retrouvant dans l’une ou l’autre maison pour une partie de belote. Françoise était une grande<br />
jeune fille, très saine, épanouie, avec une magnifique chevelure brune. <strong>Les</strong> premières années nous<br />
fûmes étroitement complices. Nous ne nous quittions guère. Nous jouions dans le jardin, à<br />
construire des cabanes de branches. Nous ravagions les fraisiers et les framboisiers. <strong>Les</strong> premiers<br />
temps nous explorâmes même les merveilles du « touche–pipi ». C’était puéril et innocent. Elle<br />
n’avait pas de regard pour nul autre garçon que moi. Nous étions Tristan et Yseult, Pétrarque et<br />
Laure, Dante et Bérénice, Daphnis et Chloé. Nous nous aimions tranquillement dans le crépitement<br />
des étés, dans les hautes herbes sauvages du fond du jardin. Nous nous aimions ? cela veut dire que<br />
nous nous contemplions, sans faire le moindre geste, que nous nous couchions, corps contre corps,<br />
éblouis, muets de stupeur, les yeux brûlés par la lumière, le feu de l’astre, que nous nous caressions<br />
avec une pudeur extrême, que nous échangions des baisers furtifs.<br />
J’étais tout pour elle, je crois. Elle était tout pour moi. L’avenir était clair et net : quand nous<br />
aurions l’âge, nous nous épouserions. Nous nous le sommes promis maintes fois. Un soir, afin de<br />
donner à l’engagement mutuel une signification encore plus solennelle, quasi sacrée, nous<br />
procédâmes au rituel de l’échange des sangs. Avec un petit canif je fis perler une goutte de sang au<br />
bout d’un doigt de Françoise. J’agis de même pour moi. Et nous collâmes nos deux doigts ensemble<br />
tandis que nos regards plongeaient l’un dans l’autre, chavirés d’amour. Instant magique. Nous<br />
n’étions plus dans une triste banlieue ouvrière, avec ses rangées de pavillons gris, ses jardins<br />
mesquins, ses marronniers rabougris, son église au coq rouillé et déséquilibré. Nous étions ailleurs,<br />
au vert pays des amours enfantines.<br />
Nous n’avions plus peur ni de la guerre ni de la mort. En quelque sorte nous étions sauvés, nous<br />
habitions la « main de dieu ». Que de grandes et multiples choses allions–nous réaliser. Sur les<br />
cartes des océans et des continents nous inventions mille surprenants voyages : nous descendions en<br />
pirogue l’Amazone, nous errions à dos d’éléphants au pays des maharadjas, nous faisions face à des<br />
hordes nègres dans la jungle africaine, nous nous enlacions dans une gondole à Venise, nous<br />
faisions des pirouettes sur les toits des gratte–ciel à New York.<br />
Toutes les amours enfantines se ressemblent à coup sûr et les nôtres n’eurent rien d’étonnantes,<br />
sans doute. Mais je demeure persuadé que les « amours enfantines » même si elle sont nommées<br />
ainsi à l’âge mûr, à travers le prisme de la nostalgie, ont existé et existent toujours. Elles disent<br />
l’élan chaleureux vers l’autre, l’immense besoin de tendresse, le désir fou de se perdre dans une<br />
- 30 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
dimension vague, floue, l’infini. Elles disent peut être le meilleur de l’individu avant qu’il ne soit –<br />
sauf rares exceptions – « normalisé », métamorphosé en adulte raisonnable et réaliste, condamné à<br />
la soumission, au labeur, à la mécanique répétitive des jours et des nuits, aux passages cloutés et<br />
aux rues sans issues, à la mélancolie.<br />
Dans un monde de « marchandises » où l’enfant est odieusement exploité, d’autant plus exploité<br />
qu’il est mythifié, célébré hypocritement, frauduleusement choyé, les « amours enfantines » sont,<br />
j’en ai l’intuition, porteuses de subversion. C’est pourquoi on les dénature, on les folklorise, on les<br />
amenuise, on les réduit à des enfantillages. Personnellement, je compte énormément sur les<br />
« amours enfantines » pour ébranler définitivement le vieux monde pourri qui demeure encore le<br />
seul que nous ayons à notre disposition, avec la seule arme pour lui échapper, celle du suicide<br />
volontaire, lucide. Que de grossières plaisanteries avons–nous pu entendre, Françoise et moi, à<br />
propos de nos amours. <strong>Les</strong> adultes qui ignorent tout de l’amour ne cesseront donc jamais de bafouer<br />
l’enfance qui est à la fois cruauté et lumière, lyrisme et violence. Un enfant tue un rat à coups de<br />
pierre. <strong>Les</strong> adultes s’étonnent de la cruauté de l’enfant, eux qui n’ont pas bronché au spectacle du<br />
génocide arménien commis par les Turcs, eux qui n’ont pas tremblé quand les crématoires nazis<br />
crachaient leur sinistre fumée à l’odeur humaine, eux qui n’ont pas bronché au terrifiant massacre<br />
d’Hiroshima, eux que n’empêchent pas de dormir, de nettoyer avec des soins infinis leur voiture, de<br />
s’effondrer sur les plages du sud, les terrifiantes dictatures, les régimes totalitaires et autoritaires, les<br />
démocraties musclées qui écrasent, depuis la nuit des temps, l’humanité souffrante et complice.<br />
<strong>Les</strong> années passant, insensiblement, les rapport établis entre Françoise et moi se modifièrent. Un<br />
autre type de lien s’établit, de par sa volonté, entre nous : quelque chose comme une amitié<br />
passionnée. Quand elle entra dans une école de comptabilité elle tomba amoureuse d’un de mes<br />
compagnons de classe, Félix, auquel je l’avais présentée. Je ne cesse pas, aujourd’hui encore, d’être<br />
étonné par le mystère des choix. Une jeune femme qui rêve au « prince charmant » va tomber<br />
follement amoureuse d’un garçon ordinaire. Un garçon, la tête pleine des photos des stars de cinéma<br />
va s’éprendre d’une gentille jeune demoiselle, ni laide ni belle, ni sotte, ni intelligente.<br />
Je fus désemparé. Mais mes relations avec Félix survécurent à mon désarroi. Je n’arrivais pas à<br />
vivre ce dernier comme un rival. Françoise avait parfaitement le droit d’en aimer un autre. Malgré<br />
tout, quelque chose était brisé en moi. Je ne pouvais plus me promener dans le grand jardin où nous<br />
avions partagé tant de secrets sans que les larmes me montassent aux yeux. J’étais triste. Je devenais<br />
renfermé. Même les farces d’André Kopf ne m’amusaient plus. Je m’écartais de mes compagnons<br />
habituels. Je plongeais dans une songerie cotonneuse. Je rêvais à de grands départs, à de grands<br />
exils, loin des trains, de la gare de triage, des usines, des rues tristes de ma ville.<br />
J’étais d’autant plus inquiet, angoissé, qu’à la maison la situation se détériorait. Mon père venait<br />
d’être licencié de la SNCF, après un procès infamant. Magasinier, il avait à charge la gestion du<br />
matériel d’entretien : balais, serpillières, brosses… Un soir, au lieu de les jeter comme il aurait dû le<br />
faire, il avait rapporté à la maison quelques toiles à laver le carrelage. Une voisine qui nous<br />
détestait, en dépit de ses beaux sourires, apprit incidemment la chose. Elle n’hésita pas et dans une<br />
lettre anonyme aux autorités des chemins de fer, elle dénonça proprement mon père. Il y eut<br />
enquête. Mon père fut accusé d’autres menus larcins dont il n’était aucunement responsable. Jugé, il<br />
fut mis à pied, jeté sur le pavé. Son humeur devint irascible. La violence resurgit en lui. Il se mit à<br />
boire et de fréquentes altercations l’opposaient à Mère 2. C’est ainsi qu’un matin je reçus en pleine<br />
figure, lancé à toute volée, son rasoir mécanique. Heureusement pour moi le rasoir m’atteignit sous<br />
l’œil. Le lendemain, la joue enflée, tuméfiée j’allais à l’école. L’instituteur me demanda ce qui<br />
m’était arrivé. Je lui répondis assez évasivement que j’avais glissé dans l’escalier de la cave. Je<br />
crois qu’il ne crut pas à ma version de l’accident. Grâce à un ami de bistrot, mon père trouva un<br />
emploi dans une entreprise de couverture–plomberie. Il apprit à monter sur les toits. C’était un<br />
homme doué de ses mains. En quelques mois il devint un excellent couvreur–plombier–zingueur.<br />
- 31 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Mais il ne cessait de changer d’entreprise car à la moindre remarque d’un contremaître, d’un patron,<br />
il n’hésitait pas à passer à la manière forte. Certains jours nos assiettes n’étaient pas très pleines à<br />
l’heure du dîner. Mère 2 l’injuriait, lui reprochait d’être un révolté, de ne pas être docile. Elle lui<br />
jetait à la figure l’exemple d’X ou d’Y qui étaient des ouvriers modèles, obéissants. Mon père, le<br />
rouge de la confusion, de la honte et de la rage confondues au front, se taisait. Il ne répondait pas. Il<br />
serrait les poings d’impuissance. Je devinais que cela bouillonnait derrière ses tempes, qu’il aurait<br />
voulu expliquer que la dignité du prolétaire existe malgré l’oppression. Mais il n’avait pas le<br />
pouvoir des mots. Il gardait pour lui sa rancune, sa haine, une rancune et une haine qui l’ont dressé,<br />
dans sa vieillesse, violemment, contre les jeunes gens de Mai 68, contre tous ceux qui tentaient de<br />
briser le vieil ordre. Mon père était devenu un sanglier blessé, solitaire. Il se battait seul, le dos au<br />
mur, ne comprenant pas ce monde. Il ressassait certainement des images du passé, du temps où il<br />
combattait pour la « cause ». Il souffrait de voir les compagnons d’autrefois lui tourner le dos, lui<br />
refuser la main. Il était devenu « une vipère lubrique ».<br />
Il était devenu deux fois esclave. C’est à cette époque–là que le feu de la révolte commença à<br />
brûler en moi. Je comprenais parfaitement bien que mon père était victime d’une série d’injustices,<br />
je pressentais déjà que le monde était « mal fait ». Moi aussi, je serrais les poings de fureur et<br />
d’impuissance. Je ne pouvais même pas communier avec lui. Il avait dressé entre nous une barrière<br />
infranchissable. Son orgueil et ses idées « bourgeoises » l’empêchaient de s’adresser à moi comme<br />
à un être humain digne de ses aveux, de sa confiance, de ses tourments. Je mourais de mille morts à<br />
quelques pas de lui. J’étais littéralement crucifié. C’est là, dans cette modeste cuisine, banale, que<br />
s’est développée ma haine increvable pour l’ordre établi, là que s’est forgée ma volonté de<br />
contribuer, du mieux possible, à la chute de cet ordre. Je n’étais qu’un révolté en herbe. Il me fallait<br />
apprendre à devenir un révolutionnaire. Mais devenu révolutionnaire, je n’ai jamais perdu contact<br />
avec le feu de la révolte. Je suis d’ailleurs totalement convaincu que si tous les prétendus<br />
révolutionnaires qui s’ingénient à sauver l’humanité douloureuse étaient d’authentiques révoltés, il<br />
y a belle lurette que le monde ancien serait mort et enterré. Mais tel n’est pas le cas car les zéros<br />
sont fatigués, très tôt.<br />
Françoise est morte. Je répète ces trois mots à l’instant même où je les dactylographie, presque<br />
trente ans après l’événement. Il est quatre heures de l’après–midi. La lumière implacable et sèche<br />
cogne les murs de la petite ville où je me suis réfugié pour écrire cette « autobiographie<br />
fantasmée ». Dans la grande pièce du deuxième étage du restaurant où je suis hébergé par des <strong>amis</strong><br />
affectueux, règne une ombre de fraîcheur. Du rez–de–chaussée me parvient la musique d’un disque.<br />
C’est Lou Reed qui chante, qui hurle, qui monte en croix. De temps à autre, je bois un demi verre de<br />
ce bon vin de Beaucaire que l’ami Jack Thieuloy m’a apporté l’autre nuitée. Des moustiques<br />
voltigent au plafond. J’ai la tête broyée par la fatigue, la nervosité, l’impatience. J’entends, venant<br />
de très loin, d’au–delà le Rhône et les remparts, la voix de Maïakovski qui supplie : Camarade la<br />
vie presse le pas. Je relis la lettre d’une femme qui dit m’aimer, qui m’aime à coup sûr, mais qui ne<br />
sait pas m’aimer. Je songe à toutes les femmes sur lesquelles, tendre, amoureux, avec une volonté<br />
de douceur et de dialogue, je me suis couché. Le temps s’abolit. Le verbe aimer danse dans mon<br />
crâne surchauffé. Le temps s’ouvre.<br />
Françoise est morte. Comme c’est étrange, on dirait que cela est arrivé hier. J’entends encore sa<br />
voix plaintive de malade, son cri d’oiseau effrayé par la vision des portes noires qui donnent sur le<br />
silence et l’énigme. Je vois très clairement son regard d’été robuste, fauché en pleine jeunesse, qui<br />
résiste, qui ne veut pas mourir, qui proteste, qui s’insurge, qui quémande. Je vois ses pâles mains<br />
aux longs doigts maigres. Je vois sa chevelure éteinte, éparpillée autour de sa tête sur l’oreiller de la<br />
chambre d’hôpital. Françoise est morte. Je n’ai jamais été une seule fois depuis sur sa tombe. C’est<br />
un effort impossible pour moi. Et puis, pourquoi faudrait–il aller se recueillir dans un petit cimetière<br />
de campagne, au–dessus d’une dalle moussue. Françoise n’est plus sous cette pierre tombale lavée<br />
- 32 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
par les pluies en novembre, griffée par les chants d’oiseaux en juillet. Poussière, elle s’est dissoute.<br />
Elle est devenue étendue sans limites. Françoise est enterrée dans chacune de mes veines, dans<br />
chacune de mes respirations. Elle voyage avec moi, elle dort avec moi depuis presque trente ans.<br />
Clandestinement. Incognito. Elle-même sans doute l’ignore. Là-bas, près de Soissons, une tombe<br />
porte son nom. La rivière roucoule doucement sous la feuillée. Une paix tranquille habite le petit<br />
cimetière. Je le sais puisque je n’y suis jamais retourné. Puisque Françoise est avec moi.<br />
Tout arriva brutalement. Un samedi ou un dimanche – nous approchions des fêtes de Pâques –<br />
Françoise eut un malaise. Une grande et mystérieuse lassitude s’abattit sur elle. Au départ, personne<br />
ne s’alarma. On appela malgré tout le médecin de famille qui ne diagnostiqua rien de grave,<br />
apparemment. Par acquit de conscience, il recommanda une analyse du sang. Comme ça, pour voir.<br />
Quand le médecin de famille eut entre les mains les résultats de cette analyse dont il n’attendait<br />
aucune mauvaise indication, il sursauta. L’analyse prouvait que la leucémie ravageait Françoise, que<br />
le mal avait atteint une dimension qui condamnait pratiquement la jeune fille à une mort rapide. Le<br />
médecin mit au courant les parents de Françoise avec tout le tact possible. <strong>Les</strong> perspectives étaient<br />
effrayantes car en ce temps-là la leucémie était une maladie mortelle dans la plupart des cas. J’étais<br />
là. Mon imagination fébrile, détraquée, me faisait voir un immense champ de bataille où<br />
s’affrontaient globules blancs et globules rouges. J’entendais le fracas d’empoignades furieuses.<br />
Des éclairs de feu illuminaient la scène. <strong>Les</strong> parents étaient effondrés. Mère 2 et mon père faisaient<br />
ce qu’ils pouvaient. Ils tentaient de réconforter l’un et l’autre. Mère 2 fît du café très fort. Ce soir–là<br />
on veilla très tard dans nos deux maisons. Il n’était pas question, bien sûr, de dire la vérité à<br />
Françoise. Nous organisâmes le mensonge, un mensonge d’amour. Nous lui racontions qu’elle était<br />
la proie d’une maladie pénible mais absolument pas dangereuse. Je ne saurais jamais si Françoise a<br />
partagé notre mensonge, si son énorme désire de vivre ne la poussait pas à nous faire confiance, à<br />
croire nos paroles, ou bien si, au contraire, sans être dupe un instant, elle ne fit pas semblant de nous<br />
croire afin de ne pas nous désespérer tout à fait. J’allais lui rendre visite presque chaque jour. Je lui<br />
apportais des nouvelles de Félix mais il semblait que la maladie ait éloigné Félix d’elle. Il semblait<br />
que je redevenais le Roi d’amour. Elle prenait mes mains sans rien dire. Elle les pressait très fort.<br />
Ses yeux étaient transparents. Ils semblaient n’avoir pas de fond. Je lui apportais des livres, des<br />
magazines, des échos de la vie et de la rue, des bouquets de fleurs. Je refoulais les larmes qui<br />
noyaient mes yeux. Je m’efforçais à sourire, à plaisanter même. J’évoquais sa prochaine sortie de<br />
l’hôpital. Ce serait encore l’été. Nous irions tous ensemble à la mer. Elle souriait, lointaine déjà.<br />
L’été pour Françoise se limita aux quatre murs de la chambre d’hôpital, aux visites de ses parents,<br />
de quelques <strong>amis</strong>, voisins. À mon irruption quotidienne.<br />
Au commencement de l’automne, je compris mystérieusement qu’il n’y en avait plus pour<br />
longtemps. <strong>Les</strong> transfusions de sang avaient échoué. <strong>Les</strong> salauds de globules blancs, en rangs serrés<br />
comme des armées de Moyen–Age, progressaient, élargissaient leur territoire. Françoise devenait de<br />
plus en plus diaphane. Elle était littéralement une chandelle qui s’éteignait à petit feu. Son<br />
pathétique visage devenait de plus en plus pâle. Ses yeux s’agrandissaient, dévorant le visage. Elle<br />
ne se plaignait pas. Elle jouait avec les fleurs qu’elle tournait entre ses doigts fragiles. Son regard<br />
s’attardait sur les choses, longuement. On aurait dit qu’elle faisait ses adieux à la lumière du ciel, au<br />
vase de fleurs, aux figures connues, aux objets usuels.<br />
Elle entra dans le coma quelques jours avant Noël. J’insistai pour la voir une dernière fois. Image<br />
terrible. Elle n’avait plus conscience. Je murmurai inutilement son nom. Oubliant ses parents,<br />
l’infirmière, le docteur présent je baisai longuement ses lèvres glacées déjà, et je sortis<br />
précipitamment, la poitrine broyée de sanglots.<br />
Le lendemain, Françoise mourut. On l’enterra quelques jours plus tard dans le cimetière familial<br />
près de Soissons. Je me rappelle encore la petite église avec le carreau cassé. Il pleuvait, je crois.<br />
Nous avions froid. <strong>Les</strong> parents de Françoise, son frère Christian étaient soutenus par mes parents.<br />
- 33 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
J’avais obtenu une faveur : qu’on dépose un poème que j’avais écrit pour Françoise dans son<br />
cercueil. Après l’office nous gagnâmes le petit cimetière tout proche. Le cercueil fut descendu dans<br />
le grand trou obscur. Nous jetâmes une fleur rouge. Puis les employés du cimetière commencèrent à<br />
jeter des pelletées de terre. Je ne pouvais détacher mon regard de l’humble cercueil qui disparaissait<br />
peu à peu. Enfin, il n’y eut plus que la terre, mouillée, muette. Tout était consommé. Nous nous<br />
attardâmes encore longuement puis mes parents entraînèrent doucement les parents de Françoise;<br />
Nous marchâmes en silence jusqu’à la demeure familiale. Mère 2 fit du café très fort, des tisanes, du<br />
thé. Chacun était dans son coin, effondré, impuissant.<br />
Là–bas Françoise commençait son long sommeil de « belle au bois » qui attend le Prince<br />
Charmant. Mais le Prince Charmant il n’existe plus depuis longtemps.<br />
Je n’irai jamais là–bas. Je ne revisiterai jamais plus le grand jardin. Il me suffit, Françoise, de<br />
fermer les yeux, de t’appeler. Ta voix me répond. C’est chaque jour le jour de nos épousailles. J’en<br />
parle dans presque tous mes livres. Avec des mots, je te déterre, je te désenfouis, j’arrache ton beau,<br />
ton pur visage à la pourriture. Je te pare, je te fais belle, je te fais femme, je te donne cette vie à<br />
laquelle, tout autant qu’une autre, tu avais droit. Je te donne la vie qu’on t’a volée. Je te fais des<br />
enfants. Je t’emmène en voyage. « Vois comme Lisbonne est belle à cinq heures du matin »,<br />
« Regarde ce cactus qui semble vouloir blesser le Christ en croix, le Christ en plaies », « Écoute la<br />
rumeur du petit peuple quand l’aube se lève sur les minarets d’Istanbul ».<br />
Je te fais femme. Je te fais Reine. C’est pour toi que je souffre. C’est pour toi que j’accepte de ne<br />
pas mourir, d’errer entre des bras de femmes aveugles, déboussolées. C’est pour toi que j’affronte la<br />
faim et la soif, la peur et la nostalgie, la mélancolie et la frayeur.<br />
Parce que aussi longtemps que mes mots te seront litière royale, que mes mots te réintégreront<br />
aux foules d’aujourd’hui, tu ne pourras pas mourir vraiment.<br />
Tu mourras quand moi aussi je mourrai. À l’instant ou je rendrai mon dernier souffle toi et moi<br />
entrerons ensemble dans le royaume de l’éternelle paix, de l’éternelle illumination.<br />
Réjouis–toi, Françoise. Cet instant viendra, inexorablement. Je m’y prépare depuis ta fausse<br />
fuite. Je suis prêt. Qui peut prétendre séparer deux astres, une lune et un soleil après leurs noces<br />
fertiles.<br />
Dans la nuit de ma solitude d’homme, effrayé par le passage du rat ou de l’éclair, Françoise, je te<br />
fais femme. Afin que toi aussi, belle, rayonnante, la peau parfumée – lavande et laurier – tu puisses<br />
enfouir ton visage incendié dans l’eau des fontaines d’Aix, tu puisses rouler au milieu du romarin,<br />
pour le rite d’amour.<br />
Depuis trente ans, je ne cesse de te cajoler, de te bercer, d’essuyer la poussière qui souille tes<br />
paumes. Je te porte dans mes bras jusqu’aux hautes montagnes sacrées, jusqu’aux plateaux<br />
désertiques où reposent la table des lois.<br />
Vois, le monde est beau, clair, harmonieux. <strong>Les</strong> aigles et les moutons dialoguent. Sais–tu que<br />
nous sommes devenus soleils ?<br />
- 34 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
L’ENVOL D’ICARE<br />
- 35 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
C’est un peu après la mort de Françoise que ma « vraie vie » commença. J’allais rencontrer des<br />
êtres qui devaient me révéler à moi–même, m’orienter sur des chemins nouveaux. Jusque là, je<br />
n’avais été qu’un jeune garçon qui, de cheminements en cheminements obscurs, était devenu<br />
rebelle. Mais j’étais inculte, ignare. Je vivais dans un monde où l’Art, au sens le plus noble du<br />
terme, n’avait pas de place, où les chromos remplaçaient les toiles de Van Gogh et où les romans de<br />
Delly repoussaient loin James Joyce. Je cherchais quelque chose mais je ne savais pas encore quoi.<br />
Je titubais le long des rues, de rage et de fureur. J’aimais des filles qui ne partageaient pas ma<br />
révolte instinctive. Je détestais les lourdauds qui étaient mes compagnons de classe. J’étais blessé,<br />
solitaire. Mon père et Mère 2 ne me comprenaient pas. Comment auraient–ils pu d’ailleurs me<br />
comprendre ? Je pressentais confusément un monde différent. La télévision – qui vivait alors sa<br />
préhistoire – me révélait des mondes nouveaux, des modes d’existence différents. J’étouffais entre<br />
la gare, les cinémas de quartier, l’école. Je prenais des coups. Mon père n’était pas avare de ce côté–<br />
là. Mais en même temps je jouissais d’une sorte de liberté totale. Je pouvais faire pratiquement tout<br />
ce que je voulais. La seule condition était de ne pas réveiller mon père. De plus en plus souvent, je<br />
rentrais tardivement. Je traînais, j’errais. J’étais en chasse comme un chien fou, un « crazy dog ». Je<br />
ne dormais que d’un œil. Je me posais des tas de questions. Est–ce que Dieu existe ? Pourquoi y a–<br />
t–il des riches et des pauvres ? des gens qui dépensent des sommes folles sans jamais travailler et<br />
des gens qui tirent leur vie entière le diable par la queue en s’esquintant au labeur ? D’où viennent<br />
les étoiles ? La mort c’est quoi ? Et l’existence humaine ? Mais, jusqu’alors je n’avais trouvé<br />
personne pour me guider dans ma quête, pour m’aider de ses conseils, sinon un vieux bibliothécaire<br />
municipal qui écrivait des recueils d’alexandrins dans lesquels il célébrait « l’immortelle beauté ».<br />
Amoureux de « Lys » j’avais la certitude de ne pas trahir Françoise. J’obéissais à un<br />
commandement obscur qui me jetait en direction des vivants. Lys était vivante. Jeune fille « libre »<br />
elle pouvait m’entraîner dans la maison de ses parents absents. Je commençais à comprendre que<br />
l’amour pouvait aller au–delà de ces attouchements attendrissants que j’avais pratiqués avec<br />
Françoise. Lys fumait. Elle ne craignait pas de se promener nue devant moi. J’ignorais tout du sexe.<br />
Une seule fois, j’en avais eu une vision, horrible, quand en Auvergne un vieux berger avait tenté de<br />
me violer. Je n’avais dû le salut qu’à la rapidité de ma course. Il avait réussi à arracher ma petite<br />
culotte. Il voulait me sodomiser, le vieux crapaud. Son visage de pomme de terre rétrécie me faisait<br />
horreur. Je me débattais comme un beau diable tandis que sa main rugueuse tentait en pure perte<br />
d’attraper mon sexe. Je réussis à échapper à son étreinte furieuse. Je courus jusqu’au village, à<br />
demi–nu.<br />
Lys, elle, expérimentait sa propre sensualité, sexualité. Elle me fit don de son corps. Elle<br />
s’empara du mien qu’elle explora, embrassa, lécha en poussant des grognements, des gémissements<br />
d’animal. Instinctivement, je trouvais le chemin de son sexe. Mais ma main ne m’apporta pas le<br />
plaisir rêvé. Alors, comme dans les méchants romans que j’avais lu en cachette, je me glissai le long<br />
du ventre jusqu’à ce que ma bouche se trouvât à la hauteur du sexe. Ma langue fiévreuse s’enfonça<br />
dans la caverne obscure et rosé. Lys se tortillait. Ses ongles s’enfonçaient dans la peau de mon dos.<br />
À la fois elle s’offrait et se refusait. J’avais perdu conscience. J’étais tout entier dans ma langue qui,<br />
- 36 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
furieusement, mais tendrement aussi, fouillait, excitait. Mes mains se refermaient sur ses seins<br />
d’adolescente. J’étais nerveux, maladroit. Je décodais ce corps qui n’était déjà plus celui d’une<br />
fillette.<br />
Ce fut terrible, beau et inoubliable.<br />
Lys me quitta quelque temps plus tard pour un autre<br />
amant.<br />
Je savais qu’un monde m’attendait, dur, cruel, violent,<br />
Le temps des métamorphoses approchait.<br />
J’avais quelques poils aux joues.<br />
J’éprouvais une violente rage contre les limites.<br />
J’aurai voulu exploser.<br />
Quitter ma peau.<br />
Prendre place parmi les étoiles.<br />
Mourir d’amour.<br />
C’est alors que tout se déclencha, comme avec une logique irréprochable. J’étais un écolier sans<br />
grands moyens financiers. Je m’étais donc résolu à voler les classiques imposés par le professeur<br />
dans une librairie proche de notre école. Ayant mauvaise conscience, je replaçais subtilement les<br />
ouvrages là où je les avais volés, une fois usage fait. Durant plusieurs mois, je pus agir sans être<br />
inquiété. Lamartine succédait à Victor Hugo qui précédait Alfred de Musset. Il était logique qu’un<br />
jour la brave dame à cheveux blancs me prit la main dans le sac. Le jour fatidique arriva. Je<br />
m’attendais à des réprimandes sévères, à pire encore, une dénonciation à mes parents. Je ne doutais<br />
pas d’être remis entre les mains des policiers. Rien de tout cela n’arriva. Bien au contraire. La dame<br />
me parla d’une voix douce : « Vous aimez la poésie, jeune homme ? ». D’une voix éperdue, je<br />
répondis que oui j’aimais la poésie. « C’est très bien » commenta–t–elle. Puis elle ajouta : « Mon<br />
fils aussi est poète. Voulez–vous le connaître ? ». Je fis un signe affirmatif de la tête. Elle se tourna<br />
en direction de la pièce située derrière la librairie. « Serge » appela–t–elle. Quelques secondes plus<br />
tard je vis apparaître un grand gaillard barbu. Il avait des yeux pleins de tendresse et de malice. Il<br />
me tendit énergiquement la main et se présenta : Serge Wellens. Sa mère nous laissa en tête–à–tête.<br />
Il m’interrogea afin de savoir qui j’étais. Il avait huit ou neuf ans de plus que moi. C’était une<br />
« grande personne ». J’étais plutôt intimidé. Il me demanda quels étaient mes poètes préférés. Je lui<br />
nommais Lamartine, Victor Hugo, Alfred de Musset. Il eut un sourire amusé. Avant de me quitter ce<br />
jour–là il m’invita à venir chez lui, le dimanche suivant, en début d’après midi. Il avait un petit<br />
appartement sur un boulevard peu éloigné de la librairie. Il y aurait des <strong>amis</strong>, des filles. Il me<br />
communiqua l’adresse qu’il copia sur un bout de papier. Ému, je l’enfouis soigneusement dans ma<br />
poche. Je promis de venir. Il ajouta enfin : « venez, je serai content, je vous prêterai des livres ».<br />
Je repartis bouleversé. Je devinais que j’approchais un nouveau monde. J’avais l’intuition aiguë<br />
que quelque chose de décisif allait se produire dans ma vie, que mon destin allait être changé. Un<br />
royaume neuf devait s’ouvrir à ma faim, à mon impatience, à mon désir.<br />
Nous étions un mercredi ou un jeudi. Je ne songeais plus qu’au rendez–vous du dimanche. Je<br />
brûlais d’impatience. Je ne dis rien à mes parents. Il n’y avait pas de problèmes. J’étais, grosso<br />
modo, libre d’aller et venir à ma guise. Enfin le dimanche fut là. Je me peignais avec soin.<br />
J’essayais d’être élégant, J’étais un peu intimidé à l'idée de tomber au milieu d’un groupe de jeunes<br />
gens d’une vingtaine d’années – je portais encore des culottes courtes. Un quart d’heure de marche,<br />
sans me presser, – suffit à me porter jusqu’à la hauteur de l’immeuble dont j’avais dix fois vérifié le<br />
numéro sur le petit bout de papier. Je grimpai un étage. Une musique de jazz parvint à mes oreilles.<br />
Des voix d’hommes et de femmes, joyeuses, m’indiquèrent, avant même que je lise le nom inscrit<br />
sur la porte, le lieu où j’étais attendu. Je repris mon souffle. J’hésitais à cogner contre la porte. Une<br />
- 37 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
seconde, l’idée de fuir envahit mon esprit mais la curiosité l’emporta. Je cognai. J’entendis des pas<br />
et la porte s’ouvrit. Une belle grande jeune fille se tenait devant moi, un verre à la main, le regard<br />
amusé. Je bafouillais : « Monsieur Wellens s’il vous plaît ? ». Elle se retourna et appela « Serge,<br />
c’est pour toi ». Quand elle se retourna j’eus le temps d’apercevoir un couple, allongé sur le lit, qui<br />
s’embrassait voluptueusement. Mon cœur se mit à battre. Je distinguais encore, accrochés aux murs<br />
des tableaux étranges, une armoire vitrée pleine de livres. D’autres gens, dans une seconde pièce.<br />
Serge arriva. Il me tendit la main, toujours aussi chaleureusement, et il m’entraîna vers les autres. Il<br />
y avait des filles et des garçons, une dizaine environ dans un espace relativement étroit. Le couple<br />
ne s’était pas arrêté. Personne ne semblait faire attention à leurs ébats amoureux. « Je vous présente<br />
une graine de poète : une vraie graine de poète puisque monsieur n’hésitait pas à voler dans la<br />
librairie des livres qu’il rapportait ensuite » dit Serge, la figure fendue par un large sourire, à<br />
l’adresse des autres qui me fixaient amicalement. Des cris d’admiration s’élevèrent. Serge me tendit<br />
un verre rempli de vin. Je fis comme si j’étais accoutumé à la boisson. J’avalai mon verre d’un trait.<br />
Serge me présenta les autres : Jacques, Georges, Sophie, les frères Buclet, Maurice, Marguerite que<br />
Serge allait prochainement épouser. Mes yeux couraient des visages aux tableaux sur les murs, des<br />
tableaux aux objets posés sur les meubles.<br />
Ce dimanche-là je vécus des heures inoubliables. Je venais de rencontrer ceux qui allaient<br />
devenir pour longtemps mes <strong>amis</strong> les plus proches. Plusieurs d’entre eux demeurent toujours<br />
aujourd’hui mes <strong>amis</strong>. Et rien ne dit que pour les autres, il n’en irait pas de même si les hasards de<br />
l’existence qui nous ont séparés, nous rassemblaient à nouveau. Serge est toujours vivant. Il a<br />
publié, sans se presser, cinq ou six recueils de poèmes, dépouillés, rigoureux, qui sont comme des<br />
fruits arrachés au silence, baignés d’une lumière rugueuse qui n’est pas sans rappeler la lumière de<br />
Guillevic et la clarté pierreuse de René Char. Georges continue de lutter pour réaliser les films dont<br />
il rêve avec sa femme Nicole. Jacques, passionné de musique, est devenu un photographe, un grand<br />
photographe, un maître de la microphotographie. Ses tiroirs sont pleins de dizaines de milliers de<br />
négatifs et diapositives consacrés aux abeilles, aux grenouilles, aux minuscules bestioles dont il<br />
enregistre la naissance, les amours, les rituels érotiques, les métamorphoses. Je n’ai pas revu les<br />
frères Buclet. À l’époque, ils étaient « petits chanteurs à la croix de bois ». Ils voyageaient<br />
beaucoup, ce qui leur permettait d’éblouir les filles avec des récits de voyages plus ou moins<br />
inventés, plus ou moins réels. C’étaient des garçons gais, fraternels, experts en farces et<br />
plaisanteries en tout genre. Roland est devenu réalisateur de télévision. C’est lui qui filma<br />
l’émission de Denise Glaser « Discorama ». Esprit curieux, multiforme, il se consacre à la<br />
composition musicale. Sophie chante. Elle porte le nom sur scène du célèbre anarchiste ukrainien<br />
Makhno. Liliane est devenue traductrice. Elle a traduit plusieurs livres de l’écrivain grec Nikos<br />
Kazantzakis et en collaboration avec son compagnon, Nikos Athanassiou, poète devenu patron d’un<br />
petit « empire » dans la restauration grecque à Paris, elle a fait paraître une « petite planète »<br />
consacrée à Chypre.<br />
La plupart des membres du groupe ont persévéré, ont créé, ont trouvé leur chemin. À travers<br />
mille détours, mille échecs, mille défaites. C’est sans doute grâce à eux que je suis devenu ce que je<br />
devais devenir. En perdant moins de temps. En brûlant les étapes. Quand je quittais Serge et mes<br />
nouveaux « <strong>amis</strong> » j’emportais sous mon bras une poignée de livres : Arthur Rimbaud, Michel<br />
Leiris, Georges Bataille, Saint-John Perse. Mon initiation commençait. À mesure que je dévorais<br />
ces livres, je découvrais que je tenais enfin ce qu’obscurément je cherchais. Adieu Lamartine et<br />
Albert Samain, Adieu Musset. Des abîmes de frayeur, mais aussi de lumière foudroyante<br />
s’ouvraient devant mes pas. Le cri du rebelle de Charleville faisait saigner ma poitrine et mon âme.<br />
Zarathoustra déchirait mes muscles. La lucidité impitoyable de Leiris et de Cioran me terrassait.<br />
Je lisais comme un dément. Chaque semaine, Serge me prêtait de nouveaux livres. Je découvris<br />
Freud et Michaux, Jean Follain et Pierre-Jean Jouve, Paul Klee et Joan Miró.<br />
- 38 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Je m’éloignais de mes parents, de mon milieu, de ma famille. Je me rapprochais de moi. Je<br />
commençais à me vivre. Je commençais à nommer mes désirs, mes jougs, mes révoltes.<br />
La poésie m’avait accroché. Je savais qu’elle ne me lâcherait plus. La Poésie c’est-à-dire la vie,<br />
le risque, l’aventure. Blaise Cendrars m’emportait à bord du Transsibérien. Saint-John-Perse me<br />
livrait des continents fabuleux. Aimé Césaire ouvrait devant moi un chemin à travers une jungle<br />
incrustée de cris d’oiseaux, de bambous acérés comme des lances de guerriers fangs, de visages de<br />
reines.<br />
Je ne voyais plus la médiocrité de ma ville. Je traversai les murs, les apparences. J’étais libre,<br />
libre « sur parole ». J’avais hâte de me jeter dans la mêlée du monde, de découvrir océans et cités,<br />
déserts et forêts tropicales.<br />
Je marchais sur une route sans retour. Dans une clarté de naissance. Escorté de tambours.<br />
J’entrais dans des villes neuves. Des villes que je traversais avec la majesté d’un Roi, d’un rebelle.<br />
Par pans entiers le « vieux monde » s’écroulait dans ma poitrine sèche.<br />
Le groupe animait le ciné-club et un club de musique. <strong>Les</strong> séances du club de musique avaient<br />
lieu chez Jacques. On se réunissait dans la grande salle à manger où l’on écoutait les nouveaux<br />
enregistrements : jazz, musique classique et moderne. La mère de Jacques, une étonnante petite<br />
femme pleine de vitalité, nous servait des rafraîchissements. Elle trouvait tout à fait sympathique<br />
qu’à minuit, assez fréquemment, nous éprouvions le désir de manger des frites. Elle se mettait<br />
gaiement à l’ouvrage, avec notre aide plus ou moins maladroite. C’est au ciné-club où Serge<br />
exerçait ses talents d’animateur volubile que je vis pour la première fois le Cuirassé Potemkine. Je<br />
fus proprement bouleversé. Le vent de la révolte sembla frapper les murs de la petite salle obscure.<br />
Le spectacle de ces marins fiers, épris de leur dignité au point de se dresser contre des officiers<br />
cyniques et cruels, m’enthousiasma. Un autre grand moment de mon apprentissage de cinéphile fut<br />
les projections de Zéro de conduite et L’Atalante de Jean Vigo. La révolte absolue du premier, la<br />
poésie profonde du second laissèrent en moi des traces indélébiles. C’est tellement vrai que bien<br />
plus tard, ayant écrit un scénario de film en songeant à Michel Simon avec qui j’étais lié depuis<br />
plusieurs années, je le lui communiquai. Il en aima le sujet : un « mai 68 » vécu par une poignée de<br />
femmes et d’hommes du 3 e âge. L’essentiel de mon histoire se passait dans un café de la Place des<br />
fêtes et dans des lieux des alentours. Je contais l’histoire d’une bande de sympathiques vieux et<br />
vieilles, que les événements de Mai faisaient rêver. Plusieurs d’entre eux vivaient chez un fils, une<br />
fille mariée, d’autres, après le café, rentraient dans leur maison vide. Pourquoi ne pas vivre<br />
ensemble, pourquoi ne pas fonder à l’instar des jeunes gens une communauté ? C’est alors que<br />
Michel Simon apprenait étonné qu’il venait d’hériter d’une femme grecque morte très riche. Cette<br />
femme, il l’avait connue et aimée, une quarantaine d’années auparavant, quand il était officier dans<br />
la marine militaire. Avec une partie de cet argent, le groupe devenait propriétaire d’une usine<br />
désaffectée qu’ils aménageaient alors pour y vivre. Malheureusement cette usine se trouvait sur un<br />
terrain lorgné par des promoteurs avides. Le groupe accueillait un musicien drogué, un algérien<br />
travailleur émigré licencié de son emploi. La guerre éclatait entre les promoteurs forts de leurs<br />
prétendus droits et le groupe. Un jour, la police tentait de les déloger. Il devait se produire une<br />
grande bagarre où les vieux pour pallier leur faiblesse physique, recouraient à toutes sortes de<br />
procédés comiques afin de faire face aux forces de l'ordre. Vaincus, en fin de compte, le groupe,<br />
désolé, devait abandonner l’usine. On les voyait alors en procession sur la route, poussant des<br />
landaus, tirant des charrettes chargées de leurs maigres trésors, de tout un fouillis d’objets précieux<br />
et dérisoires. Sur un panneau, une flèche indiquait : « Larzac ». Ils se concertaient du regard et<br />
décidaient de ne pas renoncer. Par passion pour L’Atalante, par tendresse pour Michel Simon,<br />
j’avais prévu d’inclure dans le film que j’avais mentalement réalisé, plan après plan, une « citation »<br />
du film de Vigo : celle de la séquence où pour distraire la jeune épouse de son « patron » Michel<br />
Simon animait les tatouages de sa poitrine. Il fut très touché par mon intention. J’étais heureux car<br />
- 39 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
nous avions trouvé une productrice.<br />
À l’exception de films pédagogiques en Afrique, et de deux ou trois courts-métrages de fiction,<br />
je n’avais encore jamais eu un de mes scénarios filmé. Le contrat devait être signé quelques jours<br />
plus tard. Un début d’après–midi j’achetais Le Monde à un kiosque à journaux des grands<br />
boulevards. Tout en continuant à marcher, je parcourais des yeux la première page. Il ne me fallut<br />
pas cinq secondes pour que mon regard accrochât un titre. Un titre laconique, brutal : «Michel<br />
Simon est mort ». J’eus comme un vertige. La vie vacilla dans ma tête. Je restais cloué de stupeur.<br />
Je ne voyais plus les passants. Des larmes roulèrent subitement sur mes joues. Je ne songeais même<br />
pas à les camoufler. Certes, notre amitié était assez récente et du fait de nos âges respectifs elle<br />
n’avait jamais franchi certaines limites. Mais elle était vraie, profonde, invincible. Le projet fut<br />
enterré et il n’y eut jamais à l’affiche un film nommé Le drapeau noir n ’a pas de cheveux blancs<br />
avec en tête de la distribution le grand, l’irremplaçable Michel. J’avais aussi prévu de réunir tous les<br />
survivants de l’entre-deux-guerres, de Charles Vanel à Raymond Bussières, tous ces merveilleux<br />
comédiens sans lesquels un certain grand cinéma français n’aurait pas été ce qu’il a été. Il m’arrive<br />
encore aujourd’hui de projeter pour moi seul Le drapeau noir. Il suffit pour cela de m’asseoir au<br />
fond d’un grand fauteuil, après avoir fait l’obscurité, puis de fermer les yeux. J’entends alors le<br />
ronronnement de l’appareil de projection. Et c’est beau, émouvant.<br />
Où en étais-je en ces moments décisifs de mon existence, où tout m’arrivait en même temps au<br />
point qu’il m’est difficile aujourd’hui de mettre de l’ordre dans ces années revisitées. J’étais<br />
d’abord et avant tout révolté. Une révolte contre l’ordre social. En cette matière j’étais encore<br />
inculte. Mais j’étais convaincu que ce n’était pas un hasard s’il existait des gens ayant les moyens<br />
de s’offrir tous les luxes, et des gens qui n’arrivaient jamais à « joindre les deux bouts », qui<br />
crevaient lentement mais sûrement dans des besognes exténuantes ou fastidieuses. <strong>Les</strong> journaux, les<br />
revues, la télévision montraient des visages de gosses ravagés par la maladie, la malnutrition, en<br />
Inde, en Asie, en Afrique, en Amérique Latine. Des chiffres sombres heurtaient mon esprit. Des<br />
images déchiraient mon quotidien. J’apprenais chaque jour que des peuples entiers étaient sans<br />
cesse broyés par des ordres iniques, impitoyables, cruels, que des tyrans massacraient des<br />
populations entières pour assouvir leur sadisme, leur paranoïa. Tout aurait dû logiquement me porter<br />
vers les rangs du Parti Communiste. Mais j’étais méfiant. Il m’arrivait de côtoyer des communistes,<br />
militants acharnés, sympathiques, fraternels. Je ne parvenais pourtant pas à adhérer à leur vision du<br />
monde. Je ne m’exaltais pas comme eux à l’évocation des « succès » de la « patrie des prolétaires »,<br />
l’Union soviétique. Je ne croyais pas, bien entendu, tout ce qu’écrivait la « presse bourgeoise »,<br />
mais je soupçonnais que dans les accusations portées par cette presse contre l’URSS, tout n’était pas<br />
faux. De plus, sans en saisir tous les tenants et aboutissants, j’avais douloureusement vécu les<br />
mésaventures de mon père.<br />
Je me sentais « différent ». Je rêvais d’une révolution qui, non seulement, abolirait l’oppression<br />
de tous ceux qui travaillent, et produisent, mais porterait au pouvoir l’imagination, l’amour, la<br />
poésie. J’anticipais Mai 68. À ma façon j’étais en avance. J’étais intimement persuadé que le<br />
Travail n’était pas une fin en soi, que sa glorification était néfaste. Je devinais que les prolétaires ne<br />
cessaient d’être abusés par des leaders politiques et syndicaux dont les propos ne différaient guère<br />
de ceux des hommes politiques de la « bourgeoisie ». Leurs valeurs n’étaient pas les miennes. Mes<br />
héros à moi s’appelaient Rimbaud et Nietzsche. La figure du « voleur de feu » m’obsédait. J’avais<br />
lu la Saison en enfer, les Illuminations comme un moine lit son bréviaire. Ses paroles de lave<br />
m’avaient ravagé de haut en bas. Moi aussi, je souhaitais « changer la vie », aider à la création d’un<br />
monde qui serait fondé sur la vision poétique, sur la frénésie poétique. Avec Zarathoustra, je criais<br />
mon désir d’un « homme nouveau », à jamais débarrassé de la petitesse de pensée, de la vulgarité,<br />
de la sottise. J’avais perdu la foi en dieu. Mais l’avais-je jamais eue ? J’aurais voulu que Dieu<br />
existât mais quelque chose en moi de violent s’opposait à ce souhait. J’aurais voulu que Dieu existât<br />
- 40 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
pour le provoquer en duel, pour le punir d’avoir fait un tel monde. J’étais exalté, mystique. Je lisais<br />
Saint François d’Assise, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d’Avila. Bientôt j’allais découvrir<br />
dans les Cahiers du sud les poètes Soufis arabes.<br />
J’étais plein d’un pathos incroyable. Je ne cessais de m’étonner de voir les esclaves subir leur<br />
esclavage en cherchant des dérivatifs ailleurs. Pourquoi ne se révoltaient–ils donc pas. Pourquoi ne<br />
se levaient pas, parmi eux, des milliers et des milliers de Spartacus brandissant le glaive contre<br />
l’ordre maudit ?<br />
Plus tard, un homme, un philosophe qui devint, durant quelques saisons au gré des malentendus,<br />
l’idole de la jeunesse, devait poser la même question : qu’y-a-t-il dans la constitution<br />
anthropologique de l’Homme qui fait que celui-ci prenne toujours le parti de Thanatos – l’instinct<br />
de mort-contre Éros l’instinct de vie ? Qu’est-ce qui conduit l’Homme à préférer la mutilation,<br />
l’aliénation, la soumission plutôt que la quête de la satisfaction de ses désirs vrais ? Cet homme<br />
s’appelait Herbert Marcuse. Je devais le rencontrer, l’estimer énormément, l’aimer comme un fils.<br />
Durant cette période, j’étais, souvent, envahi par une sorte de délire. Tout basculait devant mes<br />
yeux. La réalité même devenait hypothétique. Je me demandais si vraiment nous n’étions pas autre<br />
chose qu’un rêve en train de rêver. Je touchais les choses dix fois pour me prouver qu’elles étaient<br />
bien là, à leur place, que le contact n’était pas imaginaire. Je contemplais le ciel piqué d’étoiles,<br />
cette vaste étendue, et m’interrogeais sur la possible existence d’autres univers.<br />
Je craignais la mort. Je la vivais physiquement. Ayant vite souffert de diverses difficultés<br />
corporelles, en premier lieu une obstruction nasale qui me rendait la respiration difficile, il<br />
m’arrivait, après une course un peu trop longue, d’étouffer littéralement. Je me voyais mourir, la<br />
langue sèche et brûlante, les yeux exorbités.<br />
J’ai connu la mort très tôt. Il y eut d’abord celle de Françoise que j’ai déjà évoquée. Un peu plus<br />
tard ma tante mourut d’un cancer foudroyant. Elle était devenue presque obèse. On décida une<br />
opération qui devait n’avoir aucune conséquence grave. C’est un médecin vieil ami de ma tante et<br />
de mon oncle qui devait opérer. Le jour de l’opération, j’accompagnais mon oncle et mon père<br />
jusqu’à la clinique. Nous rencontrâmes le chirurgien qui donna une grande tape dans le dos de mon<br />
oncle. Il nous conseilla d’aller faire une promenade. Il en aurait approximativement pour une heure.<br />
Nous fîmes une station dans un bistrot, nous errâmes dans quelques rues. Le temps de passer une<br />
demi–heure, guère plus. Mon oncle, impatient, proposa qu’on revienne à la clinique. Dès notre<br />
arrivée, nous apprîmes que l’opération était achevée et que le docteur souhaitait voir d’urgence mon<br />
oncle et mon père. On me laissa dans la pièce attenante au bureau du chirurgien. Un assez long<br />
temps passa. Quand la porte s’ouvrit, je vis mon père et mon oncle les yeux rougis par les larmes.<br />
Le médecin ne disait rien. Il avait la tête basse. Qu’était-il donc arrivé ? Il était arrivé que le<br />
médecin, dès le début de son intervention, avait découvert le cancer généralisé de ma tante. Il se<br />
retrouva impuissant. Il ne tenta pas d’aller plus loin. C’était inutile. Il referma la plaie. Ma tante<br />
entra dans le coma quelques heures plus tard. Elle mourut moins de deux jours après.<br />
Puis ce fut au tour de ma Grand-mère, elle aussi frappée par le cancer. Elle ne pouvait pas rester<br />
seule chez elle. Nous la transportâmes dans notre maison. Comme celle–ci était d’une surface<br />
réduite, grand-mère fut installée dans la cuisine. La nuit, Mère 2, mon père et moi prenions, l’un<br />
après l’autre, un tour de garde. Grand-mère mourut dans mes bras. Je m’étais assoupi. Elle semblait<br />
reposer calmement. Soudain, un gémissement répété m’arracha à ma léthargie. J’allumai la lampe<br />
de chevet. Grand-mère fixait sur moi des yeux vitrifiés élargis. Ses lèvres bougeaient. Elle voulait<br />
me dire quelque chose mais nul mot ne franchit la barrière de ses lèvres. Je voulus m’éloigner pour<br />
aller réveiller mes parents. Mais ses doigts maigres se refermèrent sur mon avant-bras. Je me<br />
penchai sur elle, essuyai son visage. Soudain, elle se redressa violemment, rejetant loin les draps. Sa<br />
robe de nuit était remontée jusqu’au ventre. En un éclair, j’aperçus son sexe de vieille femme<br />
décharnée, une touffe de poils gris. Un gémissement plus fort que les autres s’échappa de sa<br />
- 41 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
poitrine. Ses bras battirent l’air. Ses yeux s’agrandirent encore jusqu’à dévorer le visage entier. Puis<br />
elle retomba, inerte. Elle était morte. Au même moment, mes parents surgirent de leur chambre.<br />
C’était fini.<br />
Longtemps, je contemplai Grand-mère morte. Je n’arrivais pas à détourner mon regard de son<br />
cadavre. Cette femme qui m’avait fait sauter, bébé, sur ses genoux, n’était plus que silence et<br />
distance. Mère 2 effondrée sur une chaise, pleurait. Mon père prépara des cafés chauds. Cette nuit-là<br />
la lampe resta allumée jusqu’au matin.<br />
J’avais écrit une poignée de poèmes. Entre-temps notre groupe s’était lancé dans l’édition avec<br />
l’aide d’un peintre sérigraphe, Guy R. Nous imprimions nous-mêmes de petites plaquettes à<br />
l’enseigne de l’Orphéon. Des poètes « réputés » Jean Rousselot, Paul Chaulot, Marcel Béalu, Jean<br />
l’Anselme donnèrent des textes. Personnellement, j’avais déjà publié une modeste plaquette aux<br />
Éditions « Terre de feu » : Couleur végétale, éditions fondées par le poète Marc A. avec qui je<br />
devais partager une longue saison d’amitié, absolue, exigeante. Je commençai à m’éloigner de la<br />
maison familiale. À la suite d’un échec au concours d’entrée à l’École Normale, concours qu’avait<br />
suggéré un de mes professeurs, j’avais dû interrompre mes études. Grâce à une relation de mon<br />
oncle, j’entrais comme employé au Crédit Lyonnais. Je fus nommé guichetier à l’agence R. proche<br />
du Printemps et des Galeries Lafayette. C’était une agence qui recevait, chaque soir, d’énormes<br />
fonds en provenance de ces deux grands magasins. Elle était dotée d’un système sophistiqué de<br />
protection. Le responsable du siège central qui m’avait accueilli, me pria d’aller me présenter au<br />
directeur de l’agence R. Il n’y avait guère que cinq ou six cents mètres entre le siège social et<br />
l’agence. Je les parcourus à pied. J’arrivais quelques minutes avant la fermeture de l’agence. Le<br />
directeur, un gros homme ventripotent, me reçut avec courtoisie. Il parcourut mon dossier,<br />
m’expliqua quelles allaient être mes tâches dans l’agence. Au terme de notre entretien, comme je<br />
m’apprêtais à me retirer, il me retint : « Restez avec nous, s’il vous plaît, ce soir il y a une petite<br />
fête, comme chaque année, pour les employés ». Je n’osais pas refuser. <strong>Les</strong> employés se<br />
dépêchèrent de finir leurs travaux. Puis ils dressèrent une grande table chargée de jus de fruits, de<br />
boissons diverses, de gâteaux. Un pick-up avait été branché. Le directeur me présenta aux<br />
employés. La petite fête commença, banale. Je m’ennuyais fermement. Pour vaincre mon ennui, je<br />
commençais à vider subrepticement verre sur verre de vin. En moins d’un quart d’heure, j’avais la<br />
tête bourdonnante. Par ailleurs, je raflais méthodiquement les paquets de cigarettes disposés ici et<br />
là. Bientôt, j’eus des nausées épouvantables. Localisant une chaise, je me dis que le mieux était de<br />
me glisser jusqu’à elle, sans me faire remarquer et d’attendre des minutes meilleures. Je respirai un<br />
grand coup et m’élançai. Mal m’en prit. Mes pieds accrochèrent une moquette. Je trébuchai, battis<br />
l’air de mes bras, et m’écroulai sur le plancher. Sous l’effet du choc, je me mis à vomir. J’avais les<br />
boyaux en feu. Une terrifiante migraine écrasait mes tempes. Des employées me soignèrent. J’étais<br />
à demi inconscient. J’éprouvais une honte sans nom. Je m’excusais en bafouillant. Le directeur,<br />
magnanime, appela un taxi qui me ramena en banlieue. Quand mes parents me virent dans cet état,<br />
ils ne purent s’empêcher d’éclater de rire. J’évitais ainsi la violence de mon père. Je me jurais<br />
d’aller le lendemain au travail. Ce fut épouvantable. Une employée m’expliquait les secrets du<br />
métier. Moi, j’avais l’œil rivé si l’on peut dire sur les convulsions de mon foie. À chaque grosse<br />
nausée, le mouchoir écrasé sur la bouche, je filai, livide, en direction des cabinets. Je repris souffle à<br />
mesure que la journée déclinait. En quelques semaines, on fit de moi un employé de banque<br />
exemplaire. Mais il était dit que je ne finirais pas mon existence dans une banque. Très vite, je<br />
rejoignis les rangs du syndicat CGT, ce qui me valut une mauvaise note. J’étais particulièrement<br />
actif, dévoué. Je fus rapidement élu représentant du personnel. La direction, elle, m’avait dans le<br />
collimateur. Un autre événement allait attirer l’attention sur moi. C’était un après-midi d’été. La<br />
chaleur était accablante. Derrière nos guichets nous nous ennuyions ferme. C’est alors que pénétra<br />
- 42 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
dans l’agence un Écossais en costume traditionnel. Il était gros, gras, avec des poils pleins les<br />
jambes. Ce n’était pourtant pas un monstre. Malgré tout le fou rire me prit. <strong>Les</strong> copines de travail<br />
échangeaient des gestes codés. L’Écossais s’était assis à la grande table installée au milieu de<br />
l’agence. Il remplissait un chèque. Il se leva, se dirigea vers moi. Je tendais déjà la main pour<br />
prendre le chèque lorsque brutalement je le vis blêmir, tituber, reculer vers le banc de bois.<br />
Instinctivement, je contournai le comptoir et me portai à son secours à l’instant même où il<br />
s’effondrait sous la table. Des clientes poussèrent des cris d’effroi. L’inconnu était frappé par une<br />
crise cardiaque. Déjà, le directeur avait surgi de son bureau « <strong>Laude</strong>, s’il vous plaît appelez<br />
d’urgence Police-secours ». Je bondis vers le fond de l’agence. Était–ce l’émotion, toujours est–il<br />
que je me trompais sans m’en rendre compte de bouton. J’appuyai sur le bouton réservé en cas de<br />
hold-up. La conscience tranquille, je revins près du moribond. Entre-temps, il avait réussi à<br />
murmurer le nom et le numéro de téléphone de son hôtel, voisin d’ailleurs. Il réclamait sa femme.<br />
L’homme respirait bruyamment. Il suffoquait. Quelques minutes passèrent et soudain un vacarme de<br />
sirènes de police déchira l’espace. Plusieurs véhicules s’arrêtèrent devant l’agence, dans des<br />
hurlements de pneus, de freins, et des hommes en uniformes jaillirent dans l’agence, mitraillette au<br />
poing. C’était un spectacle délirant : des flics en quête de gangsters, un Écossais en kilt en train de<br />
mourir.<br />
Ils n’étaient pas venus pour rien. Un véhicule emporta rapidement l’homme couché sur une<br />
civière. Il devait mourir quelques instants plus tard. J’eus droit à un très sévère sermon du directeur<br />
qui m’invita à ne pas renouveler ce genre de plaisanterie, compte tenu de mon dossier chargé.<br />
Las ! quelques semaines plus tard un nouvel avatar me tomba sur les épaules. J’avais comme<br />
cliente Madame de H., ci-devant député. Cette femme particulièrement vulgaire et agressive avait<br />
pour habitude de vouloir être servie immédiatement, qu’il y eut ou pas d’autres gens arrivés avant<br />
elle. Je ne l’aimais pas du tout. Jusque-là je m’étais contenté de respecter la neutralité de l’employé<br />
que j’étais. Poli mais sans plus. Un jour, en fin de matinée, elle se présenta plus autoritaire que<br />
jamais. Remontant la file des clients elle déposa devant moi un chèque, du bout des doigts. J’étais<br />
quelque peu énervé ce matin-là. Je lui fis remarquer aimablement qu’il y avait d’autres clients avant<br />
elle. Elle m’abreuva aussitôt d’injures, exigea la venue du directeur. Une nouvelle fois, je<br />
renouvelais mon propos, en essayant de garder mon sang-froid. J’eus droit à une nouvelle bordée<br />
d’injures. Alors, la fureur explosa dans ma tête. De toute la violence dont j’étais capable, je la giflai<br />
par-dessus le comptoir. Le directeur accourut, ventre à terre. Il me jeta des yeux furibonds, me<br />
menaçant de toutes les sanctions. Cette espèce de grosse baudruche creuse ne me faisait pas peur.<br />
J’étais convaincu d’être dans mon droit. D’ailleurs, plusieurs clients prirent fait et cause en ma<br />
faveur. Le directeur décida de demander ma mutation au siège central, loin des clients, m’obtint<br />
dans les plus brefs délais. Je quittai donc l’agence R. Je n’avais plus à servir Madame de H. J’étais<br />
satisfait.<br />
Au fond j’étais profondément malheureux. Je n’en pouvais plus de cette vie là. Je haïssais les<br />
notions de taux d’escompte, d’agios, de cavalerie. Je désirais presque être licencié. Je rêvais de<br />
vivre de ma plume. Je voulais devenir journaliste. Mon désir fut exaucé à quelques détails près. Il y<br />
eut un mouvement de grève important. J’en étais un des organisateurs et responsables. Notre<br />
première manifestation sema la panique dans l’établissement. Nous apprîmes par une note de la<br />
direction qu’une équipe de télévision réalisant un reportage sur la vie des banques, viendrait nous<br />
filmer, à l’heure de la sortie des bureaux. Nous décidâmes de profiter de l’occasion pour faire<br />
connaître nos revendications, et demandâmes aux employés de préparer des petits cartons sur<br />
lesquels étaient inscrites ces revendications, de les brandir quand nous donnerions le signal. <strong>Les</strong><br />
camarades syndiqués avaient pour mission de ralentir le plus possible le flot des employés trop<br />
contents de quitter leur travail un quart d’heure plus tôt que l’heure normale. Le jour « J » arriva. À<br />
- 43 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
l’heure dite, les employés commencèrent à descendre lentement les escaliers, contenus par nos<br />
camarades. Toute la direction était rassemblée dans la galerie qui surplombe le hall : Directeurs<br />
généraux, adjoints, sous directeurs, etc, poitrines constellées de décorations. La main dans le gilet.<br />
Obèses et vaniteux. Nous lançâmes le signal convenu. Aussitôt, comme par miracle, des dizaines et des<br />
dizaines de pancartes jaillirent tandis que les slogans repris par mille poitrines, résonnaient sous les<br />
lambris. Après un instant de stupeur, ce fut la débandade dans les rangs de la direction. <strong>Les</strong> opérateurs<br />
de la télévision étaient plies en deux. Le lendemain sur chaque bureau était posée une note qui dénonçait<br />
les actions impolies d’une « bande de trublions » qui… que…<br />
La fièvre n’était pas encore retombée quand il y eut une décisive réunion de la Direction et des<br />
délégués syndicaux. La discussion était serrée, technique, sans gentillesse. À une de mes remarques,<br />
le PDG répondit par un acerbe « Monsieur <strong>Laude</strong>, il faudra vous y faire, nous ne sommes pas nés du<br />
même côté de la barricade ».<br />
Le rouge de la révolte empourpra mon front. Je me levai d’un bond et yeux rivés à ceux du PDG<br />
je hurlai : « Dépêchez-vous d’en profiter, Monsieur, nous tressons la corde pour vous pendre ». À<br />
cet instant, curieusement, la presque totalité des délégués du personnel éprouva le besoin de<br />
ramasser un crayon tombé à terre par mégarde.<br />
La Direction décida d’avoir ma peau. Elle ne pouvait pas me rendre un meilleur service. On me<br />
déplaça d’office dans un service où mon travail conditionnait celui d’une dizaine d’employés. J’en<br />
prenais à mon aise avec le temps légal accordé aux responsables syndicaux. Ce qui devait arriver<br />
arriva. Le service fut en quelques jours inactif. On trouva un vague prétexte pour me licencier pour<br />
« faute professionnelle ». J’aurai presque embrassé le PDG.<br />
Je dis adieu définitivement à la banque, à tout travail « normal ». Je décidais de vivre autrement.<br />
J’allais pouvoir me consacrer d’abord à mes activités au sein de la « Fédération communiste<br />
Libertaire » (FCL).<br />
J’étais devenu Communiste Libertaire à cause de Michel D. Celui-ci était le fils du directeur de<br />
l’école qui nous donnait les cours d’éducation civique. Mais c’est dans le groupe de Serge que je<br />
devais le rencontrer. Bien que de « gauche » aucun de mes <strong>amis</strong> n’était vraiment engagé dans un<br />
mouvement quelconque. Ils haïssaient les staliniens, manipulaient un vocabulaire extrémiste. J’étais<br />
poussé, moi, par un besoin de concrétiser ma révolte, de la mettre en actes. Michel D. fut l’envoyé<br />
des dieux. Je le connus à l’époque où un grand nombre de militants de la vieille Fédération<br />
Anarchiste étaient conscients de la nécessité d’une nouvelle organisation. La F.A. vivait dans le<br />
souvenir et le culte des vieilles figures : Bakounine, Pelloutier. Il y avait des relents de « Bande à<br />
Bonnot » dans les colonnes du Libertaire. La pensée anarchiste était faible, simpliste. Elle ne<br />
fournissait plus aucun outil d’analyse et de compréhension du monde qui était le nôtre, où des<br />
mutations importantes avaient lieu, où surgissaient les « classes » moyennes », où se préparait la<br />
vague de « décolonisation », où de nouveaux impérialismes s’affirmaient. À l’horizon, la Chine,<br />
sous la houlette de Mao, demeurait obscure, mystérieuse, fascinante. Nous étions sensibles à l’effort<br />
de ce peuple immense s’acharnant avec une ténacité de fourmis, à jeter les bases d’une nouvelle vie.<br />
Mais le maoïsme autoritaire, voué à la construction de l’État fort, ne pouvait nous séduire. Je<br />
discutais longuement avec Michel D. qui me fit lire des ouvrages de base, des textes essentiels. Je<br />
découvris ainsi les livres de Bakounine, de Kropotkine, les textes des anarchistes allemands des<br />
années 20, je m’initiai aux luttes de Durruti et de ses compagnons en Catalogne. J’appris la vérité<br />
sur Makhno. Je dévorais le livre de Voline consacré au Mouvement d’Ukraine. Mon cœur battit<br />
avec les révoltes de Cronstadt qui voulaient la « révolution ». Michel D. était un merveilleux<br />
professeur. Il n’imposait pas. Il posait des questions, balayait les contre–vérités, suggérait des voies<br />
possibles. Il ne prétendait pas être dépositaire de la vérité unique. Il était profondément,<br />
définitivement libertaire. C’était une époque difficile pour tous ceux qui s’opposaient aux<br />
communistes staliniens. Ceux–ci exerçaient dans les milieux intellectuels, éditoriaux une<br />
- 44 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
hégémonie sans limites. Ils jouissaient de l’appui des « compagnons de route », de tous ces<br />
bourgeois intellectuels fascinés par le Pouvoir de Staline, par la grandiose Union Soviétique, mais<br />
que mille tourments empêchaient de rejoindre ouvertement les rangs du Parti.<br />
Je ne croyais pas, je ne pouvais pas croire au marxisme-léninisme, qu’Anton Pannekoek avait,<br />
dans un essai fantastique Lénine philosophe, ramené à sa vraie dimension : une duperie ou plutôt<br />
une philosophie d’oppression. J’étais plus que persuadé que nul état révolutionnaire n’était en<br />
mesure de dépérir selon la profession de foi marxiste. Ce qui se passait sur la planète n’était pas de<br />
nature à me contredire. Je ne croyais pas démagogiquement aux « masses ». <strong>Les</strong> « masses »<br />
m’épouvantaient. Je n’ai jamais respecté que les hommes libres, conscients, qui s’unissent pour<br />
tenter de transformer le monde. J’étais déjà convaincu que l’État – bourgeois ou prolétarien – est<br />
l’obstacle majeur à toute tentative d’émancipation authentique.<br />
« Ni dieu ni césar ni tribun » était ma profession de foi. Je n’acceptais pas de m’en remettre à<br />
quelque libérateur, aussi sympathique et sincère fut-il. Chacun avec les autres devait conquérir la<br />
liberté, forger les armes de la libération. Le « jeune Marx » m’éblouissait. L’auteur du Capital<br />
m’enchantait moins. Quant à Engels il m’agaçait prodigieusement. Je bénissais Emma Goldman<br />
d’avoir existé : femme en lutte, femme pour la lutte de toute l’humanité brisée par les fers de<br />
l’esclavage. Je trouvais chez les militants libertaires des sentiments différents de chez les militants<br />
communistes. Ils témoignaient d’autres rapports entre les individus. Ainsi, je n’ai jamais pu durant<br />
les époques où je fus marié, présenter à quiconque ma « femme » autrement que « ma compagne ».<br />
Sourira qui voudra, c’est quand même une nuance importante même si les attitudes contredisent<br />
trop souvent le propos.<br />
Grâce à Michel D. j’étudiais l’histoire sociale et politique, l’Économie: Je me constituais un<br />
arsenal de convictions inébranlables.<br />
- 45 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
LUMIÈRE LIBERTAIRE<br />
- 46 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
La rencontre avec Michel D. devait marquer ma rupture avec mon milieu familial, avec la ville<br />
où j’avais vécu mon enfance et ma jeunesse, où j’avais, solitaire, erré en quête de quelque chose<br />
d’inconnu, de mystérieux, de sublime. J’étais en marche depuis longtemps, révolté par le monde qui<br />
m’entourait, par l’hypocrisie et la veulerie de nombre de gens, par la mesquinerie des existences. Je<br />
n’avais plus cessé de maudire le travail qui lamine l’homme, la famille qui étouffe l’individu, les<br />
plaisirs et les joies des « honnêtes gens » qui m’écœuraient profondément. Ma « différence »<br />
s’accentuait. Longtemps, je n’avais pu mettre un nom sur ma révolte, lui donner un contenu. Mais,<br />
grâce à Serge et aux autres, j’avais vu un chemin se dessiner. Je savais dorénavant qu’il y avait une<br />
sortie de secours, que je n’étais pas irrémédiablement condamné à pourrir dans un décor<br />
mélancolique de gare, de talus maigres, de boutiques aux façades écaillées, de rues aux pavillons<br />
grotesques avec leurs pots de fleurs et leurs perrons décorés d’animaux en plâtre. Ma révolte était<br />
incandescente. Je ne faisais pas pitié. J’étais sans partage. Je songeais à d’obscures tables rases. Je<br />
n’éprouvais qu’un unique désir : dynamiter cette réalité, afin de reconstruire un autre monde sur les<br />
ruines. Je brûlais d’impatience. Ceux qui recommandaient la patience, « la patience Camarade »,<br />
provoquaient des nausées en moi. J’insultais Dieu mais je hurlais après Dieu, sa terrible absence.<br />
Mon Dieu était vague, obscur, immense comme la planète. C’était forcément un dieu de lumière, de<br />
bonté, de justice. Un dieu de vie. Il n’était pas, ce dieu, un défenseur de la vie lente, grise, triste.<br />
C’était un dieu qui appelait la tourmente, la tempête, les sacrés combats, l’apocalypse. Un dieu qui<br />
exigeait des créatures qu’elles escaladassent une route qui monte et jamais ne descend. Je me<br />
voulais Fils du Soleil, j’écrivais des poèmes maladroits traversés par des peuples d’indiens<br />
farouches, rebelles, ensemençant le sol assoiffé de leur sang fertile. Des mustangs humides<br />
fendaient la prairie, des guerriers couronnés de plumes rouges, étincelantes, couraient plus vite que<br />
le vent fourbu.<br />
J’étais confusion et lucidité à la fois. J’étais définitivement acquis à la lutte des classes. Mais je<br />
ne pouvais pas m’empêcher de constater que ceux qui luttaient pour « changer le monde », pour<br />
abattre le « vieux monde » luttaient dans la plupart des cas avec des armes arrachées à ce même<br />
vieux monde. De plus la « lutte sociale » au sens strict du terme ne me suffisait pas. Le simple<br />
triomphe de la « justice sociale » et de « l’égalité » – égalité dont je perçus très vite qu’elle<br />
consisterait en cas de victoire des révolutionnaires à niveler les individus au niveau le plus bas, le<br />
plus médiocre – ne me paraissait pas de nature à créer un monde nouveau qui soit exaltant à vivre.<br />
La rage de Rimbaud, celle de Van Gogh et celle de Nietzsche m’avaient profondément marqué.<br />
C’est l’homme qu’il fallait refaire de haut en bas. C’est la vie qu’il fallait réinventer. Il devenait<br />
nécessaire et urgent de plonger le fer dans tous les domaines de l’existence. J’aspirais à un monde<br />
où hommes et femmes pleureraient, unis dans la splendeur d’un coucher de soleil au–dessus d’une<br />
forêt romantique, où ils seraient bouleversés par la mort d’un insecte écrasé par le pied aveugle, où<br />
ils suffoqueraient devant la vision d’un couple enlacé dans « les portes de la nuit », où ils<br />
s’agenouilleraient lorsqu’un barde déclamerait un antique poème brassant étoiles et vagues<br />
celtiques, colombes, et tours des cités méditerranéennes, où ils prendraient sans réfléchir les armes à<br />
l’apparition de la moindre souillure apportée à la beauté des choses. J’étais désarmé. Mais décidé.<br />
- 47 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Tendu comme la corde de l’arc du chasseur d’Amazonie, du tireur zen. J’étais brasier, braise<br />
menaçante. Je ne dormais que d’un œil.<br />
C’est à cette époque que j’entrepris pour la première fois de tenter d’écrire une pièce de théâtre<br />
dans laquelle je voulais enfouir mes angoisses, mes contradictions. Cette pièce ne fut jamais<br />
achevée, ni même écrite à moitié. Mais j’en garde encore présent à la mémoire la trame. Situant<br />
mon action dans une vague dictature d’Amérique Latine, je racontais l’histoire d’un jeune étudiant<br />
surnommé par ses camarades « Face d’ange ». Ils l’avaient surnommé ainsi parce qu’il était très<br />
beau, très pur. Face d’ange, fils d’un notable du régime dictatorial, est étudiant. Son pays est ravagé<br />
par la violence qu’entretient la milice prétorienne du dictateur. Ce dernier s’est accaparé la quasi<br />
totalité des terres fertiles. <strong>Les</strong> paysans crèvent littéralement de faim. La terreur, la corruption, la<br />
répression dirigent le pays. Face d’ange est amoureux fou de la fille du dictateur. Révolté lyrique<br />
plus que révolutionnaire face d’ange rédige des pamphlets enflammés contre le tyran. Il rêve avec<br />
quelques autres jeunes bourgeois de l’élite de renverser le tyran, de fonder le royaume de la bonté.<br />
Mais ils le savent par où commencer. Deux ou trois actions fébrilement menées n’ont eu pour<br />
résultat que de décimer leur petit groupe. Face d’ange enlève la fille du dictateur qui met sa tête à<br />
prix. Ils se cachent, se terrent chez des <strong>amis</strong>. Ils commencent à songer à organiser une guérilla dans<br />
les régions montagneuses du pays. Un représentant du grand trust yankee « Illimited Fruit » prend<br />
contact avec eux. Il leur explique que son gouvernement, craignant que les folies sanglantes du<br />
dictateur favorisent la prise du pouvoir dans le pays par les « Rouges », est prêt à les aider à vaincre<br />
et renverser le tyran, à condition que le nouveau gouvernement sauvegarde les intérêts de la grande<br />
puissance USA. Face d’Ange accepte l’accord. Quelques heures plus tard, une poignée de paysans,<br />
à bout de douleur, déclenchent une insurrection armée. L’insurrection est faible, mais le tyran n’est<br />
plus qu’un tyran au pied d’argile. En quelques jours l’insurrection se répand à travers le pays. Le<br />
tyran, vaincu, s’enfuit à la dernière minute, emportant son trésor, après avoir fait incendier les<br />
quelques richesses du pays. La foule triomphante en quête de chef acclame sur le balcon du Palais<br />
du tyran Face d’Ange. Ce dernier ne désire pas prendre le pouvoir. Contraint et forcé, il accepte.<br />
Leader charismatique, il prend des décisions qui tendent à entraîner le pays sur la pente du « bien et<br />
du beau ». « Illimited Fruit » ne l’entend pas de cette oreille. Des complots sont organisés très vite.<br />
Le trust, qui dispose de moyens financiers impressionnants, rameute mercenaires et anciens <strong>amis</strong> du<br />
tyran exilé. Le peuple commence à gronder. Face d’Ange devient à son tour, jour après jour, un<br />
tyran, aveuglé par son rêve de pureté, de grandeur. Une insurrection, financée par « Illimited Fruit »<br />
éclate. Face d’Ange et sa compagne sont lynchés par la foule de ceux qui, peu de temps auparavant,<br />
les ovationnaient frénétiquement. Dans l’ombre, le représentant d’« Illimited Fruit » ricane, en<br />
fumant voluptueusement un gros cigare. Un pseudo–régime démocratique est proclamé qui promet<br />
une réforme agraire, la création d’écoles. Mais d’abord il faut retourner aux champs, à l’usine. Il<br />
faut produire, et produire encore. Demain, annoncent les nouveaux maîtres, la misère ne sera plus<br />
qu’un mauvais souvenir dans ce pays. Demain…<br />
Face d’ange c’est moi, aurais-je pu affirmer, à l’instar de Flaubert. Dans ce personnage je tentais<br />
alors de faire vivre mes élans contradictoires, mes pulsions originelles, mes désirs multiformes.<br />
Désespéré et actif, rêveur et vaincu d’avance, il était mon double. Aujourd’hui, je l’avoue, l’envie<br />
me prend de renouer avec Face d’Ange, je ne renie pas mon personnage. Je crois même, à quelques<br />
avatars près, qu’il était assez prémonitoire.<br />
Ma rupture survint sans prévenir. Chez moi nous ne parlions guère. Ainsi que je l’ai déjà révélé,<br />
nous n’échangions que les mots utilitaires, fonctionnels. J’étouffais de plus en plus. Je ne pouvais<br />
accepter, je l’avoue, mon milieu d’origine. Mon père, broyé, brisé par les événements, s’était<br />
réfugié dans une haine sourde, têtue, contre l’humanité entière qu’il rendait responsable de tous ses<br />
malheurs. Il promenait une figure de catastrophe. Il avait trouvé un emploi de couvreur zingueur. Il<br />
- 48 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
noyait l’ennui du travail dans la boisson, les jeux de chevaux, la lecture de polars de kiosques de<br />
gare et de magazines nauséeux. Mère 2 partageait son temps entre les travaux ménagers, les<br />
papotages autour d’un café noir avec quelque voisine, les épouvantables migraines qui<br />
l’empêchaient de dormir, et les incessantes récriminations contre mon père qui avait une nette<br />
tendance à se faire mettre à la porte d’une entreprise pour cause de violences. Durant ces périodes<br />
de chômage non–voulu nous nous contentions de repas maigres : des pommes de terres bouillies,<br />
des œufs, un vague morceau de viande. Ce n’était pas la famine, c’était la pauvreté, la vraie<br />
pauvreté, celle qui se cache derrière les murs, celle dont on ne parle pas dans les livres, et pour<br />
cause, puisque tous ceux qui écrivent des livres, à quelques exceptions près, viennent d’un monde<br />
où la faim est un mot, une réalité qui ne signifie pas grand-chose.<br />
Un soir donc, la rupture survint brutalement. Je ne sais plus très bien comment tout cela<br />
commença. Un mot maladroit de ma part sans doute, grossi par le rire de Mère 2, un rire qui<br />
m’étonna puisqu’elle ne riait pour ainsi dire jamais. Mon père prit très mal la chose. Il me menaça<br />
comme il savait le faire. Chez lui, la violence à mon égard n’était pas systématique. Je ne fus jamais<br />
un enfant « martyr ». Mais elle surgissait brusquement. À travers cette violence il se vidait d’une<br />
colère qui ne trouvait guère où se briser. D’ailleurs, il la regrettait immédiatement après son geste,<br />
et éclatait en sanglots. C’était affreusement tragique. Une mauvaise note à l’école, un recul dans ma<br />
place me valaient une sérieuse correction.<br />
Mais ce fameux soir, je n’avais plus peur de lui. Je me sentais de force à lui résister, mieux, à lui<br />
faire face. Je lui fis doucement remarquer que j’avais grandi, que je n’étais plus le gamin qu’il avait<br />
connu, que mes poings pouvaient faire mal. Ces propos le rendirent presque fou et quelque part je le<br />
comprends. Il fonça sur moi, la main levée, les yeux sombres, la bouche farouche, tordue. J’étais<br />
d’une lucidité extrême. Au moment où sa main allait s’abattre sur moi, je saisis l’énorme pot de<br />
fleurs posé au milieu de la table de la chambre-salle à manger, je le brandis au-dessus de ma tête et<br />
l’écrasais de toutes mes forces sur la tempe de mon père. Celui-ci fut stoppé net dans son élan. Ses<br />
bras battirent l’air comme des ailes d’oiseau en perdition. Il s’écroula et roula sous la table. Mère 2<br />
hurlait de terreur. J’étais effrayé. Qu’allait-il se passer quand mon père reprendrait connaissance. Il<br />
allait sans doute me tuer. Mère 2 alla chercher une serviette mouillée. Elle nettoya le visage<br />
ensanglanté de mon père. Parfois, ses yeux croisaient les miens. Je n’y lu aucun reproche violent.<br />
J’avais la sensation que ce coup l’avait, elle aussi, vengé de certaines brutalités, humiliations.<br />
J’aurais pu m’enfuir aussitôt. Mais je n’y parvenais pas. Je me réfugiais dehors sur le petit balcon.<br />
Tout vacillait en moi. J’avais des larmes plein les yeux. Je ne regrettais pas mon geste. Mais je<br />
maudissais en silence un monde où l’on parvenait à une telle situation. Mes mains frémissaient sous<br />
d’étranges décharges électriques. Des tics nerveux tordaient ma bouche. De longs instants<br />
passèrent. Soudain, Mère 2 apparut. Elle m’apportait le message de mon père. Il était impossible<br />
que deux hommes vivent sous le même toit. En conséquence il me fallait m’en aller. Tout était fini.<br />
Je rentrai dans la cuisine. Mon père s’était réfugié dans la pièce du fond dont il avait fermé la porte<br />
à double tour. Aidé par Mère 2 je préparais ma valise. Je regroupais quelques affaires, mes<br />
manuscrits. Mère 2 me glissa dans la poche une petite somme d’argent. Elle me demanda avec<br />
insistance de pardonner à mon père. Je lui expliquais le plus simplement possible que je ne lui en<br />
voulais pas, mais qu’au fond, c’était mieux ainsi. Le temps était venu pour moi de décider de ma<br />
vie. Je promis de la tenir au courant. Je descendis les marches en bois en trébuchant. J’aperçus à<br />
travers les volets à demi tirés la silhouette de mon père qui allait et venait à travers la chambre. Je<br />
restais quelques instants, immobile, pétrifié, puis, brusquement, je m’éloignais à grands pas, le cœur<br />
chaviré. J’atteignis la gare. Le dernier train pour Paris n’était pas encore passé. Je l’attendis. Une<br />
demi–heure plus tard je débarquais à la Gare du Nord. J’étais épuisé. Je pris une chambre d’hôtel. Je<br />
m’endormis aussitôt mais je fus éveillé par des cris d’hommes saouls dans la rue, sous les fenêtres.<br />
Je mis longtemps à retrouver le sommeil. Le lendemain, je me levais pour rejoindre mon agence de<br />
- 49 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
banque.<br />
Je louais une chambre dans un hôtel plus proche de mon lieu de travail. Quelques jours plus tard,<br />
grâce à une de mes collègues, je trouvais à louer une modeste chambre de bonne, dans un vieil<br />
immeuble du neuvième arrondissement.<br />
Je repris contact avec Michel D. Il m’annonça la prochaine création d’une « Fédération Communiste<br />
Libertaire » (FCL). Une majorité de la vieille « Fédération anarchiste », écœurée par l’archaïsme<br />
de l’organisation, ses discours simplistes, complètement décrochés de la réalité, son pathos<br />
lyrique mais flou, son incapacité à établir une analyse correcte de la situation française et internationale<br />
du moment, son impuissance à proposer des méthodes et des plans de lutte en relation étroite<br />
avec les « masses laborieuses », avaient décidé de faire rupture. Je m’estimais suffisamment<br />
instruit, et sûr de mes convictions, et fît savoir à Michel D. que je souhaitais vivement m’intégrer à<br />
la nouvelle organisation. Il en fut très content. Ses yeux brillèrent de sympathie. Quelque temps plus<br />
tard, il devait mourir bêtement, si j’ose dire. L’ayant rencontré par hasard dans la rue nous nous<br />
attardâmes assez longtemps dans une conversation animée. Il avait un rendez-vous important.<br />
Michel était un homme ponctuel. Plus d’une demi–heure était passée quand il se décida à quitter la<br />
table de café où nous étions installés. Je le vis regagner son automobile. Il démarra sur les chapeaux<br />
de roues. Une vague angoisse me saisit que je rejetai aussitôt. Le soir même, j’appris les<br />
circonstances du drame. Quelques minutes après m’avoir quitté, Michel D., d’ordinaire<br />
extrêmement prudent et calme, avait, l’esprit ailleurs sans doute, « brûlé » un feu rouge. Son<br />
véhicule fut fauché de plein fouet par un autre véhicule qui circulait à très grande vitesse, lui aussi.<br />
Le choc fut au dire des témoins, terrifiant. D’un affreux amas de ferrailles tordues, brûlées, on retira<br />
le cadavre de Michel qui avait été tué sur le coup.<br />
Je fus malade plusieurs jours. Je me reprochais cette mort absurde qui m’enlevait un ami de<br />
lumière et privait les rangs révolutionnaires d’un homme d’action, d’un esprit fécond, d’une<br />
intelligence aiguë. Si je ne l’avais pas retenu, il n’aurait pas commis cette faute. Sa compagne me<br />
gronda tendrement. Michel fut enterré, entouré de la présence bouleversée, tendue, des camarades.<br />
Il tombait une petite pluie glacée, sinistre. Après que la dernière pelletée de terre eut recouvert son<br />
cercueil, après une ultime méditation face à sa tombe, nous nous réfugiâmes, transis, vidés,<br />
mélancoliques, dans un petit café proche du cimetière. Nous noyâmes notre chagrin, une poignée de<br />
compagnons, dans le rhum et le vin. Puis chacun s’éloigna du côté où les choses de la vie – et de la<br />
mort – l’appelaient.<br />
Il m’arrive, parfois, contemplant au cœur de la nuit, les étoiles lointaines, de retrouver le visage<br />
de Michel. Un visage que j’invente à coup sûr, tant le temps et ses violences ont creusé en moi une<br />
vallée d’oubli. Il m’arrive de lui parler, de lui demander conseil comme s’il était là près de moi,<br />
vivant, tout feu tout flamme.<br />
C’est peu après la mort de Michel D. que je rencontrais Josée. Nous étions, un groupe d’<strong>amis</strong>,<br />
attablés à la terrasse d’un café, Place du Tertre, à Montmartre. La soirée était douce, lumineuse.<br />
Nous étions à la fin de l’été. Des grappes de touristes américains erraient à travers les rues du<br />
quartier, en quête d’émotions culturelles, ou plus simplement en quête de plaisirs nocturnes.<br />
Elle arriva soudainement. Elle connaissait plusieurs personnes de notre petit groupe. On me<br />
présenta. Quelqu’un glissa une chaise vers elle. Elle se retrouva à mes côtés. Nous commençâmes<br />
classiquement la conversation en parlant de la pluie et du beau temps. Le garçon de café renouvelait<br />
les bouteilles à un rythme assez redoutable. <strong>Les</strong> esprits s’échauffaient. Plusieurs conversations<br />
animaient la table. Josée m’apprit qu’elle était modèle de peintre. Elle posait assez souvent pour<br />
Foujita. C’était une femme très séduisante. De taille moyenne, une chevelure brune, des yeux<br />
pétillants de malice. Une bouche remarquablement dessinée. Quand elle était arrivée, j’avais noté<br />
l’harmonie de ses formes. Sa poitrine était ni menue ni lourde. Sa voix était mélodieuse, avec un<br />
- 50 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
certain accent chantant qui indiquait une origine sudiste. Je lui parlais de ma poésie, je lui promis de<br />
lui offrir, si elle le désirait, les quelques plaquettes que j’avais publiées : Couleur végétale,<br />
Nomades du soleil, Pétales du chant. Elle fut touchée par mon offre. Jusque–là je n’avais connu que<br />
des femmes de mon âge. J’avais fait l’amour avec Lys. J’avais connu quelques prostituées. Josée<br />
avait vingt ans de plus que moi, autrement dit elle approchait de la quarantaine. Mais elle<br />
éblouissait comme une jeune fille. Je ne sais trop comment cela se passa. Nous nous retrouvâmes<br />
seuls en fin de soirée. <strong>Les</strong> autres étaient partis vers d’autres horizons nocturnes et alcoolisés. Josée<br />
avait gentiment refusé de les suivre, prétextant quelque fatigue. Josée me proposa de la<br />
raccompagner. Elle habitait Rue Norvins. Comme l’atmosphère était douce, détendue, nous nous<br />
promenâmes à travers Montmartre, échangeant les noms de nos peintres, de nos poètes, de nos<br />
musiciens, de nos écrivains préférés. Elle riait, rejetant légèrement la tête en arrière. Je l’avoue, je<br />
commençais à la contempler avec un certain regard. J’étais ému par sa beauté, sa culture, son<br />
maintien. Elle était grâce et gentillesse. Enfin nous parvînmes devant sa porte. Je m’apprêtais alors<br />
à la quitter. Pour tout l’or du monde je ne voulais qu’elle puisse se rendre compte de mon trouble,<br />
de mon émoi. Sous l’étoffe du pantalon mon sexe était dur. Mais au–delà de la faim sexuelle, se<br />
déployait une émotion pure. Josée ne m’aurait–elle proposé que de dormir près d’elle, sans la<br />
moindre parole, sans le moindre geste, que mon cœur aurait sursauté de bonheur dans ma poitrine.<br />
Un étrange sourire sur les lèvres, Josée me proposa de boire un dernier verre chez elle.<br />
J’acceptais tout en précisant que je ne pourrais guère m’attarder étant donné que je travaillais le<br />
lendemain. Le mot lendemain ne convenait pas d’ailleurs puisque nous avions franchi depuis plus<br />
d’une heure la barre fatidique.<br />
Nous grimpâmes deux étages. Josée habitait un merveilleux petit studio. Une pièce, une<br />
minuscule cuisine, un bout de balcon. Tandis qu’elle préparait les boissons, mes yeux exploraient la<br />
pièce. Il y avait plusieurs toiles accrochées aux murs, quelques affiches de music–hall. Une poignée<br />
de colliers pendaient à un clou. La pièce était aménagée simplement. Elle avait un petit air<br />
« japonais ». Josée revint, portant les verres. Puis elle posa sur le pick-up un disque de musique<br />
d’Asie. La musique était lancinante, étrange, une musique que coupaient, de temps à autres, des<br />
prières murmurées dans une langue qui creusait le vertige intérieur. Nous ne disions rien, fumant et<br />
buvant, abandonnés à la musique. Josée s’absenta quelques instants. Quand elle revint, elle était<br />
vêtue d’une robe en étoffe légère qui lui tombait jusqu’aux pieds. Elle était vraiment divine,<br />
superbe. Jamais je ne pourrais retrouver le fragment de seconde où nos bouches se rejoignirent par<br />
consentement mutuel et muet. Qui avait commencé le mouvement : elle ou moi, emporté par la<br />
fièvre, soudain débarrassé de mon angoisse, de ma pudeur. Cela importe peu. L’essentiel est que nos<br />
lèvres se joignirent. J’étais plutôt maladroit en amour, du moins en étais-je persuadé. Ce fut un long,<br />
un interminable baiser. La langue de Josée fouillait ma bouche avec une science inouïe. Une de ses<br />
mains s’était refermée sur ma nuque qu’elle pétrissait doucement, l’autre errait le long de mon<br />
corps, glissait comme une eau vive jusqu’à mes cuisses puis remontait et s’attardait à la hauteur du<br />
sexe qu’elle affolait de plus en plus. Moi, je caressais ses seins qui s’éveillaient sous la mince<br />
étoffe. Mes gestes étaient timides. Je n’osais pas aller plus loin. Le désir flambait dans tout mon<br />
être. À l’intérieur je n’étais que fournaise ardente. Mais une obscure angoisse me paralysait. Le<br />
divan où nous avions pris place prenait des allures de navire balancé par la tempête furieuse. C’est<br />
alors que Josée retira la main de ma nuque. Elle se pencha en direction d’un interrupteur. Une demie<br />
pénombre envahit la pièce. Josée, d’un geste souple, agrippa les pans de sa robe et, les bras tendus<br />
au–dessus de la tête, délivra son corps de l’étoffe. Elle était nue maintenant devant moi. La lumière<br />
t<strong>amis</strong>ée éclairait son sexe. Mon regard accrocha la vivante toison. Mon désir et mon trouble<br />
redoublèrent. Josée s’agenouilla devant moi entre mes jambes. Ses deux mains se joignirent sur ma<br />
nuque. Doucement, elle m’attira vers elle. Un nouveau baiser déchira mes tripes. Mille lucioles<br />
illuminèrent ma tête. Mille soleils pulvérisèrent les ténèbres de ma poitrine. Ce baiser me sembla<br />
- 51 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
durer une éternité. Je suffoquais presque. Mais je ne voulais absolument pas briser l’enchantement.<br />
Sans quitter ma bouche, elle arracha ses mains de ma nuque. Ses mains descendirent lentement le<br />
long de mon dos. Puis ses mains vinrent doucement se poser sur mon sexe invisible. Lentement, les<br />
doigts dénouèrent la ceinture, firent sauter les boutons de la braguette. Mon corps obéissait aux<br />
gestes de Josée. Avec la même lenteur, ses mains firent glisser le pantalon et le slip en même temps,<br />
sous les fesses, jusqu’aux genoux. J’avais fermé les yeux. Violemment. J’appartenais tout entier à<br />
l’incendie qui se propageait sous mes paupières closes. Ni Josée ni moi n’avions murmuré le<br />
moindre mot depuis de longues minutes. C’est alors qu’une sensation encore plus étonnante remplit<br />
soudain mon être. Une onde électrique douce et rugueuse à la fois. J’entrouvris les paupières. La<br />
chevelure de Josée semblait flamber. Sa bouche avait happé mon sexe tandis que sa main droite<br />
caressait la chair alentour. Une immense clarté se déployait des pieds à la racine des cheveux. La<br />
bouche de Josée savait tout de l’amour. L’inexpérience, l’excitation étaient telles qu’il me fut<br />
impossible de maîtriser mes réactions. J’éjaculais sans retenue, totalement saisi par la fièvre, une<br />
espèce de tremblement nerveux. Je proférais des mots sans suite. Mes mains fouillaient la chevelure<br />
de Josée dont les lèvres s’acharnaient. Elle buvait le sperme, infatigablement. Enfin, elle releva le<br />
visage. Il était magnifique, avec quelque chose de plus qu’humain. Transfiguré. C’était la splendeur<br />
du monde qui m’était enfin révélée. Elle se redressa et ses lèvres humides se posèrent sur les<br />
miennes. Comme pour me pacifier. Une lassitude sans nom s’abattit sur moi. Je m’effondrai,<br />
endormi. Quand je me réveillai, quelques heures plus tard, j’étais allongé nu, sur le divan. Josée,<br />
nue, reposait près de moi, pelotonnée contre ma hanche. Ce matin–là, la tête encore lourde, mais<br />
follement conscient, je lui fis l’amour. Ce fut un second éblouissement. Ce n’était que le premier<br />
d’une assez longue chaîne d’or. L’amour se confondit pour moi avec Liberté. J’aimais Josée, chair<br />
et esprit. Je ne voulais plus la quitter. Le matin, nous prîmes un copieux petit–déjeuner, en robes de<br />
chambre, sur le minuscule balcon. Josée semblait épanouie. Ses yeux distillaient une tendresse rare.<br />
Moi, je planais littéralement. Je contemplais les gens qui, dans la rue, marchaient vers les stations<br />
d’autobus, le métro. Ils me faisaient horreur, pitié. Et en même temps j’avais envie de les interpeller,<br />
de les prendre par le cou, de leur crier que l’amour n’était pas mort, que la terre était belle, que les<br />
monstres n’avaient plus d’avenir puisque Josée et moi nous étions capables d’allumer des myriades<br />
de soleils. J’avais envie de les détourner du droit chemin, de les entraîner sur les chemins verts de la<br />
fantaisie, de la beauté, de la réconciliation. Ce matin–là je décidai de ne pas aller au travail. A<br />
nouveau, un maillon de ma chaîne d’esclave se brisait. Je ne craignais ni dieu ni diable. Josée était<br />
vivante. Vivante. Immensément vivante. Elle était sentinelle de ce pays de cette immense contrée<br />
découverte par Apollinaire. Elle repoussait la mort qui mordait mes talons. Durant tout une saison,<br />
j’eus une respiration. Je tournoyais comme un oiseau enveloppé de pollen. Un jour nous quittâmes<br />
Paris à bord d’une petite auto prêtée par des <strong>amis</strong>. Nous roulâmes jusqu’à Fécamp. L’odeur de<br />
poisson, du sel rongeant les pontons du port provoqua en nous une émouvante ivresse. Josée riait à<br />
pleine gorge. Le soir, nous dévorâmes une assiette pleine de fruits de mer puis nous roulâmes le<br />
long des grèves du pays de Caux, tandis qu’au–dessus des falaises crayeuses, trouées, les mouettes<br />
faisaient d’immenses cercles en poussant des cris aigus. À la moindre occasion, à cause d’un reflet<br />
du soleil couchant dans l’océan, à cause de la beauté parfaite d’un galet, d’une racine tordue<br />
échouée sur les cailloux, d’un chien galopant le long de la frange d’écume j’embrassais<br />
passionnément Josée qui s’abandonnait alors entre mes bras, entre mes doigts, plante vivace et<br />
tumultueuse. Parfois, elle m’échappait des mains, elle courait vers l’immense masse liquide comme<br />
si elle allait se jeter dedans, dans une fanfare d’étincelles, mais elle s’immobilisait juste à l’endroit<br />
où l’eau venait doucement caresser les jambes, et elle demeurait immobile, de très longues minutes,<br />
contemplant un invisible paysage, situé au large de la ligne d’horizon. Ses yeux marrons–gris<br />
n’étaient plus que myriades de minuscules feux. L’étoffe qui tremblait contre son épaule avait des<br />
pâleurs de chair. J’aimais alors Josée de toute la force humaine possible. Elle coïncidait avec moi.<br />
- 52 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Elle était intelligence et compréhension. Elle n’accusait pas mes excès de boisson. Une angoisse,<br />
plus forte que l’amour–passion que je lui portais, me conduisait souvent à boire, au–delà des limites<br />
acceptables. C’était atroce. Je devenais capable de cruauté. Je mentais effrontément. Je travestissais<br />
les faits. J’injuriais Josée. Je la traitais de tous les noms. Je lui hurlais qu’elle n’était qu’une vieille<br />
femme et qu’il fallait bien que je sois idiot et dégénéré pour m’occuper d’elle, l’aimer. Ses yeux<br />
s’emplissaient de larmes. Mais elle ne faisait aucun reproche. Après chacun de ces éclats sans<br />
gloire, j’étais malade de honte. Je la suppliais de me pardonner. J’évoquais honteusement et trop<br />
facilement une vague hérédité qui m’avait fait de la sorte. Je me traînais à ses genoux. J’enfonçais<br />
mon visage brûlant dans l’étoffe de ses genoux. Elle caressait mes cheveux, sans la moindre haine,<br />
le moindre courroux, apparemment. Je lui en voulus même de cette sorte d’acceptation. J’aurais<br />
parfois préféré qu’elle me frappât, me crachât à la face, me congédiât. Sans doute son amour était<br />
tellement vaste, tellement définitif qu’elle ne pouvait avoir d’autre attitude.<br />
Le lendemain de notre arrivée à Fécamp, nous allâmes cogner à la porte d’une amie peintre qui<br />
vivait dans une vieille ferme aménagée, à l’extrémité d’un hameau qui ne comptait que quelques<br />
feux. Nous vécûmes là quelques heures éblouissantes. L’amie nous montra sa dernière série de<br />
toiles : des souches douloureuses, fendues, des troncs d’arbres tordus par une souffrance<br />
innommable. <strong>Les</strong> couleurs étaient d’un vert mortel. Nous fûmes frappés par l’intensité de ces toiles<br />
qui créaient chez le « regardeur » un indéniable malaise. L’amie, une jeune femme très mince, aux<br />
yeux glauques, au visage de biche maigre brisa d’un grand éclat de rire le malaise que nous<br />
éprouvions : « Si on allait dîner ? ». Nous passâmes dans la grande salle à manger. Le feu nourri de<br />
branches sèches crépitait ardemment. À travers le carreau de la vitre, nous pouvions voir quelques<br />
mouettes continuant à inventer d’insolites chorégraphies sous les nuages incendiés par le soleil<br />
couchant. Le lendemain, tôt levés, nous rentrâmes à Paris, par le chemin des écoliers.<br />
Josée avait un ami. Un ami vrai. Le type d’ami qui se meurt de passion pour une femme mais qui<br />
s’interdit de lui avouer cette passion. Ce type d’ami qui emmène une femme au théâtre, au cinéma,<br />
au bois de Boulogne ou de Vincennes, qui n’oublie jamais d’offrir une rosé, qui témoigne d’une<br />
infinie délicatesse et d’une incommensurable prévenance dans toutes les situations de la vie. L’ami<br />
de Josée s’appelait Marcel. Ce n’était pas en soi un prénom chargé de poésie. Mais Marcel valait<br />
mieux que son prénom. Cet homme assez corpulent, mais grand de taille, aux cheveux coupés en<br />
brosse, portant des lunettes occupait les fonctions de chef de service dans une administration. Il<br />
téléphonait chaque jour à Josée lui proposant un dîner, une sortie pour voir une pièce inédite, un<br />
film américain. Josée l’aimait beaucoup. Mais elle ne l’aimait pas comme cet homme aurait désiré<br />
être aimé. Trop timide, trop amoureux de Josée, Marcel n’avait jamais depuis plus de dix ans<br />
cherché à créer une situation « scabreuse ».<br />
Je m’étais installé en toute simplicité chez Josée. Mes bagages étaient plutôt légers, absolument<br />
pas encombrants, quelques livres et quelques menus objets. Le reste, je l’avais déposé chez un<br />
vague copain. Josée qui était honnête fit savoir très vite à Marcel la situation nouvelle pour elle.<br />
Marcel encaissa le coup. Il accepta même une invitation pour dîner à trois. Il arriva avec l’immuable<br />
rosé rouge. Il fut parfait de courtoisie. Il fît comme si rien n’avait changé dans le décor. Quelle<br />
inexplicable cruauté me poussa à faire, devant lui, des gestes non équivoques, à l’intention de Josée,<br />
quand je me déplaçais pour aller chercher les plats à la cuisine. Il dut en souffrir atrocement. J’étais<br />
jeune, fier d’avoir pour amante une femme si séduisante, si riche de virtualités, si intelligente et<br />
fine. Je n’ignorais pas qu’en agissant de la sorte je froissais quelque peu Josée qui, d’ailleurs, m’en<br />
fît la remarque, calmement, mais d’une voix d’exigence. Je lui fermais la bouche d’un long baiser.<br />
Je me croyais le plus fort, le plus malin. Marcel nous souhaita tout le bonheur possible. Ses visites<br />
et ses coups de téléphone à Josée s’espacèrent. Lorsqu’il téléphonait et que c’était moi qui répondait<br />
parce que Josée était absente, il bafouillait, s’excusait et raccrochait rapidement en me priant de<br />
- 53 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
saluer Josée de sa part. Marcel n’oubliait pas Josée. C’était impossible pour lui. Josée était l’unique<br />
femme. <strong>Les</strong> autres, je crois qu’il ne les voyait même pas. Il ne vivait que pour elle, à travers elle. Je<br />
l’imaginais solitaire dans son studio de célibataire, mordant de douleur son oreiller. En vérité, je<br />
n’étais pas très fier, il n’était pas homme à aller assouvir ses instincts chez les prostituées. Marcel<br />
avait été élevé dans la rigueur protestante d’une famille des Cévennes.<br />
Il est vrai aussi que durant tout le temps où je vécus avec Josée, je ne l’ai point trompée une<br />
seule fois. Je n’étais, je ne fus jamais un apôtre du libertinage. Certes, je suis convaincu qu’aucun<br />
être ne peut en satisfaire un autre, mais j’ai toujours pensé qu’il y avait quelque chose de fascinant,<br />
de fantastique, à triompher de la tentation, de quitter quelqu’un pour un autre, de tituber de lit en lit,<br />
d’errer de sexe en sexe.<br />
Josée, outre les peintres qui affectionnaient ses services, posait pour les élèves d’une académie,<br />
rue de la Grande Chaumière. Nous avions pour habitude de nous retrouver à la Rotonde, au Dôme<br />
ou à la Coupole. Nous passions fréquemment des nuits blanches à Saint-Germain-des-Prés où nous<br />
rencontrions Boris Vian, Juliette Gréco, Mouloudji, Sartre, Camus, Chester Himes, des musiciens<br />
de jazz, des poètes faméliques, des peintres sans le sou, l’éternelle bohème.Parfois l’étrange<br />
silhouette d’Arthur Adamov fendait l’ombre. Nous picorions un sandwich au Royal Saint Germain<br />
ou aux Deux magots. Nous allions danser au Village. Rue Jacob, il y avait quelques cafés tenus par<br />
de braves bougnats où l’on pouvait, pour une somme modique, s’empiffrer de pommes de terre<br />
frites, ou de soupes paysannes.<br />
Parfois, avec la « bande à Brassens » nous grimpions jusqu’à la Porte des Lilas. <strong>Les</strong> beuveries<br />
interminables succédaient aux beuveries interminables. Léo Ferré improvisait des mélodies<br />
fiévreuses. René Fallet racontait quelque histoire grivoise.<br />
Aux Deux magots, réfugiés l’hiver près du poêle, Sartre et de Beauvoir couvraient d’encre des<br />
pages et des pages blanches. Nous flânions le long de la Seine. Puis nous revenions vers Saint-<br />
Germain-des-Prés, vers le Storyville, le Birdland, le Tabou. Boris Vian crachait ses poumons dans<br />
une « trompinette » délirante.<br />
Saint-Germain-des-Prés jetait ses derniers feux. Comme tout incendie qui ne va pas tarder à<br />
s’éteindre, le quartier flambait, conscient de l’agonie proche. <strong>Les</strong> fêtes éclataient dans chaque<br />
appartement. Il suffisait d’arriver avec un saucisson, un fromage. Aussitôt on était adopté. La<br />
jeunesse, qui avait eu vingt ans à la Libération, voulait jouir, profiter de la vie. C’est au cours d’une<br />
de ces nuits folles que je réalisais une sorte d’exploit qui me valut une certaine notoriété au<br />
Quartier. Je vendis les Chevaux de Marly à un touriste américain pour une somme de plus de 5.000<br />
francs, en argent d’aujourd’hui. J’avais rencontré ce touriste au Bar Bac. Il avait perdu ses<br />
compagnons. Mais il s’en moquait tant il était éméché. Il me trouva fort sympathique. Il lia<br />
conversation avec moi, paya force pots, sortant de sa poche des liasses de dollars. Heureusement<br />
pour lui je n’étais ni Lacenaire ni Bonnot. Tard dans la nuit, autrement dit aux aurores, il me<br />
demanda de le raccompagner jusqu’à son hôtel. J’acceptais pour le remercier de ses faveurs. J’avais<br />
le temps. Josée était absente de Paris. Nous partîmes titubants le long des murs. Je n’étais pas aussi<br />
ivre que lui mais j’en tenais un « bon coup » comme on dit chez le brave peuple. Lorsque nous<br />
arrivâmes à la hauteur du Louvre, il eut l’idée saugrenue de tourner la tête vers moi – je reçus son<br />
haleine alcoolisée en pleine figure – et de me demander où j’habitais. Je ne sais pas ce qui me prit<br />
alors mais, montrant de la main le Louvre, je lui répondis « ici ».<br />
Il n’était quand même pas assez ivre pour avoir oublié ce qu’était le Louvre. Alors, je lui fournis<br />
quelques précisions. Je lui expliquais, sans le moindre sourire, très calmement, que le Louvre avait<br />
jadis appartenu à ma famille, qu’en vérité en dépit de mes blue-jeans, de mon tricot rapiécé, j’étais<br />
ce qu’on appelle « un fils de famille ». J’ajoutais que ma famille avait vendu par nécessité le Louvre<br />
à l’État, mais qu’elle avait gardé quelques appartements en propriété. Le texan sembla accepter ma<br />
- 54 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
version. Emporté par l’élan, conforté par son acquiescement à mes propos délirants et mensongers,<br />
je fis un vaste demi cercle de la main, en disant : « et tout ceci nous appartient encore ». C’est ainsi<br />
que cette nuit-à je vendis les Chevaux de Marly, cash. Nous nous assîmes sur un banc. Il parvint à<br />
sortir de sa poche les liasses de billets. Je pris cet argent sans mauvaise conscience, je l’avoue. Pour<br />
cet homme c’était visiblement une somme dérisoire. Il m’avait parlé auparavant de ses richesses. Il<br />
était « roi » de quelque chose aux USA. Il voulut même qu’on rebroussât chemin pour aller fêter<br />
cela. J’étais trop las pour accepter. Je le saisis par les épaules et l’emportai, l’entraînai jusqu’à son<br />
hôtel où je l’abandonnai aux bons soins du veilleur de nuit. Je repris le chemin du Quartier, la poche<br />
pleine de dollars. De grandes fêtes eurent lieu pour célébrer ma chance et mon sens des affaires.<br />
Mais je n’ai pas encore dit le plus surprenant. Deux ou trois jours plus tard j’ouvris par hasard un<br />
journal du soir. Un titre accrocha mon regard. Dans cet article il était question d’un touriste<br />
américain qui prétendait avoir acheté à son légitime propriétaire les Chevaux de Marly. Sorti de son<br />
ivresse, le touriste yankee n’avait pas oublié son achat. Il avait demandé les services d’une maison<br />
de déménagement, au départ un peu étonnée, mais que le papier que j’avais remis au texan, dûment<br />
signé – une signature illisible – avait suffisamment convaincue pour qu’elle se décide à envoyer<br />
matériel et hommes sur les lieux. Des agents de police, étonnés de voir des ouvriers envelopper de<br />
cordes les célèbres Chevaux de Marly s’approchèrent, s’enquérirent, demandèrent quelques<br />
explications. <strong>Les</strong> agents comprirent vite que le brave touriste avait été victime d’un « vulgaire<br />
escroc ». Ils prirent le parti d’en rire. Et ils invitèrent le touriste à en rire avec eux. Le signalement<br />
fourni par le milliardaire en goguette était assez flou pour qu’au moins la moitié de la population de<br />
Saint–Germain–des–Prés puisse s’estimer concernée.<br />
Quand Josée revint de son voyage, plus de cent rosés rouges encombraient le studio de la Rue<br />
Norvins. Je lui racontais tout. Elle me traita de « gangster » puis décida aussitôt que nous ferions<br />
l’amour sur un lit de pétales.<br />
Ce fut une étrange virée au paradis.<br />
J’en frémis aujourd’hui encore.<br />
Un jour, alors que, déjeunant dans un petit bistrot du Boulevard Saint-Michel, j’hésitais entre une<br />
entrecôte béarnaise et un cassoulet toulousain, Josée brisa le silence : « Chéri, dans dix ans,<br />
m’aimeras–tu encore ? ». Une telle question n’avait jamais effleuré mon esprit. Je compris pourtant,<br />
tout de suite, ce qu’elle voulait dire. Dans dix ans, Josée aurait presque cinquante ans. Moi, je<br />
n’aurais pas encore franchi la trentaine. Josée avait peur de cette différence d’âge. Pour l’heure tout<br />
allait bien. Josée n’était pas une « vieille femme » et les regards courroucés que me jetait le<br />
concierge de la Rue Norvins ne gâtaient aucunement son plaisir. Mais qu’adviendrait-il quand elle<br />
franchirait cet âge critique de cinquante ans. L’angoisse du visage flétri, de la beauté enfuie hantait<br />
sans doute Josée. Je la fixai droit dans les yeux. Je posai ma main sur sa main et lui dis : « tu es<br />
idiote, mon amour. » Et j’ajoutai : « je t’aimerai toujours ». Elle eut un attendrissant sourire, mais au<br />
fond de ce sourire je pus déceler le rayon de la mélancolie. Je fus soudain inquiet, troublé au plus<br />
profond de moi–même. J’avais vécu jusque–là au jour le jour avec Josée. Et soudain sa petite<br />
question ouvrait une brèche. J’imaginais Josée à soixante ans. Quel visage aurait-elle ? Mes<br />
quarante ans n’auraient–ils pas alors l’envie secrète de nouer à nouveau avec la jeunesse physique.<br />
J’étais perdu dans de sombres pensées quand la voix de Josée qui me recommandait le cassoulet<br />
toulousain me ramena à la réalité. Elle parla d’autre chose, sans cesser de m’offrir son beau sourire.<br />
Deux mois passèrent encore, entrecoupés de quelques promenades à la campagne et au bord de<br />
la mer. J’étais libre puisque je venais de déserter ma peau d’employé de banque. Je rêvais de vivre<br />
dorénavant de ma plume. Et je voulais me consacrer le plus possible à l’action libertaire.<br />
Un soir l’irrémédiable fit irruption dans le studio de la rue Norvins. La nuit tombait lentement<br />
noyant peu à peu les objets, les choses. J’étais allongé sur le lit, perdu en pleine songerie<br />
- 55 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
cotonneuse. J’apercevais le profil de Josée, enfouie au creux du divan. Elle était totalement<br />
immobile. Soudain sa voix résonna : – André ?<br />
– Oui, Josée…<br />
Au ton grave de la voix je pressentis l’arrivée de quelque malheur. Josée se leva, elle vint<br />
s’asseoir près de moi, au bord du lit. Elle laissa sa main errer dans ma chevelure.<br />
– André…<br />
Elle s’arrêta un long instant après avoir prononcé mon prénom.<br />
Je restais silencieux.<br />
– André, il faut que nous nous séparions. Il le faut.<br />
Elle avait dit ces mots rapidement comme si elle avait craint de ne pas pouvoir arriver au bout de<br />
la courte phrase qui me fît mal comme un coup de poing en pleine figure.<br />
Aussi étrange que cela paraisse, je ne la questionnai pas. Je savais en toute certitude que sa<br />
décision était irrévocable. La conversation du bistrot du Boulevard Saint-Michel me revint alors à la<br />
mémoire. Je ne doutai pas que Josée avait pris sa décision ce jour–là ou quelques jours plus tard.<br />
J’en eus la preuve la semaine suivante lorsque je pus enfin avoir un entretien avec Marcel. Je l’avais<br />
appelé au téléphone, persuadé qu’il n’ignorait rien de cette décision. Il accepta sans réticence ma<br />
proposition de rendez–vous. Nous nous retrouvâmes dans un café de la rue Saint Dominique, près<br />
de son bureau. Il me dit tout. Le lendemain de notre fameuse conversation, Josée l’avait appelé à<br />
son bureau et elle lui avait dit, en substance : « Marcel, je sais que vous désirez depuis longtemps<br />
m’épouser. Le voulez–vous toujours ? »<br />
Marcel avait avoué dans un souffle que c’était là son plus cher désir. Alors Josée avait demandé à<br />
Marcel de l’épouser au plus vite. Il n’était pas dupe. Il savait que Josée ne l’aimait pas d’amour.<br />
Mais son amour à lui était si puissant, si total, qu’il n’avait pas hésité une seconde. Marcel m’apprit<br />
enfin qu’ils allaient se marier deux semaines plus tard et que Josée et lui partiraient faire un long<br />
voyage de noces aux États–Unis. Marcel ne témoigna durant cette rencontre d’aucun triomphalisme.<br />
J’appréciai beaucoup sa gentillesse. J’eus même la sensation qu’il se faisait du souci pour moi.<br />
Nous nous quittâmes sur un « bonne chance » mutuel.<br />
Deux heures plus tard, après l’aveu de Josée, je quittais la rue Norvins. Elle souhaita faire une<br />
dernière fois l’amour. Elle s’abandonna comme jamais elle ne l’avait fait. J’étais impuissant,<br />
nerveux, bouleversé. Je fis un effort désespéré pour ne pas pleurer comme un enfant « paumé »,<br />
meurtri. Je couvris son visage de baisers. Je murmurais « Josée, Josée ». J’avais une épée plantée<br />
entre les deux épaules. La bouche sèche. Josée se taisait, paupières closes. Elle n’était que chair<br />
frémissante, blessée.<br />
Le moment vint de m’en aller. Sur le pas de la porte elle me donna un dernier bref baiser, puis<br />
elle referma rapidement la porte. Je descendis l’escalier en titubant. Ma valise me semblait pleine de<br />
gros cailloux très lourds. Je me retrouvai dans la rue presque déserte. Je traversai la chaussée et<br />
parvenu à l’autre trottoir posai ma valise sur le sol. Mécaniquement mes yeux se levèrent en<br />
direction de la fenêtre de Josée. Je vis un rideau frémir, j’eus la nette conviction d’entrevoir la<br />
silhouette, le visage de Josée.<br />
J’étais à nouveau seul, broyé, douloureux, orphelin. D’un café de la Place du Tertre, je téléphonai<br />
à un ami qui accepta de m’héberger pour une ou deux nuits. Quand j’eus déposé ma valise chez lui,<br />
dans le quartier de la Bastille, je repartis seul dans la nuit. J’avais envie de m’enivrer jusqu’à la<br />
déroute de la mémoire. Ce fut une nuit sordide traversée de querelles absurdes de bord de zinc. De<br />
nausées et de vomissements, de larmes à peine cachées.<br />
Je ne revis plus Josée, ni Marcel. Je n’eus plus jamais aucune nouvelle d’elle. Je désertais la<br />
Place du Tertre. J’évitais la rue Norvins. Et le temps commença à faire son œuvre.<br />
La Fédération Communiste Libertaire prenait corps. Nous étions installés dans des locaux<br />
- 56 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
exigus, plutôt miteux situés Quai de Valmy, à proximité du fameux pont qui fait face à l’Hôtel du<br />
Nord. Ce décor très « prévertien » qui m’évoquait sans cesse le célèbre film de Marcel Carné<br />
réjouissait mon âme. C’était cela pour moi l’univers des révolutionnaires : pauvreté, fièvre dans un<br />
climat d’apparente illégalité ou de demi–légalité. Dans ces locaux peuplés d’une vieille machine à<br />
écrire, d’une longue table, d’une ronéo, de quelques chaises bancales, aux carreaux opaques et gris<br />
que personne ne prenait le soin de nettoyer on croisait à l’occasion des survivants de la Guerre<br />
d’Espagne, de vieux anarchistes baltes ou bulgares, des réfugiés politiques de l’Est, des types qui<br />
avaient – pour paraphraser Charles Plisnier – fait un peu brûler Madrid et Berlin, Sofia et Saragosse.<br />
C’était le lieu de discussions à perte de nuit. Discussions agitées, souvent orageuses. Nous étions<br />
saisis par le vertige. Après tant de défaites, de martyrs, nous avions une tâche immense à<br />
accomplir : changer le monde. Devant nous, face à notre rêve, à nos bras presque désarmés se<br />
dressait un ennemi implacable qui couvrait la planète comme une immense et sanglante toile<br />
d’araignée : le stalinisme.<br />
La FCL, était née de la révolte des nouvelles générations qui par dégoût du stalinisme avaient,<br />
faute de mieux, rejoint les rangs de l’antique F.A., sans pour autant fermer les yeux sur les carences<br />
et les faiblesses de cette organisation qui, comme la seiche, dégageait un vaste nuage d’encre afin<br />
de masquer le néant de sa théorie. Ces jeunes gens, nouvellement engagés dans l’aventure<br />
révolutionnaire, n’éprouvaient pas la même réaction de rejet des écrits de Marx que les vieux<br />
« anars » qui s’étaient toujours refusés à en débattre. Ceux là pratiquaient une interprétation<br />
mécaniste, aveugle, de Marx. <strong>Les</strong> ambiguïtés, les contradictions, le non–achèvement de l’œuvre du<br />
révolutionnaire allemand leur échappaient.<br />
Nous les nouveaux venus, nous nous entendions à croire qu’il était essentiel de confronter Marx<br />
et Bakounine, de « relire » leurs écrits à seule fin de débusquer ce qu’il y avait de vivant, de bon et<br />
utile pour nous chez chacun d’eux. La question n’était pas de réaliser une sorte de patchwork avec<br />
des bouts récoltés chez B. et chez M., mais d’accomplir une sorte de « dépassement » de ces deux<br />
pensées qui avaient été contemporaines, confrontées aux mêmes données historiques. Nous n’en<br />
pouvions plus d’entendre répondre à nos questions précises concernant la nature de l’État, de<br />
l’organisation révolutionnaire à construire, les rapports de l’Art et de la Révolution, la signification<br />
moderne de l’aliénation, le rôle des minorités (déjà ! ) par des litanies de mots éculés à force d’être<br />
répétés plus ou moins inconsciemment. Nous avions à bâtir un monde qui ne renouvelât pas<br />
l’oppression, nous avions à frayer des chemins où le combat contre l’injustice sociale et l’aliénation<br />
ne déboucheraient pas sur une aliénation et une injustice encore plus flagrantes. <strong>Les</strong> uns continuaient à<br />
rêver à la grande grève générale insurrectionnelle. Il fallait donc œuvrer au cœur des masses, répéter<br />
chaque jour les vérités élémentaires, susciter à chaque occasion qu’offraient les maîtres, la prise de<br />
conscience, de la révolte à la révolution. D’autres ne croyaient qu’à l’efficacité des petits noyaux<br />
hyperconscients, armés de la « science », révolutionnaire, seuls capables de briser l’étau d’acier dans<br />
lequel agonisaient, étouffaient les masses arrachées à leur propre identité. D’autres encore, épouvantés<br />
par la profondeur des abîmes que nous explorions maladroitement, avec nos limites et nos zones<br />
d’ombres, étaient gagnés par la tentation de l’activisme à outrance. Nous ne faisions que répéter les<br />
grands débats qui depuis un siècle animaient les rangs révolutionnaires. Nous ne faisions que préfigurer<br />
les débats qui allaient, un peu plus d’une décennie plus tard, faire résonner les vieux murs de la noble<br />
Sorbonne.<br />
Personnellement, je creusais mes connaissances. Je lisais minutieusement Rosa Luxemburg.<br />
J’étais fasciné par la personnalité de cette révolutionnaire, torche de feu, par sa foi inébranlable, par<br />
son courage, par l’acuité de ses analyses. Cette petite femme atteinte de claudication avait le génie<br />
de la parole. Comme son compagnon Karl Liebknecht, elle savait enflammer les foules. Chacun de<br />
ses discours, de ses écrits étaient à la fois un appel aux armes, une leçon de morale et de dignité,<br />
une vision messianique, un poème haletant, une vraie leçon révolutionnaire.<br />
- 57 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
<strong>Les</strong> femmes et les hommes du Spartakusbund m’exaltaient. Il m’arrivait à force de concentration de me<br />
retrouver, en chair et en os, parmi eux, en 1920, lors de l’insurrection, sur les barricades. Ces femmes et<br />
ces hommes étaient le sel de la terre. L’évocation de la mort sauvage donnée par les junkers barbares à<br />
Rosa et Karl, l’écho de leurs ultimes messages frappés du sceau de la volonté, me déchiraient.<br />
C’était l’époque où je me passionnais pour l’Expressionnisme allemand, pour ce grand cri<br />
utopique lancé depuis le milieu des ruines. Leur haine-fascination de la grande ville qui pourrit tout,<br />
qui transforme l’homme en chômeur affamé, la jeune fille en prostituée, la fleur en pourriture, leur<br />
rage contre la misère, les ténèbres de l’Esprit, les chaînes de l’oppression, leur désespoir hanté de<br />
visions de cadavres dévorés par la vermine, me fouettaient en plein visage. Plus tard je devais lire<br />
avidement l’Esprit de l’Utopie du philosophe Ernst Bloch qui, à propos du sens à donner à<br />
l’Expressionnisme, s’était beaucoup disputé avec Georg Lukács et Bertolt Brecht. Je retrouvais<br />
l’ancienne exaltation au cours de cette lecture. Bloch y affirmait la grandeur de la lutte pour<br />
l’Utopie. Il affirmait que toute défaite était source de combat. Il y mettait en pièces la pensée<br />
« orthodoxe » du théoricien hongrois. Il y réconciliait les rêves de Rimbaud et les visions de Marx.<br />
De même, la découverte des Dadaïstes allemands provoqua en moi d’étranges et infinis<br />
bouleversements. J’admirais leur violence de ton, leur intégration à la lutte réelle aux côtés des<br />
Spartakistes, leur puissance d’invention dans la construction d’un arsenal d’armes susceptibles de<br />
réveiller les consciences, d’allumer les Esprits, de fracasser les ombres. <strong>Les</strong> photomontages de John<br />
Heartfield, de Hannah Höch étaient autant de coups de poignards portés dans la viande putride du<br />
vieil ordre inique. <strong>Les</strong> manifestes, les poèmes, les textes de Huelsenbeck et Hausmann, dans<br />
lesquels la langue rompait brutalement avec le principe logique, la valeur usuelle, étaient autant de<br />
boulets rouges tirés en direction des forteresses branlantes du Capital, de la Raison.<br />
Je découvrais, au–delà de l’Allemagne de Bismarck et de l’Empereur Guillaume II, du junker et<br />
du hobereau, une autre Allemagne, celle des poètes insurgés et des révolutionnaires habités par<br />
l’Esprit d’Utopie. Je continue toujours de penser que l’Allemagne a beaucoup à nous apprendre. De<br />
ce point de vue là, je ne saurais trop remercier mon ami Jean-Michel Palmier, germaniste émérite et<br />
esprit curieux, à qui l’on doit plusieurs ouvrages qui mettent en valeur l’apport révolutionnaire<br />
allemand tant dans la Culture que dans la théorie et pratique de la lutte des classes. Je pense<br />
notamment à ce remarquable Expressionnisme comme révolte, dont à l’heure où j’écris ces mots,<br />
nous ne connaissons qu’un premier volume, lequel retrace avec force détails les différents<br />
mouvements qui ont fait agir et créer sous le règne de la fragile République de Weimar, les poètes,<br />
les dramaturges, les écrivains de cabarets, les peintres et architectes du Bauhaus, de Die Bruche, de<br />
Blaue Reiter. L’Allemagne des années 20 a vécu intensément tous les problèmes qui sont encore<br />
aujourd’hui, compte–tenu des différences de situation, les nôtres. Dans cette Allemagne je décelais<br />
la Révolution à laquelle je souhaitais travailler. Ma révolution ne pouvait pas ignorer les poèmes de<br />
Georg Trakl, de Georg Heym, de Gottfried Benn, de J.R. Bêcher. Elle ne pouvait pas ne pas<br />
s’exalter à la vue des magnifiques chevaux bleus de Franz Marc, chevaux qui devaient susciter<br />
particulièrement la hargne du futur führer. Elle ne pouvait pas ne pas s’interroger à la lecture des<br />
écrits de Wilhelm Reich, de Rudolf Rocker, de Marcuse, d’Adorno. Elle ne pouvait pas ne pas<br />
compulser fiévreusement les liasses jaunies des comptes rendus des controverses enflammées qui<br />
déchiraient en ces années de tumulte et de sang les rangs de l’Ultragauche.<br />
Ma révolution était pour la lumière, pour l’extension ininterrompue du territoire de la liberté.<br />
Elle était allemande, occitane, canaque, indienne, féminine, océanienne, enfantine, lyrique, lucide,<br />
armée et rieuse. Je haïssais déjà violemment tous ceux qui détournaient la révolution de son cours<br />
naturel, ceux qui étouffaient le Prolétariat soudain surgi de son apathie fataliste, se dressant,<br />
s’élevant au–dessus de sa geôle d’ombres, et venant buter contre l’obstacle multiforme. Cette<br />
fatalité n’a jamais cessé de me tourmenter, de me meurtrir : les opprimés s’arrachent<br />
mystérieusement à la relative paix établie entre eux et les Maîtres. Ils passent à l’attaque, ils<br />
- 58 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
agissent, se trouvent confrontés à cent, mille problèmes auxquels en tâtonnant ils tentent d’apporter<br />
des solutions en corrélation avec leurs vrais besoins. Passant à l’attaque, ils se trouvent emportés<br />
dans un mouvement qui les contraint à remettre bien des choses en question. Ils apprennent; ils<br />
inventent. Ils prennent jusqu’à un certain point, conscience de la réalité de leur oppression, de la<br />
réalité de leurs désirs. Ils parviennent très souvent à maîtriser par l’expérience vécue plus que par le<br />
savoir les mécanismes de l’oppression. Durant cette période, ils se hissent au–dessus de leur état<br />
habituel. La fleur humaine s’épanouit en eux. La bêtise, l’égoïsme, la bassesse de comportement<br />
reculent. La solidarité, la compréhension mutuelle, l’acceptation de la « différence » gagnent du<br />
terrain. Alors la foule des opprimés – écrire le mot « masses » m’écorche la bouche – écarte avec<br />
intelligence quelques–unes des barrières qu’on élève face à sa longue marche vers la libération. Elle<br />
peut nommer ses ennemis qui ne figurent pas tous dans les rangs des Maîtres, mais aussi et plus<br />
dangereusement pour elle dans les rangs de ceux qui se proclament ses « défenseurs », ses<br />
« sauveurs », et qui ayant la maîtrise de la parole se saisissent assez aisément des postes de<br />
commande. C’est alors que cette conscience collective, admirable, lumineuse, combative vient buter<br />
contre les obstacles. Le vieil adage qui veut qu’il soit plus facile de faire table rase du vieux monde<br />
que d’en construire un nouveau, se vérifie tragiquement une fois de plus. Divisée par les idéologies<br />
trompeuses, manipulée par les chefs avides de pouvoir, laminée par la vastitude des problèmes à<br />
résoudre, leur complexité, manipulée par les Maîtres en péril décidés à sauver leurs privilèges à<br />
n’importe quel prix, fût–ce au prix du sang, la foule des opprimés titube, perd pied comme un<br />
voyageur égaré dans les marais mouvants. Elle se divise en camps antagonistes. Elle oppose des<br />
intérêts spécifiques à d’autres intérêts spécifiques. Elle perd de vue cette unité qu’elle avait réussi à<br />
mettre au jour, cette communauté de destin qu’elle avait mesurée au cœur des luttes. Elle retourne<br />
par angoisse, lassitude, à ses vieux démons. Au pire, elle donne raison aux maîtres qui depuis<br />
toujours lui enseignent qu’elle est incapable de se forger une liberté. Elle revit la « tragédie de<br />
Spartacus » admirablement analysée par André Prudhommeaux aujourd’hui disparu, dans un texte –<br />
préface au petit livre consacré à Rosa Luxemburg et aux Spartakistes aux Éditions… Spartacus du<br />
cher René Lefeuvre. Souvenez–vous : L’armée des esclaves révoltés ayant Spartacus à sa tête<br />
parvient sous les murs de Rome. <strong>Les</strong> lieutenants de Spartacus pressent ce dernier de donner l’ordre<br />
de l’assaut final. La cité impériale est là, à une portée de jet de pierre, sans défense, prête à être<br />
prise. Mais Spartacus, dont la révolte est née dans cette cité, qui se souvient d’avoir été esclave, qui<br />
n’a sans doute pu effacer en lui les traces de cet esclavage, ne peut se résoudre à donner un ordre<br />
qui aura, à priori, pour conséquence de transformer la cité impériale en un champ de ruines<br />
fumantes, en un vaste carnage. Spartacus décide alors de renoncer à prendre la cité impériale. Il<br />
décide de lui tourner le dos, de marcher jusqu’à la mer, d’embarquer et d’aller fonder dans une île<br />
lointaine le monde nouveau. <strong>Les</strong> consuls romains mettront à profit cette décision. <strong>Les</strong> légions<br />
romaines, la veille décimées sont reformées. Elles se lancent à la poursuite de Spartacus. Au lieu<br />
d’affronter la puissante armée des esclaves rebelles en un seul bloc, les consuls romains, recourant à<br />
une subtile tactique, forcent celle–ci à se diviser en plusieurs armées moindres qu’ils attaquent et<br />
écrasent, l’une après l’autre. La fin est connue : Spartacus et les survivants crucifiés jalonneront la<br />
route qui mène à la Cité impériale. On peut s’interroger sur le sens profond de l’épopée de<br />
Spartacus. On peut y lire cette tragédie simple : des esclaves dressés contre l’Ordre cruel se<br />
trouvent, à cause de leur victoire militaire, dans la situation de s’emparer d’un pouvoir contre lequel<br />
ils se sont révoltés justement parce qu’il était Le Pouvoir. Spartacus désire un monde d’hommes<br />
libres. Mais comment fabrique–t–on un monde d’hommes libres ? J’imagine Spartacus, la tête<br />
brûlante, douloureux, conscient des périls qui guettent son entreprise. Entrer dans Rome, dans la<br />
Rome impériale, c’est à coup sûr être plébiscité par la foule des esclaves qui veulent un « chef ».<br />
C’est d’une certaine manière devenir le « César » de la plèbe. Spartacus ne le veut pas. C’est<br />
l’homme de l’utopie increvable. Il se décide donc à tourner les talons, à contempler l’étendue, à<br />
- 59 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
rêver à l’ailleurs, là où il n’y a nulle trace de la Rome impériale, au royaume d’innocence où peut<br />
être fondée l’harmonie. Des siècles et des siècles après Spartacus I er , un autre Spartacus, lui aussi,<br />
parviendra à la tête de ses rebelles sous les murs de la Cité impériale. Il est barbu, jovial, une<br />
énergie inépuisable, un géant de l’action, un courage de fer, un romantisme fou aux lèvres. Il entrera<br />
dans la cité impériale. Il sera plébiscité. Il deviendra le « lider maximo ». Chef charismatique il<br />
déclenchera l’enthousiasme des foules, des petites gens, des pauvres, des poètes, des rêveurs, des<br />
faibles. Alors, la révolution est une fête. L’imagination est au pouvoir. Le délire pousse dans les rues<br />
sous la forme de grands arbres aux couleurs éclatantes. On pose son fusil et on fait l’amour. <strong>Les</strong><br />
négrillons dévorent des glaces en inventant des chansons savoureuses, ensoleillées. Mais l’homme<br />
ne vit pas seulement de poèmes. Il veut du pain, des médicaments, du travail, la sécurité, la<br />
satisfaction de ses besoins élémentaires. L’héritier de Spartacus est contraint au réalisme. On range<br />
dans les armoires les instruments de musique. On devient soupçonneux. On voit à chaque angle de<br />
rue des « ennemis de la révolution ». La crainte du peuple le pousse à fantasmer. <strong>Les</strong> poètes, les<br />
homosexuels, les amoureux de la liberté tout simplement sont dénoncés bientôt comme les membres<br />
d’une mystérieuse et éternelle « cinquième colonne ». La répression s’abat. Le Dieu–Productivité<br />
crache ses ordres, ses commandements et ses verdicts dans les micros, les haut–parleurs. L’héritier<br />
de Spartacus découvre avec ravissement les charmes de la condition de lider maximo. Il n’oublie<br />
jamais de paraître en public avec, épinglées au revers de sa vareuse soigneusement coupée, toutes<br />
les décorations que lui ont offertes d’autres « leaders », « chefs » et « sauveurs suprêmes ».<br />
De la Rome impériale de Spartacus à La Havane de Fidel Castro, la même implacable « fatalité »<br />
a joué.<br />
Lénine ? Bakounine ? Mao ? Che Guevara ? Gandhi ?<br />
Qui a la « voie » ?<br />
Qui connaît le chemin ?<br />
Rimbaud ? Saint-Jean-de-la-Croix, Staline ?<br />
Le sang des pauvres ne cesse de souiller la terre. Quelles semences mortelles féconde-t-il ? Qu’y<br />
a-t-il d’increvable dans l’espèce humaine qui la conduit régulièrement à se lever d’entre les morts, à<br />
casser, à briser les structures de l’oppression au nom d’une soif sacrée de libération, tout en<br />
fabriquant dans le même temps, tout en aidant à fabriquer de nouveaux outils d’esclavage. Question<br />
lancinante, à rendre fou, qui pervertit l’existence de celui à la peau duquel elle colle comme une<br />
blessure vrillante. Sera-ce donc toujours le même scénario : une poignée de rebelles authentiques,<br />
sachant au nom de quoi ils se sont rebellés, rejoints un jour par ces « masses » aux sentiments divers<br />
(souci de ne pas s’aliéner le vainqueur, instinct de survie, opportunisme, désir de se faire un<br />
« trou », une situation au sein du nouvel édifice…), désirant ardemment entraîner leur peuple sur la<br />
pente du « beau et du bien » et peu à peu amenés, au nom même de ce « beau et ce bien », à se<br />
métamorphoser en flics, puis en bourreaux, tandis que les foules divisées en clans multiples, les uns<br />
en proie au plus grand fanatisme, à la plus dangereuse paranoïa, les autres à l’effroi absolu,<br />
s’enfoncent derrière le nouveau tyran, vers des abysses de larmes et de sang, ou complotent<br />
mystérieusement sa chute.<br />
Guignol affreux de l’histoire qui se répète inlassablement. Et dans quelque chambre d’hôtel<br />
miteux, le « pur » met un terme à la contradiction en se tirant une balle dans la bouche, en avalant<br />
un poison violent. Tandis que derrière les murs des prisons nouvellement bâties, confondus en une<br />
mêlée confuse, « traîtres », et « contre–révolutionnaires » boivent leur propre urine. Pour faire un<br />
spectacle parfait, il ne manque jamais quelque idiot de village figurant parmi eux, idiot qui ne<br />
comprend rien à rien, qui ne comprend que la langue des oiseaux.<br />
Oui, comment rompre une fois pour toutes avec ces révolutions qui se dévorent elles–mêmes, et<br />
qui dévorent dans le même temps leurs propres enfants. L’humanité est–elle définitivement<br />
condamnée à errer « au large d’Eden » ? Exister ne se résumera-t-il, pour les plus lucides, les plus<br />
- 60 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
exigeants, qu’à une horreur à peine atténuée par les soleils du sexe, du vin, des rencontres du<br />
hasard, la beauté de quelques livres et de quelques paysages, la splendeur de quelques musiques, de<br />
quelques visages.<br />
Je sais que je ne sais pas. Tant de livres déchiffrés à la clarté d’une pâle bougie, tant de débats<br />
dans des arrière-salles de cafés enfumées, tant de combats et de paroles, tant de vertiges et de<br />
fièvres, tant de cauchemars et de fièvres pour aboutir à cet aveu :<br />
JE SAIS QUE JE NE SAIS PAS<br />
- 61 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
L’ILLUMINATION SURRÉALISTE<br />
- 62 -
LA REVOLTE S’APPELLE ESCLARMONDE<br />
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
C’est grâce à Serge, Jacques, Georges, Michel D. que je découvris très tôt, dans ma maison<br />
d’Aulnay–sous–bois, le surréalisme. J’en étais encore à écrire des poèmes qui n’étaient que des<br />
décalques des poèmes de Lamartine, de Musset, de Théophile Gautier, de Victor Hugo. J’écrivais<br />
chaque jour. J’étais persuadé qu’un seul jour sans un poème était un jour mort. Je barbouillais des<br />
cahiers d’écolier. J’étalais en longues strophes mon cœur meurtri. Je hurlais à l’amour et j’ignorais<br />
tout ou presque de l’amour. Je me croyais le plus malheureux de la planète. J’empilais des lieux–<br />
communs. Mon père furieux faisait la chasse à mes carnets qu’il déchirait rageusement après<br />
m’avoir traité de sale fainéant, de bon à rien. Je serrais les dents. Puis je recommençais.<br />
Quand j’eus intégré le « groupe » ce fut comme une marche forcée. La bibliothèque de Serge<br />
m’ouvrait des horizons insoupçonnés. Je me jetais voracement sur les livres, lisant pêle–mêle sans<br />
trop bien toujours comprendre, Freud, Nietzsche, Dostoïevski, Malraux, Bernanos, Michaux, Marx,<br />
Bakounine, Faulkner, Dos Passos, Rimbaud, Zola, Jules Vallès, Lao-Tseu, Lanza Del Vasto,<br />
Gurdjieff…<br />
Inévitablement, je ne pouvais pas ne pas rencontrer sur ma route chaotique, le surréalisme. Ce<br />
furent d’abord les deux Manifestes d’André Breton. Une lecture éblouissante qui me laissa sur le<br />
flanc. Quelqu’un disait tout haut ce que je pensais obscurément tout bas. Quelqu’un avait le pouvoir<br />
magique des mots, en sa possession la clef des aubes. Ce tumulte qui gémissait, flambait en moi,<br />
quelqu’un l’ordonnait, quelqu’un montrait du doigt la bête, quelqu’un désignait l’issue. Je sortis<br />
bouleversé de cette lecture. Bouleversé est un mot insuffisant d’ailleurs. Il y eut comme un<br />
tremblement de terre, comme un tremblement de ciel dans mes veines. Une métamorphose radicale<br />
s’opéra. Du jour au lendemain, Rimbaud, Lautréamont, Jacques Vaché remplacèrent dans mon<br />
panthéon intime Lamartine et Musset. J’étais définitivement marqué du signe du « fils du soleil ».<br />
Je commençais à écrire des poèmes sous l’influence de ces rencontres fabuleuses. Des poèmes<br />
dont le meilleur (?) devait s’intégrer à diverses plaquettes : Couleur végétale, Nomades du soleil,<br />
Pétales du Chant. J’avais trouvé ma vocation : changer la vie et transformer le monde. Dans mon<br />
être, dans mon sang, mes muscles, la Poésie et la Révolution ne faisaient plus qu’une seule et même<br />
chose. La poésie devenait un risque mortel. J’allais bientôt découvrir, grâce à Michel Leiris, qu’un<br />
authentique poète ne pouvait écrire qu’à « l’ombre de la corne du taureau ». L’écriture était une<br />
corrida. Je me fis taureau et matador.<br />
<strong>Les</strong> revendications énoncées par André Breton étaient les miennes. <strong>Les</strong> désaccords que je<br />
ressentais ne pesaient pas à côté de l’accord profond, fondamental. Avec les surréalistes je<br />
partageais la haine de la raison cartésienne, avec eux je haïssais l’ordre glacé de Versailles. Avec<br />
eux je frémissais aux fatrasies du moyen–âge, aux « Nursery Rhymes » anglaises, aux comptines<br />
débridées. Grâce à eux je compris à quel point le langage usuel faisait partie de l’arsenal oppressif<br />
du pouvoir. Libérer la langue de sa gangue de rationalité idiote c’était déjà commencer la lutte de<br />
libération. Couché sur les feuillets de braise de Fata Morgana, de Nadja, du Revolver à cheveux<br />
blanc, des Pas perdus, d’Arcane 17 d’André Breton, du Passager du Transatlantique, de Feu<br />
- 63 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Central de Benjamin Péret, de Ne pas voir plus loin que le bout de son sexe de Léo Malet, j’étais<br />
forêt de vertèbres secouée par des vents de force 20.<br />
Dans tous ces livres – mais étaient–ce seulement des livres ? – les mots « faisaient l’amour ».<br />
Ces lectures n’étaient pas sans troubles profonds. Elles heurtaient encore des convictions de<br />
jeunesse. Mais je ne pouvais me cacher la fascination que je ressentais. La poésie cessait d’être pour<br />
moi quelque chose qu’il fallait « comprendre ». Au sens où l’on comprend un article de journal.<br />
Dans les Vases communicants Breton m’enseignait les liens qui unissaient la réalité objective et<br />
Tin–conscient. J’appris que j’étais un iceberg dont une immense partie, immergée, demeurait<br />
ignorée des explorateurs, et que c’était à coup sûr dans cette partie immergée que résidaient des<br />
connaissances nécessaires à la compréhension du phénomène de l’existence. Je me passionnais pour<br />
les petites phrases qui viennent cogner contre la vitre. Je me mis à noter mes rêves, les phrases qui<br />
surgissaient au moment du demi-sommeil. L’une d’entre elles me revient subitement à la mémoire,<br />
complète, nette et claire : <strong>Les</strong> chevaliers de la Table Ronde cueillirent d’une main légère l’églantine<br />
du rêve avant d’aller jeter leurs armures pleines d’herbes folles dans le vieux puits moussu du<br />
château du Baron cathare.<br />
J’étais incapable d’expliquer la beauté que ces mots « donnés », jetait entre mes genoux<br />
tremblants, comme peut s’y jeter la femme amoureuse, la chevelure défaite, la poitrine hantée<br />
d’oiseaux verts et rouges. Mais pour cette beauté–là je serais mort sur place, le cœur percé de mille<br />
dagues, de mille flèches.<br />
Avec Breton, Péret et les autres je partageais la fascination des « lieux inspirés » : grands<br />
boulevards éclairés par les néons, altères propices aux plus délicieuses rencontres, hôtels de passe<br />
aux enseignes écaillées, insolites, halls de gares, ruelles aux rares lampadaires, squares aux recoins<br />
ombreux chargés d’obscure magie, cafés où le tueur des abattoirs de la Villette côtoie la « dame »<br />
des beaux quartiers, au cou frangé d’un collier de perles à trois rangées.<br />
Avec eux, je me perdais au fond de landes où Brocéliande, l’Enchanteur Merlin, Perceval le<br />
Gallois, manipulaient les formules sacrées. Avec eux, je m’enfonçais au cœur des landes<br />
inquiétantes où la peur était un cadeau de la nuit.<br />
Avec eux je criais « Orages désirés, levez–vous ».<br />
Chair tendue comme un arc, avec eux j’étais rébellion, prophétie, incantation et voyance.<br />
Certes, j’émettais des objections. Je n’avais guère croyance en l’écriture automatique. Je ne<br />
tardais pas d’ailleurs à savoir qu’André Breton, lui–même, le soi–disant « Pape » – baptisé ainsi par<br />
les médiocres, les ratés, les envieux, les pisseurs inconscients de copie – n’y croyait guère. Il en<br />
disait les échecs.<br />
De plus, et cela était essentiel à mes yeux, le Surréalisme « parisien » avait pour moi des parfums<br />
de seizième arrondissement. Pour tout dire, je ne le trouvais pas assez « sauvage », assez « barbare ». Il<br />
ne suffisait pas, à mes yeux, de désirer voir les petits chevaux mongols boire dans les fontaines de la<br />
Concorde. Et d’écrire cela magnifiquement parce que l’homme était en possession de dons inouïs.<br />
J’exigeais secrètement un « surréalisme farouche », je réclamais de ces hommes et de ces<br />
femmes qui mettaient en accusation toutes les valeurs ou prétendues telles sur lesquelles la société<br />
était fondée, sur lesquelles elle se maintenait tant bien que mal, et surtout grâce à une répression qui<br />
empruntait mille masques, celui du flic, de l’adjudant, du maître d’école, du patron, de l’intellectuel<br />
bourgeois, du contremaître, du psychiatre fou convaincu de l’exactitude de sa science – qu’ils<br />
joignissent l’acte à la parole. Je peux l’avouer. Aujourd’hui encore, et quelle que soit la<br />
« vénération » que je continue à lui porter, je ne puis relire sans quelque gêne ces admirables<br />
phrases de 1’Amour fou dans lesquelles André Breton explique pourquoi il ne rejoignit pas les rangs<br />
des révolutionnaires espagnols menacés d’extinction par la coalition de Franco, de Mussolini, de la<br />
non intervention de Léon Blum et des « démocraties bourgeoises » et surtout par la haine farouche<br />
de Staline qui, à cette époque, espérait encore un accord avec les capitales occidentales pour faire<br />
- 64 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
face au péril hitlérien que les dirigeants de la III e Internationale permirent de franchir le stade de<br />
l’hypothèse à celui de réalité. Quand Franco et les autres militaires espagnols déclenchèrent la<br />
guerre civile parce que la bourgeoisie espagnole, les propriétaires fonciers étaient conscients qu’une<br />
révolution sociale menée par les anarchistes cognait à leurs portes, Benjamin Péret, sans conférence<br />
de presse, sans tapage diurne ou nocturne, sans discours devant les micros de la radio française –<br />
laquelle d’ailleurs se souciait comme d’une guigne du poète de je ne mange pas de ce pain là, quitta<br />
son pays, rejoignit l’Espagne au plus vite et s’intégra aux milices du POUM, où il devait retrouver<br />
Georges Orwell, l’auteur de 1984, Colette Audry et d’autres authentiques antifascistes.<br />
Non, il n’y eut jamais en Espagne de « guerre » opposant la Démocratie – avec un grand D – au<br />
Fascisme avec un grand F. Il y eut quelque chose de plus terrifiant, de plus saignant, de plus<br />
exaltant : une révolution sociale en voie de développement, une révolution sociale fondée sur les<br />
enseignements de l’anarchisme espagnol, une révolution donc qui, non contente d’ignorer les<br />
schémas mitonnes par les bureaucrates du Komintern, s’opposaient radicalement à ceux–ci. Lorsque<br />
la prétendue « guerre civile » éclata, il n’y avait, outre Pyrénées, qu’une infime poignée de<br />
communistes ralliés à Moscou. Par contre, il y avait plus de deux millions d’ouvriers, de paysans,<br />
d’intellectuels, d’employés à la CNT-FAI. Il faudra les étonnants tours de prestidigitation des tueurs,<br />
hommes de main, valets larbins de Staline, pour qu’en quelques mois Le Parti communiste espagnol<br />
acquiert des dimensions « honorables ».<br />
Il faudra des crimes innommables, des assassinats multiples, des rapts ignominieux. Il faudra la<br />
peau d’Andrès Nin, des secrétaires de Trotsky, de Camillo Berneri l’arnarchiste italien. Il faudra que<br />
la police « prolétarienne » de l’URSS – qu’elle s’appelle G.P.U, NKVD, KGB – commette forfait<br />
sur forfait. Il faudra la « manipulation des « bonnes âmes » des Brigades internationales dont les<br />
chefs et en premier lieu Palmiro Togliatti n’ignoraient rien des complots tramés à l’ombre des<br />
coupoles du Kremlin. Combien de poètes inconnus, d’anonymes étudiants, de travailleurs sans nom<br />
qui résonne, reposent aujourd’hui dans la fameuse vallée des morts, près – honneur suprême ou<br />
suprême dérision ! – du Caudillo.<br />
L’Espagne, on le sait maintenant clairement, fut sacrifiée sur l’autel de la Realpolitik. Qui aurait<br />
pu accepter alors une révolution qui démontrait que la « fatalité » pouvait être vaincue, qu’il n’était<br />
pas donné comme vérité éternelle que toute tentative de transformation du monde dusse aboutir à un<br />
« goulag ».<br />
C’est au nom de cette Espagne là, libertaire, que plus de trente ans plus tard il me fut donné de<br />
demander au vieux compagnon Gaston Leval en proie alors aux difficultés du grand âge ainsi qu’à<br />
une cruelle maladie, de consentir l’effort de plonger dans ses archives et d’en extraire la masse de<br />
notes – enregistrées à chaud – lors des débats des conseils ouvriers et des différentes structures nées<br />
en Catalogne sous l’impulsion de l’avant–garde de la CNT–FAI. Cela donna un fort volumineux<br />
ouvrage qui parut aux Éditions de « La tête de feuilles » ouvrage qui avait, selon moi, pour but de<br />
clouer à jamais le bec des staliniens haineux ainsi que celui des gens qui avaient une nette<br />
propension à faire la louange des idées libertaires tout en précisant aussitôt qu’elles étaient<br />
irréalisables. En fin de compte pour ces gens–là le Communisme Libertaire était d’autant plus beau<br />
qu’il n’avait aucune chance de s’incarner. Le livre passionné du regretté Gaston Leval leur apporta<br />
un démenti cinglant. Une révolution non autoritaire avait bel et bien été écrasée en Catalogne.<br />
Puisqu’elle contredisait les plans machiavéliques de Moscou, puisqu’elle n’était pas assimilable à<br />
cette misérable social–démocratie, dont on sait depuis plus de cinq décennies, que non contente de<br />
gérer les intérêts du Capital, elle peut – comme en Allemagne de Weimar – faire le lit du fascisme le<br />
plus fou, le plus criminel, puisqu’on conséquence elle ne pouvait qu’effaroucher les « démocrates »<br />
français déjà prêts à chanter au passage de Pétain « Maréchal nous voilà », les « démocrates »<br />
anglais et américains prêts à ne rien perdre de la valeur de La Livre et du sacro–saint Dollar, il<br />
- 65 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
fallait donc que cette révolution crevât. On monta un habile scénario.<br />
Ne discutons pas : l’Espagne « noir et rouge » n’est pas morte de la seule main, du seul garrot,<br />
du seul peloton d’exécution commandés par la hyène Franco. Elle est morte de l’estocade lucide<br />
portée par les régimes qui avaient tout à craindre du triomphe d’une révolution qui aurait été la mise<br />
en accusation de la fameuse « Révolution d’Octobre ». <strong>Les</strong> assassins de Cronstadt, les meurtriers<br />
des anarchistes et sociaux révolutionnaires russes, les traqueurs de Trotski, les bureaucrates du<br />
« goulag » dont les formes étaient déjà préfigurées bien avant la mort du « grand timonier »<br />
Vladimir Illitch Oulianov, n’avaient plus d’avenir si Durruti l’emportait sur la bête fasciste.<br />
Breton disait cela superbement dans des textes illuminés par la colère du lion qu’il était. Mais<br />
Breton se réfugia aux États–Unis. Il ne se porta pas au secours d’Esclarmonde.<br />
Qui dira un jour l’étonnant rôle des femmes dans la « guerre d’Espagne ». À tout hasard, je fais<br />
rappel d’un ouvrage paru il y a seulement quelques mois, un ouvrage intitulé Mujeres Libres dont je<br />
conseille la lecture la plus attentionnée aux plus sectaires des membres du « Mouvement de<br />
Libération des femmes ». Cet ouvrage retrace l’épopée des femmes anarchistes de la CNT–FAI,<br />
l’extraordinaire séisme qu’elles vécurent alors, ayant à affronter à la fois les tâches de mères,<br />
d’épouses, de compagnes, de militantes, de guerrières et enfin de femmes qui, à travers le combat,<br />
purent prendre conscience de leur oppression spécifique. <strong>Les</strong> militants anarchistes n’étaient pas<br />
exempts de tares qui vérolaient ce que j’appellerai assez aisément le machisme léniniste latino<br />
américain. Ces femmes où se mêlaient paysannes illettrées, ouvrières aliénées, intellectuelles<br />
d’origine bourgeoise, menèrent, par le fusil et la plume, l’acte et la pensée, un combat exemplaire.<br />
Elles ne tombèrent point dans ce racisme anti-homme, fantasmatique et imbécile, qui caractérise,<br />
aujourd’hui, une large partie de la mouvance « Libération des femmes ». Elles comprirent très vite<br />
qu’il n’y aurait point de « libération » des femmes sans une « libération » des hommes. De par leurs<br />
origines sociales, de par leur situation dans la lutte réelle, elles échappèrent aux fantasmes d’autoagression<br />
qui conduisent aujourd’hui tant de femmes « en lutte » à revendiquer, sous le prétexte<br />
d’une prétendue « autonomie féminine » des fonctions, des rôles et plus gravement encore des<br />
« pouvoirs » que les hommes s’étaient jusque là appropriés au prix de toutes les saloperies<br />
possibles. En toute clarté, elles ne regrettent pas d’être des femmes et, à la limite, elles auraient<br />
même tendance à s’en féliciter. Elles ne sont pas de celles qui gémissent sur l’horreur de la situation<br />
de la femme condamnée, dans l’acte d’amour, à être « en dessous ». Elles avaient d’autres chats à<br />
fouetter que ceux qu’on cajole et nourrit quotidiennement de « Friskies ». Mais elles ne faisaient<br />
pas de cadeaux dans leurs prises de paroles, dans leurs écrits dont, souvent, la maladresse émeut.<br />
Elles étaient d’une lucidité effrayante. Elles étaient en mesure, instruites ou non, de « pointer » le<br />
nœud de l’oppression du mâle. Elles ne s’en laissaient pas conter. Leur grandeur fut de mener des<br />
luttes absolument « irrécupérables » par l’ordre établi, ce qui n’est pas le cas de nos actuelles<br />
amazones portées facilement à l’injure grossière, au sarcasme gâteux, à l’insolence sans preuve.<br />
Ce qui m’avait frappé à la lecture d’André Breton, d’emblée, c’était cette exaltation de la<br />
Femme. Je n’avais, bien au contraire, aucune raison de la contredire. En ce temps–là, c’est vrai, je<br />
plaçais toutes mes espérances dans la femme qui se confondait avec la Poésie, la Révolution, la<br />
Liberté. Je m’exaltais à la relecture de l’Union Libre. Chaque page d’Arcane 17 me bouleversait.<br />
J’étais pour ma part convaincu, comme André Breton, que la femme était un pont entre l’inconnu et<br />
le connu. Qu’elle puisse reproduire la vie dans la caverne de son ventre, m’était preuve indiscutable<br />
et éblouissement.<br />
Je relisais jusqu’à l’épuisement mental et physique les premières lignes d’Arcane 17. Je n’aurais<br />
pas l’outrecuidance de les rappeler au regard du lecteur. Malgré la splendeur de cette prose de<br />
diamant transparent, de tremblante écume, quelque chose me froissait. Il n’était là pas question de la<br />
femme aux gros doigts durcis par l’hiver, défigurés par l’ouvrage, les travaux ménagers. Breton<br />
- 66 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
volait à hauteur de pollen, de nuages purs… Je me méfiais de cette dualité qu’on me proposait, la<br />
femme comme sainte, divinité ou comme prostituée. La littérature est pleine de ces images. Mais où<br />
donc était passée la femme réelle, la femme qui souffre, écarte les cuisses, chie (O la souffrance de<br />
Swift à propos de sa chère Célia), vomit, sue, accouche.<br />
J’étais en toute certitude profondément d’accord avec les objectifs que Breton avait énoncés dans<br />
ses manifestes. Mais je ne pouvais pas le suivre complètement, jusqu’au bout, sur les chemins de<br />
l’esthétisme. Dès le départ, mon ambition était de tout dire : la fleur rouge éclatée sur un tas<br />
d’ordures, les silhouettes épousées de deux amants sur le Pont de Nantes, la rude fraternité des rues<br />
et des pauvres, la bouche du volcan engloutissant un cobra, la solitude du jeune terroriste qui écrit,<br />
au deuxième étage d’un bouge mal famé, sa lettre d’adieu à celle qu’il aime parce qu’il sait qu’il va,<br />
deux heures plus tard, abattre le tyran, mais il sait aussi qu’il n’en sortira pas vivant, la rumeur du<br />
ressac à Roscoff, les rires des enfants dans les « slums » hallucinants de Calcutta, le rat qui dévore<br />
la moitié du visage d’un gosse suspendu dans son berceau de bric et de broc, dans le bidonville de<br />
Lima, le cri de douleur de la guerillera dont on vient de trancher les seins comme un soldat aux<br />
èvres limées par la soif tranche fiévreusement une pastèque, la marche des hommes libres nouée à<br />
la marche des astres, le monde entier contenu dans un tesson de verre abandonné sur un flanc de<br />
talus de terrain vague, l’immensité de la vie réfugiée dans le regard d’une marchande de galettes de<br />
maïs à Mexico, le calme des bords de Loire et la fureur des fleuves rougis par le sang des victimes<br />
des caïmans en Amazonie, la mort de la vieille femme après qu’elle ait rapporté l’ultime fagot de<br />
bois dans sa maison obscure, la jungle de poings fermés d’ouvriers insurgés alors que la faux de la<br />
lumière d’été griffe les murs…<br />
Moi, pour dire cela, je n’avais que des mots simples, rudes, lourds de sang, des mots comme<br />
ceux qui fleurissaient dans la gorge de Nazim Hikmet et Yannis Ritsos, Antonio Machado et Miguel<br />
Hernandez, Atahualpa Yupanqui et Nikos Kazantzakis.<br />
Je n’étais pas non plus totalement convaincu que les Surréalistes voulussent vraiment la<br />
Révolution c’est-à-dire l’avènement d’un monde sans hiérarchie, sans dieu ni maître.<br />
Je pressentais qu’ils avaient beaucoup à perdre, quelles que fussent leurs paroles, si une telle<br />
révolution émergeait. Moi, je savais depuis l’enfance que j’avais tout à gagner, et d’abord mes<br />
poignets libres de toutes menottes.<br />
Mais, occitan, l’appel à Esclarmonde, le chant dédié à la fille du Comte de Foix montant la<br />
première sur le bûcher de Montségur, ne pouvaient que m’émouvoir au plus profond.<br />
Pourtant un certain idéalisme de Breton me fâchait beaucoup. Je compris mieux lorsque je me<br />
mis à étudier très soigneusement les rapports entre André Breton et Georges Bataille. Bataille était<br />
convaincu que la lumière ne se gagne qu’au prix de la traversée douloureuse des ténèbres. Qu’il<br />
fallait s’écorcher vif aux épines de la nuit pour espérer déboucher en pleine clarté. La découverte<br />
des Écrits de Laure devait longtemps après me confirmer en cette perspective.<br />
Quant à Breton, s’il s’abandonnait aisément aux prestiges, aux magies de la nuit, en poète, il la<br />
craignait visiblement. Breton avait mis le cap en navigateur solitaire sur le récif de la Clarté, l’Île<br />
des lumières. Il n’éprouvait que dégoût envers la maladie, l’excès, la folie vraie. Dégoût et<br />
inquiétude profonde.<br />
Mais dans cet homme j’aimais qu’une part qui le portait aisément vers les mignardises de<br />
Mallarmé et Valéry, soit contrebattue par une autre part qui ne bâillonnait pas la voix de la révolte,<br />
du blasphème, du refus global. Je vivais Breton comme un être en proie à un partage douloureux, en<br />
fin de compte fertile. Je ne souhaitais plus que le connaître, obtenir si possible son amitié. Je<br />
devinais bien que si un hasard heureux nous faisait nous lier, de sévères discussions auraient lieu<br />
alors. Je ne les craignais pas. Je respectais suffisamment cet homme pour oser me permettre de lui<br />
faire part de mes divergences irréductibles.<br />
- 67 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
La rencontre eut lieu. Elle fut le fruit d’un enchaînement de circonstances. Pour un certain<br />
nombre d’articles publiés dans Le Libertaire – la vieille FA avait dû nous abandonner le titre et<br />
intituler son propre journal Le monde libertaire – j’eus de sérieux démêlés avec la justice. Encore<br />
heureux que je signais d’un pseudonyme connu de quelques camarades sûrs, éprouvés, mes textes<br />
les plus incendiaires, les plus violents, les plus injurieux. On me fit procès. Je ne savais pas très bien<br />
alors que Breton subissait l’influence libertaire. La flamme trotskiste avait quelque peu décliné sur<br />
sa ligne d’horizon. Contacté par notre organisation, il accepta de venir témoigner. Il fît un discours<br />
remarquable d’intransigeance révolutionnaire. Bref, je m’en tirais sans trop de dégâts. Breton<br />
m’invita à prendre un verre en sa compagnie. Ironiquement, étant tout à fait au courant des us et<br />
coutumes du groupe surréaliste depuis sa fondation, je commandai un « mandarin curaçao ». Il eut<br />
la bonté de ne pas s’offusquer de ce geste. Jusqu’à cet instant, pour Breton, je n’étais qu’un jeune<br />
militant. Je lui avouais timidement combien la lecture de ses livres m’avait perturbé, changé.<br />
J’ajoutais que moi aussi j’écrivais des poèmes mais que je n’avais absolument pas la certitude que<br />
ces poèmes étaient surréalistes, et que de toute manière, je me moquais qu’ils soient ou non<br />
surréalistes. Il me pria gentiment de les lui communiquer. Ce que je fis dès le lendemain. J’étais très<br />
angoissé. Qu’allait penser Breton de mes pauvres œuvres. Il m’avait aussi demandé de le rappeler<br />
au téléphone deux jours plus tard. Ce que je fis, tremblant et impatient. J’entends encore la voix de<br />
Breton affirmant : « mais vous êtes surréaliste, André ». C’en était trop. Je pleurais presque dans<br />
l’écouteur. Breton me proposa de lui rendre visite, au 42 rue Fontaine.<br />
C’est le cœur battant que le jour dit, je grimpais l’escalier qui menait à l’atelier rendu célèbre par<br />
les photographies. Je savais en partie ce que j’allais découvrir : des toiles réputées dont j’avais à<br />
maintes occasion contemplé les reproductions, des poupées indiennes Hopi, des objets océaniens…<br />
Breton me reçut avec sa traditionnelle courtoisie. Mes yeux éblouis couraient du beau visage de<br />
Breton au « Cerveau de l’enfant » de Giorgio de Chirico. Le visage de Breton me fascinait.<br />
Remarquablement sculpté, il dégageait puissance et douceur. <strong>Les</strong> yeux profonds et sombres<br />
pouvaient subitement se remplir d’éclairs à l’évocation d’une personne détestée ou même<br />
franchement haïe, d’une controverse ardente d’autrefois, d’une rupture. Ses mains soignées<br />
déplaçaient de temps à autre une pile de livres pour dégager un ouvrage dont il voulait me lire un<br />
passage qui avait retenu son attention, ou me montrer une illustration qui l’avait, dès le premier<br />
regard, excité. J’étais, cela va de soi, extrêmement intimidé. Je n’avais pas encore, à cette époque,<br />
rencontré beaucoup d’écrivains en chair et en os. Et Breton était le premier de « mes dieux » que<br />
j’approchais. Entre la parution du Premier manifeste et ma première rencontre avec Breton, presque<br />
trente ans s’étaient écoulés, jalonnés de créations, d’interventions, de livres, de prises de positions,<br />
de rencontres et de ruptures, de « scandales » et d’empoignades furibondes. Alors pour moi Breton<br />
c’était l’homme qui avait lancé le défi à un monde s’appuyant sur des « valeurs » que sa raison<br />
ardente ne pouvait en aucune sorte justifier, accepter, c’était l’homme qui avait déchiré le rideau<br />
d’ombre derrière lequel se tenait en éveil le vieux, admirable, digne Saint Pol-Roux, le poète de la<br />
voyance pure, c’était l’homme qui avait fustigé sans jamais faiblir les staliniens fossoyeurs des<br />
espérances révolutionnaires, c’était l’homme qui avait à maintes reprises et plus particulièrement<br />
dans Arcane 17, affirmé à haute voix son espoir inébranlable en la jeunesse du monde, c’était<br />
l’homme aux mains propres qui n’avait jamais accepté des honneurs et autres colifichets dont une<br />
société couronne ses élites, dans la mesure où elles ne lui sont pas trop hostiles, ou quand leur<br />
hostilité demeure assez vague et se limite à des articles de journaux, pour ne pas la mettre<br />
véritablement en péril de mort, c’était l’homme qui, contre vents et marées, aux prix sans doute de<br />
quelques injustices et errements, avait maintenu vivant le groupe surréaliste. Je ne crois pas qu’il ait<br />
existé d’autre groupes ayant bénéficié d’une aussi surprenante longévité. Si l’on excepte les<br />
quelques années qui ont suivi la mort de Breton et se sont closes par la dissolution officielle du<br />
groupe par Jean Schuster qui en assumait la maintenance, Breton aura animé le groupe de 1924 à<br />
- 68 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
1966, soit plus de quarante ans. C’était enfin l’homme qui n’avait jamais désespéré de voir les<br />
valeurs du Surréalisme triompher d’un monde qui, de génocides et guerres en Hiroshima, de crimes<br />
en entreprises systématiques et cruelles de destruction de l’individu incapable de « prendre le pli »,<br />
de mensonges en trucages, d’assassins en bourreaux, s’acheminait vers l’abîme final. Mais<br />
quelqu’un – certes il n’était pas unique, pourtant il n’y eut jamais foule de ce côté–là – s’était<br />
dressé, un homme avait dit « non » à l’intolérable, à la misère humaine, un homme avait déterré la<br />
hache de la guerre, une guerre pour la vie, la lumière, l’amour, la liberté. Un homme avait repoussé<br />
la tentation de l’inaction. Il avait su vaincre l’ombre du découragement quand chaque jour voit dix<br />
et cent fois bafoué ce pour quoi des hommes dignes de ce nom combattent, et souffrent, et meurent<br />
souvent.<br />
Qu’un tel homme existât allégeait la peine quotidienne, il rendait son bleu perdu au ciel, sa saveur à<br />
l’air, ses couleurs pimpantes à l’aube.<br />
Peu m’ont, autant que Breton, fait battre le cœur. Il ne fut jamais question bien entendu pour moi<br />
de le déifier. On sait trop bien où mènent des chefs divinisés par des foules hystériques. Il suffit<br />
aujourd’hui de tourner les yeux du côté de l’Iran en proie aux mollahs fanatisés et rétrogrades pour<br />
éprouver l’envie de vomir. J’ai simplement éprouvé pour Breton une affection presque filiale. À<br />
mes yeux il ne fut jamais le « Pape » décrié par tant de besogneux sans aura, tant de médiocres et<br />
d’envieux, tant d’imbéciles heureux de l’être. Drôle de pape en effet qu’un pape qui installe ses<br />
appartements vaticanaux dans des cafés. Drôle de pape qui n’eut de cesse tout au long de son<br />
existence humaine de prêcher un salutaire et vigoureux « crosse en l’air ». Drôle de pape qui, au<br />
lieu d’envoyer ses missionnaires convertir les « nègres », prétendit révéler à l’Occident blanc ce en<br />
quoi justement ces « nègres » pouvaient nous aider à vaincre nos maux.<br />
Ma première rencontre avec Breton et Élisa dura peut–être deux heures. Il me questionna à propos<br />
de mes travaux d’écriture. Il s’enquit de mes passions. Il commenta avec bienveillance sa lecture des<br />
quelques plaquettes que je lui avais fait parvenir. Il me fit partager ses inquiétudes de l’heure : c’était le<br />
temps de la guerre d’Indochine, de la « guerre froide », de nouveaux procès dans le bloc soviétique,<br />
c’était le temps des premiers pas de la « révolution chinoise », des affrontements entre deux<br />
impérialismes : celui du dollar et celui du rouble, c’était le temps en France d’une bourgeoisie qui, ses<br />
plaies pansées, relevait de plus en plus insolemment la tête et s’acharnait contre un mouvement ouvrier<br />
dénaturé par l’hégémonie communiste. <strong>Les</strong> révolutionnaires se regroupaient frileusement dans de petites<br />
organisations, autour d’une revue, d’une feuille. Ils criaient dans le désert. Breton m’interrogea aussi à<br />
propos de la Fédération Communiste Libertaire. Je lui répondis du mieux que je pus. Je maudis alors<br />
mes carences, lacunes, faiblesses de pensée. Je n’ignorais pas qu’il avait toujours été fasciné par la<br />
personnalité de Léon Trotski. On connaît l’admirable discours qu’il prononça après l’assassinat du<br />
« Vieux » par Ramon Mercader sur l’ordre de Staline. Je n’étais pas d’évidence trotskiste. J’étais loin de<br />
partager les convictions de ceux qui proclamaient que si le « Vieux » avait succédé à Lénine, la<br />
révolution socialiste aurait connu un cours différent de celui que nous savons. Je n’oubliais pas que<br />
Trotski avait poignardé la révolte de Cronstadt, je ne pouvais méconnaître son acharnement à dénoncer<br />
avec fureur les « ennemis de la révolution », ni son autoritarisme. Je ne pouvais oublier qu’il était au<br />
sommet de la hiérarchie lorsque Lénine, d’une signature de décret, avait dépossédé de leurs prérogatives<br />
les Conseils ouvriers, lorsque le Parti arrachait, pan après pan, les conquêtes du Peuple. Certes, l’homme<br />
avait une intelligence hors pair, un courage physique étonnant, une fidélité à soi–même digne d’éloges.<br />
C’était un géant. J’avais donc évité lors de ce premier entretien d’aborder sur ce rivage dangereux.<br />
J’aurais été très malheureux d’offusquer Breton, et de briser les ponts entre nous. Secrètement, je<br />
songeais alors que ce serait quelque chose de magnifique si la F.C.L. pouvait compter sur la contribution<br />
des surréalistes. Ce qui me paraissait encore possible avec Péret m’apparaissait impossible en ce qui<br />
concernait Breton. Je me trompais puisque quelques mois plus tard, Breton et les autres : Benayoun,<br />
Péret, Legrand, Schuster, Toyen inaugurèrent, sous la forme de billets hebdomadaires, une<br />
- 69 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
collaboration régulière à notre journal Le Libertaire. Mais il est vrai aussi que cette collaboration ne<br />
dura guère qu’une année et qu’elle s’acheva sans que mes liens avec Breton et le groupe en<br />
subissent de graves conséquences.<br />
Après avoir quitté Élisa et André Breton, il me fallut marcher très longtemps le long des rues,<br />
tant ma fièvre était grande. Je me remémorais les propos tenus. Mes yeux gardaient la vive lumière<br />
des beautés que j’avais eu loisir de contempler dans l’Atelier de la rue Fontaine. J’exultais à la<br />
pensée que je venais de vivre plusieurs heures en compagnie de celui qui avait connu, fréquenté,<br />
aimé Apollinaire et Jacques Vaché, Jacques Rigaut et Robert Desnos, Nadja et René Crevel.<br />
Et cela d’autant plus qu’André Breton, au moment de nous quitter, m’avait très simplement<br />
invité à me joindre, selon mon bon plaisir, à ses compagnons et à lui–même, dans le saint des saints<br />
surréalistes : le café où perdurait une tradition solidement assise depuis les années 20, les années<br />
héroïques.<br />
- 70 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
DE LA FRENESIE EN AMOUR ET EN TOUTES CHOSES<br />
En ce temps–là les réunions quasi quotidiennes du groupe surréaliste avaient lieu au Palais-<br />
Royal, dans un café nommé Le Musset. C’était un café plutôt élégant avec de grandes glaces<br />
scintillantes. Je n’allais pas tarder à comprendre l’importance des glaces dans l’existence réelle et<br />
rêveuse de Breton. Quand j’entrai dans Le Musset, ce jour–là à six heures du soir, il n’y avait encore<br />
que trois ou quatre personnes dont Benayoun et Legrand que je connaissais un peu. Je pris place à la<br />
table, timide et silencieux. J’écoutais les autres évoquer diverses questions, la préparation d’une<br />
exposition surréaliste à l’étranger, la rédaction d’un tract. Enfin, Breton arriva. J’étais plus à mon<br />
aise. Il me salua, me félicita d’être venu. Breton prit place de telle sorte qu’il pouvait de sa chaise<br />
apercevoir avant d’être vu les personnes qui pénétraient dans le café. Jean Schuster entra à son tour,<br />
il occupa la chaise près de Breton. C’était, j’allais au fil des jours m’en rendre compte, une habitude<br />
de « droit ». Schuster était quelque chose comme le « lieutenant », le « bras droit » de Breton. Puis<br />
arrivèrent l’aristocratique et élégant André Pieyre de Mandiargues accompagné de son épouse à la<br />
« beauté du diable », la peintre Bona, Nora Mitrani, magnifique comme une flamme courbe, qui<br />
devait mourir prématurément, Joyce Mansour à la chevelure sombre de sorcière, Jean-Pierre Duprey<br />
le poète fabuleux de Derrière mon double, qui se tenait tout serré contre sa femme Jacqueline,<br />
Benjamin Péret, échappé de son humble labeur de correcteur d’imprimerie, le défi permanent sur les<br />
lèvres, Sarane Alexandrian, Toyen la secrète aux pervers enchantements graphiques, Georges<br />
Goldfayn cinéphile fanatique tout comme Legrand et Benayoun avec lesquels il allait bientôt<br />
animer une revue L’âge du cinéma dont les rares et précieux numéros sont encore aujourd’hui<br />
recherchés avidement par les amateurs. D’autres encore rejoignirent la table : des jeunes gens, des<br />
jeunes filles pour la plupart qui avaient, comme tant d’autres jeunes gens et jeunes filles depuis les<br />
années 20, entendu l’appel ardent de Breton, l’appel à la sédition, à la guerre sainte contre les ruines<br />
du vieux monde.<br />
Est–ce ce jour là que je vis pour la première fois Octavio Paz ? Le poète mexicain, alors en poste<br />
diplomatique à Paris qu’il devait quitter pour l’Orient, admirait profondément Breton. Indépendant<br />
certes, il se savait lié aux objectifs essentiels du Surréalisme. Il apportait au sein de cette assemblée<br />
une coloration unique, une violence faite de terre et de ciel, d’épines et de pierre. Il apportait la<br />
mémoire indienne, les échos d’un Sacré enfoui sous les masques des Temples du Yucatan. J’aimais<br />
aussitôt son beau visage superbement sculpté, son regard d’une profondeur vertigineuse, sa parole<br />
lente, trouant l’obscurité comme une racine de céréale fécondée par le soleil implacable. Octavio<br />
Paz mûrissait en silence ce très beau labyrinthe de la solitude qui devait nous ouvrir à tous des<br />
chemins inespérés.<br />
Mais c’est très certainement ce jour–là que je devais rencontrer pour la première fois un être qui<br />
allait me marquer en profondeur, un être auquel j’allais, en dépit de nos singularités ou plutôt grâce<br />
à elles, être lié jusqu’à sa mort prématurée. Jacques S. me fascina d’emblée. Je peux même dire<br />
qu’il m’inquiéta. C’était un jeune homme de fièvre absolue. Je devinais aussitôt que tout son corps<br />
n’était qu’une électricité concentrée, source de douleur. Son regard avait quelque chose d’halluciné,<br />
- 71 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
de vacillant. Il me fit songer à Antonin Artaud. La rage de Jacques n’avait pas de limites. Elle<br />
brûlait tout sur son passage. Il avait entendu au pied de la lettre les objurgations de Rimbaud, de<br />
Vaché, de Breton. Il s’acharnait à tenter coûte que coûte de changer de vie. La drogue était un outil<br />
parmi d’autres. Toutes ses forces étaient dirigées contre les limites de peau et de pensée qui nous<br />
retiennent rivés au sol acre, aride, alors que, tel Icare, nous éprouvons la tentation lancinante de<br />
prendre notre envol et d’approcher le soleil qui ne peut être que « noir ». Jacques longeait en<br />
permanence un précipice où hurlaient au fond des monstres échappés des récits d’horreur de<br />
Lovecraft. Je pressentais obscurément que ce jeune homme de feu et de colère ne vivrait pas vieux<br />
parmi les troupeaux de la soumission et de la servilité. Horrible prédiction qui s’avéra juste. Je ne<br />
sais ce qui nous porta l’un vers l’autre. Toujours est-il que nous devînmes vite deux inséparables. Il<br />
vivait encore chez ses parents, d’insolites et admirables parents. Sa mère était une femme douce,<br />
particulièrement instruite mais qui craignait quelque peu le voisinage des volcans et laves<br />
surréalistes. Le père, un fonctionnaire sans éclat apparent, avait une passion dévorante : Gérard de<br />
Nerval. Il avait consacré plusieurs études au poète d’Aurélia, études qui de l’avis de son fils étaient<br />
loin d’être négligeables. Nerval était le carrefour où se croisaient les routes de ces deux hommes<br />
que séparaient plusieurs générations, l’expérience.<br />
Jacques et moi nous nous réfugions dans la petite chambre encombrée de livres, de dessins,<br />
d’objets récupérés dans quelque brocante, sur quelque décharge publique. Nous écoutions des<br />
disques de jazz, des musiques « primitives ». Nous nous lisions mutuellement nos textes. Jacques<br />
écrivait comme on griffe le papier. Ses proses, ses poèmes opéraient au plus profond de l’être<br />
humain, là où Eros et Thanatos s’empoignent en un combat décisif. Leur rythme était haletant le<br />
plus souvent. Ce rythme restituait bien l’impatience vécue par Jacques, impatience qui était mienne.<br />
Quelques–uns de ces textes ont été publiés, quelques années après sa fin tragique. Mais je songe à<br />
d’autres qui demeurent inédits et dont j’avais reçu la marque en Z, tels ces Cris de l’écriture qu’il<br />
conviendrait, pour le bénéfice des jeunes révoltés d’aujourd’hui, d’arracher à leur clandestinité.<br />
Je voyais Jacques presque chaque jour, sauf lorsque j’étais absent de Paris pour aller mener<br />
ailleurs d’autres combats où ceux qui y participaient recouraient à des armes beaucoup plus<br />
classiques. Mais quand nous étions ensemble c’était folle vie. Nous allions au cinéma jusqu’au<br />
vertige. <strong>Les</strong> bouches fardées des grandes stars hollywoodiennes nous étaient rendez–vous<br />
quotidiens. En bons surréalistes que nous étions, que nous souhaitions être, nous n’évitions pas des<br />
films idiots sachant qu’il y avait peut–être, blotti au cœur de ces bandes, à l’insu de tous d’ailleurs,<br />
un moment de poésie ravageuse, un éclair entre deux nuits. L’iconoclastie des Marx Brothers nous<br />
enchantait, mais tel navet de Delannoy ou de Léo Joannon, transfigurés par nos regards, pouvait<br />
déboucher sans prévenir sur une prairie de merveilles. Vigo et Bunuel étaient nos dieux. <strong>Les</strong> jambes de<br />
Cyd Charisse nous faisaient traverser au pas de course Paris, les yeux de Lauren Bacall nous<br />
plongeaient dans une songerie sans nom, le bas de Marlène Dietrich dans l’Ange bleu nous faisait ciller<br />
et Jean Harlow avait droit à nos aveux chavirés.<br />
Un jour, nous décidâmes de passer aux actes. Puisque le cinéma nous fascinait tant nous allions<br />
tourner un petit film. Nous concoctâmes un scénario aussi délirant que ceux qu’écrivaient Robert<br />
Desnos et Benjamin Péret. Cela s’appelait La Vie ne tient qu’à un fil. C’était une farce d’humour<br />
noir, l’histoire tragique d’un homme décidé au suicide mais qui rate chacune de ses tentatives. Nous<br />
avions rassemblé quelque argent, le matériel minimum, quelques <strong>amis</strong> techniciens. Il y avait une<br />
scène invraisemblable qui se passait dans la cage d’ascenseur du vieil immeuble où habitait<br />
Jacques. Ce fut un tournage homérique. Il ne fut jamais vraiment achevé. Nous passâmes à autre<br />
chose. Surtout ne pas rester immobiles, ne pas s’enfermer.<br />
Il y eut d’étonnantes dérives à travers Paris. Nous avions toute confiance dans le hasard objectif.<br />
Nous aussi nous étions en quête de Nadja. Nous parcourions des faubourgs tristes, des ruelles mal<br />
- 72 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
éclairées, des cafés ouvriers, des bouges sordides, des halls de gares où nous restions de longues<br />
minutes à contempler cette inscription : Partie du train restant en gare. Comme tous les vrais<br />
poètes j’ai toujours aimé les gares, ces sortes de no man ’s land où peut se jouer l’aventure, où l’on<br />
quitte sa peau pour une peau encore inconnue, où l’on peut se vêtir de toutes les identités y compris<br />
les plus saugrenues, où il n’est pas impossible qu’apparaisse brusquement, à travers le rideau d’un<br />
jet de vapeur libéré par la vieille locomotive « la femme de votre vie ». Plus tard il me fut donné de<br />
fréquenter les gares en compagnie de Blaise Cendrars et de son chien Wagon-Lit. Nous nous<br />
rendions de préférence Gare de Lyon où l’Orient Express n’attendait plus que nous pour quitter<br />
enfin le quai avec son convoi de consuls, d’espionnes baltes, de joueurs de casinos traqués par les<br />
polices, de riches marchands de bijoux, de Princes sans couronne.<br />
Une de ces dérives nous amena, une nuit de Noël, aux Halles, à L’Alsace à Paris. L’atmosphère<br />
était étonnante, bigarrée, à la hauteur de nos vœux : des gens en fête, des clochards aux regards<br />
vineux, des bouchers et des poissonniers des Halles. Un accordéoniste jouait des chansons<br />
populaires que des tables entières passablement éméchées reprenaient en chœur au refrain. Des<br />
guirlandes tombaient du plafond. Il régnait là une fumée à couper au couteau. Un indescriptible<br />
brouhaha remplissait l’immense salle. Jacques et moi nous parvînmes à nous faire une place, autour<br />
d’une minuscule table poussée dans un coin. Nous étions pour tout dire ivres ayant célébré à<br />
maintes reprises, le long du trajet, l’imminente naissance du fils de dieu. C’est alors que mes yeux<br />
accrochèrent un visage qui ne m’était pas, loin de là, inconnu. C’était Alberto Giacometti en<br />
compagnie d’une jeune et charmante personne. Nous ne connaissions pas véritablement Alberto.<br />
Nous l’avions côtoyé à Montparnasse. Mais, Jacques et moi, admirions profondément son œuvre et<br />
sa personne. C’est le vin qui me donna sans aucun doute le courage nécessaire. Je me redressai<br />
péniblement sur ma chaise et, louvoyant entre les couples enlacés, les serveurs, je titubai jusqu’à la<br />
table de Giacometti. Arrivé là je ne sus quoi dire. Le rouge de la confusion envahit mon front. Je<br />
bafouillai un vague : « Bonjour Monsieur Giacometti » et filai aussitôt retrouver Jacques. J’étais<br />
honteux. Je plongeai le nez dans mon assiette. C’est alors qu’une voix nous arracha à nos douces<br />
brumes. Alberto Giacometti se tenait devant nous, visage affable. Il nous invita à rejoindre sa table.<br />
Ce qui nous fîmes sans hésiter. Ce fut le début d’une mémorable nuit qui nous laissa à l’aube tous<br />
couchés sur le flanc. Sans doute n’avions-nous pas rencontré Nadja. Mais le regard d’Alberto était<br />
un tout autant essentiel trésor.<br />
Nadja… il me faut évoquer ici l’étrange histoire qui m’arriva car Jacques en fut d’une certaine<br />
façon témoin. Et aujourd’hui encore, si la nostalgie de l’amour fou vient par surprise m’émouvoir,<br />
je ne puis que songer à celle que j’ai pour toujours nommé Nadja de Nantes.<br />
Pour rajouter au charme, il aura fallu que cette histoire m’arrivât dans une ville qui a toujours<br />
résonné aux oreilles des surréalistes comme une invitation à la magie. J’avais un autre ami poète qui<br />
vivait alors à Nantes. Je lui avais fait connaître au cours d’un premier déplacement Jacques. Ils<br />
avaient sympathisé. Un jour cet ami nous invita à nouveau, Jacques et moi. Nous décidâmes de<br />
répondre à l’invitation. C’était une occasion d’aller rêver dans le mystérieux Passage Pommeraye<br />
que nous devions retrouver, plus tard, avec émotion, dans le film de Jacques Demy : Lola.<br />
Nous arrivâmes chez Paul, dans la soirée. C’était le début du printemps. L’air était chargé de<br />
parfums. Après un apéritif, nous passâmes à table. La femme de Paul avait préparé un dîner simple<br />
et succulent. Quelqu’un pénétra alors dans la maison sans frapper. D’abord je n’arrivais pas à<br />
distinguer si cet être était un homme ou une femme. Un long imperméable à capuchon me dérobait<br />
le sexe de cette personne. Quand elle sortit de la pénombre, je sus aussitôt qu’il s’agissait d’une<br />
femme. Son regard me happa. C’était un regard étrange, un regard qui visiblement passait au–<br />
dessus des choses pour se poser ailleurs. La jeune femme salua, se pencha vers Paul et murmura<br />
quelques mots. Paul fit « oui » de la tête. La jeune femme disparut vers une autre pièce. J’étais<br />
- 73 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
troublé. J’essayais de cacher ce trouble. Cinq minutes plus tard, la jeune femme reparut, salua à<br />
nouveau et sortit de la maison. Je laissai passer quelques minutes, puis d’un air qui se voulait<br />
indifférent, je questionnais Paul à propos de l’inconnue. Paul me dit qu’il ne la connaissait pas très<br />
bien, qu’à priori elle demeurait aux lisières de la ville, dans une grande demeure bourgeoise, en<br />
compagnie d’une grand–mère qui n’avait plus toute sa tête. Paul ne savait pas exactement à quoi<br />
cette jeune femme vouait son existence. Ce qu’il pouvait dire c’est qu’elle était une personne très<br />
raffinée, musicienne, passionnée de poésie. Elle apparaissait sans prévenir chez Paul puis<br />
disparaissait et ne donnait plus de nouvelles pendant de longues semaines. C’était beaucoup, c’était<br />
peu pour atténuer mon trouble. Au contraire, à mesure que Paul me confiait ce qu’il savait ou<br />
croyait savoir, mon trouble allait grandissant. Je fis effort pour chasser de mon esprit cette présence.<br />
C’est alors qu’à nouveau la porte s’ouvrit sur la jeune femme. Sans dire un mot elle se débarrassa<br />
de son imperméable et prit place près de Paul. Jacques aussi était fasciné. Du coin de l’œil, tout en<br />
m’efforçant de donner les apparences, je l’observais. Son visage n’était pas sans rappeler celui<br />
d’une déesse que j’avais par hasard contemplée, en feuilletant un album d’art. Sa chevelure partagée<br />
en deux masses sombres était nouée en chignon sur la nuque. La chair était très pâle. Elle avait dans<br />
un geste adorable, volontaire (?) croisé ses bras sur la poitrine et je pouvais voir ses longues mains,<br />
objet sans aucun doute d’un soin méticuleux.<br />
Le repas était achevé depuis un long moment quand Paul proposa de faire une petite promenade.<br />
<strong>Les</strong> enfants applaudirent. Paul invita la jeune femme à nous suivre. Nous partîmes à pas lents. Le<br />
hasard (?) fit qu’au bout de quelques minutes je me retrouvais, seul, en sa compagnie. Jacques, Paul<br />
et sa femme marchaient à plus de vingt mètres devant nous, précédés par les trois enfants du couple.<br />
Nous nous dirigions vers le port. C’était l’heure entre chien et loup. La nuit commençait à noyer les<br />
choses. Je restais silencieux. Je n’osais pas rompre le silence. Et puis que dire ? La jeune femme ne<br />
semblait éprouver le désir de parler. Elle regardait droit devant elle. Nous traversâmes plusieurs rues<br />
étroites, des places désertes. C’est alors que je me rendis compte que nous avions perdu nos <strong>amis</strong>. Je<br />
ne pus m’empêcher d’en faire la remarque à voix haute. La jeune femme se tourna vers moi et dit<br />
« Venez ». Totalement subjugué je pris la main qu’elle me tendait, une main glacée et brûlante à la<br />
fois.<br />
Comment ressusciter ce qui arriva ensuite. <strong>Les</strong> mots sont impuissants. Comment nommer des<br />
lieux, des moments que j’ai traversé comme un somnambule. Plus tard, évoquant cette aventure<br />
dans un récit que j’écrivais, il m’arriva de me poser franchement la question : « André, n’as–tu pas<br />
rêvé tout cela ? La vérité c’est que j’ai rêvé à l’intérieur d’un rêve. La jeune femme m’entraîna.<br />
Connaissant à peine la topographie de la ville, j’étais proprement égaré. Mais égaré je l’étais à tous<br />
les sens du mot.<br />
La jeune femme sortit une clé de sa poche. Nous pénétrâmes dans un vaste appartement obscur<br />
où tous les meubles étaient recouverts d’une housse. Elle semblait connaître les lieux par cœur.<br />
J’aperçus accrochés aux murs des tableaux classiques, des nus, des scènes de chasse. Nous entrâmes<br />
dans une pièce plus petite. Un grand lit à colonnes en occupait le centre. La jeune femme, presque<br />
collée à mon corps, me fixa avec une intensité décuplée. Lentement sa bouche se rapprocha de la<br />
mienne. Elle noua ses mains sur ma nuque et m’embrassa avec une violence qui me fît presque<br />
peur. Mais je ne pouvais même pas envisager de fuir. J’étais incapable de faire un pas de côté. Le<br />
baiser dura longtemps, une éternité peut–être. Je vacillais. J’avais le ventre écartelé, les épaules<br />
percées par une foudre blanche. Nous roulâmes sur le lit à colonnes. Nous fîmes l’amour. À un<br />
moment, je voulus lui demander son nom, apprendre quelque chose d’elle. Elle posa un doigt sur<br />
mes lèvres. Je me gardai de récidiver.<br />
Tard dans la nuit nous quittâmes cet appartement. Nous marchâmes à travers la cité éteinte. Nous<br />
nous retrouvâmes au buffet de la gare où somnolaient quelques voyageurs en attente du train. Nous<br />
bûmes plusieurs cafés. Puis notre errance reprit. L’inconnue m’entraîna encore dans d’autres lieux,<br />
- 74 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
déserts, étranges, comme abandonnés, qu’elle semblait parfaitement connaître aussi. Plusieurs fois<br />
l’étreinte érotique mêla nos chairs, nos souffles.<br />
À l’aube j’étais fourbu. Un banc de pierre d’une petite place où résonnaient les pas des premières<br />
religieuses se rendant à l’office m’accueillit. La jeune femme dont j’ignorais toujours tout se tenait<br />
debout devant moi. Soudainement, elle se pencha vers moi, m’embrassa longuement et murmura<br />
« Adieu ». Quand je pus réagir contre le sommeil qui commençait à me paralyser, elle avait déjà<br />
disparu. Je courais en tous sens, scrutant les alentours. J’écoutais. <strong>Les</strong> seuls pas qui résonnaient<br />
étaient ceux des religieuses à cornettes qui, par groupe de cinq ou six, se dirigeaient vers les Églises.<br />
Je regagnais la maison de mon ami. Il ne me questionna pas. J’inventais n’importe quoi. Je me<br />
couchai et m’endormis d’un profond sommeil. Le soir même, Jacques et moi regagnâmes Paris.<br />
Emporté par le tohu-bohu quotidien je n’arrivais pas à oublier mon inconnue. Avec Jacques à qui<br />
j’avais tout raconté, j’échafaudais des hypothèses.<br />
Deux semaines plus tard le mystère devait encore s’épaissir. Je reçus un courrier de mon ami<br />
Paul. À la lettre était jointe une coupure récente de journal. L’article évoquait un fait–divers :<br />
quelques jours plut tôt, la police avait repêché près du vieux port le cadavre d’une jeune femme<br />
dont le corps portait des traces de torture. C’était à n’y pas croire. La photographie qui<br />
accompagnait l’article représentait un visage qui ressemblait exactement au visage que j’avais<br />
étreint entre mes paumes, durant cette longue nuit de vertige et d’incendie. Il ressortait de l’article<br />
que la jeune femme était de toute apparence une prostituée qui avait dû être « punie » pour quelque<br />
obscur motif. Dans sa lettre Paul exprimait aussi son étonnement. Je lui répondis aussitôt que je<br />
serai à Nantes le prochain week-end afin de tenter d’élucider le mystère. Dans un télégramme, Paul<br />
me fit savoir qu’il valait mieux que je patiente deux semaines, qu’il était contraint de se rendre à<br />
l’étranger avec sa femme et ses enfants. Quelques jours plus tard Le Monde m’apprenait que l’avion<br />
à bord duquel mes <strong>amis</strong> avaient pris place avait sombré corps et biens dans l’Océan Atlantique. Il ne<br />
restait aucun survivant. Longtemps après toujours obsédé par cette étrange histoire, je me rendis à<br />
Nantes. Je fis une « enquête », j’interrogeais des patrons de cafés, des marchands de journaux, des<br />
vieilles gens. Je ne pus trouver la moindre piste. La police avait rangé le dossier. Il était dit que<br />
Nadja de Nantes garderait son secret, vivante et morte, fantasme ou réalité.<br />
Ma « militance » libertaire m’éloignait souvent des réunions quotidiennes du groupe surréaliste.<br />
C’est pourquoi je n’ai que peu collaboré aux activités du groupe, tout en étant présent, au bord. De<br />
plus, je vivais un conflit profond. Tout en étant en accord avec les objectifs du Surréalisme, tout en<br />
partageant nombre de conceptions de ses membres, la poésie que je tentais d’écrire échappait au<br />
Surréalisme. Je voulais non seulement explorer le royaume des images, les zones obscures de l’Être,<br />
mais je voulais dire encore la réalité quotidienne, les luttes, la vie immédiate ; chaude,<br />
contradictoire. Je me nourrissais déjà beaucoup de poésie hispano américaine, je continuais à subir<br />
la fascination des poètes expressionnistes. Je n’arrivais pas à suivre Breton dans certains<br />
développements « mystiques ». J’étais passablement déchiré.<br />
Mais j’aimais retrouver Breton et les autres à Saint–Cirq–Lapopie, dans ce vieux village<br />
suspendu, comme soudain pétrifié dans son inévitable chute, au–dessus du Lot. Là, loin de Paris,<br />
l’amitié se réchauffait au doux soleil. Des « jeux » multiples nous rassemblaient autour d’une table.<br />
<strong>Les</strong> « cadavres exquis » ouvraient les portes de corne et d’ivoire. La vielle maison de mariniers que<br />
Breton avait rachetée était accueillante. Nous nous promenions en quête de cailloux étranges que nous<br />
ramassions le long des rives de la rivière.<br />
Est–ce à Saint–Cirq que Jacques et moi, dans les premiers mois de la Guerre d’Algérie,<br />
rédigeâmes un « tract » violent dans lequel nous célébrions l’acte d’un jeune appelé qui pour ne pas<br />
aller combattre, pour ne pas quitter celle qu’il aimait, avait demandé à celle–ci de lui trancher d’un<br />
coup de hache, deux doigts de la main droite ? Le jeune homme fut condamné. Devenu incapable de<br />
- 75 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
manœuvrer un fusil, il ne participa pas à la « sale guerre ».<br />
Une fois de plus la liberté était en péril. Une fois de plus elle était bafouée, frappée.<br />
Mais les amants étaient plus grands que les bourreaux.<br />
Jacques devait mourir quelques années plus tard, dans des circonstances tragiques : hydrocuté<br />
dans une rivière du sud de la France, par une belle matinée d’été. On le retrouva, paraît–il,<br />
agenouillé, affaissé au milieu du mince courant d’eau. Mort.<br />
Une autre liberté commençait pour lui. Moi je n’en avais pas encore terminé avec les affres et les<br />
ombres.<br />
- 76 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
ALGÉRIA<br />
OU<br />
LES SAISONS<br />
SAUVAGES<br />
- 77 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
La guerre d’Algérie commença la nuit de la Toussaint 1954. J’étais rentré d’Espagne quelques<br />
jours plus tôt. J’avais enfin obtenu de Paco l’autorisation de participer à une « opération » de son<br />
groupe. J’avais connu Paco dans les locaux de la F.C.L. Nous nous étions liés d’amitié<br />
immédiatement, dès le premier coup d’œil. Paco était un fils d’anarchistes espagnols qui avaient été<br />
exécutés durant la guerre civile au garrot. Paco était encore un très jeune enfant. Il participa aux<br />
derniers combats quand les révolutionnaires désarmés ou presque luttaient pour la dignité. Avec des<br />
enfants de son âge il montait, mains nues, à l’assaut des nids de mitrailleuses franquistes. Tous ceux<br />
qui avaient à craindre la haine de Franco franchissaient la frontière. Tous ceux qui fuyaient, refusant<br />
de continuer à vivre sur le sol d’un pays abattu par la bête fasciste, se heurtaient aux gendarmes<br />
français qui les dirigeaient vers les camps d’accueils (!) où on les parquait comme déjà en<br />
Allemagne nazie Hitler et ses fauves SS parquaient les juifs, les oppositionnels, les démocrates, les<br />
libéraux, les insoumis avant de les exterminer. Parmi eux, il y avait le poète Antonio Machado,<br />
épousant la douleur de son peuple, liant définitivement son sort à la troupe des vaincus, des humbles<br />
dont la supériorité en armes des insurgés avait eu raison. On sait que c’est à Collioure que Machado<br />
devait rendre l’âme, épuisé, brisé par la tragédie sanglante, par la mise en croix de son Espagne du<br />
marteau et de la faux.<br />
Paco avait dû fuir comme les autres. Mourir avait été une tentation. Mais une autre tentation<br />
avait triomphé : celle de demeurer vivant pour venger les siens, ses parents, son peuple bafoué,<br />
martyrisé. Depuis ces heures affreuses, toute l’énergie de Paco avait consisté à sauver en lui les<br />
forces de vie, à nourrir sa haine lancinante et lumineuse, à vaincre tous les obstacles qui auraient pu<br />
le mener à la mort, au tombeau. Il s’était fait une santé de fer. Il avait violenté son corps afin que<br />
celui–ci acquiert une résistance inébranlable. Il avait entretenu sans cesse la flamme dans son esprit.<br />
Paco avait survécu avec l’aide d’<strong>amis</strong> français. Il avait traversé sans trop de difficultés la seconde<br />
guerre mondiale. Grâce à un vieux compagnon réchappé, lui aussi, de l’enfer, il avait apprit tous les<br />
secrets du métier d’orfèvre.<br />
Quand je fis sa connaissance, Paco était officiellement orfèvre. Il gérait une petite boutique dans<br />
une rue assez sordide du quartier de la Bastille. Je ne pense pas que la police était dupe. Car Paco<br />
n’était pas qu’un orfèvre apparemment tranquille, un homme sans histoires, un brave père de<br />
famille. Il était l’animateur d’un réseau de lutte antifranquiste. Il lui arrivait assez régulièrement de<br />
s’absenter de Paris. <strong>Les</strong> clients ne discutaient pas les prétextes avancés par sa compagne qu’il<br />
nommait toujours Melba. Ce n’était sans doute pas son vrai prénom. Je ne connus jamais le vrai.<br />
Melba était d’origine andalouse. C’était une femme d’une beauté étonnante. Je ne sais si cette<br />
beauté résidait dans sa chevelure toute sombre, dans la pure blancheur de sa peau, dans le doux<br />
profil de son visage.<br />
Dès notre première rencontre Paco m’invita chez lui. Il habitait un minuscule appartement au–<br />
dessus de la boutique. Le mobilier était des plus rudimentaires : une table, une grosse armoire, un<br />
buffet, un lit, le lit de leur adorable fillette de trois ans, quelques chaises plus ou moins branlantes.<br />
Mais sur cette pauvreté assumée rayonnait Melba. Sa présence transfigurait la grisaille des murs<br />
lépreux, le carreau à travers lequel ne filtrait qu’une maigre lumière étouffée par les murs d’une<br />
- 78 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
arrière–cour. Des livres, des brochures, des journaux encombraient plusieurs rayonnages cloués le<br />
long des murs.<br />
Paco avait, par–delà sa compagne, sa fille, la volonté de venger ses parents et son peuple, le<br />
communisme libertaire, une autre passion : la poésie. Il écrivait d’étranges petites pièces de théâtre<br />
qui se passaient curieusement presque toujours dans les tombes des cimetières. <strong>Les</strong> squelettes<br />
vivaient dans ces lieux incongrus des aventures semblables à celles que vivaient ceux qui respiraient<br />
au–dessus d’eux, ils connaissaient les transes de l’amour et de la jalousie, les affres de la mort, les<br />
sueurs de l’angoisse, les rages des rebelles, les violences de l’oppression, les songes de la libération<br />
possible, espérée. Le verbe de Paco avait la puissance d’un soc de charrue éventrant les terres<br />
incandescentes de sa région natale – il était natif du Levant. Il ressemblait assez au poète Miguel<br />
Hernandez qui mourut épuisé dans les prisons d’Alicante en répétant le nom de sa bien–aimée :<br />
« Josefina, Josefina… ». Paco avait la vigueur d’un figuier ardent. Il se déplaçait avec cette légèreté<br />
et cette maîtrise des mouvements de qui sait qu’à tout instant il peut prendre une balle dans la peau.<br />
Il savait l’économie des gestes. Je ne sais pourquoi mais il réveillait en moi l’image d’un autre<br />
meneur anarchiste qui avait, dans les années 20, fait trembler les bandes fascisantes de l’époque :<br />
Noy del Sucre.<br />
Avec Paco, je plongeais dans la réalité espagnole. Par–delà l’apparente léthargie, j’écoutais les<br />
voix de ceux qui résistaient, de ceux qui n’avaient pas abdiqué, de ceux qui, dans un dérisoire défi,<br />
affrontaient les forces de la répression, un appareil gouvernemental sauvage, de ceux qui prenaient<br />
les risques d’être arrêtés vivants, de subir les plus sadiques tortures.<br />
J’aidais Paco à rédiger, imprimer des tracts, des brochures. J’étais toute attention quand il<br />
recevait des messages et commentait la situation du moment.<br />
Un jour, je lui avouais que je désirais agir avec lui, que je voulais exposer ma poitrine pour le<br />
salut de l’Espagne. Il eut un grand éclat de rire, me jeta un œil tendre. Melba aussi souriait. J’étais<br />
vexé. J’avais la ferme sensation que Paco ne me croyait pas capable de remplir une tâche<br />
révolutionnaire. Romantique, je me promettais à moi–même d’être capable de mourir si la situation<br />
l’exigeait, de me taire même sous la pire torture, de ne pas dénoncer mes compagnons.<br />
Paco remplit mon verre. Il me donna une grande tape dans le dos et suggéra qu’il était temps<br />
d’aller dormir car les hommes qui veulent devenir libres doivent savoir se lever au premier chant du<br />
coq.<br />
Dans mon coin je rongeais silencieusement mon frein. Je continuais mes activités quotidiennes.<br />
À cette époque pour vivre je demandais à ma plume toutes sortes de sacrifices. J’écrivais des<br />
âneries pour des hebdomadaires féminins, je travaillais un peu pour des agences de publicité, je<br />
publiais des articles dans Combat. Il y avait un sujet que j’étais en mesure alors de développer<br />
amplement : Comment crever de sa plume. Je raconte tout cela dans un autre livre en chantier qui<br />
s’appellera, ou ne s’appellera pas, <strong>Les</strong> doigts pleins d’encre.<br />
Depuis quelques temps je vivais avec une jeune étudiante de l’École des Beaux–Arts :<br />
Christiane. Nous habitions dans un misérable atelier de la rue de la Glacière, située juste au–dessus<br />
de la rivière souterraine, la Bièvre. <strong>Les</strong> autres ateliers étaient pour la plupart occupés par des<br />
artistes. Nous formions une communauté fraternelle, nous entraidant les uns les autres. Celui ou<br />
celle qui avait gagné quelque somme d’argent en prêtait une partie à celui ou celle d’entre nous qui,<br />
à ce moment–là, était particulièrement démuni. Christiane était la fille d’un couple d’industriel du<br />
nord de la France, très conservateurs à tous points de vue. Bien qu’ils n’éprouvassent que haine à<br />
mon égard, ils envoyaient régulièrement à Christiane un chèque ou un mandat. Ils ne désespéraient<br />
pas de la séparer de moi. À leurs yeux, et compte tenu de leur ignorance crasse, je n’étais qu’un<br />
voyou de communiste.<br />
J’aimais Christiane, je m’accrochais. Elle semblait être heureuse près de moi. Elle semblait<br />
- 79 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
partager mes révoltes et mes combats. Elle n’hésitait pas à me montrer les lettres ignobles,<br />
hypocrites, que sa mère lui écrivait quasi quotidiennement, lettres dans lesquelles elle disait la<br />
souffrance que son mari et elle éprouvaient à l’idée de l’existence que Christiane vivait. Elle en<br />
appelait à sa compréhension, à sa raison. Elle acceptait bien de reconnaître qu’érotiquement<br />
Christiane pouvait avoir des motifs de vivre en ma compagnie, mais elle montrait du doigt les<br />
inévitables gouffres qui nous guettaient tous deux. Jour après jour, cette mère catholique,<br />
bourgeoise démolissait sa propre fille, le fruit de ses entrailles. Elle avait déclenché contre moi une<br />
guerre inexpiable. C’est cette femme qui l’emporta.<br />
Elle et son pâle époux y mirent le temps. Mais ils œuvrèrent avec la patience des rats. Ils<br />
connaissaient trop bien les failles, les faiblesses de leur fille. Ils n’ignoraient pas combien ce conflit<br />
alimenté par eux seuls épuisait ma compagne.<br />
C’est alors que le destin vint à leurs secours. Ce fut pour moi une douloureuse période qui<br />
m’éloigna contre mon gré et de la FCL et de Paco et et de tout ce qui faisait ma vie.<br />
Un jour, Christiane m’avoua qu’elle était enceinte. Je n’avais encore jamais été père. C’était une<br />
perspective qui à la fois m’excitait et m’effrayait. Après en avoir longuement causé, nous décidâmes<br />
de ne pas permettre à cet enfant de naître. Malheureusement, Christiane, au nom de je ne sais quelle<br />
pudeur, quel souci de ne pas m’importuner, avait attendu le dernier moment pour me mettre en<br />
confidence. Nous ne disposions plus que d’un temps très limité pour intervenir. À cette époque,<br />
toute personne complice d’un avortement, à moins qu’elle ne fisse partie du petit monde ayant le<br />
bras long, risquait énormément. Je pris aussitôt contact avec une camarade anarchiste docteur qui<br />
accepta d’emblée de nous secourir. Elle nous fixa rendez–vous pour le lendemain matin. Elle vint<br />
comme promis, fit son ouvrage avec dextérité. Elle me précisa divers détails, elle promit de revenir<br />
quelques heures plus tard. Tragiquement, le destin une fois de plus joua contre nous. Quelques<br />
minutes après nous avoir quittés, cette camarade entra en collision avec une autre automobile. Elle<br />
fut assez grièvement blessée, assez pour se trouver dans l’impossibilité de songer à nous joindre.<br />
Christiane souffrait. Je n’avais jamais été témoin d’une scène où une femme s’apprêtait à accoucher<br />
ou avorter. Je mordais mes poings d’impuissance. Je posais des linges frais sur le front de<br />
Christiane que je renouvelais fréquemment. <strong>Les</strong> douleurs la déchiraient de plus en plus violemment.<br />
Je craignais qu’elle rejetât la sonde. À mesure qu’approchait l’heure où notre camarade devait<br />
frapper à la porte, mon angoisse grandissait. J’appréhendais obscurément quelque catastrophe. Je ne<br />
me trompais pas. L’heure sonna. Personne. J’allais et venais du lit à la fenêtre, épiant tout véhicule<br />
cherchant une place dans mon champ visuel. Une longue heure passa. Rien. J’étais vraiment affolé.<br />
Christiane, ruisselante de sueur, gémissait. Ses ongles s’enfonçaient dans son ventre meurtri. Une<br />
autre heure fit défiler ses lugubres minutes. Toujours rien. J’étais désespéré. Je craignais en alertant<br />
la police de nous jeter dans la gueule du loup. Je téléphonais chez mon amie. Personne ne répondit<br />
sinon le lancinant tintement du téléphone.<br />
Je me jetai à genoux au chevet de Christiane. Je lui demandai pardon pour toutes ces souffrances.<br />
Je pleurai. Elle s’efforçait à sourire.Quand elle pressentit que le moment était venu elle me demanda<br />
d’aller chercher une grande bassine.<br />
Un mouchoir enfoncé au fond de la gorge elle vécut de longs moments un vrai martyre. Ce fut<br />
épouvantable, atroce, à vomir. Christiane portait des jumeaux dont la forme humaine était déjà<br />
largement dessinée.<br />
Je fermais les yeux d’horreur. Je titubais renversant lampe et piles de livres. J’avais envie de fuir.<br />
Quand tout fut enfin terminé Christiane me demanda d’achever la besogne. Je vidai, le cœur broyé<br />
d’une effroyable nausée, le contenu de la cuvette dans un sac en plastic. Je revêtis un duffle–coat<br />
sous lequel je cachais le sac du crime. Je descendis dans la rue, fis d’un pas qui se voulait apaisé le<br />
tour du pâté de maison. Soudain, la gueule d’un égout accrocha mon regard. Je vérifiai que<br />
personne ne m’observait. Je jetai le sac qui disparut, englouti par la bouche affreuse. Je courus<br />
- 80 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
jusqu’au premier café où je bus coup sur coup trois rhums. Puis je téléphonais à un autre ami<br />
médecin, lui demandant de venir d’urgence à la maison, de me faire confiance puisque je n’osais<br />
pas lui expliquer de vive voix au téléphone la raison de mon appel.<br />
Il vint aussitôt, soigna Christiane afin de lui éviter l’infection prévisible. Il jura de garder le<br />
secret. Il me réconforta. Tout s’était bien passé. Il n’y avait pratiquement rien à redouter.<br />
Christiane, épuisée, s’était endormie. Je restais jusqu’au cœur de la nuit, effondré sur une chaise,<br />
incapable de lire, de penser, de ne rien faire. Je ne pouvais chasser de mes yeux ces deux petites<br />
formes qui étaient des petits de femme et d’homme et que nous avions condamnés à mort, aussitôt<br />
que sortis du ventre maternel.<br />
De ce jour-là quelque chose se défit entre Christiane et moi. Ce fut d’abord imperceptible, puis<br />
de plus en plus flagrant. Christiane en était venu à me haïr. Sa famille avait presque remporté la<br />
bataille. Il ne me manquait plus que le coup de grâce. Il vint sous la forme d’un ami de Christiane,<br />
un ami d’adolescence dont la famille était très liée à celle de ma compagne. Je compris très vite que<br />
les deux familles avaient espéré un mariage entre Christiane et ce garçon, ni beau ni laid, mais<br />
quelque peu fortuné, appelé à prendre la succession de son père à la tête de l’entreprise familiale. Je<br />
l’avais accueilli chez nous en toute sympathie. Il venait fréquemment partager notre dîner.<br />
J’étais très pris par mes multiples occupations à la FCL et ailleurs ainsi que par la conquête du<br />
pain quotidien. Je délaissais de plus en plus Christiane. Un jour que je me rendais chez Paco, je le<br />
trouvais soucieux. Il avait reçu de fort mauvaises nouvelles d’Espagne. Depuis plusieurs jours les<br />
arrestations de membres de son réseau se multipliaient. <strong>Les</strong> camarades responsables en étaient<br />
arrivés à la ferme conviction que ces arrestations n’étaient pas les fruits du hasard, mais qu’il y avait<br />
un « traître » dans les rangs de l’organisation. <strong>Les</strong> soupçons se portaient vers un certain Miguel.<br />
Toutes sortes de recoupements, d’indications prouvaient presque à coup sûr que c’était bien lui qui<br />
dénonçait aux franquistes les militants libertaires. En accord avec Paco, à qui ils demandaient de<br />
venir d’urgence, les responsables avaient décidé de démasquer Miguel. Pour ce faire, ils décidèrent<br />
de mener une opération suicide : un attentat contre un bâtiment administratif à Madrid. Compte tenu<br />
de leur quasi certitude de la culpabilité de Miguel, il n’y avait plus que deux solutions<br />
envisageables : ou Miguel pressentant qu’il était soupçonné ferait en sorte que l’opération se<br />
déroule sans encombre, ou bien persuadé de son rôle secret, il transmettrait les renseignements à la<br />
police. L’organisation avait rassemblé une dizaine de volontaires. Miguel avait été tenu habilement<br />
à l’écart, de telle sorte qu’il ne se doutât de rien. Paco devait diriger l’opération. Ce matin–là quand<br />
je le retrouvais, il se préparait au départ qui devait avoir lieu le soir même. C’est alors qu’il me<br />
regarda curieusement « tu veux toujours agir pour la liberté de l’Espagne ? ». Je lui répondis<br />
« oui ». Il réfléchit longuement puis il me dit : « alors tu peux venir avec moi ».<br />
Jusqu’au lendemain je vécus dans l’excitation. À l’heure dite, je me retrouvais chez Paco. Melba<br />
avait préparé un bon dîner. Elle agissait comme si Paco et moi partions en voyage d’agrément.<br />
Melba avait une volonté fantastique. Elle cachait son émotion. Pourtant, chaque départ de Paco la<br />
jetait dans des abîmes d’angoisse car elle savait que la tête de son compagnon était mise à prix.<br />
Mais elle aussi était chair martyrisée d’Espagne, elle aussi était crucifiée. Elle aussi haïssait la bête<br />
au chapeau de cuir bouilli.<br />
Tard dans la soirée, après avoir fait nos adieux, nous prîmes le train. Paco me recommanda de<br />
dormir. Nous avions rendez–vous dans une petite ville proche de la frontière où nous devions<br />
retrouver des camarades qui avaient organisé notre passage clandestin. Le voyage se déroula sans<br />
incidents. <strong>Les</strong> compagnons étaient à l’heure. Ils nous emmenèrent dans une maison cachée au<br />
milieu de la campagne. Paco et eux, après s’être restaurés, mirent au point les détails du passage. Il<br />
devait avoir lieu de nuit. D’autres camarades devaient nous attendre de l’autre côté. La journée se<br />
déroula rapidement en discussions, échanges, longs silences. Puis l’heure du départ sonna. Deux<br />
- 81 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
camarades étaient chargés de nous guider par des sentiers discrets où les risques étaient moindres de<br />
croiser une patrouille de « gardes civils ». Je n’avais jamais encore été en Espagne et j’ignorais tout<br />
de la région que nous allions traverser. Mais j’étais avec Paco. Cela suffisait à tempérer mon<br />
trouble. Nous marchâmes plusieurs heures avec quelques haltes. <strong>Les</strong> hommes ne parlaient pas,<br />
seulement de temps à autre une brève indication murmurée à voix basse. Paco avait toute confiance<br />
en eux. Ce n’était pas la première fois qu’il faisait le passage avec eux. Ils connaissaient<br />
parfaitement le terrain. De fait tout se passa bien. Nous ne rencontrâmes aucune patrouille. Je ne sus<br />
à quel moment je quittai la France pour entrer dans ce pays qui me hantait tant par ses poètes que<br />
par ses peuples en lutte, un pays proche et lointain dont nous parvenaient à Paris des rumeurs de<br />
sang, des noms de femmes et d’hommes suppliciés dans la nuit de l’oubli général.<br />
Enfin, nous parvînmes à un petit bois. Paco me dit que c’était là que nous allions attendre les<br />
camarades espagnols. Nous nous tapîmes dans les broussailles. Nous plongeâmes dans un demi–<br />
sommeil tandis qu’un des camarades veillait. Soudain deux silhouettes se déplaçant avec prudence<br />
apparurent. C’étaient nos relais. Nous sortîmes des broussailles. <strong>Les</strong> hommes se saluèrent avec des<br />
poignées de mains vigoureuses. Puis les « passeurs » reprirent le chemin du retour. Si tout se<br />
déroulait comme prévu, ils devaient nous reprendre au même endroit, deux jours plus tard.<br />
Nous étions en possession de faux papier. Par des chemins détournés nous marchâmes jusqu’à<br />
une automobile cachée sous les frondaisons. Destination : Madrid. J’ouvrai grands les yeux devant<br />
une réalité que je découvrais au–delà des vitres du véhicule. Nous traversâmes des villages.<br />
J’aperçus des femmes aux sombres vêtements, aux visages burinés de paysannes, des enfants, des<br />
hommes bruns, méditatifs. Nous croisâmes à plusieurs reprises des patrouilles de « gardes civils ».<br />
Des mots abstraits devenaient soudain réalité. Des vers de Lorca revinrent à ma mémoire, des vers<br />
où passaient, sombres, sanglantes, les ombres des hommes de la Guardia. <strong>Les</strong> compagnons de Paco<br />
étaient des hommes à la peau particulièrement brune, avec des yeux malicieux. C’étaient des<br />
Andalous. Ces hommes faisaient calmement leurs besognes. On devinait que chaque jour pouvait<br />
être pour eux le dernier jour de leur existence. Ils avaient pris la mesure de l’ennemi qu’ils<br />
affrontaient. Ils ne le surestimaient pas, ils ne le mésestimaient pas. Ils en connaissaient la<br />
puissance, la cruauté, la bestialité. Ils avaient mis une fois pour toutes leurs vies en jeu comme<br />
Paco. Deux Espagnes s’affrontaient depuis un siècle : l’Espagne de la lumière, de la liberté et<br />
l’Espagne de la ténèbre et du démon. Ces hommes respiraient près de moi. C’étaient des hommes<br />
avec des désirs, des faiblesses, c’étaient des hommes qui pouvaient mourir. Ce n’était pas des héros<br />
de bandes dessinées. C’étaient des frères inconnus.<br />
Nous atteignîmes ainsi les « portes » de Madrid. Nous devions faire la dernière étape à pied.<br />
Nous nous séparâmes en deux groupes. Je marchais aux côtés de Paco. Il savait où nous allions.<br />
Nous avancions à travers un faubourg pauvre. <strong>Les</strong> deux camarades qui nous précédaient<br />
surveillaient attentivement les alentours. Nous croisâmes des ouvriers silencieux, en bleus de<br />
travail, des mères humbles. Du regard, Paco me désigna une vieille maison de trois étages « c’est<br />
là ». Nous ralentîmes notre marche, les autres camarades faisaient semblant de converser au bord du<br />
trottoir. Un dernier coup d’œil circulaire. Il n’y avait rien d’inquiétant. Nous pénétrâmes dans une<br />
sorte de corridor sombre. Paco murmura à mon oreille : « la maison est sûre, ce sont des<br />
compagnons qui l’habitent ».<br />
Nous grimpâmes jusqu’au dernier étage. <strong>Les</strong> murs étaient écaillés, sales. Une porte nue, sans la<br />
moindre indication. Paco frappa deux fois trois coups. <strong>Les</strong> autres surveillaient en bas. La porte<br />
s’ouvrit. Nous pénétrâmes dans une pièce sommairement meublée. L’appartement comprenait deux<br />
pièces. Une table, un lit de fer, plusieurs chaises. Trois hommes et une jeune femme se trouvaient là.<br />
Quand ils virent Paco, un sourire éclaira leur visage. Je comprenais très mal la langue espagnole. Je<br />
compris pourtant qu’ils annonçaient à Paco de nouvelles arrestations. Paco dit qu’il fallait réunir le<br />
groupe le soir-même. L’opération aurait lieu le lendemain en fin de matinée. Nous ne sortîmes pas<br />
- 82 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
de la journée. Durant cette journée Paco m’expliqua qu’elle serait ma tâche. N’ayant aucune<br />
expérience en ce qui concernait ce genre d’actions il n’était pas question que je puisse participer au<br />
premier rang. De plus, Paco visiblement tenait à me ramener vivant. J’aurais une mission de<br />
surveillance, une mission essentielle précisa Paco en souriant. Paco se reposa plusieurs heures.<br />
J’admirais cet homme qui pouvait évoquer tour à tour un poème de Unamuno, un problème<br />
théorique révolutionnaire puis dresser les plans d’une attaque à main armée avec la même aisance,<br />
le même calme, la même fermeté.<br />
À la nuit tombée, la réunion eut lieu. Tous ceux qui devaient participer à l’opération arrivèrent<br />
les uns après les autres afin de ne pas donner l’éveil. Ils étaient au nombre d’une dizaine, le plus<br />
vieux n’avait pas cinquante ans. C’étaient des combattants valeureux, expérimentés, sûrs de leurs<br />
nerfs, habitués aux décisions rapides devant l’irruption de l’incident non prévu. Paco n’était pas leur<br />
chef. C’était celui à qui ils avaient délégué la responsabilité décisive. Puisque selon eux Paco était<br />
le meilleur, il était logique qu’il fut celui qui harmonisait les volontés farouches. Des compagnons<br />
veillaient autour de la maison. Paco avait étalé un plan sur la table. <strong>Les</strong> hommes disaient l’essentiel,<br />
posaient les questions urgentes. Chacun se remplissait de sa tâche. Apprenait la succession des<br />
gestes. Paco n’était pas un romantique assez fou pour sacrifier inutilement des vies humaines. La<br />
victoire résidait en cela aussi : la survie des camarades.<br />
La réunion dura plus de deux heures. Puis les hommes repartirent. Ils allaient passer la nuit dans<br />
des caches sûres éparpillées dans le quartier.<br />
Une ultime fois, Paco me répéta ma mission. J’aurais à surveiller les véhicules qui devaient<br />
emporter les armes après l’attaque. En cas de piège, un noyau était chargé de faire diversion afin<br />
que les armes puissent échapper aux policiers.<br />
Je dormis très mal cette nuit-là. Je me retournais sans cesse sur le lit de fer que je partageais avec<br />
Paco. Lui dormait à poings fermés. Calme comme toujours. Je songeais à Melba qui, là–bas à Paris,<br />
avec les enfants, attendait, comme elle avait si souvent attendu, le cœur battant, de crainte<br />
d’entendre cogner au carreau le sombre messager.<br />
Le lendemain, nous nous levâmes de bonne heure. Paco avait l’air joyeux, il me dit qu’il en était<br />
toujours ainsi. Une certaine excitation s’emparait de lui à la veille de chaque opération. Deux<br />
camarades arrivèrent bientôt chargés de paquets mystérieux. Ces paquets renfermaient les armes.<br />
Paco et les compagnons vérifièrent soigneusement les pistolets-mitrailleurs et les mitraillettes, les<br />
explosifs. À dix heures du matin, tout le groupe était réuni. La jeune femme que j’avais vu la veille<br />
en faisait partie, c’était la seule femme du groupe. Paco me dit, en aparté, qu’elle était une des plus<br />
courageuses militantes de l’organisation, une tireuse exceptionnelle. Elle avait été arrêtée une fois<br />
déjà, sauvagement torturée. On lui avait brûlé les seins. Elle avait été violée à plusieurs reprises par<br />
les bourreaux. Elle avait réussi à s’échapper. Elle avait aussitôt repris sa place dans les rangs de<br />
l’organisation. Elle s’appelait Concha. J’aurais aimé lui parler. Mais ce n’était pas l’heure.<br />
Une fois encore, Paco résuma le plan de l’attaque. Il demanda à chacun s’il y avait une question,<br />
il n’y en avait pas. L’attaque devait avoir lieu à midi juste. <strong>Les</strong> armes furent descendues et cachées<br />
dans les trois véhicules qui s’éloignèrent à tour de rôle. Le groupe devait, deux par deux, rejoindre<br />
un lieu précis qui était situé à cent mètres de l’objectif.<br />
Paco me confia à Antonio, un garçon d’une trentaine d’années, grand et mince, surnommé Lobo<br />
par ses compagnons. Je partis donc avec « le loup ». Lobo avait refermé sa main sur mon épaule<br />
pour être certain de ne pas me perdre.. J’étais tellement tendu que je ne voyais pas le décor<br />
environnant. Nous marchâmes un petit quart d’heure. Enfin nous arrivâmes au lieu de rendez–vous.<br />
C’était un café tenu par un sympathisant qui n’avait jamais été inquiété jusque–là. Le café était situé<br />
au fond d’une ruelle. <strong>Les</strong> véhicules étaient stationnés à quelques dizaines de mètres les uns des<br />
autres. Il m’appartenait de les surveiller durant l’attaque, de prévenir les camarades chauffeurs de<br />
tout fait suspect.<br />
- 83 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Dans une arrière-pièce du café les armes furent partagées. Je vis Concha se saisir d’un pistolet<br />
mitrailleur. Le groupe devait s’infiltrer dans le bâtiment administratif par une entrée restée libre<br />
grâce à la complicité d’un gardien. Là, il devait déposer des charges d’explosifs susceptibles de<br />
réduire en poussière des dizaines de dossiers dangereux pour les militants, tout en évitant<br />
d’atteindre des civils. Il devait se retirer aussitôt posées les charges explosives. <strong>Les</strong> véhicules<br />
devaient prendre en charge les armes. <strong>Les</strong> membres du groupe se disperseraient alors et<br />
rejoindraient l’appartement deux par deux. Paco régla les montres. Puis il marcha vers la fenêtre et<br />
là je le vis sortir d’une de ses poches une photographie qu’il contempla plusieurs minutes, sans<br />
doute Melba et les enfants. Je restais à distance. Puis soudain Paco replaça la photographie dans sa<br />
poche. Il se tourna vers les autres, eut un sourire et s’approcha de Concha qu’il étreignit<br />
longuement. <strong>Les</strong> hommes se serrèrent les mains mutuellement. Ils embrassèrent Concha. Puis Paco<br />
donna l’ordre du départ. Il était prévu qu’en cas de catastrophe je me réfugierais si possible dans le<br />
café.<br />
Je me trouvais sur le trottoir, allant et venant lentement sur une cinquantaine de mètres. Je<br />
n’osais pas regarder les camarades chauffeurs. Je jetais des regards furtifs sur le cadran de ma<br />
montre. Midi moins cinq, midi moins quatre, midi moins trois, midi moins deux, midi.<br />
Brusquement des rafales d’armes automatiques déchirèrent le demi-silence. D’autres rafales<br />
répondirent. Que se passait–il donc ? Il se passait que le groupe était tombé dans un piège.<br />
Paco m’expliqua un peu plus tard ce qui s’était produit. Le groupe avait franchi comme prévu<br />
l’entrée du bâtiment grâce à la complicité du gardien. Il s’était engagé dans les escaliers<br />
monumentaux qui conduisaient aux pièces où les charges explosives devaient être déposées et<br />
allumées. C’est alors que le piège se referma sur eux. Des gardes civils, des policiers embusqués<br />
dans les encoignures, les zones d’ombres, les toits, ouvrirent le feu sur eux. Concha s’effondra la<br />
première, une balle en plein front. Il n’était pas possible de déposer les charges explosives mais du<br />
moins Paco et ses compagnons avaient la preuve indiscutable que Miguel les avait trahis, qu’il était<br />
donc le responsable des multiples arrestations suivies de séances de torture de nombreux<br />
compagnons. Paco donna l’ordre de repli. Antonio fut chargé de prévenir les conducteurs des<br />
véhicules de ne pas s’attarder plus. C’était trop dangereux. Quand il eut accompli sa mission,<br />
Antonio, pistolet mitrailleur mal caché sous sa veste, rejoignit les autres qui reculaient pied à pied.<br />
Fou de rage Paco se battit comme un lion. Il s’agissait de ne laisser aucun blessé entre les mains de<br />
la police, d’avoir le moins de victimes possible.<br />
Je me repliai vers le café comme prévu. <strong>Les</strong> rafales continuaient de se succéder. Je craignais pour<br />
la vie de Paco, pour la vie des compagnons. Puis les rafales cessèrent. Le patron du café épiait le<br />
bout de la ruelle. Un des hommes du groupe qui avait été blessé arriva au café. Il avait un ordre<br />
impératif de Paco à me transmettre. Je ne devais pas bouger. Je n’avais rien à craindre. Le camarade<br />
patron de café n’avait jamais été soupçonné de sympathie pour une organisation anarchiste. Paco<br />
avait encore quelque chose d’important à accomplir. Le soir, il me récupérerait et nous repartirions<br />
pour la France.<br />
Le soir même, j’appris ce qu’avait d’important encore à accomplir Paco. Miguel avait été jugé,<br />
exécuté pour sa traîtrise. Miguel qui ne se croyait pas découvert était tombé lui aussi dans le piège.<br />
Il ne put se défendre. Il avoua tout. <strong>Les</strong> camarades lui donnèrent une chance de faire justice lui–<br />
même. Ils lui tendirent un pistolet. Miguel ne put se résoudre à se tirer une balle dans la tête. Ce<br />
furent Antonio et Pablo qui l’exécutèrent.<br />
Le bilan était lourd : outre Concha quatre camarades avaient été tués durant l’attaque. C’étaient<br />
les quatre camarades chargés de couvrir le repli du groupe. Deux autres étaient assez grièvement<br />
blessés. Deux autres dont Antonio avaient frôlé la mort de près. Paco était miraculeusement<br />
indemne. La baraka ! Mais justice était faite. Je savais que cette action avait douloureusement<br />
- 84 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
déchiré Paco. Mais il n’y avait pas d’autre issue. Miguel connaissait tous les rouages de<br />
l’organisation. Il avait déjà suffisamment fait de mal. Il ne pouvait plus vivre.<br />
<strong>Les</strong> camarades blessés furent clandestinement accueillis dans les cliniques où l’organisation<br />
disposait de sympathisants. La souffrance de Paco était de n’avoir pu emporter les cadavres des<br />
compagnons morts, d’avoir dû les abandonner.<br />
La nuit qui suivit Paco et moi refranchîmes la frontière. Il n’y eut plus d’arrestations<br />
inexplicables dans l’organisation qui pansa ses plaies, reforma ses rangs en vue d’autres combats.<br />
Quand nous retrouvâmes Melba, ce fut fête. J’étais fier, j’étais initié.<br />
Paco dit à sa compagne que j’avais été très bien, que j’étais un vrai révolutionnaire sans peur et<br />
sans reproche. Le lendemain, il rouvrit sa boutique d’orfèvrerie. À une cliente étonnée par la<br />
fermeture de quelques jours, il expliqua qu’il avait dû se rendre en province pour rendre visite à un<br />
vieux camarade gravement malade. Et les mains de Paco qui savaient si bien manipuler un pistolet–<br />
mitrailleur retrouvèrent les gestes de l’artiste travaillant le métal pour la joie des parisiennes du<br />
quartier de la Bastille.<br />
C’est au retour de cette inoubliable épopée que Christiane me signifia mon congé. Elle me<br />
quittait pour épouser l’ami de sa famille. Elle allait repartir dans le nord de la France où elle<br />
continuerait ses études artistiques. Une fois de plus je dus déménager. J’étais un nomade de<br />
l’amour, de la révolte, du rêve.<br />
Je suppliais Christiane de ne pas m’abandonner. Elle était devenue une figure fermée. La<br />
Christiane que j’avais aimée, qui me donnait son corps avec tant d’allégresse, était devenue une<br />
étrangère. Elle retournait là d’où elle était partie : la bourgeoisie étroite, égoïste des manufactures.<br />
Elle allait devenir une bonne épouse, une mère digne et aimante, elle arroserait chaque matin les<br />
fleurs de son jardin. Deux ou trois fois par semaine elle recevrait les collègues de travail de son<br />
mari et leurs épouses. Elle voyagerait entre New York et les îles grecques, elle serait honorée. Peut–<br />
être même irait-elle chaque dimanche à la messe. Moi, je n’étais que cet homme insondable qui, un<br />
soir, avait jeté, affolé, un sac de plastic dans un égout.<br />
Je jurai à moi–même de ne plus jamais m’agenouiller devant une femme, de ne plus jamais<br />
pleurer, de ne plus supplier. La chute d’Icare commençait déjà. J’étais au large d’Eden. Nadja<br />
n’existait pas. Il n’y avait que ce remugle de cris, d’accusations mutuelles, d’injures réciproques. Il<br />
n’y avait que malheur et abîme, nuit et poignard, solitude et chagrin. Je quittai Christiane, et dès que<br />
j’eus franchi la porte de l’atelier elle commença à pourrir en moi.<br />
C’est donc quelques jours après que Christiane m’eût abandonné qu’éclata la Guerre d’Algérie.<br />
<strong>Les</strong> enfants qui avaient été contemporains des massacres de Sétif passaient à l’attaque. À la F.C.L.<br />
nous ne fûmes pas pris de court. Depuis longtemps nous étions en contact avec le mouvement<br />
nationaliste algérien. Nous étions, depuis la fondation de la fédération, messalistes. Le vieux<br />
Messali Hadj, fondateur de l’Étoile nord–africaine, du PPA, du MNA, du MTLD, symbolisait pour<br />
nous cinquante ans et plus de résistance du peuple algérien qui fournissait les « soutiers » de<br />
l’Europe. Pour l’essentiel, d’ailleurs, c’étaient des kabyles qui s’expatriaient et qui se frottant à<br />
l’Europe nourrissaient le mouvement nationaliste. Je me rappelle encore un repas où je me<br />
retrouvais assis face à Messali. C’était un beau vieillard. Il en imposait, entouré de ses gardes du<br />
corps.<br />
Mais nous le suspections déjà de n’être qu’un « nationaliste », priorité d’où découlait une<br />
certaine stratégie et non un véritable programme révolutionnaire.<br />
Nous n’avions relativement que très peu d’informations quant aux activités de la mystérieuse<br />
O.S (Organisation spéciale) qui au sein du mouvement messaliste, militait en faveur de<br />
l’insurrection générale. Insurrection qui fut donc déclenchée la nuit de la Toussaint 1954.<br />
- 85 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
L’Humanité évoqua, à l’unisson avec les journaux « bourgeois », des activités de « bandes de<br />
rebelles », à priori sans avenir. Le Parti Communiste était en faveur de l’Union française. Le Parti<br />
qui avait revendiqué, à côté des bourgeois, le drapeau bleu–blanc–rouge se retrouvait complètement<br />
à côté de la plaque. <strong>Les</strong> « bandes de rebelles » ne furent pas écrasées. Au contraire, l’insurrection se<br />
développa. Il y eut d’intenses discussions au sein de la FCL mais, en définitive, nous nous portâmes<br />
du côté de la nouvelle organisation.<br />
<strong>Les</strong> discussions étaient d’autant plus âpres au sein de la FCL que la « direction » était accusée de<br />
tendances léninistes, le pire des péchés. Une fois de plus nous affrontions la question de la nature,<br />
de la structure d’une organisation se proclamant anti-autoritaire. On sait quel usage on fait dans les<br />
médias et dans les conversations banales quotidiennes du mot « anarchie ». Voilà un mot détourné<br />
de son sens authentique. Je crois même que c’est le mot le plus dénaturé. Anarchie ne saurait<br />
signifier chaos, désordre au sens classique du terme puisqu’il veut dire « sans pouvoir ». <strong>Les</strong><br />
anarchistes combattent pour un monde sans Pouvoir et sans pouvoirs. Mais les anarchistes sont<br />
aussi des citoyens du vieux monde. <strong>Les</strong> individus ont une nette tendance à chercher des chefs, à<br />
quêter des leaders, à réclamer des ordres. <strong>Les</strong> individus pour la plupart ont peur de la liberté. La<br />
liberté épuise. Elle exige des choix, des décisions. La liberté questionne. Elle est source de<br />
tourments, de vertiges, d’angoisses, de crises internes. C’est ainsi que l’Histoire est devenue une<br />
succession de révoltes de gens exigeant la liberté et craignant comme la peste de s’en saisir.<br />
<strong>Les</strong> peuples ont préféré de tous temps l’esclavage agrémenté de loisirs : la pêche, la chasse, les<br />
jeux modernes tels que le loto et le tiercé. La religion n’est sans doute pas l’opium du peuple le plus<br />
néfaste aujourd’hui. L’opium le plus néfaste c’est la non–croyance des êtres en la dignité humaine<br />
qui implique qu’on ne doive en aucun cas s’en remettre à d’autres pour organiser l’existence<br />
humaine.<br />
Toutes les tentatives révolutionnaires meurent de cette lèpre / Robespierre enterre les Enragés,<br />
Lénine enterre les prolétaires des Conseils d’ouvriers, de paysans et de soldats, Castro enterre la<br />
« fête cubaine ». De temps à autre, un éclair troue le ciel de l’implacable mal : et c’est Cronstadt, et<br />
c’est Berlin Spartakiste, c’est la Catalogne révolutionnaire, libertaire et c’est Budapest 1956, c’est<br />
un certain Mai 68 et c’est peut–être à l’heure où j’écris le Nicaragua.<br />
Comme questionne Marcuse : qu’y a-t-il dans la nature anthropologique de l’homme qui le<br />
pousse vers la soumission, l’esclavage, l’obéissance passive ? Dures, atroces questions.<br />
La FCL allait mourir, non vraiment des coups que le Pouvoir allait lui porter, mais de cette lèpre<br />
intime. Car, pour son honneur, la FCL fut l’organisation la plus traquée, la plus frappée durant la<br />
Guerre d’Algérie. Dès le déclenchement de l’insurrection nous étions prêts à faire face à une<br />
activité de type clandestine. Mais nous agissions aussi et surtout au grand jour. Ainsi, nous<br />
décidâmes de tenter d’entraîner hors des rails traditionnels la manifestation du 1 er mai 1955. Ce fut<br />
une bataille sanglante. Nos militants s’étaient éparpillés dans les rangs du meeting public. Nous ne<br />
cessions de couvrir les insipides déclarations des leaders de la CGT de nos slogans qui dénonçaient<br />
violemment la répression, affirmaient le droit du peuple algérien à se séparer de la France et de<br />
l’Union française pour vivre son propre destin. Nos militants furent violemment agressés par les<br />
« gros bras » du syndicat. Qui dira la misère de ces « gros bras » qui, à plus de vingt ans de<br />
distance, se ressemblent, hier comme aujourd’hui : des gueules de brutes incultes seulement<br />
capables de cogner : « On peut cogner chef ! ». Nous étions préparés au combat. Nous étions<br />
nombreux. À l’époque l’organisation pouvait aligner jusqu’à vingt mille militants aguerris. <strong>Les</strong><br />
coups pleuvaient de partout. Nos rangs étaient brisés par des charges renouvelées. Des camarades<br />
ensanglantés continuaient à faire face. Nous étions fous de rage de voir un « parti prolétarien »<br />
réprimer de la sorte des travailleurs révoltés. Nous entraînâmes plusieurs milliers de militants et de<br />
sympathisants cégétistes. Nous occupâmes les grands boulevards durant plusieurs heures. Peu à<br />
- 86 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
peu, les attaques successives de la police, CRS et gardes mobiles, nous contraignirent à refluer<br />
jusqu’à la Place de la Bastille. <strong>Les</strong> combats se poursuivirent le long des rails du métro. Je me<br />
rappelle avoir arraché, avec quelques autres, aux mains des flics une jeune fille qui avait eu le nez<br />
brisé d’un violent coup de casque porté en plein visage. <strong>Les</strong> gaz lacrymogènes faisaient pleurer les<br />
yeux, obscurcissaient les poitrines. Mais nous étions décidés à tenir et nous tînmes jusqu’au<br />
crépuscule. De nombreux flics étaient blessés. Dans nos rangs il y avait aussi beaucoup de visages<br />
ensanglantés. De nombreuses arrestations eurent lieu. Mais nous avions atteint, d’une certaine<br />
façon, notre objectif.<br />
Une période terrible commençait. Il y eut d’abord les rappelés. Nous fîmes de nombreuses<br />
manifestations dans les gares pour nous opposer au départ des trains qui emportaient les rappelés<br />
dont la plupart refusaient la sale guerre. Paris se transformait, jour après jour, en ville semblable à<br />
une capitale de dictature latino–américaine sillonnée par les patrouilles armées. <strong>Les</strong> violences<br />
étaient quotidiennes. <strong>Les</strong> contrôles d’identité rappelaient une funeste époque. La droite et l’extrême<br />
droite se déchaînaient contre l’anti-France. Des ministres socialistes – dont plusieurs d’entre eux<br />
n’ont toujours pas quitté la scène politique – acceptèrent d’avoir les « mains sales » au nom de<br />
l’intérêt national. Ils couvraient les violences, les atteintes portées à la personne humaine. L’armée<br />
française ratissait les djebels, incendiait les mechtas, expérimentait la torture sur les « rebelles ».<br />
<strong>Les</strong> appelés inconscients et en proie à un racisme plus ou moins avoué partaient casser du<br />
« bougnoule ». Nous étions impuissants devant ce fleuve de cruauté, de sottise, de sadisme. De plus,<br />
les nationalistes algériens se déchiraient entre eux avec une violence inouïe : Messalistes contre<br />
militants du FLN.<br />
<strong>Les</strong> « ratonnades » devenaient le pain quotidien. <strong>Les</strong> gens continuaient à faire la queue devant les<br />
cinémas tandis qu’à quelques kilomètres des Algériens étaient soumis aux violences, aux<br />
humiliations, aux vexations les plus brutales. On retrouvait chaque jour des cadavres. Des femmes,<br />
des hommes étaient à jamais marqués dans leur chair par les bourreaux.<br />
L’aveuglement des colons m’effarait. Je n’ignorais pas, qu’à l’exception de ceux dont les<br />
exactions étaient trop immenses, la plupart des Français d’Algérie, pouvaient trouver une place dans<br />
une Algérie indépendante, progressiste. Mieux même une Algérie sur la voie du développement<br />
avait besoin d’eux. Mais manipulés par la violence des temps, la propagande des fanatiques, les<br />
discours enflammés et trompeurs des gouvernants, ils ne purent éviter la rupture totale. Ils<br />
s’engouffrèrent dans le labyrinthe des souffrances, de la déraison, de l’exil.<br />
Des familles qui avaient humblement, farouchement, ensemencé une terre, ne pouvaient<br />
purement et simplement être rejetées. Leur malheur fut de confondre leurs intérêts avec ceux de<br />
quelques gros propriétaires disposant de tous les moyens d’agitation, reliés aux milieux les plus<br />
réactionnaires de l’Armée et de l’appareil d’État. Aujourd’hui, les Harkis, comme les soldats de<br />
Sétif, ont appris de quel prix la France récompensait leurs sacrifices. Il y eut des trompés dans tous<br />
les camps. La naïveté a la peau dure.<br />
J’ai, je l’avoue, toujours lutté plus contre que « pour ». Je ne me faisais guère d’illusion sur les<br />
chances d’une Algérie socialiste. Je mesurais tous les obstacles qui se dressaient contre une<br />
véritable émancipation du peuple algérien, et d’abord celui qu’incarnait une religion qui, après avoir<br />
été ferment de liberté, était devenue moyen d’oppression sinon de régression (On retrouve<br />
aujourd’hui en Iran cette douloureuse ambiguïté).<br />
Mais les ennemis de mes ennemis sont mes <strong>amis</strong>. Adage simplificateur dira-t-on ? peut–être.<br />
Mais il n’empêche, à l’époque, il fonctionnait pour moi.<br />
Je voulais demeurer lucide dans cette bataille que je prévoyais complexe, longue, douloureuse.<br />
Le déchirement de Camus me déchirait aussi. Je ne voulais que le bonheur des Français d’Algérie,<br />
je ne voulais que la liberté d’un peuple dont l’identité avait été écrasée par la conquête et les actes<br />
- 87 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
qui s’ensuivirent.<br />
La violence qui opposait les deux camps nationalistes m’épouvantait. Nous retombions dans le<br />
fanatisme. <strong>Les</strong> individus perdaient la tête. Ils creusaient leur propre tombe.<br />
Je m’occupais particulièrement du passage des insoumis à l’étranger. En relation avec des<br />
pasteurs protestants suisses. <strong>Les</strong> insoumis ne furent jamais foule, mais pour l’honneur de la vraie<br />
France, il y en eut plusieurs milliers. Je me chargeais de leur trouver domicile, emploi, papiers<br />
légaux, dans les pays environnants. Il m’arriva même de prendre en charge un jeune homme qui<br />
était membre d’une organisation secrète « Algérie française ». Je ne sais trop pourquoi, ce jeune<br />
homme avait été rejeté de l’organisation, condamné à mort. Paniqué, de fil en aiguille, il avait atterri<br />
entre mes bras. J’eus une longue discussion nocturne avec lui. À l’aube, il s’était rendu à mes<br />
arguments. Il avait réalisé de quel fantasmes, lectures racistes, il avait été le jouet. Je le fis passer en<br />
Suisse. Je ne sus jamais ce qu’il advint de lui.<br />
Je publiais des articles dans la revue Esprit. Si les staliniens se faisaient complices des assassins<br />
– n’allaient–ils pas voter les pleins pouvoirs au gouvernement de Guy Mollet, ce digne héritier du<br />
social–démocrate allemand Noske qui avait accepté, complice des junkers et des corps Francs<br />
d’être le « chien sanglant » – les chrétiens de gauche avec Jean-Marie Domenach,Paul Ricœur,<br />
Casamayor et d’autres, dénonçaient les tortures, la violence insupportable faite au peuple algérien.<br />
Je vivais alors dans un bain de sang. Chaque jour m’apprenait la mort d’un homme ou d’une femme<br />
que je connaissais, avec qui j’avais échangé paroles, songes, révoltes. Un matin c’était un ami du<br />
MNA exécuté peut–être par un ami membre du FLN. C’était un camarade tombé au sommet d’un<br />
djebel. C’était un autre poignardé dans une rue d’Alger. <strong>Les</strong> communistes incitaient leurs jeunes<br />
<strong>amis</strong> à partir à la guerre, à agir démocratiquement. Comme s’il était possible d’agir, une fois la<br />
Méditerranée franchie.<br />
C’était atroce, ignoble. Ma haine contre ce Parti grandissait à vue d’œil. Le mot de<br />
« communiste » je le revendiquais pour nous, mes compagnons et moi. Il était souillé par Thorez et<br />
sa clique. <strong>Les</strong> assassins – cartes SFIO en poche – occupaient les fauteuils du gouvernement. Ces<br />
hommes grassouillets, boursouflés de plis de chair, aux paupières lourdes incarnaient la France<br />
officielle. J’étais fier d’appartenir à une autre France. À vrai dire la France hexagonale je m’en<br />
foutais royalement (Que me pardonnent les mânes de Mistral et de Maurras !). La pourriture, la<br />
lâcheté, la veulerie, l’intrigue, l’aveuglement triomphaient partout. C’est dans cet état d’esprit que<br />
je fis connaissance de l’équipe d’Exigence. C’était une revue rédigée par un noyau déjeunes gens<br />
romantiques, quelque peu libertins, marqués par la lecture de Roger Vailland et des moralistes du<br />
XVIII e siècle. Au comité de rédaction figuraient François Bott – qui devait, dix ans plus tard,<br />
devenir un de mes <strong>amis</strong> les plus chers, et que j’allais retrouver à la rédaction du Monde à la veille de<br />
Mai 68 –, Gael, un de ses cousins, dandy du désespoir qui accepta de partir sur un djebel pour<br />
connaître une expérience différente, des émotions fortes. Gael était un étrange personnage, en proie<br />
au néant des choses et qui masquait sa détresse derrière une ironie froide, des gestes de défi<br />
aristocratique. Il devait crever sur un de ces djebels qui ne s’appelait pas Amour mais Absurde.<br />
J’imagine sa mort, les yeux crevés par la lumière « de Midi le juste ». Une sorte d’abandon, une<br />
curieuse douceur qui s’infiltre dans la poitrine surchauffée. Il y avait encore Dominique Eudes à qui<br />
l’on doit un remarquable ouvrage consacré à la résistance antifasciste grecque, Bernard Thomas<br />
pour qui la lutte continue dans les colonnes du Canard enchaîné.<br />
Je revenais alors du Portugal où je m’étais rendu à l’appel de la fiancée de Herminio Marvao,<br />
leader de la jeunesse démocratique. Herminio avait été arrêté, atrocement torturé. Il se mourait dans<br />
sa geôle proche de Lisbonne. Sa fiancée avait désespérément tenté d’alerter l’opinion publique<br />
internationale, cette chose floue, changeante, contradictoire. Je ne sais trop par quel canal son appel<br />
me parvint. Je décidai de me rendre clandestinement au Portugal. Je le lui fis savoir. Elle organisa<br />
- 88 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
mon séjour. Une dizaine de jours, je sillonnais le pays, de cache en cache, recueillant témoignage<br />
sur témoignage, chacun plus accablant que le précédant, pour la dictature de Salazar. À l’époque, le<br />
Portugal n’existait pas pour la gauche occidentale. L’Espagne garrottée suffisait amplement à ses<br />
fantasmes. Je revins avec la matière d’une brochure. J’avais lu déjà un ou deux numéros<br />
d’Exigence. J’étais ému par le courage, l’obstination de ces jeunes gens qui, sans grands moyens,<br />
s’acharnaient à déchirer le rideau d’ombre et de sottise qui avait enveloppé le pays dans sa presque<br />
totalité.<br />
Je leur proposai mon reportage. Ils acceptèrent d’enthousiasme de le publier. C’est ainsi que je<br />
fis leur connaissance. Mon reportage parut et intéressa suffisamment la direction du Monde qui<br />
obtint l’autorisation de le publier à son tour. Ce reportage de sang et d’horreur fut ma première<br />
contribution à ce journal auquel aujourd’hui encore je collabore régulièrement, et sans honte. J’ai<br />
toujours préféré un Journal « libéral » à une feuille « gauchiste–hystérique », et je suis de ceux qui<br />
peuvent appeler « gros tas de margarine » le camarade Mao.<br />
Ma vie quotidienne se résumait à une sorte de course folle. Il m’était de plus en plus difficile<br />
d’accorder ma vie de pigiste avec celle d’activiste clandestin. Agir au grand jour et agir<br />
parallèlement dans le secret de l’ombre devenait une tâche délicate. Je courrais en toute<br />
vraisemblance à ma perte. La répression s’abattait de plus en plus fortement sur la FCL.<br />
Interpellations, perquisitions chez les uns et les autres, menaces se succédaient à un rythme affolant.<br />
Je vivais d’amours brèves, de rencontres sans lendemain. Le rêve de l’amour fou éclatait en<br />
morceaux. Je fréquentais de moins en moins les réunions du groupe surréaliste qui concoctait, sans<br />
interruption, de subversifs manifestes. J’étais plongé dans une action multiforme. La petitesse de<br />
cette actionne pouvait être tenue à distance qu’à cause de la certitude qu’à certains moments de<br />
l’existence humaine, il y a des choix impératifs, des actes qu’on ne peut pas ne pas commettre, quel<br />
que soit le résultat. L’avenir était totalement incertain, un mot vide de sens, je m’accrochais de<br />
toutes mes forces au présent, à l’instant. J’étais prêt à mourir une heure, une semaine, un an, un<br />
siècle plus tard. C’est alors que le Pouvoir décida de frapper un grand coup, en interdisant la FCL.<br />
Depuis un certain temps nous avions quitté le Quai de Valmy et son atmosphère prévertienne pour<br />
nous installer rue St Denis où, entre deux « passes » des prostitués compréhensives et quelque peu<br />
expertes en dactylographie, venaient nous aider à la rédaction du Libertaire. Le filet se refermait<br />
lentement sur nous. Mes articles dans Combat, Esprit, Le Libertaire m’avaient valu des lettres de<br />
menaces de mort que, mes camarades et moi prenions très au sérieux. Je n’étais pas le seul dans ce<br />
cas. <strong>Les</strong> fanatiques de l’Algérie française développaient leurs activités, leurs agressions, leurs<br />
attentats. La gauche à l’exception d’une minorité de lucides et honnêtes gens, criait très fort pour<br />
masquer non seulement son inaction mais sa complicité de fait avec les dirigeants de la bourgeoisie.<br />
Hypocrites comme toujours, habiles comme de fins renards, les communistes tenaient plusieurs fers<br />
au feu. Ils célébraient à la fois les actes de résistance de certains de leurs jeunes militants tout en<br />
condamnant les révolutionnaires algériens qui n’étaient pas précisément communistes. Ils jouaient<br />
un jeu dont ils n’ont jamais perdu les règles.<br />
Pour moi une échéance approchait : j’avais toute chance d’être appelé à la guerre puisque<br />
personne d’entre nous pensait qu’elle puisse s’achever avant 1956.<br />
C’était décidé depuis longtemps. Je serai insoumis. Je savais ce que cette décision impliquait : la<br />
clandestinité totale. Je n’avais aucune expérience de ce côté–là. Mais j’étais décidé à ne pas aller<br />
mourir pour le compte de la bourgeoisie française, à ne pas aller combattre contre un peuple dont<br />
les options révolutionnaires n’étaient pas les miennes, mais contre lequel je n’avais aucune raison<br />
de combattre les armes à la main.<br />
L’année fatidique arriva. Ce ne fut pas seulement l’année de mon insoumission, mais aussi celle<br />
de la révolte de Budapest. Un éclair d’aube déchirait enfin les ombres du bloc soviétique.<br />
- 89 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Douze ans plus tard l’occupation par les chars soviétiques de la Tchécoslovaquie devait ameuter<br />
les intellectuels et l’opinion publique. Ceux–ci et celle–là avait été beaucoup moins bruyante lors de<br />
la révolte de Budapest. La raison en était simple. Alors qu’à Prague, le mouvement fut une<br />
revendication des « droits de l’homme » – une notion assez floue d’ailleurs – la révolte de Budapest<br />
signifiait une « critique par les armes », une « critique de gauche » de l’ordre communiste. <strong>Les</strong><br />
bourgeoisies occidentales, les élites culturelles sauf rares exceptions comprirent que les insurgés de<br />
Budapest mettaient en cause leurs privilèges de classe, leur domination à l’intérieur du système<br />
démocratique. À Budapest, ce furent des Conseils ouvriers que les tanks des héritiers de Staline<br />
écrasèrent, des conseils qui, comme ceux de Cronstadt, plus de trente ans auparavant, réclamaient<br />
tout le pouvoir aux soviets. L’illusion communiste éclatait au grand jour. <strong>Les</strong> bourreaux, les fous de<br />
pouvoir dévoilaient leurs faces sinistres. <strong>Les</strong> États-Unis n’avaient – et pour cause – aucune raison<br />
de soutenir un tel mouvement. <strong>Les</strong> travailleurs occidentaux manipulés par les PC gobèrent la<br />
version officielle : des contre–révolutionnaires mettaient à Budapest en péril les acquis du<br />
Prolétariat – avec majuscule s’il vous plaît. <strong>Les</strong> sociaux–démocrates, de par leur allégeance aux<br />
bourgeoisies locales et leur anticommunisme primaire, firent le reste de la besogne. Budapest creva,<br />
broyée, laminée. L’ultime appel du speaker de la radio des Conseils ouvriers : « <strong>Les</strong> Conseils<br />
ouvriers de Hongrie en appellent à la solidarité de tous les travailleurs du monde. Ici c’est la liberté<br />
qu’on écrase… ». C’était effectivement la liberté, la volonté de liberté qu’on écrasait.<br />
Douze ans plus tard des intellectuels qui n’avaient pas bronché au massacre de Budapest<br />
rompaient bruyamment avec le Parti – quitte à y revenir un peu plus tard sur la pointe des pieds,<br />
quitte à n’y point revenir, en s’installant, entre Vincennes et Dauphine dans la confortable position<br />
de « contestataires » disposant d’une résidence secondaire –, multiplièrent les papiers éplorés, les<br />
protestations véhémentes. Pêle-mêle Louis Pauwels, Jean d’Ormesson, Eugène Ionesco, Jean<br />
Dutourd, Jean Cau, Dominique Desanti, Raymond Aron, Tixier-Vignancour se retrouvaient devant<br />
le « mur des lamentations ». La « Prague aux doigts de pluie » du grand poète surréaliste Vitezslav<br />
Nezval – qui, malheureusement, finit sa vie dans la peau d’un chantre du stalinisme – faisait recette.<br />
On collectionnait les tablettes de chocolat pour les petits enfants affamés de Prague. On relisait<br />
Kafka à la lumière des récents événements. On veillait tard à la Coupole et au Dôme, à la Brasserie<br />
Lipp et aux Deux Magots en supputant, entre harengs de la bal tique et caviar, le nombre d’années<br />
qu’il fallait pour que l’Union soviétique se transformât en cet empire éclaté, prophétisé par une<br />
experte, Hélène Carrère d’Encausse.<br />
L’agonie de Budapest, je la vécus en compagnie des camarades, les poings serrés, la gorge sèche,<br />
la rage au cœur devant la pusillanimité des militants, le je m’en foutisme des masses, la trahison des<br />
clercs (une de plus !). Heureusement, Combat, Esprit, quelques autres publications parvenaient à<br />
franchir le mur de la honte. La lumière de la conscience et de la morale n’était pas étouffée malgré<br />
tous ces pompiers qui ne cessaient pas de crier « au feu » tout en allumant par leurs crimes infinis<br />
l’incendie. Budapest apportait, une fois encore, la preuve de la capacité du Prolétariat à briser l’étau<br />
des « sauveurs suprêmes », des partis d’avant–garde auto–proclamés, des donneurs de leçons<br />
réfugiés dans de moelleuses bibliothèques, de fonder des structures réellement anti–autoritaires.<br />
Une fois de plus, par sa pratique, par l’enseignement qu’il tirait de sa pratique, par la liaison intense<br />
qu’il eut alors avec le meilleur de l’intelligentsia, (poètes, peintres, romanciers, cinéastes,<br />
philosophes…), le Prolétariat démontrait qu’il était en mesure d’ouvrir la voie à un monde qui ne<br />
fut pas désespérément la répétition du « vieux monde ». Mais ce monde–là démasquait trop bien<br />
Washington et Moscou, Paris et Londres, pour obtenir le droit de se déployer. <strong>Les</strong> anticommunistes,<br />
qui avaient trouvé en Staline un allié de choix, ne pouvaient pas jouer de la même parole avec les<br />
insurgés de Budapest. Il était pour le moins coriace de faire la preuve que les rebelles de Budapest<br />
luttaient pour l’extension illimitée du Goulag, des procès politiques truqués, des exécutions<br />
sommaires dans les souterrains de la Loubianka et autres lieux de terreur.<br />
- 90 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Budapest demeure une plaie au flanc du mouvement révolutionnaire authentique.<br />
La gauche traditionnelle s’opposait mollement à la sale guerre. L’infime minorité qui s’y<br />
opposait ouvertement devait faire face à toutes sortes de menaces. <strong>Les</strong> exécutions à la guillotine de<br />
militants algériens se multipliaient. <strong>Les</strong> cercueils contenant les dépouilles des jeunes soldats<br />
« morts pour la France », dans les Aurès et ailleurs, étaient discrètement acheminées vers les<br />
domiciles des familles. Des jeunes hommes qui n’étaient pas nativement des monstres apprenaient à<br />
torturer, étaient témoins de séances de torture. De telles pratiques avilissaient une large fraction de<br />
la jeunesse. Celle-ci, à l’école de l’horreur, apprenait qu’une vie humaine ne pèse pas lourd. Qu’estce<br />
qu’un homme ? un tas de viande, d’os. Si l’homme n’est rien tuer des hommes n’est pas un<br />
crime. Dans la France quadrillée par les polices, livrée aux brutales vérifications d’identité, les<br />
Algériens, y compris ceux qui n’étaient pas directement impliqués dans la lutte pour<br />
l’indépendance, pouvaient à tout instant crever d’une balle perdue, des suites d’une bavure. <strong>Les</strong><br />
Français continuaient, dans leur grande masse, à vivre comme si de rien n’était. <strong>Les</strong> cinéastes<br />
faisaient des films, les écrivains écrivaient des romans qu’ils venaient commenter sur les ondes des<br />
radios et les écrans télévisés, les hommes d’affaires faisaient des affaires, les salauds ne chômaient<br />
pas, les politiciens organisaient le malheur collectif. L’exécuteur des hautes œuvres promenait de<br />
prison en prison sa sinistre machine.<br />
Je me battais du mieux possible, mais j’étais déchiré, épuisé. Je profitais alors d’une occasion<br />
pour faire un voyage à New–York et San Francisco. Je restais deux semaines loin du cloaque. Je<br />
découvris durant ces quelques journées d’autres réalités, terribles elles aussi : les épaves du Bowery,<br />
la misère du ghetto porto–ricain, la violence à Harlem. L’Amérique m’avait depuis toujours fasciné.<br />
Fou de cinéma j’avais vu tous les westerns, chefs–d’œuvre ou navets. Dès la première image, un<br />
cavalier lointain dans un nuage de poussière galopant vers une petite ville traversée par les<br />
troupeaux, je m’éveillais autre. Ce pays, qui par le travail et la prière, la volonté et la croyance<br />
absolue en son destin, s’était hissé au premier rang des nations capitalistes se dévoilait à mes yeux :<br />
un fantastique patchwork où se côtoyaient le saint et la brute, le poète et le milliardaire, la splendeur<br />
de certains paysages et la laideur de certains quartiers où s’entassaient les déshérités, les sans–<br />
lumière, la mort et la puissance vitale, la cruauté impitoyable et la générosité la plus étonnante.<br />
Je déchiffrais passionnément ce pays que les pères fondateurs avaient créé sur les dépouilles de<br />
l’indien. Je parcourais New York qui n’était qu’une succession de cités imbriquées les unes dans les<br />
autres : New York des Juifs, New York des Chinois, New York des Chicanos, New York des nègres,<br />
New York des riches, New York des dépossédés…<br />
Écrasé par la masse des gratte–ciel, des gigantesques buildings, j’apprivoisais le New York des<br />
solitudes. Ici l’homme qui trébuchait, tombait d’épuisement, de lassitude face à l’interminable<br />
struggle for life était un homme perdu.<br />
Pays mirage pour tous ceux qui voguèrent vers lui, après avoir échappé de la Russie à<br />
l’Allemagne, de la Grèce à l’Espagne aux sévices, à la faim, à la pouillerie, aux cachots. Pays–<br />
cauchemar pour tous ceux qui ayant enfin franchi les portes de la terre promise retournaient à la<br />
pouillerie, à la faim, aux cachots.<br />
Pays qu’un Européen ne pouvait aborder qu’avec haine et amour mêlés. L’Amérique de<br />
Whitman était aussi l’Amérique de la Guerre de Corée, l’Amérique de la bombe atomique lancée<br />
sur Hiroshima et Nagasaki, l’Amérique qui protégeait de son aile d’acier les sanglantes dictatures<br />
d’Amérique Latine. L’Amérique de Whitman était aussi l’Amérique du Ku–Klux–Klan, de la<br />
Mafia, du Syndicat du crime. L’Amérique des sympathiques « privés » de Chandler et Hammet était<br />
aussi l’Amérique des assassins légaux, installés dans de vastes bureaux modernes. L’Amérique de la<br />
Bible était aussi l’Amérique du revolver.<br />
- 91 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
À San Francisco, je rencontrais des jeunes gens fous de poésie, d’écriture, de randonnées folles à<br />
travers le pays dans des bagnoles déglinguées, fous de jazz, de spiritualité, de vin et d’amitié. Ils<br />
s’appelaient Allen Ginsberg, Peter Orlovsky, Gary Snyder, Gregory Corso, Jack Kerouac, Lawrence<br />
Ferlinghetti. Ils avaient pour ami l’écrivain William Burroughs plus âgé qu’eux. Depuis une récente<br />
mémorable lecture publique de leurs poèmes, les journaux commençaient à parler d’eux en les<br />
appelant les poètes beat. La Beat génération commençait à s’imposer. Il faut dire que ses membres<br />
faisaient ce qu’il fallait pour qu’on ne les oublie pas. Jeunes, vigoureux, insolents, héritiers de<br />
Whitman – un Whitman qui aurait fumé la marijuana, balancé au rythme du jazz cool et aurait eu<br />
pour livre de chevet le Yi King – ils renouvelaient le sang de la poésie américaine. Il l’arrachait aux<br />
bibliothèques, la jetait sur la route, à travers vallées et canyons, Rocheuses et Middle West.<br />
Je me liais d’amitié et d’affection avec la plupart d’entre eux. Beaucoup sont devenus célèbres,<br />
mais, installés dans une vraie maison ou non, ils continuent toujours de « faire la route », avec leur<br />
baluchon de songes, de désirs, de révolte. Ils n’ont pas renoncé à trouver la voie, la « vraie vie ».<br />
D’autres sont morts brisés par la drogue, la haute tension de leur esprit, le combat spirituel et<br />
physique, ou la désillusion : Jack Kerouac, Neil Cassady.<br />
En leur compagnie, je vécus quelques belles et rares heures de délire, d’élan lyrique. Kerouac<br />
brûlait la chandelle par les deux bouts. Il m’enthousiasma. Il fonçait avec son angoisse de grand<br />
même. Allen entendait de plus en plus les voix de l’Orient. Sa bonté était déjà « bouddhique ».<br />
Il y eut quelques sacrées beuveries. La drogue m’ouvrit de nouvelles portes de perception. Je me<br />
libérais du carcan d’une vieille culture qui pesait sur mes épaules, entravait mon envol d’Icare. Eux,<br />
étaient d’une certaine façon plus libres. Ils appartenaient à un pays encore inachevé. Moi, en<br />
Europe, je n’avais pas d’autre ligne d’horizon que le mur d’en face. J’étais l’otage d’un espace clos,<br />
fini, pétrifié. Peu avant mon départ, avec quelques–uns d’entre eux, j’allais saluer Miller sur son<br />
perchoir au–dessus des profondeurs bleutées du Pacifique. Mes yeux s’emparèrent d’un territoire<br />
illimité. Il y eut des noces de lumière et d’eau, d’espace et d’air. Henry plissait malicieusement les<br />
yeux. Il peignait des aquarelles, jolies et naïves. Il dialoguait avec les forces de vie. Il jetait sur le<br />
tohu–bohu humain un regard fraternel et lucide. Il fut heureux d’apprendre que je connaissais<br />
Joseph Delteil qu’il admirait profondément. Nous fîmes une longue promenade le long des falaises<br />
abruptes. Le soleil, à l’horizon, s’enfonçait dans l’océan dans une gerbe d’étincelles. J’eus la<br />
sensation, durant un bref moment, d’être devenu immortel.<br />
C’est la tristesse au cœur que je repris l’avion pour Paris. Mais nous étions sûrs de nous<br />
retrouver un jour sur la terre. Je retrouvais le Paris que j’avais quitté. La guerre continuait avec<br />
chaque jour son lot de morts, la répression continuait elle aussi. Le Libertaire était saisi<br />
pratiquement chaque semaine. Nos moyens s’effilochaient. De plus, la crise interne déchirait de<br />
plus belle l’organisation. Cette crise ce fut la mise hors-la-loi, pure et simple, qui y mit un terme.<br />
J’étais un insoumis recherché. Je n’avais plus de domicile fixe. Je changeais fréquemment de<br />
logement. J’habitais chez des <strong>amis</strong> sûrs. Il me fallait dans la rue redoubler d’attention, ne pas<br />
susciter la curiosité d’un flic. Éviter les contrôles d’identité. Je n’avais pas d’amour. Je jouais au<br />
chat et à la souris avec les autorités. J’avais repris mes activités secrètes. J’avais appris à dépister un<br />
flic possible dans le métro, à m’arrêter négligemment devant une vitrine pour vérifier si je n’étais<br />
pas suivi, surveillé. C’était tragique de vivre avec son secret au milieu des gens de mon pays. Il me<br />
fallait écouter malgré moi, dans le métro, dans un café où j’avais un rendez–vous, des propos<br />
atrocement racistes, quasi nazis. La « vox populi » n’exprimait que mépris et haine pour les<br />
« ratons » les « bougnoules ». À mort ! À mort ! Le gouvernement accédait au vœu de la « vox<br />
populi » de temps à autre. Alors, dans une cellule de prison, un peu avant l’aube, un homme était<br />
réveillé par les gardiens. Des messieurs très sombres, très graves accompagnaient ces gardiens.<br />
L’homme avait compris aussitôt de quoi il s’agissait. Machinalement, il caressait nerveusement son<br />
- 92 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
cou. Dans l’ombre de la cour, blafarde, luisait sinistrement la lame impitoyable. L’homme était<br />
emporté, presque soulevé de terre par les bourreaux attentionnés. Un éclair, une tête roulait dans le<br />
panier plein de sciure. Il paraît qu’une tête souffre humainement plusieurs secondes après avoir été<br />
tranchée. À quelques centaines de mètres, au delà des hauts murs, la « vox populi » dormait sur ses<br />
deux oreilles.<br />
Ce qui devait fatalement arriver arriva. Je fus arrêté un lundi à six heures du soir dans un café de<br />
la Place de la Bastille. J’avais rendez–vous avec une jeune fille qui appartenait à mon réseau. Cette<br />
jeune fille, Hélène, élevait seule un petit garçon de deux ans. Nous avions couché deux ou trois fois<br />
ensemble. Elle avait milité au Parti communiste qu’elle avait quitté, écœurée par le comportement<br />
de ce Parti face à la guerre. Elle était très active, très prudente. Mais cette prudence ne l’avait pas<br />
empêchée d’attirer sur elle le regard de la police. Très vite soupçonnée de se livrer à des activités<br />
répréhensibles, elle était « filée » depuis plusieurs semaines, en permanence. Sans le vouloir elle<br />
avait guidé jusqu’à moi les flics. L’arrestation attira à peine l’attention de quelques consommateurs.<br />
Ces messieurs – ils étaient deux – me prièrent à voix douce de bien vouloir les suivre. J’eus la<br />
tentation d’essayer de fuir mais je craignais en agissant de la sorte de compliquer le sort d’Hélène.<br />
Je suivis donc les policiers. Hélène fut retenue quelques jours mais comme aucune preuve formelle<br />
de sa culpabilité ne put être fournie, elle fut en fin de compte relâchée. Il n’en allait pas de même<br />
pour moi. Ces messieurs possédait un volumineux dossier me concernant, un dossier qui témoignait<br />
irréfutablement de mes activités.<br />
Deux jours auparavant, ils avaient arrêté un camarade chez qui j’avais logé plusieurs semaines.<br />
J’avais laissé chez lui soigneusement – du moins je le pensais – cachés au fond d’une cave, des<br />
papiers compromettants. <strong>Les</strong> policiers au terme d’une fouille minutieuse avaient découvert ces<br />
papiers. La nouvelle de l’arrestation de notre camarade avait été connue trop tard pour qu’on puisse<br />
me prévenir à temps. Mon nomadisme rendait plus difficiles les contacts.<br />
Allait commencer pour moi une sombre et dure période dont je garde encore dans ma chair les<br />
marques. Je subis de multiples interrogatoires. On exigea de moi les noms LES NOMS des<br />
membres du réseau, tous LES NOMS. Je refusais de parler. J’avais peur, mais je refusais de<br />
dénoncer mes <strong>amis</strong>. Je fus insulté, menacé, frappé. <strong>Les</strong> interrogatoires succédaient aux<br />
interrogatoires. Au bout de deux jours, j’étais épuisé. C’était comme dans les romans policiers que<br />
j’avais lus : la lampe dans les yeux, la face du flic penchée au–dessus de moi. <strong>Les</strong> éternelles,<br />
lancinantes et mêmes questions : qui est Paul, qui est Marco, qui est Jeanne ? Je serrais les dents.<br />
Alors, fous de rage, ils me cognaient dessus : la tête, le ventre, les épaules, le dos.<br />
J’avouais de faux renseignements quand je n’en pouvais plus. Je songeais que dehors peut–être il<br />
faisait beau. Je me souvenais d’un visage de femme que j’avais autrefois aimée. DES AVEUX ils<br />
voulaient DES AVEUX. Mais avouer quoi ? Ils savaient qui j’étais : un ennemi de l’ordre qu’ils<br />
défendaient à coups de revolver, à coup de poings, à coup d’insultes. Avouer quoi ? Ce qu’ils<br />
savaient déjà ? Pour le reste je ne savais rien, je ne connaissais ni Paul, ni Marco ni Jeanne.<br />
Je voyais que dans leurs yeux le désir de tuer brillait rageusement. Mais un cadavre, n’est–ce<br />
pas, ne peut pas faire des aveux !<br />
J’avais mal partout. Le sommeil fermait mes paupières. Ils me réveillaient brutalement. « On<br />
repart à zéro » disaient–ils alors avec une lueur de sadisme dans le regard. Qui est Paul, qui est<br />
Marco, qui est Jeanne ? Et les autres, nous voulons les noms des autres. Ils voyaient en moi un<br />
dangereux terroriste. Ils me soupçonnaient d’avoir commis des attentats, d’avoir posé des bombes.<br />
La nuit, dans ma cellule, les cauchemars m’accablaient. J’entendais toujours leurs voix terrifiantes,<br />
je voyais leurs faces rouges de fureur qui voltigeaient autour de ma tête douloureuse.<br />
Ils n’obtinrent rien de moi sinon une profession de foi révolutionnaire. J’apprenais à avoir peur<br />
et à vivre avec ma peur sans y succomber.<br />
- 93 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Enfin je fus jugé. J’étais absent et présent. <strong>Les</strong> juges prononçaient des mots qui n’étaient pas de<br />
ma tribu. Ils se référaient à des lois que je ne reconnaissais pas. Je fus jugé pour insoumission,<br />
incitation à la désertion, aide à des insoumis. Je fus condamné à cinq ans de prison.<br />
Je fus d’abord enfermé à la prison du Cherche–midi, puis à la prison de T. J’avais tout à<br />
apprendre de la vie carcérale : la monotonie des jours, la solitude des nuits, les rudesses des<br />
gardiens, les saloperies des « matons ». Pour eux j’étais un salaud de traître. C’était d’autant plus<br />
grave pour moi qu’à T. un des gardiens avait eu un fils tué en Algérie, quelques mois plus tôt.<br />
J’étais complice de ceux qui avaient tué son fils. Le régime à T. était exceptionnellement rude car le<br />
directeur de la prison était un véritable fasciste. Il couvrait les exactions de ses employés. Je n’ai<br />
pas la force de ressusciter ici quelques–uns des traitements que ces salauds me firent subir. À peine<br />
évoquerais-je sans m’attarder la canette de bière dont on enfonce le goulot dans l’anus de la<br />
victime. À plusieurs reprises j’eus droit à de sévères passages à tabac qui me laissaient,<br />
passablement ensanglanté, sur le carreau de la cellule. Pour un rien les coups pleuvaient, assénés à<br />
l’endroit le plus fragile du corps, le plus susceptible d’éprouver la douleur.<br />
J’étais dans le quartier des droits communs, livrés à leurs violences. <strong>Les</strong> « Droits communs »<br />
dans toutes les prisons du monde n’ont jamais guère choyé les « Politiques ». J’eus à pâtir des<br />
violences de quelques–uns d’entre ces criminels récidivistes. Leurs mauvais traitements à mon<br />
égard leur valaient, à l’occasion, quelque geste de bonté des gardiens.<br />
J’exigeais, selon la loi, d’être transféré dans le quartier des « Politiques ». On me rit au nez. On<br />
me promit de me faire la peau si j’insistais. Je décidais alors comme d’autres camarades dans<br />
d’autres prisons d’entamer une grève de la faim. Devant mon refus d’absorber la moindre nourriture<br />
ils m’alimentèrent de force, comme on gave une oie. Je vomissais ce qu’il m’avait ingurgité par la<br />
violence. Ils me frappèrent.<br />
Au bout du compte, ma grève de la faim l’emporta. Je fus transféré dans le quartier des<br />
« Politiques ». C’est là que je fis la connaissance d’Ali. Ali était un militant du FLN qui avait<br />
commis plusieurs attentats. Il était doux, grave. Il me raconta son enfance dans les ruelles de la<br />
casbah d’Alger, la tragique mort de son père abattu par un colon un jour au cours d’une dispute. Le<br />
père d’Ali avait été soldat dans l’armée française. Il avait obtenu plusieurs décorations. Après les<br />
massacres de Sétif, il s’était converti au nationalisme.<br />
À vingt ans Ali avait rejoint les rangs de ceux qui faute de n’être pas écoutés, entendus avaient<br />
décidé de prendre les armes. Ali avait été arrêté après un attentat. Il attendait son jugement. Il n’en<br />
parlait pas. Il ne laissait apparaître aucune angoisse. Mais il m’arrivait de le surprendre, songeur,<br />
lointain.<br />
Le jugement d’Ali arriva. Il fut condamné à mort. On le transféra dans une autre prison. Une<br />
dernière fois je l’étreignis entre mes bras. J’avais la gorge déchirée de sanglots, les yeux voilés de<br />
larmes. Je ne savais quoi dire. C’est Ali qui me réconforta. Il me dit qu’il avait confiance en Dieu.<br />
<strong>Les</strong> gardiens l’entraînèrent. Quinze jours plus tard Ali était exécuté.<br />
J’appris à lire et écrire à d’autres détenus algériens. Je n’ignorais pas que beaucoup d’entre eux<br />
n’auraient pas besoin de ce savoir. Mais ils étudiaient comme s’ils devaient vivre encore cent ans.<br />
Ils s’appliquaient avec un orgueil enfantin. Ils étudiaient jusqu’au dernier jour. Puis ils me disaient<br />
adieu. D’autres alors prenaient leur place.<br />
Ces « saisons sauvages » me hantent. Je ne puis les évoquer sans trembler. Des noms resurgissent<br />
de l’ombre : Mohammed, Akli, Mourad, Abdelaziz, Mouloud… Reposez en paix mes compagnons !<br />
C’est en prison que je vécus le « coup d’état légal » qui devait porter au pouvoir le général de<br />
Gaulle pour la seconde fois. Ce fut un nouveau coup terrible. La France à genoux se livrait comme<br />
elle s’était livrée, autrefois, à Pétain. Une France peureuse, frileuse, une France de « prolos »<br />
bousillés, de BOF grassouillets, d’employés timorés, de politiciens affairés. <strong>Les</strong> français<br />
- 94 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
s’accrochèrent aux basques du Général comme on s’accroche à un père. O Freud que n’étais–tu là !<br />
La gauche avait mené un baroud d’honneur ridicule et sans issue. Elle parlait haut et ne résistait pas.<br />
La gauche livra le pays au Général.<br />
Rares furent ceux qui comprirent la signification de l’événement. Je ne veux aujourd’hui me<br />
souvenir que de Serge Mallet. Là où la gauche ne voyait qu’une parenthèse sans grande importance,<br />
Mallet sut montrer les mutations survenues dans la classe bourgeoise, ce qu’elles impliquaient à<br />
priori pour le pays. Face à la stratégie des « hallebardes » des communistes, Mallet débroussailla les<br />
perspectives, il sut dégager des lignes de lutte.<br />
La France entrait en décadence. Pour l’honneur de l’Esprit était fondée la même année<br />
L’Internationale Situationniste.<br />
La loyauté veut que je dise que c’est ce même général, qui n’était pas de ma paroisse, qui<br />
m’amnistia, grâce à de pressantes interventions de personnes proches de lui, mais qui m’estimaient.<br />
Je retrouvais l’air libre, le soleil, les brumes d’automne, la foule. Longtemps encore je devais<br />
conserver quelques–uns des comportements du prisonnier que j’avais été.<br />
J’étais abîmé. Mais je n’avais pas renoncé à la révolte, au combat.<br />
Par des voies détournées, je gagnais Tunis où je pris contact avec les dirigeants de la lutte qui<br />
n’étaient pas emprisonnés. Je repris mes activités clandestines. J’étais un « révolutionnaire ». Je le<br />
croyais, il n’y avait pas d’existence possible pour moi sans la révolution socialiste, je refusais la<br />
survie de cadavre.<br />
- 95 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
LES SOLEILS DU MAGHREB<br />
LES FEUX DU MONDE<br />
- 96 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
En 1959, quelques semaines après l’entrée des colonnes de Fidel Castro dans La Havane libre, je<br />
me retrouvais à Cuba. Je tombais immédiatement dans le piège de l’illusion lyrique. Je succombais<br />
à la beauté des femmes, à la grâce des miliciennes en uniformes vert olive. J’admirais<br />
l’extraordinaire éventail de couleurs des peaux qui allait du noir le plus sombre au brun le plus<br />
chaud. Je vibrais aux sourires des enfants. Le rêve était–il en train de s’incarner sous mes yeux ?<br />
Une révolution non autoritaire, chantante, folle, jeune allait–elle mûrir au soleil des Tropiques ?<br />
Après la nuit de la prison et de la guerre allais–je être ébloui par le socialisme de la patchanga ?<br />
Je retrouvais Nicolas Guillen que j’avais connu exilé à Paris. Sa chevelure de flamme blanche<br />
couronnait un visage exalté. Le poète de « Sorongo Cosongo » vibrait à l’unisson de son peuple. Je<br />
fis la connaissance de celui qui allait être célébré à travers le monde par des jeunesses enfiévrées :<br />
Che Guevara.<br />
Il me raconta sa vie aventureuse depuis son départ d’Argentine, sa participation à la résistance du<br />
gouvernement progressiste du Guatemala lors du fameux week–end sanglant, sa rencontre avec<br />
Fidel à Mexico, l’épopée de la Sierra Maestra. J’aimais cet homme dont je ne partageais pas<br />
exactement les conceptions politiques mais dont la joie, la combativité, le courage physique,<br />
l’humour m’exaltaient.<br />
J’assistais aux étonnants discours de Castro, des discours qui étaient comme des mises en scènes<br />
de théâtre, qui pouvaient durer des heures, qui se faisaient pédagogie vivante, poème, leçon<br />
politique.<br />
En dépit de mon profond « pessimisme » je n’étais pas loin de penser que ces jeunes<br />
« Commandantes » de vingt ans ne pouvaient pas créer un monde semblable à celui qu’ailleurs les<br />
vieillards régissaient. Alors que dans la plupart des cas, les vieillards dirigent les pays, c’était pour<br />
une fois la jeunesse ardente qui se retrouvait aux postes de commandes. Ces garçons « sains »,<br />
vigoureux, joyeux ne pouvaient pas remplacer une dictature par un ordre froid, criminel, broyeur<br />
d’âmes et de corps.<br />
Le « Che » s’enflammait à l’idée de la révolution cubaine embrasant toute l’Amérique latine<br />
jusqu’aux plus lointaines cahutes des indiens de l’Altiplano.<br />
Je l’écoutais émerveillé et incrédule. Noyé dans la fumée des gros cigares, je rêvais à mon tour.<br />
À l’appel de La Havane devenue comme une Mecque de la Libération, des milliers de Spartacus se<br />
dressaient sur leurs plaies, sur leurs terres arides et au cri sacré de « Patria o Muerte » faisaient<br />
tomber les murs de la cité d’injustice. Dans les rues je côtoyais une prodigieuse vitalité. Dans les<br />
grands hôtels du Varadedo transformés en hôtels d’accueil pour les invités étrangers, je croisais des<br />
jeunes hommes aux yeux de braises, des jeunes femmes aux poitrines épanouies.<br />
Mais la raison ne me quittait pas. Comment Cuba, entourée de pays hostiles, de dictatures<br />
farouches, peu éloignée de la plus grande puissance capitaliste mondiale, pouvait–elle mener à<br />
terme une authentique révolution. Il y avait un peuple à nourrir, une économie à inventer, des<br />
anciens privilégiés qui n’avaient pas renoncé et qui depuis Miami organisaient la revanche. Il y<br />
avait l’éternelle question : est–ce que l’homme peut se hisser jusqu’à la révolution ? Peut–il tuer en<br />
- 97 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
lui l’opprimé ? Vaincre les habitudes centenaires qui le portent vers l’obéissance, la divinisation<br />
d’un chef qui ne peut que finir dans la peau d’un autocrate ?<br />
Je m’en ouvris à Fidel, au Che, à Raul Castro au cours de nos multiples rencontres. Ils riaient,<br />
m’accusaient de n’être qu’un petit–bourgeois révolutionnariste. Ils avaient foi dans le peuple, dans<br />
leur révolution.<br />
Sur chaque visage je cherchais les signes qui m’auraient aidé à repousser la crainte, l’inquiétude.<br />
Cette île jetée sur la mer des Caraïbes me paraissait bien fragile pour affronter le destin, pour<br />
trouver sa place entre les « géants » qui se disputaient la planète. Y aurait–il assez de volonté,<br />
d’énergie chez les hommes pour refuser tout ce qui pourrait limiter la marche des Cubains vers la<br />
plus grande liberté, le plus grand épanouissement de l’Esprit et du corps ? Eros allait–il enfin<br />
l’emporter sur Thanatos ?<br />
Nicolas Guillen et les autres poètes célébraient la liberté retrouvée. Leurs vers prophétisaient le<br />
monde à venir, le monde déjà en construction. La jeunesse frénétique applaudissait son « lider<br />
maximo ». Elle improvisait des chansons. Elle marchait jusqu’aux villages les plus reculés pour<br />
alphabétiser le peuple. Elle traquait les contre révolutionnaires, les ennemis de la révolution.<br />
Ces quelques semaines furent un enchantement et une occasion d’inquiétude. Je laissais derrière<br />
moi Cuba, fournaise ardente, creuset de « l’homme nouveau ». Par les hublots de l’avion, je vis l’île<br />
devenir de plus en plus petite puis disparaître de ma vue. Il n’y avait plus que l’océan, vide de toute<br />
présence humaine. L’océan toujours recommencé. Comme la longue marche de Spartacus.<br />
Je revins à Cuba à plusieurs reprises. La « révolution » s’affichait partout. Mais déjà des signes<br />
inquiétants se multipliaient. Le Commandant Matos, un ancien compagnon de la Sierra Maestra, un<br />
combattant valeureux, était en prison. « Contre-révolutionnaire » m’objurgua-t-on. D’autres aussi<br />
croupissaient déjà dans les geôles qui n’avaient commis que le crime d’exprimer leurs désaccords<br />
avec Fidel.<br />
Je me trouvais à Cuba lorsque l’attaque des mercenaires à la Baie des Cochons eut lieu. J’étais<br />
avec plusieurs dirigeants dont Le Che et Fidel lorsque la nouvelle parvint. Ce fut aussitôt la ruée. Le<br />
« Che » me demanda de me tenir tranquille. Je revendiquais hautement de prendre la défense de la<br />
révolution, au nom du sacro–saint internationalisme prolétarien. On me donna une arme. Je me<br />
retrouvais dans un camion avec des jeunes gens qui partaient au combat en chantant.<br />
<strong>Les</strong> marais de Zapata étaient une zone très dangereuse infestée de caïmans. C’est là que les<br />
« guanos » avaient décidé de débarquer, protégés par des bateaux US. Ce fut un rude combat qui<br />
s’acheva par la débandade des envahisseurs. À un moment du combat, je me retrouvais allongé près<br />
d’un nègre qui semblait suffisamment âgé pour avoir connu, enfant, l’esclavage. Il serrait entre ses<br />
mains un gros fusil. Je remarquais sur la crosse du fusil six entailles faites au couteau. Je lui dis avec un<br />
sourire victorieux : « Seis guanos » ? Sa réponse me fit froid dans le dos : « No Señor, Seis Hijos » (Non<br />
Monsieur, six fils). Cet homme venait de perdre ses six fils. Il n’y avait plus que lui pour tenir le fusil,<br />
pour résister. Je posais ma main sur son épaule que je broyais littéralement. Je voulais lui transmettre ma<br />
compassion, ma sympathie.<br />
De retour en France, je suivais les événements. Ce que je craignais ne tarda pas à se produire.<br />
Cuba tombait lentement aux mains de Moscou. Le Parti Communiste cubain dont le rôle contre la<br />
dictature de Batista avait été dérisoire, tenait de plus en plus le haut du pavé. Fidel n’allait pas tarder<br />
à se découvrir « marxiste léniniste ». <strong>Les</strong> conseillers soviétiques dictaient leurs directives<br />
impunément.<br />
La répression s’abattit sur ceux qui n’acceptaient pas une telle orientation, un pareil inféodement.<br />
On tenta de les briser par la menace, le sévice, la torture. On en brisa beaucoup. On brisa Ismael<br />
Madruga, Alfredo Carrium Obeso, Ramos Kessel, Terres Martiro, Pedro Luis Boitel, cent, mille<br />
- 98 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
autres encore. D’autres continuent de résister tel Armando Valladares emprisonné depuis 1960 au<br />
fond d’un puits de ciment. Valladares a subi de nombreuses tortures. En 1977, il n’avait reçu aucune<br />
visite depuis neuf ans. « Deux mètres d’angoisse sur un mètre de torture » a–t–il écrit dans un<br />
recueil de poèmes dont la traduction française a paru, il y a quelques mois, aux Éditions Grasset<br />
sous le titre «Prisonnier de Castro ». Prisonnier de Mao, Prisonnier de Castro, Prisonnier de<br />
Brejnev, Prisonnier de Schmidt… Le « Prisonnier » est la grande figure du XX e siècle. La<br />
« multinationale des goulags » dénoncée par le dissident russe Leonid Pliouchtch, ne se repose<br />
jamais, elle œuvre vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sur tous les continents. Valladares a<br />
aujourd’hui quarante–deux ans. À son entrée dans l’enfer, il avait vingt–trois ans. Exilée, sa femme<br />
se bat chaque jour pour le tirer vivant si possible d’un « lider maximo » devenu un vulgaire<br />
caudillo.<br />
Au fil des années, et très rapidement, la « fête cubaine » a viré au cauchemar. <strong>Les</strong><br />
« révolutionnaires » des années 60 sont devenus les <strong>amis</strong> et protecteurs de certains tyrans. Quelle<br />
honte ineffaçable !<br />
Le « lider », lui, marche toujours sur ses deux jambes. Valladares se traîne sur les genoux dans<br />
son puits infâme.<br />
Durant de longues années les indécrottables intellectuels occidentaux rendus aveugles par un<br />
billet d’avion gratuit, tressèrent les louanges du socialisme cubain. Ils n’étaient pas dans l’île pour<br />
voir la vérité mais pour voir ce qu’ils désiraient voir : une révolution victorieuse qui leur permettait,<br />
à leur retour, de venir pérorer devant de vastes assemblées dans la grande salle de la Mutualité,<br />
trompant ainsi de jeunes esprits mal armés et soucieux de posséder la conviction qu’il y avait au<br />
moins, quelque part sur la planète douloureuse, une révolution « vraie » qui éclairait le monde.<br />
Aujourd’hui le « cuba libre » a un goût amer de bouillon d’onze heures. Depuis la « défête<br />
cubaine » je me suis juré de ne jamais plus m’abandonner à l’illusion lyrique, de ne plus me laisser<br />
emporter par des proclamations enflammées, des prophéties grandioses. Je me suis promis, toujours<br />
et partout d’exiger qu’on me montrât l’envers du décor, qu’on m’ouvrit les portes, toutes les portes.<br />
Quand un pays n’a pas de camps de travail, de goulag à cacher, il ne peut craindre un œil<br />
investigateur. Mais tous les pays ont des goulags à cacher. C’est pourquoi le visiteur doit toujours,<br />
d’une façon ou d’une autre, se signaler aux autorités.<br />
Quand l’Algérie arracha enfin son indépendance après tant d’années jonchées de cadavres,<br />
malheureusement, j’étais encore disponible pour l’illusion lyrique. J’étais à l’époque en rupture<br />
d’Europe. Je souhaitais quitter le vieux continent pour ne plus jamais revenir. J’entendais l’appel<br />
d’Aden Arabie comme l’avait entendu Paul Nizan.<br />
Mon fils venait de naître. Mais sa mère m’avait quitté avant sa naissance. Cette femme ne<br />
désirait pas vivre avec moi, c’était son droit. Quand mon fils naquit ce fut un drame : il était<br />
épileptique. Sa mère se dévoua corps et âme pour lui. Elle fut admirable. De ce bébé frappé par<br />
l’adversité elle a fait – avec l’aide des thérapeutes cela va de soi – un jeune homme qui s’apprête<br />
actuellement à devenir berger, un garçon plein de vitalité, passionné de musique et de poèmes de<br />
Prévert. Mon fils !<br />
Accablé par l’ennui qui était le mien en France, je décidais donc de rejoindre l’Algérie<br />
indépendante. J’avais assisté aux journées bouleversantes qui avaient suivi la proclamation de<br />
l’indépendance. J’avais été témoin pour la première fois de ma vie d’une catharsis géante. Pendant<br />
ces trois jours les tabous s’effondrèrent chez ce peuple musulman. <strong>Les</strong> femmes arrachaient leurs<br />
voiles. Elles offraient leurs visages aux rayons du soleil nouveau. <strong>Les</strong> hommes aussi se libérèrent<br />
durant ces heures ardentes des carcans traditionnels. Pendant trois jours, ivre, j’avais sillonné cette<br />
ville en proie au délire, à l’enthousiasme, à la fièvre érotique, sexuelle. <strong>Les</strong> soldats de l’ALN<br />
tiraient en l’air, déchirant de salves les nuits orageuses. C’était un spectacle bouleversant que<br />
- 99 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Jacques Berque a magnifiquement évoqué en ouverture d’un de ses ouvrages : la dépossession du<br />
monde.<br />
Je répondis donc favorablement aux propositions des camarades algériens qui me suppliaient de<br />
venir les rejoindre, de participer avec eux à l’édification du nouveau pays. Je rejoignis au plus vite<br />
Alger. On me proposa des responsabilités importantes au sein de l’Agence de presse nationale<br />
l’APS. J’acceptais. Je m’installais au–dessus de la casbah dans un immeuble habité par nombre de<br />
veuves de guerre, quelques familles pauvres. Je disposais du dernier étage. C’était un appartement<br />
modeste mais il me convenait parfaitement. De mon balcon je pouvais découvrir d’un regard<br />
circulaire le port embrumé par les grandes chaleurs. <strong>Les</strong> gens du quartier était intimidés car une<br />
voiture de service battant pavillon national venait me chercher pour me conduire à mon lieu de<br />
travail.<br />
Je travaillais avec ardeur, passion. C’était la première fois qu’il m’était donner d’exercer ce<br />
métier de journaliste que j’aimais dans des conditions pleinement satisfaisantes. Il fallait former de<br />
jeunes reporters, de jeunes journalistes capables de traiter de l’Économie, de la politique<br />
internationale, de la Culture.<br />
L’agence était située Boulevard de la République, face à la mer. Je passais là la majeure partie de<br />
mes journées, travaillant souvent très tard. J’étais très ambitieux. Je voulais que l’Agence puisse le<br />
plus rapidement possible se hisser au niveau des grandes agences du Maghreb et du Moyen Orient.<br />
Je devins collaborateur de l’hebdomadaire Révolution africaine, où je fis la connaissance de<br />
Gérard Chaliand et de sa femme Juliette Minces. C’était Mohammed Harbi, une des intelligences du<br />
nouveau pouvoir, qui dirigeait cet hebdomadaire. Par ailleurs, je réalisais des émissions de radio<br />
concernant la culture algérienne que le peuple ignorait, coupé qu’il avait été de ses racines par le<br />
colonisateur.<br />
Je retrouvais aussi Georges Arnaud, l’auteur du Salaire de la Peur, joues creuses, mèche en<br />
bataille, toujours aussi virulent et fraternel. D’autres encore qui, comme moi, avaient décidé de<br />
quitter l’Europe pour se mettre au service de l’Algérie démocratique et socialiste.<br />
Je voyageais à travers le pays dès que j’avais quelques heures de libres. Je découvris<br />
Constantine, le ravin de la femme sauvage, les merveilleuses femmes kabyles, les oasis du sud,<br />
Oran tournant le dos à la mer, les mechtas brûlées. Je rencontrais des femmes et des hommes qui<br />
gardaient encore dans le regard des traces de l’horreur vécue, des enfants demi–nus, pauvres, qui,<br />
comme tous les enfants du monde, qu’ils soient blancs ou noirs, rouges ou jaunes, se contentent<br />
d’une vieille boîte de conserve pour s’inventer tout un monde. Je retrouvais Kateb Yacine, le<br />
bouleversant écrivain de Nedjma et du Polygone étoile. C’est en souvenir de lui que quelques<br />
années plus tard j’allais prénommer ma fille Nedjma, ce qui veut dire « Étoile ».<br />
J’étais la « voix » officielle de l’Algérie. Chaque jour je rédigeais plusieurs éditoriaux que la<br />
radio citait et que le lendemain la presse publiait. J’étais proche de l’aile gauche du Parti et des<br />
syndicats dont les membres, pour la grande majorité, avaient vécu la lutte clandestine en France<br />
puis dans les maquis. J’essayais de comprendre quelles forces s’opposaient plus ou moins<br />
ouvertement, pour la conquête du pouvoir réel. J’étais séduit par Ben Bella. Il était un mélange de<br />
bonhomie, d’autoritarisme, de démagogie, mais il irradiait de lui une certaine lumière émouvante.<br />
Le chef d’État n’avait pas étouffé le petit footballeur, le jeune militant nationaliste enthousiaste,<br />
actif et décidé. Il possédait à un degré incomparable l’art de se mettre la rue « dans la poche ». Ses<br />
interventions publiques suscitaient les youyous des femmes, les applaudissements frénétiques des<br />
hommes.<br />
Si Ahmed devint comme un leader charismatique. Boumedienne m’inquiétait autrement. Cet<br />
homme secret, grâce à qui Si Ahmed avait pu se hisser au premier fauteuil, avait la haute main sur<br />
l’armée. Cet homme qui ne s’était pas frotté à l’Europe m’échappait. Je le craignais sourdement.<br />
L’indépendance avait multiplié les clans. Des « chefs de guerre », au nom de leurs états de service,<br />
- 100 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
se taillaient des royaumes. <strong>Les</strong> marxistes en appelaient à la lutte des classes. <strong>Les</strong> « intégristes »<br />
musulmans intriguaient dans l’ombre du Palais d’été. Ma tâche était délicate. Chacun de mes<br />
éditoriaux suscitait l’ire de tel ou tel clan ou groupe. Quand je plaisais aux syndicalistes je<br />
déplaisais aux responsables du Parti, et vice-versa.<br />
J’écrivais à tâtons, le pathos lyrique, informel, remplaçait souvent la directive claire. J’exaltais<br />
toutes les luttes mondiales qui me semblaient aller dans le sens du combat du peuple algérien. Je<br />
dénonçais violemment les régimes racistes, bourgeois, l’impérialisme américain, j’évoquais<br />
quotidiennement les problèmes de la réforme agraire, du socialisme, de la libération des femmes,<br />
question qui n’était pas mince dans un pays d’Islam. À mots couverts je mettais en garde contre un<br />
appareil d’État en train de se consolider qui pouvait écraser le peuple, le déposséder de sa lutte.<br />
J’étais témoin des « magouilles » des arrivistes que toute révolution transporte inévitablement dans<br />
ses bagages, des ralliés de la dernière heure, des notables transformés en guérilleros, des affamés de<br />
puissance, tandis que le peuple, au jour le jour, cherchait son pain quotidien. Ben Bella ne maîtrisait<br />
pas cette toile d’araignée. Il louvoyait. Il avait pris visiblement le goût de sa fonction de magistrat<br />
suprême. Je ne niais pas son « honnêteté », sa sincérité de lutteur, mais cette honnêteté et cette<br />
sincérité avaient bien du mal à faire bon ménage avec sa froide volonté de garder, quoi qu’il en<br />
coûte, le pouvoir.<br />
Une administration plus ou moins occidentalisée s’emparait des postes dirigeants. Mes propres<br />
dactylographes avaient l’oreille vissée à la radio française. Elles écoutaient Johnny Hallyday dont<br />
elles connaissaient mieux les chansons que les ouvrages d’Ibn Khaldoun. Je devais les menacer de<br />
représailles. C’étaient en général des filles de la « bureaucratie » qui avait collaboré avec le<br />
colonialisme.<br />
<strong>Les</strong> grandes puissances se disputaient l’Algérie de Ben Bella. Chaque matin – c’était un rituel –<br />
deux conseillers de l’ambassade chinoise – ils arrivaient toujours les premiers – m’apportaient les<br />
derniers discours fleuves du Camarade Mao. Un quart d’heure plus tard se présentaient les deux<br />
conseillers de l’ambassade soviétique qui m’apportaient les derniers discours du Camarade<br />
Khrouchtchev. Ils avaient des raideurs de militaires, de flics de services spéciaux.<br />
Le « réalisme » et le « rêve révolutionnaire » s’affrontaient une fois de plus de haut en bas de la<br />
structure. <strong>Les</strong> uns souhaitaient qu’on accélérât l’allure, d’autres au contraire recommandaient de<br />
ralentir. Ben Bella s’imaginait sans doute qu’il était le plus fort de tous, le plus malin. Peu à peu les<br />
bases d’une économie mixte étaient jetées. <strong>Les</strong> combattants avaient rangé leurs armes. La<br />
production était devenu l’objectif de lutte. Et comme toujours la Production créait des « couches<br />
favorisées » d’administrateurs qui voyageaient avec des attachés–cases, habitaient de somptueux<br />
appartements, disposaient de moyens qui étaient interdits au humbles qui s’échinaient sur le port,<br />
dans les usines, les champs, les raffineries de pétrole.<br />
Il y eut la guerre éclair avec le Maroc. Ben Bella avait eu recours au vieux stratagème qui<br />
consiste à crier qu’il y a danger aux frontières quand les problèmes intérieurs atteignent une<br />
dangereuse intensité. S’il n’y avait eu, de part et d’autre, quelques morts, cette guerre aurait pu faire<br />
sourire. <strong>Les</strong> deux camps s’affrontaient en terrain découvert. <strong>Les</strong> officiers n’avaient pas pris le temps<br />
de troquer leurs costumes de ville contre l’uniforme réglementaire. Cravatés, en chemises blanches,<br />
jumelles collées aux yeux, ils donnaient nonchalamment leurs ordres. Il y eut quelques tirs<br />
d’artillerie. On voyait de loin arriver les obus. <strong>Les</strong> hommes se couchaient dans le sable, après avoir<br />
pris quelque distance : des nuages de poussière ! Chacun se redressait en riant. Il y eut la fièvre<br />
kabyle. L’Algérie, elle non plus, n’était pas épargnée par le problème des minorités. L’Algérie arabe<br />
s’imposait aux berbères.<br />
Après sa rencontre avec Castro Ben Bella se voulut le « lider maximo » du monde arabe. Il mena<br />
tambour battant une diplomatie caracolante qui devait l’imposer à la tête de ce vaste ensemble<br />
convoité par les grandes puissances.<br />
- 101 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Je voyageais beaucoup. Je « couvrais » les grands événements du monde : coups d’État, mort<br />
d’hommes politiques importants. Je rencontrai ainsi Soekarno qui accueillit notre délégation avec<br />
deux rangées de superbes balinaises qui jetaient sur nos pas des pétales de fleurs, et qui, ensuite<br />
nous offrit un festin royal. C’était un jouisseur. À Pékin, j’interviewais Mao Tsé-Toung qui n’allait<br />
pas tarder à déclencher la Révolution Culturelle. Ce fut un étrange entretien. Je me tenais à distance<br />
du dieu vivant. Des secrétaires-traductrices transmettaient à voix murmurée mes questions et me<br />
rapportaient les réponses du Chef. Je restais quelques jours dans la capitale, découvrant ce peuple<br />
charmant, affable, serviable. Je pressentais la puissance du Parti qui couvrait l’existence entière des<br />
individus. Je devins l’ami de Medhi Ben Barka. J’eus de longs entretiens avec Nasser au Caire. À<br />
plusieurs reprises je me rendis au Vietnam du Nord où je rencontrais l’Oncle Ho qui se fit un plaisir<br />
de m’évoquer le Paris de sa jeunesse, avec l’inévitable « Commune » de Louise Michel. Je visitais<br />
plusieurs fois les maquis du sud. J’interrogeais des héroïnes du peuple qui n’avaient pas vingt ans et<br />
qui, armées de leur seul fusil, avaient d’une unique balle abattu des avions yankees. J’étais subjugué<br />
par ces combattants qui se nourrissaient d’une ou deux poignées de riz par jour et faisaient preuve<br />
d’une ardeur sans limites. Dans des réunions de solidarité internationale anti–impérialiste, je fis la<br />
connaissance de la plupart des leaders des guérillas d’Amérique Latine. Cette existence agitée,<br />
frénétique, me comblait assez. Il ne me manquait qu’une femme aimée près de moi. Elle survint un<br />
jour, sans crier gare. Elle s’appelait Ava. Elle était métisse américano-indienne. Elle avait été mêlée<br />
dans son pays et dans d’autres contrées à diverses actions révolutionnaires de gauche. Elle vivait en<br />
Algérie en position d’attente. Notre rencontre manqua de m’être fatale. C’était Noël. Nous avions<br />
décidé – peut–être avec un peu de nostalgie – à plusieurs Pieds rouges – ce terme que j’avais un<br />
jour subitement inventé pour désigner dans un article les français qui, comme moi, s’étaient mis au<br />
service de la « révolution » algérienne, était devenu célèbre – de fêter la naissance du Christ<br />
ensemble. Nous devions nous retrouver chez un pied rouge qui disposait, sur les hauteurs d’Alger,<br />
d’un vaste appartement. L’ami me fit savoir qu’Ali – Ali (un de nos <strong>amis</strong> algériens, membre des<br />
forces de sécurité) viendrait en compagnie d’une femme très belle, très étrange. Le soir de Noël<br />
nous nous retrouvâmes donc chez mon ami. Nous étions une vingtaine, garçons et filles mêlés,<br />
français et algériens. Il y avait même un ou deux représentants d’obscurs mouvements de libération,<br />
d’Afrique noire et d’Amérique latine. Pour la saison le temps était très doux. Je songeais à ceux qui<br />
dans la vieille Europe glacée claquaient des dents à la même heure. Nous nous connaissions presque<br />
tous. Très vite de petits groupes se formèrent, échangeant leurs vues quant à l’avenir probable de la<br />
Révolution. Aux alentours de vingt–deux heures quelqu’un frappa à la porte. Notre ami se précipita.<br />
C’était Ali accompagné d’Ava. Pierre m’avait expliqué qu’ Ali était follement épris d’Ava mais que<br />
cette dernière n’éprouvait pour Ali qu’une amitié affectueuse. Je connaissais assez bien Ali. C’était<br />
un grand jeune homme au visage osseux, au front dégarni bien qu’il n’ait pas plus de trente ans. Il<br />
était vêtu d’un costume gris très strict. Ali était un bel homme d’une certaine façon. Ava avait revêtu<br />
un sari couleur safran. Elle arborait orgueilleusement le « troisième œil », un gros point rouge<br />
imprimé entre les deux yeux, sur le front. En vérité, c’était une créature d’une beauté à couper le<br />
souffle. Mais cette beauté visible à l’œil nu n’était sans aucun doute que le masque d’une autre<br />
beauté. Le regard ne trompait pas. Il brillait avec une intensité presque insoutenable.<br />
C’était la coquetterie d’Ava de revêtir dans certaines circonstances le sari traditionnel. Elle créait<br />
ainsi une certaine distanciation avec l’interlocuteur. Ses pouvoirs en étaient décuplés.<br />
On me présenta Ava. Nous échangeâmes quelques propos puis d’autres <strong>amis</strong> nous séparèrent. De<br />
plus, je ne voulais pas donner l’impression de vouloir l’accaparer.<br />
Ava allait de groupe en groupe. Elle semblait connaître la plupart des personnes présentes. Elle<br />
buvait, riait. Ali ne la quittait guère des yeux. À un moment, le hasard me ramena à ses côtés. C’est<br />
alors que – farce du maître des lieux ou pur accident – l’électricité s’éteignit brutalement.<br />
Inconsciemment, je saisis la main d’Ava qui ne la retira pas. Je crus même ressentir comme une<br />
- 102 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
complicité. La panne ne dura que quelques secondes. Quand la lumière revint aussi brusquement<br />
qu’elle était disparue je retirai précipitamment ma main mais pas assez rapidement pour empêcher<br />
Ali de voir le mouvement. J’étais mal à l’aise. Je m’éloignai d’Ava, m’intégrant à d’autres groupes.<br />
Un long moment passa. Soudain un indescriptible brouhaha s’éleva dans l’autre pièce. Je reconnus<br />
la voix d’ Ali puis celle de Pierre. J’allais rejoindre l’autre pièce lorsqu’ Ali surgit devant moi, son<br />
revolver au poing. Ali avait beaucoup bu depuis son arrivée et je savais qu’il supportait très mal<br />
l’alcool. Ses yeux flambaient de colère, de haine. Je compris aussitôt. Il était jaloux à cause d’Ava.<br />
Surpris, je n’avais pas prononcé une parole. La situation était absurde. Mais déjà Pierre et d’autres<br />
compagnons avaient agrippé Ali qui tentait de leur échapper. Son revolver tomba au sol, quelqu’un<br />
donna un coup de pied dedans. Le revolver disparut sous un meuble. Et brusquement Ali s’effondra<br />
en larmes. Avec beaucoup de ménagement, nous l’entraînâmes vers la salle de bains. Nous lui<br />
appliquâmes des linges humides sur le visage. Ali reprit peu à peu ses esprits. Il était profondément<br />
honteux. Il me demanda pardon, me fit mille excuses. Je lui répondis que tout cela n’était pas grave.<br />
La fête reprit son cours.<br />
Je revis Ava et bientôt nous vécûmes ensemble. J’étais amoureux fou d’elle. J’aimais son amour,<br />
ses exigences, sa liberté de femme. Ce furent quelques mois d’Eden. Ava était en liaison avec des<br />
groupes révolutionnaires indiens, les « naxalites. »<br />
Un matin, alors que nous venions de faire longuement l’amour et que nous étions allongés sur le<br />
balcon, au–dessus du port embrumé, Ava me dit qu’elle allait devoir s’absenter deux semaines pour<br />
une mission importante dans son pays. Elle partit le lendemain. J’étais en proie à une angoisse<br />
inexplicable. J’appréhendais quelque malheur. Ava m’avait promis de me tenir au courant. Je ne<br />
reçus jamais de ses nouvelles.<br />
Plusieurs mois plus tard, j’appris la vérité. Ava était morte en prison des suites de mauvais<br />
traitements. Elle avait été capturée deux jours après son arrivée. Longtemps, j’ai conservé un<br />
précieux cadeau d’elle, une bague qu’elle m’avait offerte pour sceller notre alliance. Cette bague<br />
devait m’être malheureusement dérobée, quelques années plus tard à Tanger, par une bande de<br />
voyous qui m’agressèrent dans une ruelle sombre. Je fus longtemps malade. Ava me manquait. Je<br />
me moquais bien du devenir de la révolution. La révolution n’était pas Ava. Je rentrais le moins<br />
possible chez moi, au-dessus du port. Je travaillais avec acharnement. J’acceptais des missions à<br />
l’étranger. Il s’agissait dans la plupart des cas de liaisons avec d’autres mouvements de libération.<br />
C’est au retour d’une de ces missions que je retrouvais à Alger Che Guevara qui, lui–même, se<br />
rendait incognito dans un pays d’Afrique en proie aux troubles et où couvait une révolte antiimpérialiste.<br />
Je lui fis part ouvertement de mes inquiétudes quant au cours de la « révolution<br />
cubaine ». J’avais à ma disposition de nombreux renseignements indiscutables qui témoignaient que<br />
la répression s’accentuait, que la mainmise de l’Union soviétique s’élargissait avec pour<br />
conséquence un durcissement général. Le « Che » répondit évasivement, détourna la conversation.<br />
Il me tendit une boîte de cigares qu’il avait apportée spécialement à mon intention. La rencontre<br />
avait lieu dans la maison d’un diplomate cubain en poste à Alger. Quand l’heure vint pour lui de se<br />
retirer, je l’étreignis longuement. Il me répondit par un vigoureux « abrazo ». Je ne devais plus<br />
revoir le « Che » vivant.<br />
L’appareil d’État, en dépit de nombreuses carences, continuait à déployer sa toile d’araignée.<br />
Apparemment Ben Bella jouissait toujours de la complète confiance du peuple, mais<br />
souterrainement, les choses commençaient à se détériorer. Je n’ignorais pas les antagonismes<br />
existant entre Ben Bella et Boumedienne. Ce dernier détestait les « pieds rouges », et les journaux à<br />
sa dévotion ne nous épargnaient pas. Un jour même, au cours d’un imbroglio confus, j’eus le<br />
privilège d’être arrêté par Sa police militaire. Je m’en tirais sans trop de mal. Mais j’étais devenu<br />
parfaitement conscient : les « clans » se disputaient âprement le pouvoir. En cas d’affrontements<br />
- 103 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
ouverts, j’avais toute chance d’écoper. Le peuple tenait le rôle qui lui était imparti : produire,<br />
applaudir les leaders, multiplier les youyous, prendre des coups à l’occasion, se taire.<br />
J’avais été particulièrement impressionné lorsque s’était tenu le Congrès des Fellahs. Des<br />
milliers de délégués venus des douars lointains avaient envahi la capitale. Nombre de ces paysans<br />
pauvres n’avaient jamais vu Alger. Ils erraient en attendant l’heure d’ouverture du Congrès se tenant<br />
par la main, en bandes d’une dizaine, de crainte de s’égarer. Que pouvait la volonté de ces hommes<br />
face aux ruses des États-majors, des bureaucrates rompus aux jeux d’Estrade, aux Élites installées<br />
dans les rouages du gouvernement, aux privilégiés du nouveau régime ? Que pouvait le regard<br />
désarmé de ces hommes de la terre, aux mains rugueuses, que la « volonté de dieu » écrasait ?<br />
Le prolétariat était en nombre insuffisant pour mettre en pièces ce nationalisme populiste auquel<br />
recouraient habilement nombre de responsables tout en le baptisant « socialisme scientifique ». Ben<br />
Bella était en péril. Le peuple –excité par de mystérieux informateurs – commençait à répéter que<br />
tout ce qui était bon était un cadeau de Si Ahmed, mais que tout ce qui était mauvais était aussi un<br />
cadeau de Si Ahmed. Or, le peuple trouvait qu’il y avait beaucoup de « mauvais » et peu de « bon ».<br />
Étant fréquemment « sur le terrain », désertant le plus souvent possible les officines<br />
gouvernementales, j’étais en mesure de prendre la dimension du danger. Des complots se tramaient<br />
dans l’ombre. Des rumeurs contradictoires parcouraient la capitale. À plusieurs reprises nous avions<br />
dû nous fâcher avec le Président qui dans ses tractations, n’hésitait pas à « vendre » la peau des<br />
« Pieds rouges ». Ben Bella louvoyait de plus en plus. À jouer clan contre clan, il en était arrivé à ne<br />
plus pouvoir compter, à la limite, que sur le carré d’extrême gauche qui jusque–là s’était protégé<br />
derrière sa personne, pour mener le plus loin possible la bataille idéologique. On prêtait à Ben Bella<br />
des intentions de coup d’État. Elles n’étaient certainement pas du seul domaine de la fiction.<br />
Des trotskystes, sous la houlette de leur leader Pablo, s’agitaient dans l’ombre et concoctaient<br />
des plans de « révolution permanente ». <strong>Les</strong> agents des grandes puissances et des pays arabes<br />
foisonnaient dans Alger, tissant leurs complots. <strong>Les</strong> richesses énergétiques sahariennes intéressaient<br />
beaucoup de gens. J’essayais de démêler le vrai du faux. Je respectais énormément Si Ahmed mais<br />
je n’étais pas dupe de la sorte de paranoïa qui s’était emparée de lui. Il se croyait alors invincible.<br />
Chaque jour, moi, je pouvais enregistrer les échecs de la Réforme agraire pour laquelle nous nous<br />
battions ardemment, convaincus que c’était là un des objectifs essentiels, décisifs de la révolution.<br />
Le peuple témoignait d’une grande, d’une incroyable capacité de création mais il butait<br />
inévitablement contre les structures étatiques. Nous étions une poignée à nous accrocher<br />
rageusement. J’aimais ce peuple, j’aimais cette terre, j’avais entendu, moi aussi, et excusez du peu,<br />
l’appel du désert comme T.E. Lawrence, Lawrence d’Arabie. J’aimais ces casbahs, ces médinas aux<br />
odeurs fortes de cuir, de laine, de teinture. J’aimais ces ruelles grouillantes de vendeurs de merguez<br />
et de loukoums. J’aimais ces jeunes « machos », bruyants. J’aimais ces femmes enveloppées dans<br />
leurs voiles, discrètes, vigoureuses comme le roc. J’aimais ces gosses toujours en quête d’une pièce<br />
de monnaie. J’aimais entendre, du haut du minaret, l’appel du muezzin appelant à la prière. J’étais<br />
profondément bouleversé par ce peuple religieux, travailleur. Une image d’Épinal s’était effondrée<br />
sous mes yeux : celle qui veut que les peuples du « tiers monde » soient des peuples de fainéants. Il<br />
faut avoir traversé les yeux fermés New Delhi, Calcutta, Bangkok, Bogota, Dakar, pour ignorer que<br />
les pauvres s’acharnent avec une increvable volonté à survivre, au prix de menues besognes payées<br />
un dinar, une roupie, trois quarts de dollar. J’en profite d’ailleurs pour rendre hommage au<br />
journaliste du Monde, Jean-Claude Guillebaud, qui, tout au long du mois d’août 1979, dans un<br />
reportage «Un voyage vers l’Asie » a remarquablement fait justice de cette imagerie trompeuse et<br />
injurieuse pour ceux qui crèvent, au jour le jour, dans les slums, les klongs, les barrios, les<br />
bidonvilles, avec pour unique objectif « mourir le plus lentement possible ». Que les « donneurs de<br />
leçons » qui peuvent se payer coup sur coup trois whiskies à 20 F (de quoi faire vivre une famille<br />
plusieurs semaines dans les lieux que je viens de citer) la ferment, nom de dieu !<br />
- 104 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Quand j’eus acquis la certitude que « quelque chose » allait arriver, et que Ben Bella ne serait pas<br />
en mesure de faire face à ce quelque chose, et que, du même coup, tous ceux qui étaient considérés<br />
comme des alliés du président, tomberaient avec les plus gros risques, je décidai de rentrer en<br />
France. Je fis part de ma décision au Président. Il balaya d’un large revers de la main mes<br />
objections.<br />
Je maintins toutefois ma décision. Par un beau matin ensoleillé, je quittais le sol algérien. J’avais<br />
promis de revenir au cas où j’estimerais que ma présence pourrait être utile, au cas où mes<br />
prophéties se révéleraient fausses. J’étais arrivé dans ce pays avec une pauvre valise. Je repartais<br />
avec une pauvre valise. Juste avec l’argent de mon dernier salaire « révolutionnaire ». De quoi<br />
survivre quelques semaines en Europe. J’étais malheureux de devoir retrouver le vieux continent.<br />
J’étais décidé à n’y point rester longtemps. Je désirais profondément repartir. Une possibilité m’était<br />
donnée de rejoindre Amilcar Cabral et les rangs du PAIGC qui combattaient en « Guinée<br />
portugaise » pour l’indépendance et là le socialisme. De tous les leaders de l’Afrique noire – et<br />
même du « tiers monde » – Cabral m’apparaissait comme un des plus authentiques, des plus<br />
responsables, des plus fraternels. Je choisis donc d’attendre à Paris les événements que je<br />
pressentais, et de réagir selon le cours de ces événements.<br />
Mon attente fut de courte durée. Un matin que je sortais de la bouche de métro « Trocadéro », le<br />
titre énorme de France Soir qui était affiché au kiosque me faisant face, accrocha immédiatement<br />
mon regard. Ayant des yeux faibles, je ne pus aussitôt déchiffrer ce titre. Mû par je ne sais quel<br />
pressentiment – ce n’était quand même pas la guerre mondiale atomique qui commençait, les gens<br />
autour de moi étaient trop calmes – je grimpais au pas de course les dernières marches.<br />
« Ben Bella destitué cette nuit ». J’achetai fébrilement un exemplaire du journal. Je m’appuyai<br />
contre la grille du métro et dévorai l’article. Profitant du tournage du film de Pontecorvo,<br />
Boumedienne avait fait faire mouvement à ses chars qui s’étaient placés aux lieux stratégiques. Ben<br />
Bella et les « benbellistes » avaient été arrêtés sans coup férir. Seuls, un ou deux ministres, quelques<br />
militants qui avaient eu la mauvaise idée de résister avaient été blessés. On ne signalait aucune<br />
manifestation populaire. Le pire pour lui, Ben Bella était tombé dans une relative indifférence. Le<br />
peuple, ce peuple qu’on met à toutes les sauces, avait bien d’autres soucis. Il avait appris que quel<br />
que soit le chef, le peuple paie, le peuple trime, le peuple s’épuise, le peuple meurt. J’avais donc été<br />
bon prophète. J’eus une pensée émue pour Si Ahmed, malgré tout. Et je songeais aux camarades qui<br />
se retrouvaient et allaient se retrouver sur la paille noire des geôles. L’Ère Boumedienne<br />
commençait, elle s’est achevée il y a peu. Sous son règne l’Algérie allait quitter les rivages du<br />
folklore pour s’engager sur les rudes voies du développement. Mais « le socialisme algérien »<br />
demeure toujours une idée neuve dans le Maghreb.<br />
Je ne partis jamais rejoindre Amilcar Cabral, les guérilleros guinéens. Peut–être à cause de mon<br />
fils, preuve vivante que si dieu existait c’était un dieu qui n’hésitait pas à frapper ses créatures<br />
démunies. Un dieu d’injustice. C’est peut–être aussi parce que quelque chose de grave s’était fêlé<br />
en moi. Le jeune homme romantique, fou de certitudes, était mort. Il pourrissait quelque part dans la<br />
pouillerie de Quito, entre les rats de Buenos–Aires, dans les eaux nauséabondes et sales des klongs<br />
thaïlandais, sous les cadavres du Vietnam, dans les prisons obscures de Fidel.<br />
Je me retrouvais mains nues, désemparé. Le seul outil que je savais manier était la plume. Je<br />
recommençais à collaborer à divers journaux, sans distinction de qualité, je rédigeais des textes<br />
publicitaires, j’étais un « pisse copie ». Entre deux poèmes, j’abattais en une vingtaine de pages, un<br />
méchant polar bourré de violence, de sexe, d’invraisemblables coups.<br />
Parfois, je posais devant moi, sur la table, la bague d’Ava. Et je rêvais de longs moments.<br />
L’Europe commençait à devenir pour moi une terre étrangère.<br />
- 105 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
LA CHUTE D’ICARE<br />
AVEC DÉTOUR<br />
PAR<br />
MAI 68<br />
- 106 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
À mon retour, il n’y avait plus de FCL. J’étais désenchanté, mais le désenchantement ne<br />
m’empêcha pas de répondre à un vieux réflexe : volonté d’action. Je rejoignis le PSU dont j’allais<br />
être membre jusqu’au lendemain de Mai 68. Le PSU était – il est toujours puisqu’il survit à toutes<br />
les intempéries – une « auberge espagnole », un fourré–tout : chrétiens de gauche, ex–militants<br />
communistes, futurs gauchistes, antistaliniens, romantiques de tout poil, jeunes gens frénétiques,<br />
jeunes femmes rêveuses s’y côtoyaient. Cette disparité faisait la richesse et la misère du Parti. Mais<br />
elle était loin d’être désagréable. Je m’intégrais à l’opposition qui allait être qualifiée<br />
« luxembourgiste » bientôt. C’était un Parti qui rassemblait les plus traditionnels comportements et<br />
ceux qui préfiguraient d’autres conceptions, d’autres approches de l’activité de « gauche ».<br />
C’était l’époque où l’étoile de Michel Rocard montait à l’horizon. Ce jeune homme protestant,<br />
d’excellente famille, venu des jeunesses SFIO, m’intriguait. Il me déplaisait et m’attirait dans le<br />
même temps. Je n’étais pas de son monde et je n’accordais guère de crédit à ses professions de foi<br />
« ultra gauche ». C’est un garçon instruit, décidé, froidement lucide, empêtré dans ses<br />
contradictions. Le PSU avait du mal à se tailler sa place au soleil. L’hégémonie du PCF était encore<br />
solidement établie parmi les travailleurs. La vieille SFIO s’accrochait durement à ses bastions<br />
traditionnels. Le retour du gaullisme avait jeté le trouble dans les rangs intellectuels. Je ne cesserai<br />
d’ailleurs jamais de m’étonner du nombre d’individus qui, faisant profession de foi de socialisme<br />
démocratique, ne cessèrent d’être fascinés par le Général, par sa rhétorique creuse et grandiloquente<br />
que Revel a dépecée dans un très subtil libelle. <strong>Les</strong> tourments de la guerre d’Algérie continuaient à<br />
me hanter. Moins que jamais, je pensais possible une révolution socialiste en Europe, une<br />
« Europe » tenue à l’œil par l’Union soviétique et les États–Unis. Le peuple commençait à savourer<br />
les délices de la « société de consommation ». <strong>Les</strong> spectres de la seconde boucherie mondiale<br />
s’éloignaient. <strong>Les</strong> classes moyennes, futures clientes des FNAC et du Club Méditerranée, se<br />
développaient sinon à la vitesse des rats, du moins avec une relative rapidité.<br />
Je m’étais lié au groupe de Socialisme ou Barbarie (S. ou B., comme il est convenu de dire) qui<br />
publiait une revue du même nom dans laquelle écrivaient, notamment, Claude Lefort et Cornélius<br />
Castoriadis. <strong>Les</strong> gens de S. ou B. étaient des trotskystes qui s’acheminaient, peu à peu, par<br />
honnêteté intellectuelle, vers une critique radicale du « socialisme scientifique ». J’appris beaucoup<br />
grâce à eux et je les en remercie aujourd’hui. De nombreuses études, concernant la « bureaucratie<br />
soviétique », étaient publiées dans cette revue. Des études approfondies, sérieuses, intelligentes.<br />
Elles ne cessaient de vérifier mes positions, mes intuitions, mes analyses. <strong>Les</strong> rouages de la<br />
bureaucratie était parfaitement mis en lumière. Il n’y avait pas à redire. L’URSS était tout, sauf<br />
socialiste. C’est à peu près à la même époque que je lus en anglais – avec beaucoup de difficultés<br />
d’ailleurs – les premiers textes mis à ma disposition de Herbert Marcuse. Ce fut un choc. Ce<br />
philosophe allemand, installé aux États–Unis, qui avait participé à la gloire de l’École de Francfort<br />
avec Adorno, Horkheimer et d’autres, mettaient à nu les mécanismes de notre oppression, dont il<br />
allait donné dans l’homme unidimensionnel une « photographie » impressionnante.<br />
- 107 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Deux ans après mon retour d’Alger, je me mariais. J’avais rencontré au hasard d’un café, une<br />
jeune femme, employée dans un ministère. Cette jeune femme avait quelque chose d’un oiseau<br />
meurtri. Je fus pris au piège, car c’est bien d’un piège – dont elle–même sans doute n’était pas<br />
consciente –qu’il s’agissait. Je n’avais jamais été marié. Je craignais fortement les liens du mariage,<br />
l’étouffement mutuel de deux êtres. Par jeu j’épousais B. J’aurais mieux fait de m’abstenir. Notre vie<br />
conjugale (?) ne fut qu’une succession de querelles, d’affrontements, de malentendus, à l’exception des<br />
quelques semaines du commencement.<br />
Bientôt B. se retrouva enceinte. Je lui fis savoir que je ne désirais pas avoir d’enfant. Pas encore<br />
du moins. L’ombre de mon fils livré aux médicaments, aux psychothérapeutes pesait lourdement sur<br />
ce choix.<br />
B. me proposa de nous rendre à Tanger où un docteur ami de sa famille pourrait intervenir<br />
efficacement, secrètement.<br />
Nous arrivâmes à Tanger pour apprendre que ce docteur ami de la famille était en vacances en<br />
Europe. Eu égard le temps écoulé, je n’avais plus le choix : j’allais être père.<br />
Ce premier séjour à Tanger fut pour moi un mélange d’ennuis et de joies. La grand–mère de ma<br />
femme était une femme rude, venue s’installer là alors que la ville n’était guère plus qu’un<br />
marécage. Elle avait besogné dur, amassé un petit magot. Elle vivait dans une maison très agréable,<br />
avec un jardin où courait une merveilleuse femelle bouledogue Siska que j’emmenai fréquemment<br />
promener avec moi.<br />
Je m’absentais le plus possible, désirant éviter ma femme. J’avais découvert un bar minuscule<br />
nommé « le trou ma dame ». C’était la seconde ou la troisième épouse de l’écrivain T’serstevens qui<br />
possédait ce bar. En route pour Dakar elle avait fait une halte à Tanger, une halte qui se prolongeait<br />
depuis bientôt dix ans. C’était une femme d’une inébranlable bonne humeur. Elle m’avait pris en<br />
sympathie, me régalait à longueur de soirée. J’avais rencontré deux ou trois fois son ex-mari à<br />
propos duquel elle ne tarissait pas d’éloges. À se demander pourquoi ils ne vivaient plus ensemble,<br />
ces deux oiseaux–là.<br />
Quand je rentrais tard dans la nuit, la grand-mère de mon épouse subtilisait mon costume<br />
d’étoffe légère, que je retrouvais, dès le matin, nettoyé de neuf.<br />
J’ai dit que cette femme était « dure ». Ce n’est pas peu dire. Elle avait abandonné sa propre fille<br />
– la mère de mon épouse donc – aux psychiatres. Cette femme qui avait perdu durant la dernière<br />
guerre son mari – le père de B. – ne s’était pas remis de cette perte douloureuse. Son système<br />
nerveux s’était effondré, sa pensée avait quelque peu éclaté. On la plaça en maison de repos. La<br />
famille hypocrite fut bien aise. On paya. On faisait son devoir humain. De maison de repos en<br />
maison de repos, la mère de B. devait aboutir à l’hôpital psychiatrique où elle allait se pendre aux<br />
barreaux de la fenêtre.<br />
B. fut très affectée. Elle avait déjà vécu un moment terrible dans son existence. À vingt ans elle<br />
était tombée dans les bras d’un jeune godelureau qui après l’avoir engrossée l’abandonna, prit ses<br />
cliques et ses claques pour aller rejoindre une demoiselle de bonne famille qui n’attendait que son<br />
heure pour lui faire enfin des « pipes ». B. décida d’avoir l’enfant, de l’élever seule. L’enfant naquit.<br />
B. trouva à se loger dans un foyer de « mères célibataires ». Quelques semaines plus tard, la<br />
tragédie fit irruption dans sa modeste chambre. B. fatiguée s’était endormie d’un profond sommeil.<br />
Elle n’entendit pas son enfant qui étouffait à la suite d’un «retour de lait ». Le matin, quand B.<br />
s’éveilla, l’enfant était raide, bleu. La police la soupçonna grossièrement d’avoir volontairement<br />
provoqué la mort de son enfant.<br />
C’est peu de temps après ce drame que je fis la connaissance de B. Quand elle apprit le suicide<br />
de sa mère, nous étions déjà séparés. Mais dans un effort de mutuelle intelligence, afin de ne pas<br />
traumatiser à l’extrême notre fille Nedjma, nous avions décidé de passer un mois d’été ensemble.<br />
Nous séjournions dans une ferme que m’avait recommandée un ancien compagnon de la FCL.<br />
- 108 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Je tombais dans un étrange univers : l’homme, alcoolique invétéré, était un polonais d’origine<br />
qui avait combattu en Indochine. Sa femme était une paysanne native de la région, une femme<br />
sèche, levée dès l’aube. Ils avaient un garçon de sept à huit ans, malin comme un singe, déluré, qui<br />
recevait plus de gifles que de caresses.<br />
Dès le premier soir de notre séjour, je fus inquiet à cause du comportement de l’homme.<br />
L’ouvrier agricole qui vivait dans la ferme me réconforta. Je compris très vite qu’il avait combattu<br />
en Indochine avec son patron, qu’il était amoureux de la femme de son ami, et qu’il restait là pour<br />
la protéger au cas où… Quelques jours plus tard, le téléphone sonna et une voix demanda<br />
« Madame <strong>Laude</strong> ». Le temps que je sortisse quérir mon épouse, la « voix » avait mis au courant la<br />
paysanne. De telle sorte que rentrant dans la cuisine, celle–ci se tourna vers B. et sans précautions<br />
oratoires lui jeta au visage « Votre mère s’est suicidée ». B. s’empara du téléphone. La « voix » lui<br />
donna les détails de l’événement. B. décida de partir aussitôt pour Limoges. Je restais à la ferme<br />
avec Nedjma.<br />
Elle revint trois jours après, muette, accablée. Quelques jours plus tard un autre « drame » qui<br />
aurait pu être sanglant devait survenir. À cette époque les Cévennes étaient habitées par de<br />
nombreuses « communautés » de jeunes gens. Le patron de la ferme décida de faire un grand<br />
méchoui et d’inviter plusieurs de ces communautés. Je lui proposai mon aide. Nous nous levâmes<br />
très tôt et fîmes en sorte que le méchoui fût à point à l’heure dite. <strong>Les</strong> « invités » arrivèrent : des<br />
garçons barbus et sales, des filles sales et fardées à l’indienne. Tous muets comme des tombes, l’œil<br />
vide, la lippe agressive. Ils ne restèrent pas une heure, raflèrent tout ce qu’ils purent ingurgiter, boire<br />
et au nom de quelque fallacieux prétexte, prirent la fuite, impatients de retrouver leurs « joints ».<br />
Le patron de la ferme en fut mortifié. Le soir, les autres personnes hébergées dans la ferme<br />
décidèrent d’aller à une fête votive dans un village voisin. Ne restèrent donc que ma femme, ma<br />
fille, les gens de la ferme et moi. Je dormais sous une tente dans une prairie au–dessus de la maison.<br />
Je me retirais de bonne heure. Je dormais déjà depuis plus d’une heure, quand soudain un<br />
rugissement m’arracha au sommeil : « Sors de là ! ». Je tâtonnai en quête de la lampe électrique. Ne<br />
la trouvant pas, je rampai jusqu’au dehors. À quelques mètres de moi, titubant, se tenait le patron de<br />
la ferme, un fusil de chasse tendu vers ma poitrine. Il était ivre. Il prononçait des mots<br />
inintelligibles. Enfin je réussis à comprendre qu’une fille d’une communauté lui avait dit que<br />
j’avais, quelques jours auparavant, traité son fils de « sale petit polak ».<br />
Je réalisais rapidement qu’il n’était pas besoin de s’échiner pour faire comprendre au bonhomme<br />
l’inanité d’une telle accusation. Il était ivre jusqu’aux paupières, armé et dangereux.<br />
Surmontant ma peur, je m’approchais lentement de lui, tout en parlant calmement. À tout instant<br />
l’idée qu’il puisse appuyer sur la gâchette m’effrayait. Quand je fus à un saut d’homme de lui je<br />
m’immobilisai. Je bandais mes muscles, je mesurais du regard la distance et brusquement, comme<br />
l’éclair je bondis. Mes doigts se refermèrent sur le canon du fusil de chasse que je tirais<br />
violemment. Il lâcha prise. Tenant toujours le fusil par le canon, je le brandis au–dessus de ma tête<br />
et l’abattis sur la tête de l’homme qui se mit à pisser le sang, tournoya dans l’air et s’effondra. Je<br />
jetai de toutes mes forces le fusil dans les broussailles et dévalai vers la ferme dont les habitants<br />
avaient été réveillés par les hurlements de l’individu. J’intimai l’ordre à mon épouse de ramasser<br />
nos affaires. Nous rejoignîmes Saint–Hippolyte–du–fort au plus vite. Là était un ami qui nous<br />
hébergea. Le lendemain, nous quittions la région. Quelques temps plus tard, les frimas étant venus,<br />
et les « communautés » ayant rallié Paris, je tombai par hasard sur la jeune personne qui avait été la<br />
cause de tout ce remue–ménage. Une solide double paire de claques conclut l’incident.<br />
Mais revenons à Tanger, quelques années plus tôt. J’avais fait la connaissance à Paris d’un jeune<br />
poète marocain Abdellatif Laâbi. Nous l’appelions tous Latif. Professeur, marié à une jeune<br />
française, père de plusieurs enfants. Latif avait créé quelques mois auparavant une revue qui allait<br />
- 109 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
jouer un rôle éminent non seulement dans les luttes du Maghreb mais aussi dans les combats du<br />
Tiers–monde. La revue s’appelait Souffles. Nous fûmes deux européens à avoir l’honneur de figurer<br />
au Comité de rédaction de cette revue : le poète Bernard Jakobiak et moi–même.<br />
Souffles luttait, culturellement, pour la reconquête de l’identité marocaine, dénaturée par la<br />
colonisation. Ses différents numéros exploraient le passé et le présent de l’héritage et de la création<br />
vivante du Maroc. Ceux qui allaient devenir les meilleurs écrivains marocains y collaborèrent :<br />
Tahar Ben Jelloun, Mostefa El Nissaboury, Khâtibi, Mohammed Khair-Eddine. Mais aussi des<br />
peintres, des philosophes, des économistes, des musicologues, des anthropologues. De numéro en<br />
numéro, Souffles divulguait un savoir remarquable, fertile. Certes, le peuple illettré était tenu à<br />
l’écart de ces richesses mais le premier objectif était de créer une classe d’intellectuels<br />
révolutionnaires dévoués à la cause du peuple. L’écriture des poètes était volcanique, torrentielle,<br />
solaire, insurgée. Elle brisait, humiliait les formes du lyrisme ancien sclérosé. Elle était<br />
annonciatrice d’aubes nouvelles, différentes, elle était porteuse de nouveaux contenus. Ces<br />
camarades vivaient dans la fièvre, la crainte qu’à tout instant la répression de la monarchie<br />
chérifienne ne s’abattit comme une foudre, sur eux. Ils parlaient une langue codée mais<br />
transparente. Ils exaltaient la marocanité mais du même coup ils devenaient universels, exemplaires.<br />
À tel point, qu’on les lût à des milliers de kilomètres de Marrakech et Rabat.<br />
Chaque numéro était un tremblement de terre, une coulée de laves en feu, une irruption de forêts<br />
barbares. Un « chant général » brassant les aubes prolétaires de Rabat et les anciennes légendes, le<br />
sous–développement et la fête des corps, le songe et la réalité cruelle, les ongles des femmes et les<br />
moignons des mendiants, le ciel et la toux sèche du poitrinaire, l’eau et les larmes, le sang et la<br />
semence du mâle…<br />
Longtemps, Souffles occupa habilement le terrain « culturel ». Puis, la situation exigea d’autres<br />
paroles. Le groupe se disloqua. Certains dont Latif devinrent marxistes–léninistes. La revue se mit<br />
au service de la révolution. Une métamorphose s’opéra dans l’écriture de Latif qui renonça à ce<br />
travail de sape pour annoncer les vérités simples, claires, urgentes. Au début des années 70 la<br />
répression s’abattit sur eux, comme prévu. Latif fut arrêté, torturé sauvagement, libéré, arrêté à<br />
nouveau et condamné à dix ans de prison pour « crime contre la sûreté de l’État ». Ayant subi, à<br />
maintes reprises, d’éprouvantes tortures, Latif se retrouva avec une santé chancelante. Il croupit<br />
toujours là bas dans sa geôle de Kenitra, résistant comme seuls savent résister les prisonniers qui<br />
savent pourquoi ils sont en prison, privés d’amour, d’<strong>amis</strong>, de papier, d’encre. Si tout va bien (!),<br />
s’il ne lui arrive pas malheur avant, Latif devrait être libéré au début des années 80. Alors, il<br />
retrouvera ses enfants qui ont grandi loin de lui, son épouse qui n’a cessé de l’accompagner dans<br />
son supplice avec une patience digne de louanges et un courage rarement rencontré. Mais la voix de<br />
Latif n’en a pas pour autant cessé de franchir les barreaux grâce notamment à son ami Ghislain<br />
Ripault qui a publié aux modestes «Inéditions Barbares» plusieurs inédits de lui dont les<br />
Chroniques de la Citadelle d’exil qui m’ont bouleversé quoique je ne sois d’aucune sorte un<br />
marxiste–léniniste.<br />
Mais cette année de Tanger, Latif n’était pas encore emprisonné. Je lui rendis visite. J’ai évoqué<br />
ces instants dans les premières pages de mon récit Joyeuse apocalypse ainsi que l’étonnante<br />
aventure qu’il m’arriva dans le car qui m’emportait de Tanger à Rabat, brinquebalant le long des<br />
chemins : une étonnante nuit de caresses avec une inconnue que le hasard avait placée à mes côtés.<br />
C’était la seule femme présente dans ce car peuplé de paysans chargés de fardeaux divers. Étrange<br />
nuit dont la nostalgie m’habite toujours. Une histoire d’amour sans sexe, sans paroles, rien que<br />
l’aveu, la folie des doigts, des bouches…<br />
Je vécus des heures inoubliables en compagnie de Nissaboury, mon cher « Nissa », de Latif, de<br />
Jocelyne sa compagne, de peintres dont les noms m’échappent à cet instant, mais je ne saurais<br />
oublier leurs figures, leurs voix.<br />
- 110 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Nous fumâmes. Nous jouâmes comme des enfants à glisser des grains de haschisch dans la part<br />
de gâteau dévolue à tel ou tel camarade. Nous eûmes chacun notre tour.<br />
Nous voltigions dans l’espace au–dessus de la misère, de la crasse, de la fatalité. À leurs peaux<br />
solaires, brunes, je réveillais une vieille ardeur assoupie, j’endormais un sombre vieux pessimisme.<br />
Je songe à Latif dans sa geôle de Kenitra comme je songe à l’ami Breyten Breytenbach dans sa<br />
prison d’Afrique du Sud, à l’ami Armando Valladares dans son puits de ciment cubain, rampant sur<br />
ses jambes paralysées. <strong>Les</strong> reverrai–je un jour attablés ensemble et moi parmi eux, fou de vin, fou<br />
de joie, fou de vie ?<br />
Je ne suis plus aujourd’hui qu’un cadavre ambulant !<br />
À Tanger je devais retrouver quelques uns des poètes de la « Beat Génération ». C’est là que je<br />
fis ma première visite à Bryon Gysin dans un petit appartement décoré d’instruments de musique<br />
africains et berbères. Il y avait Burroughs, Ginsberg, Kerouac – que je n’allais plus revoir vivant lui<br />
non plus, Peter Orlovsky en compagnie de qui j’ai lu, il y a quelques mois des poèmes au « Centre<br />
américain des Étudiants et des artistes, » boulevard Raspail à Paris.<br />
Il y avait Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti peut–être, je ne sais plus très bien. Nous nous<br />
enfoncions dans la médina, nous traversions le quartier des selliers – une odeur fauve de cuir nous<br />
assaillait –, le quartier des teinturiers pataugeant dans une immense écume bleue, le quartier des<br />
orfèvres. Nous atteignions enfin un café blotti au fond d’une ruelle. Nous nous abandonnions là à la<br />
musique, au hasch, à la marijuana, au kif. Je me souviens encore d’un petit garçon de neuf ou dix<br />
ans, tout de blanc vêtu, qui dansait au son des luths et des tambourins. Il était gracieux comme un<br />
petit prince du désert, allumant des regards de convoitise dans les yeux de certains de mes<br />
compagnons. Nous buvions à petites gorgées des thés à la menthe délicieux.<br />
Cette médina, il m’est arrivé de n’en pas sortir durant une courte semaine… J’avais fait la<br />
connaissance d’Ali qui après quelques minutes de discussion m’avait vendu à bon prix un demi-kilo<br />
de kif, puis m’avait invité à venir prendre un thé chez son cousin, Mohammed lequel justement<br />
devant se rendre au mariage de la fille de son frère Mostefa qui lui–même avait à rendre visite à<br />
Tahar, un lointain parent. Bref, sept jours pus tard, à quelques heures près, je sortais de la médina,<br />
las mais heureux. Frippé mais délicieusement aérien.<br />
J’avais vu, nue, la face de dieu !<br />
Nedjma vint au monde à Paris. J’avoue que dans les premiers temps je la détestais cordialement.<br />
Elle n’était pas l’enfant de mon désir. Tu ne m’en voudras pas, Nedjma, quand, lisant dans quelques<br />
années – puisqu’à treize ans tu es, aujourd’hui, encore un peu jeune pour lire ce livre – ces aveux<br />
qui me font mal, tu ne m’en voudras pas, je le sais, puisque tu sais que je t’aime, par–delà les mille<br />
confusions et horreurs du quotidien.<br />
Nedjma, je t’ai appelée « Étoile » parce que je savais qu’un jour tu scintillerais dans mon âme<br />
tourmentée, dans le ciel de mes ruines.<br />
Vincent et toi vous êtes mes chéris même si je vous ai mal aimés, même si trop souvent le verre<br />
de vin m’a arraché à vos confidences, même si tant de femmes au lieu de nous réunir dans la<br />
lumière admirable de l’amour, ont creusé des fossés entre nous.<br />
Enfants mal aimés vous êtes un des rares fils qui me retiennent encore aujourd’hui parmi les<br />
vivants – aux gueules de morts malheureusement pour la plupart.<br />
Je ne regrette rien. Je ne regrette pas qu’à deux reprises mon sperme féconda deux femmes. Sans<br />
doute ai–je obéi à une obscure loi. Je l’ignore. Je plaide farouchement non–coupable. Et que ceux<br />
qui me jetèrent la pierre, me couvrirent de cendres et de sarcasmes sinon d’injures se couvrent la<br />
tête, comme des coupables repentants.<br />
- 111 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
La mort de Breton déchira mon ciel. Le 28 septembre 1966, un grand château s’écroula en moi.<br />
Breton était mort. Je n’arrivais pas à me rendre à l’évidence. Je l’avais relativement peu rencontré<br />
depuis mon retour d’Algérie. Je m’étais rendu quelques fois à La promenade de Vénus, dans le<br />
quartier des Halles, ce café qui avait remplacé le Musset. J’étais assez déconnecté. Je préférais<br />
rencontrer Breton hors du groupe. Je me souviens encore que nous parcourûmes ensemble une<br />
exposition de peintures. Je vois encore Breton la pipe aux lèvres, les rides marquées, la chevelure<br />
grisonnante, se tournant vers moi, et me questionnant : « André, Croyez–vous que ce peintre est<br />
d’une certaine façon surréaliste ? ».<br />
Nous l’enterrâmes, le premier octobre, au cimetière des Batignolles où reposait déjà son vieux<br />
complice, Benjamin Péret. Des centaines de jeunes gens, anonymes, silencieux, étaient là, prostrés.<br />
On commençait déjà, au sein du groupe, à se disputer l’héritage du « vieux lion ». Benayoun allait<br />
de groupe en groupe. J’entendis l’un d’entre eux se disputant avec un autre : il s’agissait d’établir<br />
lequel des deux avait eu un ultime échange téléphonique avec André. Prévert arrive, ivre, le mégot<br />
au coin des lèvres. Sacré Frère Jacques ! Je ne me souviens plus s’il pleuvait ou s’il faisait un petit<br />
froid sec. Ce dont je me souviens parfaitement c’est que nous défilâmes devant la fosse, chacun<br />
jetant une rose rouge, une rose noire sur le cercueil, qui fut bientôt couvert d’un épais tapis de fleurs<br />
odorantes et lumineuses. Le hasard m’avait placé entre Roger Blin et Jean-Louis Barrault qui tous<br />
deux pleuraient à chaudes larmes. Un peu plus loin Prévert mordillait son mégot.<br />
Ce fût un enterrement digne, sans apparat inutile. Notre peine était immense, inconsolable.<br />
Un an plus tard, Che Guevara était massacré en Bolivie par un soldat drogué. Il paraît que le Che<br />
est mort courageusement. C’était un courage dont il avait l’habitude.<br />
Je ne peux pas oublier la dernière phrase du journal bolivien du « Che » : nous sommes dix–sept<br />
sous une lune très petite, phrase qui devait inspirer pour le titre d’un roman mon ami Michel Ragon.<br />
L’espérance mourait, feu après feu.<br />
J’étais dans la plus grande difficulté. Mon épouse avait quitté le « domicile conjugal ». J’aurais<br />
voulu l’en remercier. Elle mettait ainsi un terme à une sinistre tragico-comédie. J’en avais assez des<br />
échanges d’assiette en pleine figure, des menaces, des délires, des imprécations folles. Elle voulait<br />
vivre sa vie. Elle se retrouva parmi tout un petit misérable monde de « révoltés du dimanche », de<br />
hippies boursouflés, de poètes au stylo stérile.<br />
Mais il y avait ma fille. Peu m’importait que la mère s’enlisât, s’enfonçât, le défi aux lèvres, dans<br />
les marais putrides. Mais il y avait Nedjma et je découvris alors que j’aimais ma fille.<br />
Il devait s’ensuivre une longue période de querelles, de disputes judiciaires. On en appela dans<br />
l’autre camp à La loi (avec des majuscules, s’il vous plaît, Monsieur le Typographe ! ).<br />
J’étais plus que broyé. Écœuré. Je lisais pour me calmer les poètes mystiques arabes et<br />
espagnols. Je haïssais cette sordide réalité. Je ricanais quand je croisais un couple d’amoureux. Je<br />
les voyais déjà, quelques jours quelques semaines, quelques mois plus tard, dressés l’un face à<br />
l’autre, la haine dans le regard, l’injure à la bouche, pareils à des fauves enragés.<br />
J’étais devenu journaliste au Monde, critique littéraire. Je retrouvais François Bott et Frédéric<br />
Gaussen, perdus de vue depuis longtemps, Bernard Thomas aussi. Et Dominique Eudes,<br />
« Domino ».<br />
Depuis longtemps, j’étais en relation avec « Noir et rouge », ce groupe informel rassemblé<br />
autour d’une publication à laquelle participait Daniel Cohn-Bendit.<br />
C’est alors que Mai 68 explosa. On a tant écrit depuis douze ans à propos de ces journées folles<br />
que je n’ai guère envie de les évoquer à mon tour. Tous les détails sont connus. <strong>Les</strong> pavés de la rue<br />
Gay-Lussac ont été achetés par des touristes américains. Des milliers de photos ont été publiées<br />
dans les journaux du monde entier. Le « Mai » de Paris fit la fortune de quelques éditeurs avisés.<br />
Nous étions dorénavant de plain pied dans le règne absolu de la marchandise que nous avions<br />
- 112 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
prophétisé dans les publications de l’Internationale Situationniste.<br />
Mai 68 fut un conglomérat rassemblant les gens du « ras le bol » et ceux qui avaient un « projet<br />
politique ». Étrange phénomène qui vit des étudiants privilégiés, somme toute, casser la baraque<br />
aux côtés de loubards de banlieues qui, eux, souhaitaient avant tout casser du « flic ».<br />
Quel écrivain hyperdoué pourra jamais restituer l’atmosphère de ces journées turbulées, de ces<br />
nuits affolées où « Paris brûla, au grand dam des honnêtes gens.<br />
Il y eut le Mai des jeunes – étudiants, loubards, lycéens, paumés mêlés –, il y eut le Mai des<br />
travailleurs plus ou moins bien tenus en laisse par les syndicats.<br />
Il y a le mai fantasmé, proche et lointain, qu’increvables « vétérans » il nous arrive d’évoquer, en<br />
fin de repas.<br />
Durant ces quelques semaines insurrectionnelles, je fus affreusement lucide. Mai ne pouvait<br />
emporter un édifice gouvernemental érigé au long des siècles. Il ne pouvait changer les mentalités<br />
du jour au lendemain. De plus il était partagé entre des comportements qui, au–delà de la<br />
phraséologie violente, ne heurtaient guère l’ordre établi, et des comportements plus rarissimes, mais<br />
neufs.<br />
La vieille gauche pourrie courait après Mai, le flattait avec l’espoir d’avoir sa peau. <strong>Les</strong> jeunes<br />
gens emportés dans le tourbillon vivaient l’instant, sans souci du futur. Quelques–uns essayaient de<br />
donner au mouvement ce contenu décisif révolutionnaire qui lui faisait défaut. Nous occupâmes la<br />
Sorbonne, prîmes parti pour les « katangais » que les étudiants « politisés » et « responsables »<br />
repoussaient.<br />
Nous nous battîmes rue Gay–Lussac, comme des enragés. On ne rentrait plus vraiment chez soi.<br />
On refaisait la « Commune de Paris »; Nous étions décidément prisonniers du passé avec notre<br />
stratégie de barricades ridicules.<br />
Nous inventâmes de merveilleux mots de « désordre » qui devaient plus tard inspirer quelques<br />
gouvernants en crise d’imagination. Nous n’eûmes pas raison de l’appareil d’État oppressif. C’était<br />
logique, d’ailleurs.<br />
Je ne regrette pas ces journées, ces nuits mêlées de rires et de cris de souffrances, d’envolées<br />
lyriques et de brutalités policières, de lieux–communs et d’extraordinaires fraîches paroles.<br />
Mai ne fut même pas la répétition d’une révolution. Il fut une sorte de « récréation » prise entre<br />
deux prises de poste à l’usine. Il fut l’expression d’un immense ras–le–bol qui ne parvint pas à<br />
emporter l’adhésion des masses ouvrières, sauf rares exceptions, il fut le cri d’angoisse d’une<br />
génération privilégiée qui craignait pour son avenir. N’avions–nous pas dénoncé à l’IS 2 les étudiants<br />
comme étant des merdes, des fantômes.<br />
Mai constitua ma dernière jusqu’à ce jour « illusion lyrique ». La société permissive, à laquelle<br />
ne s’opposaient pas les nouvelles couches capitalistes, qui en avaient fini avec l’archaïsme du passé,<br />
y trouva son compte. Jouir sans entraves, ce slogan imbécile, dénué de tout poids, fleurissait sur les<br />
murs qui proclamaient tout et n’importe quoi. Une certaine jeunesse crachait son prurit avant de<br />
reprendre place dans les colonnes de l’ordre.<br />
Mai 68, je ne veux plus d’une certaine façon en entendre parler. Mai ne me concerne plus, pas<br />
plus que les fruits empoisonnés dont il accoucha par réaction : les organisations « pures et dures »<br />
décidées, une fois de plus – la millième peut-être – à bâtir le Parti du Prolétariat. Maoïstes,<br />
trotskystes forgeaient l’acier dont on fait les défaites inévitables. Mai 68 est loin. Je garde, dans<br />
mon portefeuille, quelques photos de Dany-Le-Rouge, d’insurgés masqués dressant leurs maigres<br />
armes. On ne m’en voudra pas d’avoir vieilli.<br />
2 Internationale Situationniste<br />
- 113 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
<strong>Les</strong> dix années qui suivirent Mai 68 me virent m’éloigner peu à peu de la traditionnelle<br />
« militance ». Porté par l’élan, je me retrouvais à Vive la Révolution, à l’Idiot international. Mais le<br />
cœur n’y était plus. Quelque chose avait définitivement flambé avec les carcasses d’automobiles de<br />
la rue Gay-Lussac.<br />
Ma vie devint celle d’un homme gris. J’essayais de me prouver que la cause du Larzac valait la<br />
peine d’être défendue, qu’à partir d’elle un nouvel incendie révolutionnaire pouvait embraser « la<br />
plaine ». Je connus de remarquables moments d’amitié avec les femmes en lutte de Lip. Pour elles<br />
je marchais encore sous une pluie battante.<br />
Quand le gauchisme eut fait la preuve de son impuissance, comme nombre de camarades, je me<br />
convertis à l’écologie. Il ne nous restait plus grand chose. L’internationalisme prolétarien avait volé<br />
en éclats. Mais avait–il un jour vraiment existé. La Chine et l’URSS se querellaient. Aujourd’hui,<br />
car il n’y a pas de fin, le Vietnam et la Chine se regardent en chiens de faïence. Le Vietnam colonise<br />
le Laos et envahit le Cambodge. Cuba, par « intérêt national », n’hésite pas à prendre le parti, la<br />
défense de tyrans sanglants. L’Amérique Latine est broyée. Tous les guérilleros dont les noms<br />
étaient acclamés dans la grande salle de la Mutualité sont morts ou réduits à l’état de spectres<br />
n’ayant plus que la peau et les os. La « gauche française » continue son petit bonhomme de chemin<br />
sur les voies ultra–légales.<br />
Ulrike Meinhof et Andréas Baader sont morts, morts de trop de révolte qui les a entraînés dans le<br />
cycle infernal où les tueurs du Capital les attendaient, l’arme au pied.<br />
Le terrorisme d’une poignée de femmes et d’hommes n’a cessé, au fil des années, de renforcer,<br />
justifier aux yeux des masses amorphes, les pires mesures policières, les pires dénis des « droits de<br />
l’homme ». C’étaient pourtant des purs qui voulaient changer le monde et la vie et qui, à force de<br />
manipuler bombes et pistolets mitrailleurs, ont vu leurs rêves prendre la couleur de ces armes<br />
ignobles.<br />
Une poignée de fous, accrochés aux barreaux des prisons, continuent de croire que les peuples<br />
vont se métamorphoser en guérilleros. <strong>Les</strong> peuples vont à la plage, un mois par an, et les terroristes<br />
crèvent avec leur fureur et la haine des geôliers.<br />
Nous sommes déjà tous morts. MM. les dirigeants peuvent faire l’économie d’une troisième<br />
guerre mondiale, guerre forcément atomique. Leurs bombes n’achèveraient que des cadavres.<br />
- 114 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
THANATOS CONTRE EROS : DIX ANS D’ÉCHECS<br />
- 115 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
<strong>Les</strong> grands partis traditionnels de gauche sont désormais impuissants à faire surgir au grand jour<br />
la capacité, la volonté révolutionnaires des masses d’Europe et d’Occident. D’ailleurs, tel n’est pas<br />
leur désir. Reliés par mille réseaux (sénateurs, députés, conseillers généraux, municipaux,<br />
organismes divers) à l’appareil gouvernemental, ils sont devenus une part de cet appareil. Le<br />
pouvoir les hante, et lorsque ce pouvoir leur échappe, leur ambition est de camper dans une<br />
« opposition démocratique » suffisamment molle pour ne pas mettre en péril leurs privilèges. Ce<br />
type de choix est parfaitement illustré par le Parti communiste italien, parti puissant, structuré, dont<br />
toute l’énergie ces dernières années a été d’aboutir à un compromis historique lamentable, doux<br />
euphémisme pour tenter de masquer une authentique collaboration de classes.<br />
Le Parti communiste français, en dépit de ses déclarations vitupérentes de ses rodomontades, des<br />
« gros yeux » par tel ou tel de ses dirigeants, ne fait rien d’autre que d’aider un ordre honni à se<br />
maintenir debout.<br />
Il n’en va pas différemment de la social-démocratie qui a trop longtemps « géré » les affaires de<br />
la bourgeoisie pour perdre le goût de ces fonctions.<br />
<strong>Les</strong> résultats dont ces partis s’enorgueillissent sont dérisoires. Ont-ils ouvert une brèche qui<br />
mène au chemin susceptible de conduire à l’abolition du salariat, mesure sans laquelle toute<br />
prétention à réaliser le socialisme relève de la plus sombre tromperie ? Ont-ils jamais popularisé<br />
auprès des exploités des structures de lutte préfigurant les structures de gestion du monde libéré, tels<br />
les « Conseils » ? Jamais !<br />
<strong>Les</strong> partis de gauche, soutenus en cela par les syndicats « gèrent » l’oppression du peuple de telle<br />
sorte que cette oppression soit en fin de compte acceptée par le peuple. Leur fonction se réduit à<br />
agir afin que l’abîme ne devienne pas assez vaste entre les exploités et les possédants pour susciter<br />
chez les premiers des révoltes suffisamment amples pour risquer d’emporter l’édifice entier.<br />
Grèves, manifestations de rues, meetings ne sont plus que des « amuse–gueule » qu’on propose à<br />
des travailleurs inconscients.<br />
Face à une telle situation, il était logique, qu’à la suite du « grand chambardement » de Mai 68,<br />
le « gauchisme » avec ses variantes diverses se développât. Dans la plupart des cas il ne fut qu’une<br />
radicalisation des projets communistes classiques. On se proclamait hautement marxistes léninistes<br />
alors même que les Partis communistes commençaient à gommer de leurs statuts ces expressions<br />
devenues inquiétantes dans la perspective de la conquête des vastes masses, de l’Union de « tout le<br />
peuple sauf les monopoles ».<br />
Le gauchisme a échoué. Tout au plus était–il parvenu à constituer de grosses « minorités ». Il a<br />
échoué parce qu’il n’a pas su entendre réellement les nouveaux refus qu’avaient exprimés, dans leur<br />
part la moins confuse, la plus lucide, les mouvements des jeunes révoltés d’Allemagne, d’Italie, de<br />
France…<br />
Une fois de plus, revint la vieille obsession : construire le « Parti pur et dur » qui serait en<br />
mesure de mener les masses insurgées au combat et à la victoire. On sait aujourd’hui ce qu’il est<br />
- 116 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
advenu de cette obsession.<br />
Mai 68 et les autres mouvements de l’époque ont fait surgir de nouvelles sensibilités politiques,<br />
de nouvelles approches de la lutte politique. Un thème à mes yeux capital est apparu : le refus du<br />
travail. Le mouvement marxiste classique ne sut pas, ainsi que le rappelle dans une interview de<br />
Libération Franco Piperno, un des ex-leaders de Potere Operiao, en Italie, saisir la signification<br />
« progressiste » contenue dans ce refus. Elle n’en vit que l’expression d’une jeunesse qui avait<br />
perdu tout critère moral. A une époque où la question de l’emploi redevenait brûlante, le<br />
mouvement marxiste classique ne pouvait comprendre que des jeunes gens proclamassent leur refus<br />
du travail. C’est ainsi que le PCI fut amené à se trouver, un jour, confronté au nom de la défense de<br />
l’emploi de ceux qui en possédaient un, à ceux qui n’en possédaient pas et ne souhaitaient guère en<br />
posséder. Cette confrontation donna la mesure de l’acceptation par le mouvement ouvrier officiel<br />
d’une valeur largement exploitée par la bourgeoisie et célébrée par les intellectuels « progressistes »<br />
qui n’ont pas l’habitude de connaître l’ennui des ateliers, les cadences infernales, la grisaille d’une<br />
existence vouée à la répétition quotidienne jusqu’à l’âge de la retraite ou de la mort, des mêmes<br />
gestes sans signification, puisque séparés d’une création libre, totale.<br />
On conçoit qu’à la fin du siècle dernier l’artisan qui réalisait un meuble du début à la fin puisse<br />
éprouver quelque satisfaction. <strong>Les</strong> conditions de son activité masquaient l’oppression réelle. Mais<br />
aujourd’hui, le Travail a pris, partout sur la planète et dans toutes les sociétés, les aspects d’une<br />
obligation réductrice, d’une véritable « perte de temps » qui n’est que « perte de vie ».<br />
D’autres refus, largement exprimés par la jeunesse en fièvre, n’ont jamais été vraiment intégrés<br />
aux projets, aux tactiques et stratégies des Partis de gauche et des syndicats, sinon au coup pour<br />
coup, et non sans une démagogie certaine : refus de la famille, du couple traditionnel, refus de la<br />
« marijuana qui tue », refus de limiter l’âge auquel un individu a légalement le droit de connaître les<br />
joies de l’amour charnel et spirituel, prise de conscience écologique, refus de la fonction<br />
traditionnelle, particulièrement oppressive de la « femme au foyer », refus de la « dictature »<br />
exercée sur les enfants, refus de l’École considérée notamment comme un relais de l’idéologie<br />
dominante. À ce propos n’oublions pas que ces chers instituteurs laïques – qu’un certain nombre de<br />
sociologues de « gauche » n’ont de cesse de célébrer dans leur humble condition – furent aussi ceux<br />
qui apprenaient de force aux petits occitans, aux petits bretons, la langue « nationale », ceux qui<br />
répandirent l’usage ignoble du « témoin », ceux qui apprirent aux élèves, indéracinablement liés à<br />
leurs langues natales, à s’entredénoncer.<br />
Ces refus se sont exprimés au sein de petits groupes, dans des publications aux tirages souvent<br />
limités. Ils n’ont jamais entamés les croyances de la grande masse des citoyens.<br />
L’échec des gauchismes, alimentés par l’extinction de la fièvre révolutionnaire en Amérique<br />
Latine, les oppositions franches entre les puissances « socialistes », l’indifférence des masses<br />
prolétariennes et prolétarisées, et l’orthodoxie de pensée, ne pouvaient que provoquer la<br />
« militarisation » de la contestation. L’Allemagne et l’Italie constituent deux terrains d’élection pour<br />
prendre la mesure de l’échec de cette « militarisation ». Celle–ci ne pouvait qu’isoler de plus en<br />
plus les individus qui avaient décidé de passer aux méthodes de violence. Elle ne pouvait, de plus,<br />
que dénaturer les objectifs proclamés. On ne peut pas sans risques prétendre fonder un royaume<br />
d’amour en recourant, de longues années, au fusil et à la bombe. <strong>Les</strong> débats des « mouvances »<br />
révolutionnaires italienne et allemande ont mis en lumière, il me semble, cette contradiction<br />
douloureuse. Par ailleurs, la « militarisation » forcenée de la contestation avait toute chance de<br />
rejeter, par un réflexe de peur, les masses ouvrières vers les Partis traditionnels ou, pire, l’État et ses<br />
forces de répression. Or, ces masses ne sont jamais constituées d’un bloc. On a pu s’en apercevoir<br />
lorsque en Italie, après le rapt de Moro, les militants de gauche attaquèrent violemment l’État. Il est<br />
sûr que dans ce pays, pour des raisons historiques aisément compréhensibles, l’État n’est pas<br />
« intériorisé » par les individus comme il l’est en Allemagne où la RAF trouva l’hostilité générale<br />
- 117 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
de la nation. Enfin, la « militarisation » de la contestation, présentée comme signifiant une étape<br />
nouvelle, supérieure, de la lutte n’avait en fin de compte pour signification que la réponse de<br />
« substitution » d’une poignée de révolutionnaires hantés par leur impuissance à faire basculer<br />
l’ordre dominant dans la trappe du néant.<br />
Cette « militarisation » a même coupé en fractions rageusement antagonistes les combattants<br />
eux–mêmes. Tout récemment encore, les leaders emprisonnés des « Brigades rouges » menaçaient<br />
de mort physique des combattants rattachés à la « mouvance autonome ». Une telle situation est<br />
éminemment déplorable, poignante et catastrophique.<br />
La militarisation du conflit entre les avant–gardes révolutionnaires et les forces de l’Etat ne<br />
peuvent, à l’heure actuelle, avoir pour résultat final que l’extermination des révolutionnaires.<br />
L’écrasement de la RAF en Allemagne, les répressions violentes qui frappent à l’heure actuelle<br />
(août 79) les révolutionnaires italiens, en apportent une première preuve. L’impatience qui<br />
légitimement brûle les combattants ne doit pas les rendre aveugles, les faire retomber dans une<br />
« illusion lyrique » qui trop souvent s’achève dans le sang et la tragédie. Héros ou non, Andréas<br />
Baader, Ulrike Meinhof, J.C. Raspe, Gundrun Esslin sont morts. Je préférerais les savoir vivants, et<br />
toujours au combat.<br />
Cette « militarisation » ne viendrait–elle pas aussi d’une sous–estimation de la capacité des<br />
sociétés bourgeoises occidentales qui, loin de s’endormir sur leurs lauriers, organisent chaque jour<br />
un peu mieux la répression internationale avec la création d’un « nouvel espace judiciaire<br />
européen », une coopération accrue des services de renseignements respectifs, une coordination plus<br />
poussée des forces directement impliquées dans la lutte contre la « subversion ».<br />
Prendre en considération ces données neuves n’est pas « désespérer Billancourt » ou Vincennes,<br />
ou Bologne. C’est seulement ne pas oublier qu’il ne s’agit pas seulement de « faire » la révolution,<br />
mais de faire en sorte que cette révolution soit victorieuse, pour qu’enfin commence une vraie<br />
histoire de l’humanité, pour que soient rayées de la surface du globe, ces horreurs que j’ai trop<br />
hâtivement évoquées au fil des pages de ce livre fou. Pour qu’enfin des enfants ne meurent plus par<br />
la faim, les rats, ou les napalm, pour que les vieillards ne soient pas livrés à des solitudes affreuses,<br />
pour que les amants ne soient pas séparés par des barreaux de prisons, pour qu’enfin toutes les<br />
richesses que cette terre veut bien nous donner à condition qu’on renonce à régner sur elle par la<br />
science froide et la technologie et qu’on accepte un dialogue, la complicité, deviennent des<br />
richesses pour tous, pour qu’enfin les asiles de fous se vident avec les infâmes mouroirs où l’on<br />
torture, viole, dépèce, pour qu’enfin la splendeur du monde soit fraîcheur sur la chair des créatures,<br />
pour qu’enfin la nuit cesse d’être la loi dans les jungles des villes, pour qu’enfin l’instinct de mort<br />
soit étouffé par l’instinct de vie. Pour qu’enfin soit le matin d’Eros.<br />
Que faire quand les maîtres unis par delà leurs divergences possèdent les moyens de nous<br />
écraser, un par un, révolté après révolté, Gabor Winter après Abdellatif Laâbi, Andréas Baader après<br />
Armando Valladares ?<br />
S’il y en a un qui a la certitude de posséder les clefs du futur qu’il se lève et parle ? Mais<br />
personne n’a entre les mains les clefs du futur ni les survivants de la RAF, ni Renato Curcio qui<br />
vocifère, condamne, derrière les barreaux de sa cage italienne d’engeôlé brûlant de haine, ni<br />
l’intellectuel qui publie libelle sur libelle.<br />
<strong>Les</strong> possède-t-il ces clefs, cet étonnant Tomas Borge, ministre de l’Intérieur depuis quelques<br />
semaines du « Nicaragua libre » qui, retrouvant devant lui le bourreau qui l’avait férocement<br />
torturé, a eu ce mot admirable Notre vengeance sera notre pardon. La loi révolutionnaire vient<br />
d’abolir la peine de mort au Nicaragua tandis que l’Iman Khomeiny envoie aux pelotons<br />
d’exécution chaque jour d’authentiques révolutionnaires, mêlés, pour obtenir l’effet recherché, à<br />
quelques fripouilles.<br />
- 118 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Nous savons qu’il n’y a pas de « science révolutionnaire », de boutiques où l’on pourrait se<br />
procurer des « modes d’emploi » de la révolution. Mais nous savons ce que nous voulons et ce que<br />
nous ne voulons pas. Ne voulons plus.<br />
Marcuse et d’autres nous ont appris à y voir un peu plus clair. Nous tâtonnons. Nous voudrions<br />
cesser d’être des femmes, des hommes en proie aux convulsions. Nous voudrions marcher dans la<br />
rue sans crainte de prendre une balle dans la nuque. Nous aimerions commencer à vivre.<br />
Comment transmettre aux foules, aux masses, aux peuples, la flamme dont nous brûlons vifs de<br />
Paris à Amsterdam, de Rome à Londres, de New York au « goulag », de la Havane à Rabat. <strong>Les</strong><br />
peuples n’aiment pas la violence irrationnelle. Inexplicable.<br />
Nous savons que le « vieux monde » ne s’écroulera jamais sous des brassées de fleurs. Qu’il ne<br />
tombera que lorsque nous le frapperons au cœur, avec rage, avec violence. Saurons-nous glisser<br />
dans nos armes des chargeurs d’amour ?<br />
Nous avons déjà beaucoup fait. Il ne nous reste plus, dans un suprême effort, qu’à changer la vie !<br />
Dix ans d’échecs ai–je écrit. Échecs en ce sens qu’en dépit des efforts lucides ou lyriques de<br />
milliers et de milliers de jeunes gens et d’adultes d’accord avec les « contestataires » pour tenter<br />
d’abattre le « vieux monde », nous avons jusqu’à nouvel ordre échoué. Le « vieux monde », ses<br />
flics, ses psychiatres, ses « opium du peuple », ont la peau dure. Et pis, ce sont ceux–là mêmes, et<br />
moi parmi eux, qui le contestaient qui, très souvent, lui ont – par leurs comportements, leurs peurs<br />
instinctives, leurs angoisses, leurs carences de pensée, leurs terribles élans contradictoires – fourni<br />
des « munitions ».<br />
Ce que nous avions–ce que nous avons encore et toujours ! – à abattre est immense, gigantesque.<br />
Une réalité qui coupe le souffle : un monde où cent millions d’enfants d’Inde en Colombie, du<br />
Maroc à la Thaïlande et Taïwn (cinquante deux millions employés dans l’industrie et l’agriculture<br />
plus quarante et un millions employés sans rémunération dans le cadre familial) travaillent dans des<br />
conditions la plupart du temps cauchemardesques, un monde où « l’internationale des grandes<br />
puissances » fussent–elles, de par leur nature de « grande puissance » justement antagonistes,<br />
s’entendent à merveille pour écraser, intégrer, réduire toute vraie tentative d’autre chose; un monde<br />
où des Partis politiques de « gauche » ne peuvent même plus masquer la misère spirituelle qui<br />
anime ceux qui les dirigent, des Partis où triomphent avant la volonté réelle d’aider à<br />
l’émancipation des peuples, les plus vils, les plus matérialistes intérêts. Et c’est ainsi que l’on voit<br />
un Parti communiste ainsi qu’un Parti démocrate chrétien italien livrer à l’assassinat un homme<br />
politique nommé Aldo Moro, tout en pleurnichant et en s’abritant derrière les sacro–saints intérêts<br />
de l’État, un monde où des peuples entiers sont réduits à la prostitution pour survivre, un monde où<br />
l’on fusille les homosexuels comme de vulgaires criminels, un monde où à tout instant les polices<br />
tirent impunément, expulsent des vieillards, tuent des nègres, des chicanos, des « bougnoules », un<br />
monde où sous prétexte de « crise » qui relèverait de la décision des Dieux lointains, on frappe plus<br />
encore les plus pauvres, les humiliés, un monde où tout créateur porté par un élan sans nom, se voit<br />
bafoué, un monde où sur les écrans de TV règnent les médiocres, les malins, les roquets, les<br />
requins, un monde où l’on accule au suicide la belle et lumineuse Gabrielle Russier, où l’on se<br />
rabat, en se gardant bien d’évoquer la lâcheté quotidienne de la majorité, sa veulerie, sa<br />
mesquinerie, sa démission, sur « l’autodéfense ». Tirer sur un jeune « voyou » est, certes, plus aisé<br />
que de faire la guerre des classes, un monde où les bouffons sont chamarrés d’or et où les vrais<br />
princes mangent leur pain sec, un monde où l’on connaît mieux Léon Zitrone, les lamentations de<br />
l’ex–chabanou d’Iran que les écrits toniques d’E.M. Cioran ou Georges Perros, un monde où des<br />
poètes tels que Xavier Grall, le fou d’Armorique, Tristan Cabral le Fou d’Occitanie, n’intéressent<br />
guère des journalistes accrochés aux basques de tel ou tel leader syndicaliste, politique, ressassant<br />
quotidiennement les mêmes paroles creuses, redondantes, imbéciles, un monde où le fric ouvre<br />
- 119 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
toutes les portes, où les « riches » ne vont guère souvent en prison alors que le petit voleur d’œufs –<br />
Mais souvenez–vous « qui vole un œuf vole un bœuf » – se retrouve dans une taule pour des mois,<br />
sinon des années, un monde où des chefs d’État auxquels d’autres chefs d’État serrent sans frémir la<br />
main, se révèlent être des criminels paranoïaques, un monde où l’on appelle libérateurs ceux qui<br />
inventent chaque jour une nouvelle tyrannie, un monde où, aux prix de marchandages<br />
épouvantables, les responsables de l’ordre public échangent « terroristes » et autres individus<br />
considérés comme dangereux, donc à éliminer d’avance, un monde où, comme tout récemment<br />
encore, un nazillon peut venir, salué par une vingtaine d’acolytes fanatisés, de cuir noir vêtus,<br />
témoigner devant un tribunal de cette Allemagne Fédérale où l’on meurt curieusement dans les<br />
prisons ultra-sophistiquées, et où crèvent des jeunes gens qui, eux au moins, voulaient changer la<br />
vie dans le sens du « beau et du bien » confondus.<br />
Un monde, enfin, où les gens de l’Esprit devraient figurer au premier rang des rebelles. Pour<br />
l’honneur de la profession d’écrivains et de penseurs, il y a, disséminés sur la planète, une<br />
« cinquième colonne » qui met ses actes et ses écrits au même niveau. Tandis que tant de leurs<br />
collègues trament leur mélancolie, leurs affres de créateurs, des Bars de Montparnasse à ceux de<br />
Saint-Tropez et Ibiza.<br />
Dix ans d’échecs, certes, et ne nous cachons pas la vérité : dix ans de chute vers l’abîme. <strong>Les</strong><br />
survivants des armées de Tchang Kaï-Chek continuent toujours d’acheminer les tonnes de drogue<br />
qui vont enrichir la poignée des « seigneurs » et mener à la tombe, dans le cauchemar et la maladie,<br />
des milliers de jeunes gens d’Occident. Oh ! je ne fais pas le « catho » aux fesses serrées par la<br />
trouille. Je « fume », j’aime le hasch et la marijuana et le Kif. Je ne me « pique » pas, est–ce un<br />
crime ? Et puis, cher lecteur qui sans doute m’insulte à voix basse en lisant ces lignes, cher lecteur<br />
qui a la nostalgie & Actuel et de la presse underground, as–tu lu les remarquables textes de William<br />
Burroughs (celui–là la drogue, il peut en causer, à clouer le bec à beaucoup de « junkies ») dans<br />
lesquels l’auteur de Naked Lunch (Le festin nu) éclaire de façon inquiétante le rôle que joue la<br />
drogue dans le « détournement » des énergies révolutionnaires, contestataires. Il ne s’agit pas de<br />
condamner la drogue au nom du Christ ou de la pensée Mao Tse-Toung – laquelle d’ailleurs ne se<br />
porte plus très bien sauf dans quelques carrés d’irréductibles – il s’agit de savoir quel problème<br />
fondamental est posé quand elle se répand parmi une immense jeunesse qui la consomme dans<br />
l’espérance de se trouver mieux dans sa peau.<br />
Quand je fume, quand je fumais autrefois avec mes <strong>amis</strong> marocains dans la médina de Tanger,<br />
quand j’ai fumé en Amérique Latine, sur l’Altiplane, c’était pour libérer Eros et non pour renforcer<br />
les noires armées de Thanatos !<br />
Dix ans d’échecs. Mais aussi n’oublions pas, dix ans d’efforts pour essayer d’inventer, pas à pas,<br />
une nouvelle vie. <strong>Les</strong> « communautés » malgré leurs effrayantes prétentions à tout modifier<br />
d’emblée, malgré la faiblesse de ceux qui y vinrent pour s’auto–révolutionner, ont indiqué un<br />
chemin possible, ont mis en lumière cette nécessité de vivre ensemble, d’échapper au<br />
cloisonnement dont la société a besoin pour survivre selon ses lois actuelles : on se croise mais on<br />
ne se voit jamais, on se croise mais on ne parle jamais des vrais problèmes, chacun chez soi, nom de<br />
dieu, la porte bien verrouillée, en tête a tête avec l’écran TV diluant sa perfide idéologie noyée dans<br />
les rythmes musicaux. Le « refus du travail » a ébréché une « vérité » depuis trop longtemps<br />
dominante au sein du mouvement ouvrier. Il a libéré des énergies vitales, des désirs réprimés<br />
justement par un Travail qui se confond à l’esclavage, à l’ennui mortel. <strong>Les</strong> « revendications » des<br />
minorités nationales ont fait apparaître ce qui se masquait derrière l’État-nation, elles ont remis à<br />
l’ordre du jour des cultures fondamentales tenues jusque là sous le boisseau. Elles ont fait la preuve<br />
que la richesse réside dans le « métissage » et la confrontation des identités sociales, culturelles et<br />
non dans le règne gris d’une « culture marchande », uniformisante, qui ne dépasse jamais le seuil du<br />
- 120 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
vulgaire. L’émergence du mouvement de libération des femmes – en dépit des outrances, des<br />
errements de pensée éminemment dangereux et dus pour l’essentiel à la fraction radicale, petite<br />
bourgeoise de ce mouvement – a totalement bouleversé le paysage. Et je suis persuadé que tous ses<br />
effets – effets bénéfiques pour tous j’entends ! – ne sont pas encore visibles. De toute façon –<br />
errements ou pas –quelque chose d’irréversible a été atteint; le machisme y compris celui de ceux<br />
qui ne tarissent pas d’éloges à propos de la lutte des « nanas » a été « pointé », le viol a été dans<br />
toute son ignoble réalité étalé au grand jour. Il est à regretter que la violence fabuleuse, que les<br />
innombrables « agressions » en tout genre auxquelles les femmes doivent faire face, aient provoqué<br />
chez une partie d’entre elles une – comment dire autrement ! – « haine » farouche, irrationnelle de<br />
l’homme, du mec. La lutte pour un socialisme libertaire ne peut se passer d’aucune force. Mais<br />
enfin, la femme, ni déesse ni putain, a reconquis – en partie – droit de cité. Du moins, ne se fait-elle<br />
plus facilement oublier.<br />
De même, la remise en cause de la traditionnelle activité militante, de l’activisme aveugle,<br />
fébrile, ainsi que des structures des partis et organisations, peut être mis au tableau de chasse de<br />
ceux que Mai 68, notamment, éveilla ou réveilla. Le Règne des Chefs, qui ont le « pouvoir de la<br />
parole », a pris un sérieux coup. Finie l’obéissance passive à des slogans changeants, semaine après<br />
semaine, et dictés par des « bureaux politiques » longtemps indiscutés. Finie, cette action politique<br />
qui maintenant encore dresse un mur entre vie privée et vie publique, qui renvoyait, encore et<br />
toujours aux calendes grecques, la discussion des problèmes personnels, quotidiens. Il était entendu<br />
que le Parti était tout et l’individu rien. Quand le socialisme aurait gagné, tous les problèmes<br />
trouveraient, ça allait de soi, une solution. Mais en attendant Camarades, toutes aux ronéos, tous aux<br />
manches de pioches, et motus !<br />
Cela est fini, bien fini, et c’est tant mieux. L’individualisme révolutionnaire a retrouvé une aura<br />
lumineuse – et là je songe moins à ces intellectuels douillettement installés qui concoctent entre<br />
juillet et septembre, au bord d’une piscine, un fulminant traité de défense de « l’individu », qu’à des<br />
milliers et milliers de personnes – femmes et hommes, enfants et vieillards – pour la plupart<br />
inconnus, anonymes, qui, tout simplement, au jour le jour, à la nuit la nuit, témoignent en actes et<br />
paroles de ce nouveau et fécond refus.<br />
La prise de conscience écologique, des périls du nucléaire : société nucléaire–société policière,<br />
ont aussi – c’est vraiment pas original de le répéter – amplement nourri les débats de ces dernières<br />
années.<br />
Ainsi « une révolution de la révolution » a été entreprise, ici et là, au sein de groupes multiples<br />
divers, aussi différents et aussi proches que les défenseurs des baleines bleues et les signatures du<br />
« Manifeste du 18 joint ».<br />
Mais – et comment pouvait-il en être autrement après une aussi longue glaciation de l’Esprit –<br />
tout cela s’est fait dans la dispersion, dans la confusion, avec nombre de malentendus de part et<br />
d’autre. L’unification de ces « sensibilités nouvelles » qui aboutissent toutes, en toute logique, à la<br />
mise en cause du capitalisme, à la mise en question du « modèle bureaucratique soviétique » –<br />
toutes nuances confondues – n’a pas véritablement été réalisé. Nul « projet » crédible n’a rencontré<br />
l’oreille des « masses ».<br />
Nous nous retrouvons au bord de la route avec toutes ces bribes de « savoir » arrachées aux<br />
propos, aux ouvrages de Reich, Marcuse, Ivan Illich, nous savons que la Science n’est pas neutre,<br />
que sa prétendue rationalité est source de graves périls, nous savons que l’existence même de<br />
l’École – au sens classique du mot – contredit tout véritable enseignement qui devrait voir se<br />
confronter « enfants » et « adultes », « ouvriers » et « intellectuels », « émetteurs » et « récepteurs »,<br />
« hommes » ne refoulant plus leur « féminité » et femmes ayant cessé de prendre l’homme pour un<br />
animal définitivement pourri, vieillards et adolescents, gens des villes et gens des campagnes<br />
- 121 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
jusqu’à ce que toutes ces « catégories » séparatrices, mutilantes commencent à s’effacer. Nous<br />
savons avec Marcuse les mécanismes de quelques–unes de nos oppressions. Avec Raoul Vaneigem<br />
et Guy Debord, avec les écrits situationnistes nous avons pu analyser la « misère moderne »,<br />
l’aliénation contemporaine. L’obscur – pour beaucoup – puzzle de la société à révélé quelques-uns<br />
de ses « secrets ». La dictature de la « marchandise », la « chosification » de tous les instants de<br />
notre existence renvoyée à celle de fantôme absent, ont été savamment démontrées.<br />
Nous avons aussi appris qu’un poème, une sonate, une peinture, une chanson, un mouvement de<br />
ballet appartenaient à l’avenir révolutionnaire. Qu’un jour les créateurs pourraient créer, livres,<br />
romans et poésies. Et que d’autres créeraient simplement leur existence quotidienne. Qu’un jour,<br />
sans mépris des uns pour les autres, pourraient se côtoyer un nouveau Facteur Cheval, un pêcheur à<br />
la ligne, un fanatique d’élevage d’abeilles, un nouveau Rimbaud.<br />
Et qu’alors il n’y aurait plus de Van Gogh se tranchant l’oreille, plus de Vaché se suicidant à la<br />
drogue, plus de Soutine crevant de faim, plus de Modigliani crevant de pauvreté, de fièvre, d’alcool.<br />
Du moins, qu’il n’y en aurait pas plus de deux ou trois, car la révolution ne saurait prétendre<br />
résoudre certaines inquiétudes très profondément enracinées.<br />
Il y aura un jour… Il nous arrive encore de répéter machinalement la formule magique.<br />
- 122 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
LA FLEUR PARMI LES RUINES<br />
- 123 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Le paysage de l’enfance morte s’étend devant nos yeux –<br />
En pure perte nous cherchons le visage du père, le visage de la mère –<br />
Cette solitude n’a pas de nom,<br />
Rien qu’un immense désert ossifié.<br />
Nous avions vécu, par instants miraculeux, d’herbes folles, de fruits sauvages, acides –<br />
Puis vint le temps de la grande famine –<br />
Alors nous entrâmes dans les villes avec l’allure superbe de ces lions<br />
aux ongles coupés<br />
aux crocs limés.<br />
Tout meurt sous les paupières des rêveurs obstinés,<br />
Y compris la mort.<br />
Tout meurt.<br />
Nous avons porté la lourde pierre noire<br />
jusqu’aux horizons insoupçonnés –<br />
Nous avons saigné au nom de la fleur et de la foudre.<br />
Un jour, très las,<br />
nous nous sommes allongés sur la terre grasse, humide<br />
et nous avons pleuré<br />
comme autant d’enfants couverts de plaies<br />
et d’accusations obscures.<br />
Des villes entières s’effondrèrent sur nos genoux,<br />
avec des putains aux ongles rouges,<br />
des tas de hamburgers géants –<br />
Des villes entières séparèrent minutieusement la peau des os et notre cri<br />
s’enlisa dans les sables mouvants de la désolation.<br />
Ah ! les villes géantes !<br />
crimes et énigmes !<br />
amours de bordels et conversations mystiques<br />
au bord de la fontaine qui se souvenait<br />
d’avoir entendu les confidences de Laure et Pétrarque !<br />
Un matin, nous nous habillâmes de cuir brutal<br />
Nous cassâmes tout sur les grands boulevards,<br />
Et sur les cendres des boutiques, des cafés<br />
nous dansâmes sauvagement –<br />
Souviens-toi mon frère Abel,<br />
Souviens-toi ma sœur sténo-dactylo,<br />
- 124 -
C’est après ce jour-là que nous décidâmes<br />
de changer de planète,<br />
d’habiter ailleurs.<br />
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Soudain surgirent bottés, casqués<br />
les grands oiseaux de proie,<br />
et les amours périclitèrent sur la ligne d’horizon.<br />
La monnaie sans valeur coulait vers les égouts<br />
<strong>Les</strong> chiens eux-mêmes n’avaient plus de goût à rien –<br />
<strong>Les</strong> trompettes vermoulues s’effilochaient entre les doigts des anges<br />
des cathédrales baroques –<br />
<strong>Les</strong> fenêtres obscurcies par des loques<br />
hurlaient comme des mâchoires fracassées.<br />
Nous vivions d’eau non potable et de peur,<br />
nous vivions de carcasses d’oiseaux d’une effrayante maigreur –<br />
Nous habitions là où le rat lui–même refuse d’habiter –<br />
La terre sèche écartait sans fin les douces lèvres de la plaie.<br />
Il y eut des effondrements de cieux<br />
et des pantomimes sanglantes dans les buissons d’épines –<br />
<strong>Les</strong> hommes se jetaient sur les femmes comme des fusées folles –<br />
<strong>Les</strong> idiots de village dansaient une étrange, une cruelle carmagnole –<br />
À chaque tombée de la nuit, des peuples devenaient dolmens et menhirs.<br />
La terre était l’empire de l’acier muet et du fusil sans repentir.<br />
Que faire quand dans la nuit hurlent les corps écartelés ?<br />
Bob Dylan et Lou Reed tendent nos nerfs malades –<br />
Trois milliards d’enfants fantômes réclament pauvrement du lait –<br />
À la table du festin les tyrans hésitent entre fromage et salade –<br />
Que faire quand la fatigue crève les yeux<br />
du poète titubant dans les rues froides de la cité<br />
rebondissant de mur en mur ?<br />
Quand cette espèce d’acculé prend à partie l’azur<br />
– d’ailleurs sombre et sans étoiles –<br />
avec ses poings maigres, ridicules, en proie à la pernicieuse usure.<br />
Que faire quand l’homme s’éteint dans l’homme,<br />
Quand sonne l’heure du rêve fracassé de Nietzsche ?<br />
Au loin murmurent les douces rivières de l’été,<br />
tremblent les herbes des éternelles prairies,<br />
Et pourtant on entend<br />
La pourriture au travail, déjà victorieuse, mais sans orgueil,<br />
sûre de vaincre la tendre liberté des feuilles,<br />
l’oiseau et son chant de pur osier.<br />
Nous habitâmes longtemps comme beaucoup les tentes d’exode et d’utopie.<br />
Vint l’aube et vint la nuit,<br />
- 125 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
et nous retombâmes, figures brisées, sur la terre avare de mots.<br />
<strong>Les</strong> guerres faisaient crier les hommes las d’une existence grise,<br />
<strong>Les</strong> hommes éventraient les ventres des femmes, les lunes, les semences sacrées.<br />
<strong>Les</strong> hommes crucifièrent notre enfance rêveuse,<br />
De nos bouches ardentes ils firent des champs dévastés,<br />
De nos épaules des talus secs,<br />
De nos ventres des nids de rats,<br />
Depuis longtemps nous errons entre fleuves et prés<br />
sans Savoir, sans Vérité,<br />
avec des regards de fous qui ne savent plus démêler<br />
père et mère,<br />
caillou et hibou,<br />
Pour nous punir,<br />
on nous mène l’épée dans les reins<br />
dans d’affreux déserts<br />
peuplés de miroirs<br />
de couteaux de bouchers<br />
de singes violents et malins<br />
de panthères noires<br />
de molosses de neige qui ne cessent de hurler leur effrayante faim.<br />
L’amour nous le brisâmes un jour de colère<br />
et nous devînmes fous, espèce de rage d’encre,<br />
Nous tuâmes tous les dieux adorés,<br />
Nous devînmes encolure de vent ravageur,<br />
Oiseau de malheur<br />
Nous ne fûmes plus rien d’autre que sarcasme et rire,<br />
Rire blessant la nuit comme un éclair fratricide.<br />
Dans nos veines le sang se fit acide,<br />
Nous devînmes haineux, agressifs, criminels<br />
quand l’occasion se présentait.<br />
Où se posaient nos regards une blessure éclatait.<br />
Nous semâmes terreur et mort,<br />
Obstinés et malheureux,<br />
Malheureux comme des pierres<br />
témoins depuis des millénaires<br />
de l’agonie ici–bas de l’homme<br />
errant dans les labyrinthes des visions meurtrières.<br />
Le petit homme gris<br />
a tout envahi<br />
Il prolifère<br />
vermine inexpugnable<br />
Le petit homme<br />
dicte la loi<br />
Poisson froid<br />
- 126 -
singe hurleur<br />
je le croise partout<br />
sous divers masques<br />
Il a tué ma joie<br />
mon rire d’enfant<br />
Il a brisé mes élans<br />
purs vers les hauteurs<br />
là où l'on peut toucher<br />
la transparence<br />
Il a noirci mes matins<br />
Ses crimes sont innommables<br />
mais nul trouble en lui.<br />
Depuis la nuit des temps<br />
Je fais la guerre totale<br />
au petit homme gris<br />
C’est sans doute lui<br />
qui l’emportera<br />
Mais cette guerre-là<br />
vaut mieux, bien mieux<br />
que toute paix séparée.<br />
Le petit homme gris<br />
n’a pas encore gagné !<br />
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
- 127 -
– Le fou parle et dit :<br />
Nous sommes tous malades<br />
bons à emprisonner<br />
durant au moins trois mille jours<br />
dans les cruelles cages de l’Amour<br />
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
– Le fou parle et dit :<br />
Nous ne sommes pas encore nés<br />
Nous ne sommes que projets de liberté<br />
Là où le vent sombre d’un pouce violent travaille la glaise<br />
règne une obscure, incroyable chaleur de fournaise<br />
– Le fou parle et dit :<br />
Nous sommes morts depuis déjà plusieurs millénaires<br />
La rumeur du fleuve voyage avec notre poussière<br />
Nous avions choisi la bonté<br />
et fûmes contraints de prendre les armes, d’allumer les bûchers<br />
– Le fou parle et dit :<br />
L’avenir n’est que passé qui s’apprête à resurgir<br />
Et les chaînes sont faites d’un métal inébranlable.<br />
Ceux qui ont osé lutter ont jalonné les déserts de leurs crânes.<br />
Mais nous n’avons pas encore vu de nos propres yeux l’excès et le pire.<br />
- 128 -
Liberté où es-tu ?<br />
Dans le casque du guerrier,<br />
Le ventre de la femme en train d’accoucher<br />
Dans le cri de terreur de l’aveugle<br />
cogné par les salauds de loubards<br />
Station Barbès–Rochechouart ?<br />
Liberté où es-tu ?<br />
Dans la paume du mystique à genoux,<br />
du côté du soleil couchant<br />
Dans le songe du poète au « moi » éclaté<br />
Dans le caillou jeté contre le carreau<br />
par un ivrogne de minuit ?<br />
Liberté où es-tu ?<br />
Dans la craie de la comptine de l’écolier<br />
Dans la fuite du lièvre à travers champs<br />
Dans la sève des arbres torturés de Van Gogh<br />
Dans le passage muet du schooner ?<br />
Liberté où es-tu ?<br />
Dans la musique de Bartok et Webern<br />
Dans un tableau de Piet Mondrian<br />
Un poème de Gottfried Benn<br />
un sourire de nègre travailleur immigré ?<br />
Liberté où es-tu ?<br />
Dans la nuit que nous croyons pays ami<br />
Dans le serment d’amour<br />
proféré entre quatre murs lépreux<br />
dans la seringue bleue, la houle de l’océan,<br />
<strong>Les</strong> nervures de la pierre à Carnac ?<br />
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Liberté où es-tu<br />
dans le piano aux dents de chameau<br />
Dans le tumulte du bordel andalou<br />
Dans le fric qui roule sur les tapis verts<br />
dans la seringue qui s’enfonce pour la troisième fois dans la veine malade<br />
Dans le mégot de Jacques Prévert<br />
Dans le noir cimetière de nos utopies ?<br />
Liberté qui es-tu ?<br />
Femme ou cormoran<br />
Baleine bleue ou marbre cadavérique<br />
Liberté qui es-tu ?<br />
Soleil ou aigle<br />
Maïs fier ou sombre fumier ?<br />
- 129 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
– Je suis la blessure blessée<br />
Le vent sans mémoire, l’urine<br />
du buffle et du chien.<br />
Je suis la femme lapidée<br />
qui se redresse encore sur ses membres martyrisés<br />
Je suis la rage, la rage universelle contre les limites<br />
La fleur, la Fleur d’acier,<br />
La Fleur parmi les ruines.<br />
- 130 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
La fin se lève ? qui a parlé. Moi, un inconnu, un fantôme. Nous habitons une terre féroce où les<br />
« droits de l’homme » sont au mieux notre misérable butin. Dans la nuit qui monte, j’entends<br />
tourner les roues maléfiques qui broient victimes et bourreaux, pêle-mêle.<br />
Le flanc percé d’une lance longue et fourbe, l’homme saigne.<br />
La lumière a rétréci dans nos regards jusqu’à épouser la dimension de la plus minuscule piécette<br />
d’argent.<br />
La fin se lève ?<br />
Mais nous n’avons pas encore donné notre accord.<br />
Égarés, déchirés d’amour, d’un désir d’amour surgi le premier jour avec nos os, nos vertèbres,<br />
nous tentons parfois de nous redresser hors la bauge de fatalité et d’ennui.<br />
Nous contemplons les étoiles glacées, sans signification.<br />
Nous questionnons la bête morte, putride, abandonnée au bord du chemin, et le caillou muet.<br />
Nos poings se serrent, se souvenant toujours des antiques rébellions, des songes plus anciens que<br />
la mousse au pied des arbres.<br />
La foi a déserté nos cœurs.<br />
Elle a fait place à la terrifiante lucidité.<br />
Mais la lucidité est plus amère que le plus pauvre pain.<br />
Nous nous tenons au bord de l’aube, au bord de la nuit, nous écoutons les voix sourdes des<br />
camarades qui agonisent dans les prisons bâties par des mains d’hommes. Et nous creusons des<br />
labyrinthes pour parvenir jusqu’à eux, dénouer les bâillons, déchirer les chaînes.<br />
Nous tendons à travers la ténèbre l’oreille des désespérés.<br />
Le feu s’est refroidi dans nos muscles.<br />
Devenu matière dure, infracassable, il nous maintient debout, irrémédiables dissidents.<br />
Le dernier mot de ce livre sera le mot : REFUS.<br />
- 131 -<br />
NOVEMBRE 1978 - SEPTEMBRE 1979.
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Table des matières<br />
L’ENFANCE D’UN REBELLE...........................................................................................................7<br />
L’ENVOL D’ICARE..........................................................................................................................35<br />
LUMIÈRE LIBERTAIRE...................................................................................................................46<br />
L’ILLUMINATION SURRÉALISTE................................................................................................62<br />
ALGÉRIA<br />
OU<br />
LES SAISONS<br />
SAUVAGES.......................................................................................................................................77<br />
LES SOLEILS DU MAGHREB<br />
LES FEUX DU MONDE...................................................................................................................96<br />
LA CHUTE D’ICARE<br />
AVEC DÉTOUR<br />
PAR<br />
MAI 68.............................................................................................................................................106<br />
THANATOS CONTRE EROS : DIX ANS D’ÉCHECS.................................................................115<br />
LA FLEUR PARMI LES RUINES..................................................................................................123<br />
- 132 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Index<br />
Adamov Arthur...................................................................................................................................54<br />
Adorno Theodor W.....................................................................................................................58, 107<br />
Alexandrian Sarane............................................................................................................................71<br />
Ali.......................................................................................................................................................94<br />
Alyn Marc...........................................................................................................................................42<br />
Apollinaire Guillaume..................................................................................................................52, 70<br />
Arnaud Georges................................................................................................................................100<br />
Aron Raymond...................................................................................................................................90<br />
Artaud Antonin...................................................................................................................................72<br />
Attila.....................................................................................................................................................5<br />
Audry Colette.....................................................................................................................................65<br />
Ava....................................................................................................................................102, 103, 105<br />
Baader Andréas.........................................................................................................................114, 118<br />
Bacall Lauren..................................................................................................................................9, 72<br />
Bach Jean-Sébastien.....................................................................................................................12, 29<br />
Bakounine.........................................................................................................................44, 57, 60, 63<br />
Balzac Honoré de...............................................................................................................................26<br />
Barrault Jean-Louis...........................................................................................................................112<br />
Bartok Béla.......................................................................................................................................129<br />
Bataille Georges...........................................................................................................................38, 67<br />
Béalu Marcel......................................................................................................................................42<br />
Beauvoir Simone de...........................................................................................................................54<br />
Bêcher J.R...........................................................................................................................................58<br />
Ben Barka Mehdi..............................................................................................................................102<br />
Ben Bella Ahmed......................................................................................................100, 101, 103-105<br />
Ben Jelloun Tahar.............................................................................................................................110<br />
Benayoun Robert..................................................................................................................69, 71, 112<br />
Benn Gottfried............................................................................................................................58, 129<br />
Berg Alban..........................................................................................................................................12<br />
Bergman Ingrid.....................................................................................................................................9<br />
Bernanos Georges...............................................................................................................................63<br />
Berneri Camillo..................................................................................................................................65<br />
Berque Jacques.................................................................................................................................100<br />
Bismarck.............................................................................................................................................58<br />
Blin Roger.........................................................................................................................................112<br />
Bloch Ernst.........................................................................................................................................58<br />
Blum Léon..........................................................................................................................................64<br />
Boitel Pedro Luis................................................................................................................................98<br />
Bona....................................................................................................................................................71<br />
Bonnot Jules.................................................................................................................................44, 54<br />
Borge Tomas.....................................................................................................................................118<br />
Bott François...............................................................................................................................88, 112<br />
Boumedienne Houari........................................................................................................100, 103, 105<br />
Brassens Georges................................................................................................................................54<br />
Brecht Bertolt.....................................................................................................................................58<br />
Brejnev Leonid...................................................................................................................................99<br />
- 133 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Breton André...............................................................................................4, 6, 63, 64, 66-72, 75, 112<br />
Breton Élisa..................................................................................................................................69, 70<br />
Brooks Louise.....................................................................................................................................13<br />
Bunuel Luis........................................................................................................................................72<br />
Burroughs William..............................................................................................................92, 111, 120<br />
Bussières Raymond............................................................................................................................40<br />
C. Françoise........................................................................................................................................30<br />
Cabral Amilcar..................................................................................................................................105<br />
Cabral Tristan....................................................................................................................................119<br />
Camus Albert................................................................................................................................54, 87<br />
Carrère d’Encausse Hélène.................................................................................................................90<br />
Carrium Obeso Alfredo......................................................................................................................98<br />
Cartier-Bresson Henri.........................................................................................................................17<br />
Casamayor..........................................................................................................................................88<br />
Cassady Neil.......................................................................................................................................92<br />
Castoriadis Cornélius........................................................................................................................107<br />
Castro Fidel......................................................................................................60, 86, 97, 99, 101, 105<br />
Castro Raul.........................................................................................................................................98<br />
Cau Jean..............................................................................................................................................90<br />
Céline..................................................................................................................................................16<br />
Cendrars Blaise...................................................................................................................5, 28, 39, 73<br />
Césaire Aimé......................................................................................................................................39<br />
Chaliand Gérard................................................................................................................................100<br />
Chandler Raymond.............................................................................................................................91<br />
Char René.....................................................................................................................................26, 38<br />
Charisse Cyd.......................................................................................................................................72<br />
Chaulot Paul.......................................................................................................................................42<br />
Che Guevara.......................................................................................................4, 60, 97, 98, 103, 112<br />
Chirico Giorgio de..............................................................................................................................68<br />
Christiane................................................................................................................................79-81, 85<br />
Cioran Emil.................................................................................................................................38, 119<br />
Cohn-Bendit Daniel..........................................................................................................................112<br />
Colomb Christophe...............................................................................................................................6<br />
Concha..........................................................................................................................................83, 84<br />
Corso Gregory.............................................................................................................................92, 111<br />
Crawford Joan......................................................................................................................................9<br />
Crevel René........................................................................................................................................70<br />
Curcio Renato...................................................................................................................................118<br />
Damia.................................................................................................................................................12<br />
Davis Bette...........................................................................................................................................9<br />
Debord Guy......................................................................................................................................122<br />
Deffand Madame du...........................................................................................................................12<br />
Dekobra Maurice................................................................................................................................28<br />
Delannoy Jean....................................................................................................................................72<br />
Delteil Joseph.....................................................................................................................................92<br />
Demy Jacques.....................................................................................................................................73<br />
Desanti Dominique.............................................................................................................................90<br />
Desnos Robert..............................................................................................................................70, 72<br />
- 134 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Dietrich Marlène.................................................................................................................................72<br />
Domenach Jean-Marie........................................................................................................................88<br />
Donnet Michel............................................................................................................44, 45, 47, 50, 63<br />
Dos Passos John.................................................................................................................................63<br />
Dostoïevski Fiodor.............................................................................................................................63<br />
Drieu La Rochelle...............................................................................................................................16<br />
Ducasse Isidore, comte de Lautréamont...............................................................................................5<br />
Duprey Jean-Pierre.............................................................................................................................71<br />
Durruti Buenaventura.............................................................................................................16, 44, 66<br />
Dutourd Jean.......................................................................................................................................90<br />
Dylan Bob.........................................................................................................................................125<br />
El Nissaboury Mostefa.....................................................................................................................110<br />
Engels Friedrich..................................................................................................................................45<br />
Esclarmonde.................................................................................................................................66, 67<br />
Esslin Gudrun...................................................................................................................................118<br />
Eudes Dominique........................................................................................................................88, 112<br />
Facteur Cheval..................................................................................................................................122<br />
Fallet René..........................................................................................................................................54<br />
Faulkner William..........................................................................................................................26, 63<br />
Ferlinghetti Lawrence.................................................................................................................92, 111<br />
Ferré Léo............................................................................................................................................54<br />
Flaubert Gustave.................................................................................................................................48<br />
Follain Jean.........................................................................................................................................38<br />
Franco Francisco...................................................................................................5, 16, 64-66, 78, 117<br />
Franco Francisco .................................................................................................................................5<br />
Françoise C.........................................................................................................................................30<br />
Fréhel..................................................................................................................................................12<br />
Freud Sigmund.......................................................................................................................38, 63, 95<br />
Gael.....................................................................................................................................................88<br />
Gandhi................................................................................................................................................60<br />
Garcia Lorca Federico........................................................................................................................15<br />
Gaulle Charles de..............................................................................................................17-19, 23, 94<br />
Gaussen Frédéric..............................................................................................................................112<br />
Gautier Théophile...............................................................................................................................63<br />
Gauty Lys............................................................................................................................................12<br />
Giacometti Alberto.............................................................................................................................73<br />
Ginsberg Allen............................................................................................................................92, 111<br />
Glaser Denise......................................................................................................................................38<br />
Goldfayn Georges...............................................................................................................................71<br />
Goldman Emma..................................................................................................................................45<br />
Goretta Claude....................................................................................................................................29<br />
Grall Xavier......................................................................................................................................119<br />
Gréco Juliette......................................................................................................................................54<br />
Guibert Armand..................................................................................................................................25<br />
Guillaume II........................................................................................................................................58<br />
Guillebaud Jean-Claude....................................................................................................................104<br />
Guillen Nicolas.............................................................................................................................97, 98<br />
Guillevic Eugène................................................................................................................................38<br />
- 135 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Gurdjieff Georges...............................................................................................................................63<br />
Hadj Messali.......................................................................................................................................85<br />
Hallyday Johnny...............................................................................................................................101<br />
Hammet Dashiell................................................................................................................................91<br />
Harbi Mohammed.............................................................................................................................100<br />
Harlow Jean........................................................................................................................................72<br />
Hausmann Raoul................................................................................................................................58<br />
Haydn Joseph......................................................................................................................................29<br />
Hayworth Rita......................................................................................................................................9<br />
Heartfield John...................................................................................................................................58<br />
Hélène.......................................................................................................................................3, 90, 93<br />
Hernandez Miguel........................................................................................................................67, 79<br />
Heym Georg.......................................................................................................................................58<br />
Hikmet Nazim....................................................................................................................................67<br />
Himes Chester....................................................................................................................................54<br />
Hitler Adolf...................................................................................................................8, 12, 15, 20, 78<br />
Höch Hannah......................................................................................................................................58<br />
Horkheimer Max..............................................................................................................................107<br />
Huelsenbeck Richard..........................................................................................................................58<br />
Hugo Victor..................................................................................................................................37, 63<br />
Illich Ivan..........................................................................................................................................121<br />
Ionesco Eugène...................................................................................................................................90<br />
Jakobiak Bernard..............................................................................................................................110<br />
Jaurès Jean..........................................................................................................................................10<br />
Jésus-Christ.........................................................................................................................34, 102, 120<br />
Joannon Léo........................................................................................................................................72<br />
Jones Jennifer.......................................................................................................................................9<br />
Josée..............................................................................................................................................50-56<br />
Jouve Pierre-Jean................................................................................................................................38<br />
Joyce James........................................................................................................................................36<br />
Kafka Franz........................................................................................................................................90<br />
Kazantzakis Nikos........................................................................................................................38, 67<br />
Kerouac Jack...............................................................................................................................92, 111<br />
Kessel Ramos.....................................................................................................................................98<br />
Khair-Eddine Mohammed................................................................................................................110<br />
Khaldoun Ibn....................................................................................................................................101<br />
Khâtibi..............................................................................................................................................110<br />
Khomeiny Rouhollah........................................................................................................................118<br />
Khrouchtchev Nikita........................................................................................................................101<br />
Klee Paul............................................................................................................................................38<br />
Kopf André.............................................................................................................................26, 28, 29<br />
Kropotkine..........................................................................................................................................44<br />
l’Anselme Jean...................................................................................................................................42<br />
Laâbi Abdellatif.............................................................................................................3, 109-111, 118<br />
Lacenaire............................................................................................................................................54<br />
Lamartine Alfred de................................................................................................................37, 38, 63<br />
Lanza Del Vasto..................................................................................................................................63<br />
Lao-Tseu.............................................................................................................................................63<br />
- 136 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Larbaud Valéry...................................................................................................................................28<br />
<strong>Laude</strong> (grand-père).............................................................................................................................10<br />
<strong>Laude</strong> André ........................................................................................................................................6<br />
<strong>Laude</strong> Fernand..........................................................................................................................9, 48, 63<br />
<strong>Laude</strong> Germaine.............................................................................19, 21-25, 27, 31-34, 36, 41, 42, 49<br />
<strong>Laude</strong> Sabine.............................................................................................................100, 108, 111, 112<br />
<strong>Laude</strong> Vincent...................................................................................................................................111<br />
Lautréamont....................................................................................................................................5, 63<br />
Lefeuvre René....................................................................................................................................59<br />
Lefort Claude....................................................................................................................................107<br />
Legrand Gérard.............................................................................................................................69, 71<br />
Leiris Michel................................................................................................................................38, 63<br />
Lénine.........................................................................................................................45, 60, 66, 69, 86<br />
Leval Gaston.......................................................................................................................................65<br />
Liebknecht Karl..................................................................................................................................57<br />
Lô Sophie............................................................................................................................................38<br />
Lobo....................................................................................................................................................83<br />
Lorca Federico Garcia..................................................................................................................15, 82<br />
Lou Reed............................................................................................................................................32<br />
Louazon Olga......................................................................................................................................11<br />
Katz Olga.......................................................................................................................................12<br />
Lukács Georg......................................................................................................................................58<br />
Luxemburg Rosa...........................................................................................................................57, 59<br />
Lys....................................................................................................................................12, 36, 37, 51<br />
Machado Antonio.............................................................................................................15, 16, 67, 78<br />
Madruga Ismael..................................................................................................................................98<br />
Maïakovski.........................................................................................................................................32<br />
Makhno.........................................................................................................................................38, 44<br />
Malet Léo............................................................................................................................................64<br />
Mallarmé Stéphane.............................................................................................................................67<br />
Mallet Serge........................................................................................................................................95<br />
Malraux André....................................................................................................................................63<br />
Mandiargues André Pieyre de.............................................................................................................71<br />
Mandrin................................................................................................................................................6<br />
Mansour Joyce....................................................................................................................................71<br />
Mao...........................................................................................................44, 60, 89, 99, 101, 102, 120<br />
Marc Franz..........................................................................................................................................58<br />
Marcuse Herbert.....................................................................................41, 58, 86, 107, 119, 121, 122<br />
Martiro Terres.....................................................................................................................................98<br />
Marvao Herminio...............................................................................................................................88<br />
Marx Brothers.....................................................................................................................................72<br />
Marx Karl.........................................................................................................................45, 57, 58, 63<br />
Maurras Charles..................................................................................................................................88<br />
Meinhof Ulrike.........................................................................................................................114, 118<br />
Melba...........................................................................................................................78, 79, 81, 83-85<br />
Mercader Ramon................................................................................................................................69<br />
Merlin.................................................................................................................................................64<br />
Michaux Henri..........................................................................................................................5, 38, 63<br />
- 137 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Michel Louise...................................................................................................................................102<br />
Miller Henry.......................................................................................................................................92<br />
Minces Juliette..................................................................................................................................100<br />
Miró Joan............................................................................................................................................38<br />
Mistral Frédéric..................................................................................................................................88<br />
Mitrani Nora.......................................................................................................................................71<br />
Mitterrand François............................................................................................................................24<br />
Modigliani Amedeo..........................................................................................................................122<br />
Mollet Guy..........................................................................................................................................88<br />
Mondrian Piet...................................................................................................................................129<br />
Montfort Simon de ..............................................................................................................................6<br />
Morand Paul.......................................................................................................................................28<br />
Moro Aldo.................................................................................................................................117, 119<br />
Mouloudji...........................................................................................................................................54<br />
Mozart Wolfgang................................................................................................................................29<br />
Musset Alfred de...................................................................................................9, 37, 38, 63, 71, 112<br />
Mussolini Benito..........................................................................................................................16, 64<br />
Nadja.....................................................................................................................63, 70, 72, 73, 75, 85<br />
Nasser...............................................................................................................................................102<br />
Nerval Gérard de................................................................................................................................72<br />
Nietzsche Friedrich.........................................................................................................40, 47, 63, 125<br />
Nin Andrès..............................................................................................................................15, 16, 65<br />
Nissaboury........................................................................................................................................110<br />
Nizan Paul..........................................................................................................................................99<br />
Nohain Jean........................................................................................................................................26<br />
Noske Gustav......................................................................................................................................88<br />
Orlovsky Peter............................................................................................................................92, 111<br />
Ormesson Jean d'................................................................................................................................90<br />
Orwell Georges...................................................................................................................................65<br />
Pabst...................................................................................................................................................13<br />
Paco...............................................................................................................................................78-85<br />
Palmier Jean-Michel...........................................................................................................................58<br />
Pannekoek Anton................................................................................................................................45<br />
Pauwels Louis.................................................................................................................................8, 90<br />
Paz Octavio...............................................................................................................................4, 25, 71<br />
Pelloutier.............................................................................................................................................44<br />
Perceval le Gallois..............................................................................................................................64<br />
Péret Benjamin....................................................................................................64, 65, 69, 71, 72, 112<br />
Perros Georges..................................................................................................................................119<br />
Pessoa Fernando.................................................................................................................................25<br />
Pétain Philippe..................................................................................................................19, 23, 65, 94<br />
Piperno Franco..................................................................................................................................117<br />
Pliouchtch Leonid...............................................................................................................................99<br />
Plisnier Charles...................................................................................................................................57<br />
Prévert Jacques...................................................................................................................99, 112, 129<br />
Princet Liliane....................................................................................................................................38<br />
Princet Maurice..................................................................................................................................38<br />
Proust Marcel......................................................................................................................................26<br />
- 138 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Prudhommeaux André........................................................................................................................59<br />
Ragon Michel....................................................................................................................................112<br />
Raspe J.C..........................................................................................................................................118<br />
Reed Lou..........................................................................................................................................125<br />
Reich Wilhelm............................................................................................................................58, 121<br />
Rémy Pierre-Jean................................................................................................................................28<br />
Ricœur Paul........................................................................................................................................88<br />
Rigaut Jacques....................................................................................................................................70<br />
Rimbaud Arthur..................................................................................6, 38, 40, 47, 58, 60, 63, 72, 122<br />
Ripault Ghislain................................................................................................................................110<br />
Ritsos Yannis......................................................................................................................................67<br />
Robespierre Maximilien de................................................................................................................86<br />
Robin Guy..........................................................................................................................................42<br />
Rocard Michel..................................................................................................................................107<br />
Rocker Rudolf....................................................................................................................................58<br />
Rousselot Jean....................................................................................................................................42<br />
Russier Gabrielle ...............................................................................................................................23<br />
Saint François d’Assise......................................................................................................................41<br />
Saint Jean de la Croix.........................................................................................................................41<br />
Saint Pol-Roux....................................................................................................................................68<br />
Saint-Granier......................................................................................................................................26<br />
Saint-Jean-de-la-Croix........................................................................................................................60<br />
Saint-John Perse.................................................................................................................................38<br />
Saint-John-Perse.................................................................................................................................39<br />
Sainte Thérèse d’Avila........................................................................................................................41<br />
Salazar António de Oliveira................................................................................................................89<br />
Samain Albert.....................................................................................................................................38<br />
Sartre Jean-Paul............................................................................................................................26, 54<br />
Schuster Jean..........................................................................................................................68, 69, 71<br />
Segalen Victor.......................................................................................................................................5<br />
Sénéchal Georges...............................................................................................................................38<br />
Sennelier Jacques..........................................................................................................................71-76<br />
Sévigné Madame de...........................................................................................................................12<br />
Simon Michel...............................................................................................................................39, 40<br />
Six Jacques.........................................................................................................................................38<br />
Snyder Gary........................................................................................................................................92<br />
Soekarno...........................................................................................................................................102<br />
Soutine Chaïm..................................................................................................................................122<br />
Spartacus.....................................................................................................................41, 59, 60, 97, 98<br />
Staline.............................................................................................................15, 45, 60, 64, 65, 69, 90<br />
Swift Jonathan....................................................................................................................................67<br />
Tanner Alain.......................................................................................................................................29<br />
Tchang Kaï-Chek..............................................................................................................................120<br />
Thieuloy Jack......................................................................................................................................32<br />
Thomas Bernard..........................................................................................................................88, 112<br />
Thorez Maurice............................................................................................................................23, 88<br />
Tixier-Vignancour Jean-Louis............................................................................................................90<br />
Togliatti Palmiro.................................................................................................................................65<br />
- 139 -
LIBERTÉ Couleur D’HOMME<br />
Toyen............................................................................................................................................69, 71<br />
Trakl Georg.........................................................................................................................................58<br />
Trénet Charles.....................................................................................................................................16<br />
Tristan et Yseult..................................................................................................................................28<br />
Trotski Léon..................................................................................................................................66, 69<br />
Trotsky Léon.......................................................................................................................................65<br />
Unamuno Miguel de.....................................................................................................................15, 83<br />
Vacaresco Irina.....................................................................................................................................5<br />
Vaché Jacques.................................................................................................................63, 70, 72, 122<br />
Vailland Roger....................................................................................................................................88<br />
Valéry Paul....................................................................................................................................28, 67<br />
Valladares Armando........................................................................................................3, 99, 111, 118<br />
Vallès Jules.........................................................................................................................................63<br />
Van Gogh Vincent.........................................................................................................36, 47, 122, 129<br />
Vaneigem Raoul................................................................................................................................122<br />
Vanel Charles......................................................................................................................................40<br />
Vian Boris...........................................................................................................................................54<br />
Vigo Jean......................................................................................................................................39, 72<br />
Villa Pancho..........................................................................................................................................6<br />
Webern Anton...................................................................................................................................129<br />
Wellens Serge..............................................................................................................37-39, 44, 47, 63<br />
Whitman Walt...............................................................................................................................91, 92<br />
Winter Gabor................................................................................................................................3, 118<br />
Yacine Kateb.....................................................................................................................................100<br />
Yupanqui Atahualpa............................................................................................................................67<br />
Zapata Emiliano....................................................................................................................................6<br />
Zola Émile....................................................................................................................................28, 63<br />
- 140 -