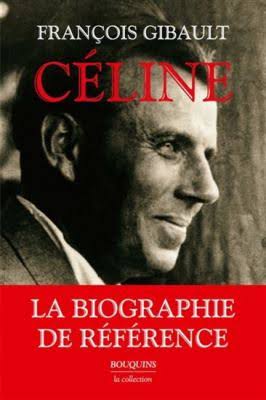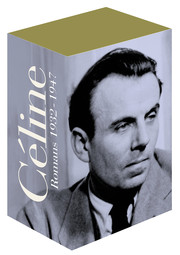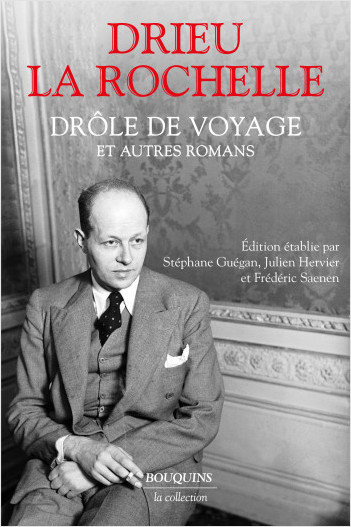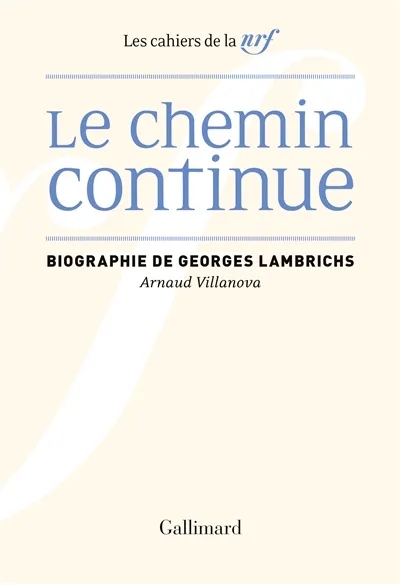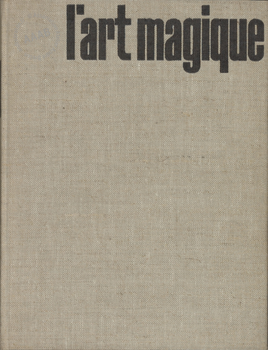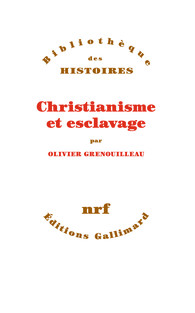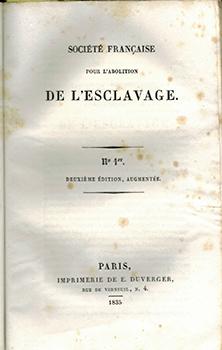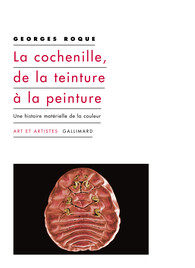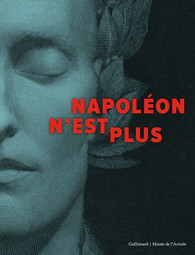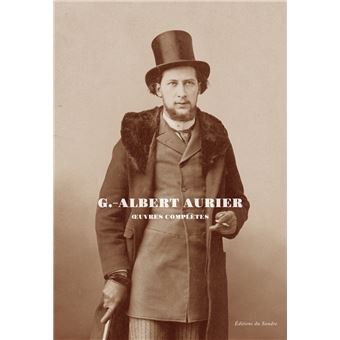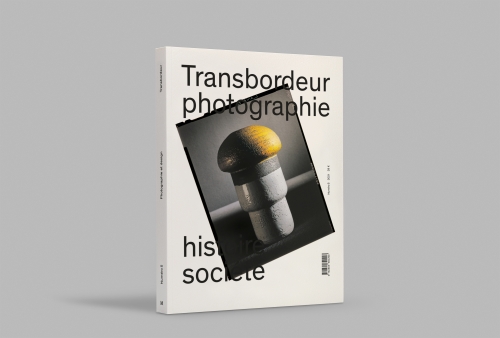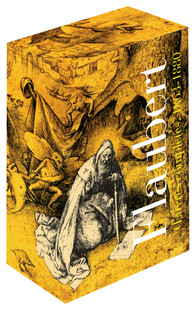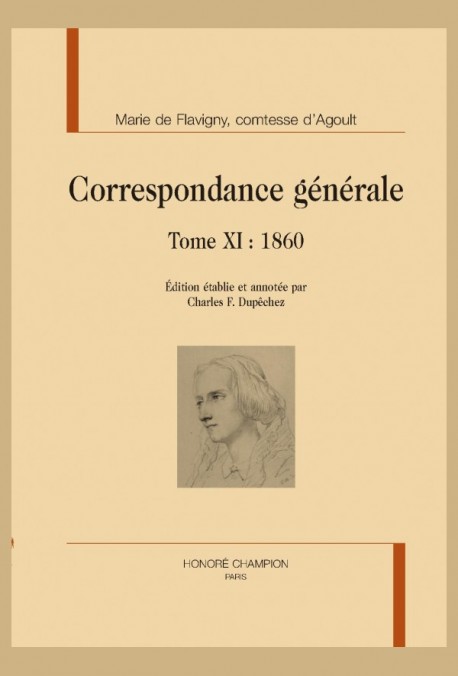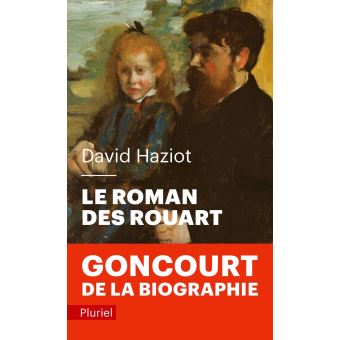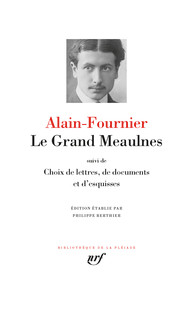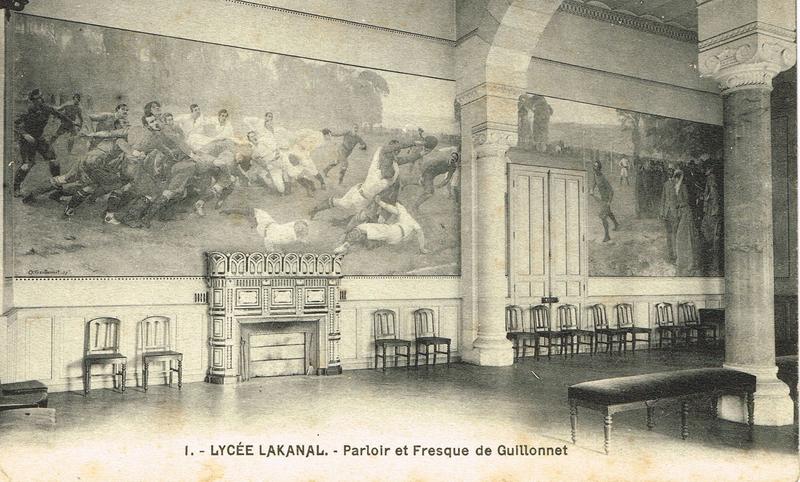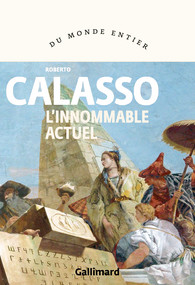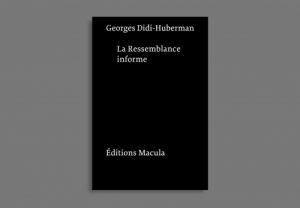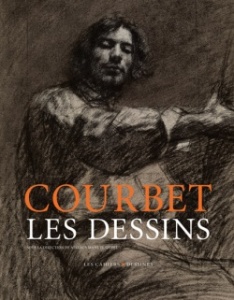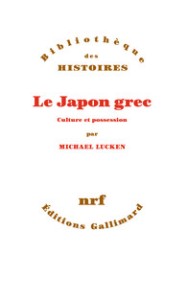Nous nous pensions libérés à jamais de l’antique stupeur, de l’effroi majeur que Machiavel lisait dans le regard des persécutés, ou du traumatisme causé par la découverte de l’horreur génocidaire, des charniers d’Arménie aux camps de la Shoah… Se sont effacés aussi, un à un, ceux qu’on appela longtemps les poilus des défilés du 11 novembre, les rescapés, les mutilés de la Grande Guerre, ceux que les orages d’acier avaient défigurés et condamnés à vivre masqués, grimés, affublés de toutes sortes de prothèses pour tromper leur misère. Claire Maingon les ramène parmi nous en ravivant la plaie. Car la mémoire visuelle de ces millions d’hommes blessés, déshumanisés n’a pas encore été assez fouillée, montrée et exposée à la double analyse de l’image et de ses multiples fonctions d’alors. Dès l’été 14, l’Europe des belligérants, soldats et civils, est meurtrie dans sa chair et l’art, au mépris des consignes, prend, donne la mesure du carnage bien avant la fin du conflit. « La Grande Guerre fut une époque de la vie où les bras et les jambes se perdaient », devait écrire le Camus du Premier homme, au sujet de son père. Il n’est peut-être pas de métaphore plus criante de l’événement et de ses retombées de toute nature que la réalité et le motif pictural des mains coupées dont la lecture de Claire Maingon enrichit l’étude. Cendrars ne formule pas autrement le sacrifice héroïque, patriotique, de son intégrité physique. Pendant que d’autres ricanent après s’être faits porter pâles, le genre Picabia ou Duchamp, certains affrontent, par l’image manuelle ou mécanique, la déshumanisation qui devait tant intéresser le Bataille des années Documents. L’épouvante du pire précède son remploi surréaliste, et ne connaît aucune frontière. L’expressionniste Kirchner, qui avait échappé au feu pour comportement anormal sous l’uniforme, se représente en soldat allemand, un moignon sanglant en évidence, dans le fameux autoportrait de 1915. Apollinaire, à chaud, refuse cette grandiloquence, où gît la culpabilité de l’arrière.
Nous nous pensions libérés à jamais de l’antique stupeur, de l’effroi majeur que Machiavel lisait dans le regard des persécutés, ou du traumatisme causé par la découverte de l’horreur génocidaire, des charniers d’Arménie aux camps de la Shoah… Se sont effacés aussi, un à un, ceux qu’on appela longtemps les poilus des défilés du 11 novembre, les rescapés, les mutilés de la Grande Guerre, ceux que les orages d’acier avaient défigurés et condamnés à vivre masqués, grimés, affublés de toutes sortes de prothèses pour tromper leur misère. Claire Maingon les ramène parmi nous en ravivant la plaie. Car la mémoire visuelle de ces millions d’hommes blessés, déshumanisés n’a pas encore été assez fouillée, montrée et exposée à la double analyse de l’image et de ses multiples fonctions d’alors. Dès l’été 14, l’Europe des belligérants, soldats et civils, est meurtrie dans sa chair et l’art, au mépris des consignes, prend, donne la mesure du carnage bien avant la fin du conflit. « La Grande Guerre fut une époque de la vie où les bras et les jambes se perdaient », devait écrire le Camus du Premier homme, au sujet de son père. Il n’est peut-être pas de métaphore plus criante de l’événement et de ses retombées de toute nature que la réalité et le motif pictural des mains coupées dont la lecture de Claire Maingon enrichit l’étude. Cendrars ne formule pas autrement le sacrifice héroïque, patriotique, de son intégrité physique. Pendant que d’autres ricanent après s’être faits porter pâles, le genre Picabia ou Duchamp, certains affrontent, par l’image manuelle ou mécanique, la déshumanisation qui devait tant intéresser le Bataille des années Documents. L’épouvante du pire précède son remploi surréaliste, et ne connaît aucune frontière. L’expressionniste Kirchner, qui avait échappé au feu pour comportement anormal sous l’uniforme, se représente en soldat allemand, un moignon sanglant en évidence, dans le fameux autoportrait de 1915. Apollinaire, à chaud, refuse cette grandiloquence, où gît la culpabilité de l’arrière.
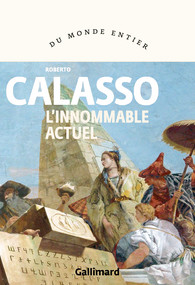 Dans le monde d’aujourd’hui, « où les lignes se dédoublent, les tissus s’effilochent, les perspectives vacillent », écrit Roberto Calasso, il n’est plus d’arrière et de front, l’ultra-violence sectaire, comme les réseaux complices de l’internet, frappe partout et à tout moment, qu’il s’agisse de cibles explicables ou de victimes dont l’anonymat et la mort aléatoire donnent sens à l’acte qui les désigne soudain à l’attention publique. Dans un monde où tout devient instantané et simultané, précise Calasso, le terrorisme islamique partage donc plus d’un trait avec « la société séculière » dont il veut précipiter la fin. On le vérifie à chacun de ses livres, au pessimisme croissant, les raisonnements binaires, banalement progressistes, ne sauraient apaiser l’inquiétude que lui inspire notre époque de déliaison. La sur-connexion en est à la fois la fable et le levier : «On peut se demander si la société séculière est une société qui croit en quelque chose qui ne soit pas elle-même. » Dieu n’est pas mort, il a changé d’apparence : « Les conflits de la société n’ont plus pour objet quelque chose qui serait en dehors et au-delà, mais la société elle-même. Or, celle-ci est tout d’abord une vaste surface expérimentale, un laboratoire où des forces opposées tentent de s’arracher réciproquement la direction des expériences.» Ce grand baudelairien de Calasso n’a pas de mal à crucifier le « sécularisme », aussi sectaire que ceux qui le combattent, le tourisme, cette religion de l’insignifiant propre à l’âge du zapping, et l’obscénité d’un multiculturalisme destructeur des différences qu’il est supposé transmettre : « La convergence des cultures vers l’unité se vérifie dans le tourisme et dans la pornographie. Ce sont des mondes parallèles régis par des règles similaires. » L’Innommable actuel demande à Baudelaire le dernier mot. Il est emprunté aux brouillons du poète. L’une de ces notes se présente comme la transcription d’un cauchemar piranésien. Baudelaire se dit avoir été assailli par la vision étouffante d’une sorte de gratte-ciel qui s’effondre sur ses occupants. Or, conclut Calasso, le rêve de Baudelaire s’est réalisé au-delà de lui-même, car les tours étaient deux – et jumelles.
Dans le monde d’aujourd’hui, « où les lignes se dédoublent, les tissus s’effilochent, les perspectives vacillent », écrit Roberto Calasso, il n’est plus d’arrière et de front, l’ultra-violence sectaire, comme les réseaux complices de l’internet, frappe partout et à tout moment, qu’il s’agisse de cibles explicables ou de victimes dont l’anonymat et la mort aléatoire donnent sens à l’acte qui les désigne soudain à l’attention publique. Dans un monde où tout devient instantané et simultané, précise Calasso, le terrorisme islamique partage donc plus d’un trait avec « la société séculière » dont il veut précipiter la fin. On le vérifie à chacun de ses livres, au pessimisme croissant, les raisonnements binaires, banalement progressistes, ne sauraient apaiser l’inquiétude que lui inspire notre époque de déliaison. La sur-connexion en est à la fois la fable et le levier : «On peut se demander si la société séculière est une société qui croit en quelque chose qui ne soit pas elle-même. » Dieu n’est pas mort, il a changé d’apparence : « Les conflits de la société n’ont plus pour objet quelque chose qui serait en dehors et au-delà, mais la société elle-même. Or, celle-ci est tout d’abord une vaste surface expérimentale, un laboratoire où des forces opposées tentent de s’arracher réciproquement la direction des expériences.» Ce grand baudelairien de Calasso n’a pas de mal à crucifier le « sécularisme », aussi sectaire que ceux qui le combattent, le tourisme, cette religion de l’insignifiant propre à l’âge du zapping, et l’obscénité d’un multiculturalisme destructeur des différences qu’il est supposé transmettre : « La convergence des cultures vers l’unité se vérifie dans le tourisme et dans la pornographie. Ce sont des mondes parallèles régis par des règles similaires. » L’Innommable actuel demande à Baudelaire le dernier mot. Il est emprunté aux brouillons du poète. L’une de ces notes se présente comme la transcription d’un cauchemar piranésien. Baudelaire se dit avoir été assailli par la vision étouffante d’une sorte de gratte-ciel qui s’effondre sur ses occupants. Or, conclut Calasso, le rêve de Baudelaire s’est réalisé au-delà de lui-même, car les tours étaient deux – et jumelles.
 Italien de naissance, 63 ans, Rudolf Stingel est new yorkais d’adoption depuis trente ans. Je ne m’étais jamais demandé s’il était un artiste du 11 septembre avant de pénétrer dans l’exposition du Palazzo Grassi. En 2013, il y avait déroulé 500 mètres de moquette à dominante rouge et à motifs orientaux. Du sol au plafond, amortissant mes pas, allongeant le silence, le vieux palais vénitien flottait dans la suspension du temps que l’artiste avait provoquée en habillant le vide. Les problématiques que la vulgate prête à l’artiste, son soi-disant besoin d’opposer figuration et abstraction, s’étaient dissipées. On dit que Stingel avait trouvé dans le cabinet londonien de Freud l’inspiration de cette architecture intériorisée, où le visiteur toutefois n’était pas seulement confronté à l’absence. De temps à autre, un contrepoint pictural émergeait de cette plénitude textile, sous la forme de petits tableaux monochromes à l’imitation d’anciennes photographies. La vieille sculpture germanique en était l’élue, le gothique le plus glaçant, le plus dérangeant, le plus opposé à l’otium visuel du reste. Une manière du Jugement dernier traité sur le mode spirite de la fin du XIXe siècle. Cette impression générale se ressent aussi à la fondation Beyeler, dominée par la note solaire que ponctuent, à l’identique, des peintures noires porteuses d’un effroi où le spectre des drames humains et les peurs archaïques de l’enfance se dissocient mal. New York a laissé d’autres traces, au sens plein, sur Stingel. A bien des égards, peu notés et commentés, il appartient à la vague des Schnabel, Basquiat (son cadet de quatre ans) et Koons, enfants du dernier Warhol. La même nostalgie du fonds d’or, de la Cène, et le même sens du palimpseste travaillent l’œuvre de Stingel. Cette rétrospective, dans les espaces uniques et la pleine lumière de Renzo Piano, aux antipodes donc de la boîte du Palazzo Grassi, c’est son moment de vérité. Une telle épreuve ne pouvait obéir à l’ordre chronologique et à la stricte sagesse thématique. Chez cet artiste qu’hante aussi l’œuvre de Richter, autre obsédé des représentations instables, le temps se compte et l’Histoire s’affiche autrement.
Italien de naissance, 63 ans, Rudolf Stingel est new yorkais d’adoption depuis trente ans. Je ne m’étais jamais demandé s’il était un artiste du 11 septembre avant de pénétrer dans l’exposition du Palazzo Grassi. En 2013, il y avait déroulé 500 mètres de moquette à dominante rouge et à motifs orientaux. Du sol au plafond, amortissant mes pas, allongeant le silence, le vieux palais vénitien flottait dans la suspension du temps que l’artiste avait provoquée en habillant le vide. Les problématiques que la vulgate prête à l’artiste, son soi-disant besoin d’opposer figuration et abstraction, s’étaient dissipées. On dit que Stingel avait trouvé dans le cabinet londonien de Freud l’inspiration de cette architecture intériorisée, où le visiteur toutefois n’était pas seulement confronté à l’absence. De temps à autre, un contrepoint pictural émergeait de cette plénitude textile, sous la forme de petits tableaux monochromes à l’imitation d’anciennes photographies. La vieille sculpture germanique en était l’élue, le gothique le plus glaçant, le plus dérangeant, le plus opposé à l’otium visuel du reste. Une manière du Jugement dernier traité sur le mode spirite de la fin du XIXe siècle. Cette impression générale se ressent aussi à la fondation Beyeler, dominée par la note solaire que ponctuent, à l’identique, des peintures noires porteuses d’un effroi où le spectre des drames humains et les peurs archaïques de l’enfance se dissocient mal. New York a laissé d’autres traces, au sens plein, sur Stingel. A bien des égards, peu notés et commentés, il appartient à la vague des Schnabel, Basquiat (son cadet de quatre ans) et Koons, enfants du dernier Warhol. La même nostalgie du fonds d’or, de la Cène, et le même sens du palimpseste travaillent l’œuvre de Stingel. Cette rétrospective, dans les espaces uniques et la pleine lumière de Renzo Piano, aux antipodes donc de la boîte du Palazzo Grassi, c’est son moment de vérité. Une telle épreuve ne pouvait obéir à l’ordre chronologique et à la stricte sagesse thématique. Chez cet artiste qu’hante aussi l’œuvre de Richter, autre obsédé des représentations instables, le temps se compte et l’Histoire s’affiche autrement.
 Ne quittons pas le terrain des images et du sacré qu’elles ouvrent ou singent… Bien que composés de matériaux hétérogènes, les volumes de la série Ninfa se succèdent avec autant de logique que de régularité. Il est vrai que cette rationalité peut échapper au lecteur de Georges Didi-Huberman tant il est friand de détours complexes et de références savantes. Il faut suivre, ne pas craindre les répétitions, les formulations risquées et les appréciations expéditives. Malgré ou à cause de cette densité textuelle, pareille lecture, c’est une vertu, ne peut être qu’active, au sens où l’entend et l’attend l’auteur. On accordera à Didi-Huberman de ne jamais céder à la tentation d’enfermer son lecteur dans les ornières d’une argumentation qui se bornerait à confirmer des postulats non démontrés. Ninfa dolorosa, réflexion sur le tragique contemporain et le pathos généralisé des médias supposés en rendre compte, conduit le disciple d’Aby Warburg à se lover, une fois de plus, dans la mémoire des images, à nouer présent immédiat et passé multiséculaire. Plus la tyrannie de l’information visuelle élude le sens, substitue l’hyper-émotion à la raison, explique-t-il, plus « la construction de la durée » est requise. « Je ne veux pas de misère », déclarait Rupert Murdoch en 1986. La photographie de guerre esthétise désormais la douleur des victimes, les désastres humanitaires, par nécessité compassionnelle. Après nous avoir invités à penser la relation esthétique dans son ancrage corporel, après avoir interrogé les œuvres qui ébranlent et font agir, Didi-Huberman fait le constat inverse : une grande partie de l’imagerie contemporaine, d’autant plus efficace qu’elle bénéficie du fallacieux «ça a été» cher à Barthes, réduit son consommateur à la passivité de l’émotion subie ou de l’envoutement. Le lisse et l’instantanéité ont chassé de nos écrans la complexité d’une autre « peinture d’histoire », dont Didi-Huberman se fait l’historien. Préférant Donatello et Goya à Gros, qu’il caricature, il fait souvent remonter plus haut l’origine des migrations propres aux formes liturgiques. Car la déploration photogénique, au Kosovo comme en Algérie, tend au christique, et non au critique. Le présent livre nous encourage fermement à ne pas les confondre.
Ne quittons pas le terrain des images et du sacré qu’elles ouvrent ou singent… Bien que composés de matériaux hétérogènes, les volumes de la série Ninfa se succèdent avec autant de logique que de régularité. Il est vrai que cette rationalité peut échapper au lecteur de Georges Didi-Huberman tant il est friand de détours complexes et de références savantes. Il faut suivre, ne pas craindre les répétitions, les formulations risquées et les appréciations expéditives. Malgré ou à cause de cette densité textuelle, pareille lecture, c’est une vertu, ne peut être qu’active, au sens où l’entend et l’attend l’auteur. On accordera à Didi-Huberman de ne jamais céder à la tentation d’enfermer son lecteur dans les ornières d’une argumentation qui se bornerait à confirmer des postulats non démontrés. Ninfa dolorosa, réflexion sur le tragique contemporain et le pathos généralisé des médias supposés en rendre compte, conduit le disciple d’Aby Warburg à se lover, une fois de plus, dans la mémoire des images, à nouer présent immédiat et passé multiséculaire. Plus la tyrannie de l’information visuelle élude le sens, substitue l’hyper-émotion à la raison, explique-t-il, plus « la construction de la durée » est requise. « Je ne veux pas de misère », déclarait Rupert Murdoch en 1986. La photographie de guerre esthétise désormais la douleur des victimes, les désastres humanitaires, par nécessité compassionnelle. Après nous avoir invités à penser la relation esthétique dans son ancrage corporel, après avoir interrogé les œuvres qui ébranlent et font agir, Didi-Huberman fait le constat inverse : une grande partie de l’imagerie contemporaine, d’autant plus efficace qu’elle bénéficie du fallacieux «ça a été» cher à Barthes, réduit son consommateur à la passivité de l’émotion subie ou de l’envoutement. Le lisse et l’instantanéité ont chassé de nos écrans la complexité d’une autre « peinture d’histoire », dont Didi-Huberman se fait l’historien. Préférant Donatello et Goya à Gros, qu’il caricature, il fait souvent remonter plus haut l’origine des migrations propres aux formes liturgiques. Car la déploration photogénique, au Kosovo comme en Algérie, tend au christique, et non au critique. Le présent livre nous encourage fermement à ne pas les confondre.
Stéphane Guégan
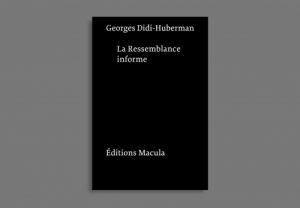 Claire Maingon, Mains coupées sur paupières closes. Blessures, mutilations subies et sublimées des artistes en guerre (1914-1930), PURH, 25€ / Roberto Calasso, L’Innommable actuel, Gallimard, 19€ / Rudolf Stingel, Fondation Beyeler, jusqu’au 6 octobre 2019 / Georges Didi-Huberman, Ninfa Dolorosa. Essai sur la mémoire d’un geste, Gallimard, collection Art et Artistes, 29€. Macula, on s’en félicite, met en circulation la 3e édition augmentée de La Ressemblance informe ou le gai savoir de Georges Bataille (32€), livre dans lequel l’expérience des limites que fut la revue Documents jette les bases d’une approche de « l’esthétique classique » à partir de sa crise.
Claire Maingon, Mains coupées sur paupières closes. Blessures, mutilations subies et sublimées des artistes en guerre (1914-1930), PURH, 25€ / Roberto Calasso, L’Innommable actuel, Gallimard, 19€ / Rudolf Stingel, Fondation Beyeler, jusqu’au 6 octobre 2019 / Georges Didi-Huberman, Ninfa Dolorosa. Essai sur la mémoire d’un geste, Gallimard, collection Art et Artistes, 29€. Macula, on s’en félicite, met en circulation la 3e édition augmentée de La Ressemblance informe ou le gai savoir de Georges Bataille (32€), livre dans lequel l’expérience des limites que fut la revue Documents jette les bases d’une approche de « l’esthétique classique » à partir de sa crise.
Derniers galops à travers les siècles
 Je ne me console pas de m’être privé de l’exposition Bernard Van Orley dont les portes se refermeront le 25 mai. En cet artiste, qui fut à la Renaissance flamande ce que Rubens serait au baroque du Nord, s’est réalisé l’idéal du peintre humaniste, docte et concret, dans sa dimension européenne la plus ambitieuse. Muni du splendide catalogue, digne des raffinements de son sujet, on peut se faire une idée de cet hommage de Bruxelles à l’un de ses fils les plus illustres. L’art de cour, qui ne peut se borner à la peinture, exige plus de ceux qu’il s’attache. Né vers 1488, Van Orley accède aux faveurs de Marguerite d’Autriche en 1518. Elle règne sur le Brabant, son portrait respire l’autorité à galoche des Habsbourg. Plus beau encore, le portrait de son jeune neveu, un certain Charles Quint, où Van Orley serre chaque détail sans perdre l’impression générale d’un prince qui va être l’un des maîtres du monde. Van Orley peint pour les grands, dans l’émulation des grands. Ils se nomment Pérugin, Léonard, Raphaël, dont on tisse les cartons à Bruxelles, ou Dürer, que Van Orley croise en 1521. Cet homme qui a tout, le génie et la protection des élites, s’expose à tout perdre. Le catalogue nous apprend qu’il va connaître une disgrâce momentanée pour curiosités, sinon affinités, luthériennes. En plus d’avoir comblé ses visiteurs de retables et de portraits, aussi beaux que ceux d’Holbein, l’exposition rassemblait quelques-unes des tapisseries où s’est joué son statut et ses privilèges. Nul médium ne saurait alors rivaliser avec ces tentures qui accompagnent les princes, rois et empereurs de lieu en lieu. Parmi celles qui chantent les premiers exploits militaires de Charles Quint, la série inhérente à La bataille de Pavie remporte une dernière victoire. Le cœur des Français souffre, mais l’œil s’abandonne aux grandes ivresses. SG/ Bernard Van Orley. Bruxelles et la Renaissance, BOZAR, Bruxelles, jusqu’au 25 mai 2019. Catalogue BOZAR Books et Mardaga, 49,90€.
Je ne me console pas de m’être privé de l’exposition Bernard Van Orley dont les portes se refermeront le 25 mai. En cet artiste, qui fut à la Renaissance flamande ce que Rubens serait au baroque du Nord, s’est réalisé l’idéal du peintre humaniste, docte et concret, dans sa dimension européenne la plus ambitieuse. Muni du splendide catalogue, digne des raffinements de son sujet, on peut se faire une idée de cet hommage de Bruxelles à l’un de ses fils les plus illustres. L’art de cour, qui ne peut se borner à la peinture, exige plus de ceux qu’il s’attache. Né vers 1488, Van Orley accède aux faveurs de Marguerite d’Autriche en 1518. Elle règne sur le Brabant, son portrait respire l’autorité à galoche des Habsbourg. Plus beau encore, le portrait de son jeune neveu, un certain Charles Quint, où Van Orley serre chaque détail sans perdre l’impression générale d’un prince qui va être l’un des maîtres du monde. Van Orley peint pour les grands, dans l’émulation des grands. Ils se nomment Pérugin, Léonard, Raphaël, dont on tisse les cartons à Bruxelles, ou Dürer, que Van Orley croise en 1521. Cet homme qui a tout, le génie et la protection des élites, s’expose à tout perdre. Le catalogue nous apprend qu’il va connaître une disgrâce momentanée pour curiosités, sinon affinités, luthériennes. En plus d’avoir comblé ses visiteurs de retables et de portraits, aussi beaux que ceux d’Holbein, l’exposition rassemblait quelques-unes des tapisseries où s’est joué son statut et ses privilèges. Nul médium ne saurait alors rivaliser avec ces tentures qui accompagnent les princes, rois et empereurs de lieu en lieu. Parmi celles qui chantent les premiers exploits militaires de Charles Quint, la série inhérente à La bataille de Pavie remporte une dernière victoire. Le cœur des Français souffre, mais l’œil s’abandonne aux grandes ivresses. SG/ Bernard Van Orley. Bruxelles et la Renaissance, BOZAR, Bruxelles, jusqu’au 25 mai 2019. Catalogue BOZAR Books et Mardaga, 49,90€.
 Il aura donc fallu une exposition, prodigieuse, il est vrai, pour rendre définitivement sensible, audible, respirable cette évidence que Balzac et Baudelaire ne cessèrent de redire : le premier acteur du romantisme fut une actrice. Une ville, Paris. Au lendemain de Waterloo, la France, tel le Mazeppa de Byron et Hugo, tombe « et se relève roi » ou reine. Car les Bourbons restaurés, avant leur raidissement final et fatal, sourirent à la génération nouvelle, et pas seulement à celle qui chantait le trône et l’autel. Ces hommes et ces femmes, sur les ruines de l’Empire, traumatisme dont nous n’avons plus idée, refusent l’idéal trop pur, trop lisse de leurs aînés, clament le retour au réel ou l’accès au rêve, bien que David et les siens, sur les deux terrains de la peinture moderne, aient ouvert la voie à leur propre disqualification. Delacroix et Géricault, du reste, ont payé leurs dettes, comptant même, envers les hommes de 1789 et de 1804… Sur le moment, la rupture générationnelle se voulut évidemment plus tranchante. Mais les romantiques, pour s’inventer, eurent besoin d’un autre mythe, celui du bourgeois, hypostase de toutes les tiédeurs du goût et de l’existence. L’épicier ne saurait pactiser avec le chevelu mérovingien et la barbe Henri III. De cette opposition sociologique promise à un bel avenir, dont Baudelaire fut le premier à sourire, l’exposition de Christophe Leribault et Jean-Marie Bruson fait justice en nous rappelant que la nouvelle sensibilité s’empara vite de tout ce qui faisait la vie, le domaine de l’utile compris, de la tabatière au gilet à taille serrée. Paris, ses salons, son Salon, ont brassé l’esthétique de l’heure dans toutes ses composantes. Et si l’art nouveau est descendu dans la rue, l’inverse a causé quelques étincelles après 1830 et avant 1848. Il était important que le parcours de Paris romantique, dont la scénographie soigne chaque station, fît entendre Delacroix et Ingres autant que Daumier et Jeanron, avant de se refermer sur le manuscrit de L’Éducation sentimentale, véritables Illusions perdues de toute une génération aux espoirs trop vastes ou trop vagues, aux amours mal vécues ou aux bonheurs trop vite consumés.
Il aura donc fallu une exposition, prodigieuse, il est vrai, pour rendre définitivement sensible, audible, respirable cette évidence que Balzac et Baudelaire ne cessèrent de redire : le premier acteur du romantisme fut une actrice. Une ville, Paris. Au lendemain de Waterloo, la France, tel le Mazeppa de Byron et Hugo, tombe « et se relève roi » ou reine. Car les Bourbons restaurés, avant leur raidissement final et fatal, sourirent à la génération nouvelle, et pas seulement à celle qui chantait le trône et l’autel. Ces hommes et ces femmes, sur les ruines de l’Empire, traumatisme dont nous n’avons plus idée, refusent l’idéal trop pur, trop lisse de leurs aînés, clament le retour au réel ou l’accès au rêve, bien que David et les siens, sur les deux terrains de la peinture moderne, aient ouvert la voie à leur propre disqualification. Delacroix et Géricault, du reste, ont payé leurs dettes, comptant même, envers les hommes de 1789 et de 1804… Sur le moment, la rupture générationnelle se voulut évidemment plus tranchante. Mais les romantiques, pour s’inventer, eurent besoin d’un autre mythe, celui du bourgeois, hypostase de toutes les tiédeurs du goût et de l’existence. L’épicier ne saurait pactiser avec le chevelu mérovingien et la barbe Henri III. De cette opposition sociologique promise à un bel avenir, dont Baudelaire fut le premier à sourire, l’exposition de Christophe Leribault et Jean-Marie Bruson fait justice en nous rappelant que la nouvelle sensibilité s’empara vite de tout ce qui faisait la vie, le domaine de l’utile compris, de la tabatière au gilet à taille serrée. Paris, ses salons, son Salon, ont brassé l’esthétique de l’heure dans toutes ses composantes. Et si l’art nouveau est descendu dans la rue, l’inverse a causé quelques étincelles après 1830 et avant 1848. Il était important que le parcours de Paris romantique, dont la scénographie soigne chaque station, fît entendre Delacroix et Ingres autant que Daumier et Jeanron, avant de se refermer sur le manuscrit de L’Éducation sentimentale, véritables Illusions perdues de toute une génération aux espoirs trop vastes ou trop vagues, aux amours mal vécues ou aux bonheurs trop vite consumés.  Mais Paris, en 1869, à la sortie du chef-d’œuvre de Flaubert, avait déjà recommencé. Manet, Degas, Verlaine, Mallarmé, Bizet en composaient le visage. SG / Paris romantique 1815-1848, Petit Palais et Musée de la vie romantique, catalogue (Paris Musées, 49,90€) sous la direction de Christophe Leribault et Jean-Marie Bruson, avec une préface balzacienne d’Adrien Goetz, à qui l’on doit, parution chaude à maints égards, une émouvante Notre-Dame de l’humanité (Grasset, 5€), dont les droits seront versés à la Fondation du patrimoine. Car Paris, c’est aussi un vaisseau de lumière, tourné vers Dieu, cet arbitre des âmes et du goût, dirait ce vieux dandy catholique de Barbey d’Aurevilly.
Mais Paris, en 1869, à la sortie du chef-d’œuvre de Flaubert, avait déjà recommencé. Manet, Degas, Verlaine, Mallarmé, Bizet en composaient le visage. SG / Paris romantique 1815-1848, Petit Palais et Musée de la vie romantique, catalogue (Paris Musées, 49,90€) sous la direction de Christophe Leribault et Jean-Marie Bruson, avec une préface balzacienne d’Adrien Goetz, à qui l’on doit, parution chaude à maints égards, une émouvante Notre-Dame de l’humanité (Grasset, 5€), dont les droits seront versés à la Fondation du patrimoine. Car Paris, c’est aussi un vaisseau de lumière, tourné vers Dieu, cet arbitre des âmes et du goût, dirait ce vieux dandy catholique de Barbey d’Aurevilly.
 Jean Pavans, dont j’ai chanté ici les hautes vertus de traducteur, écrivain et connaisseur du romantisme, nous gratifie d’une nouvelle édition, bilingue, des grands poèmes orientaux de Byron, ceux-là mêmes qui ensorcelèrent, telle la mer notre Anglais voyageur, Hugo, Delacroix, Géricault, Gautier, Berlioz et, plus tard, Barbey d’Aurevilly, Mallarmé… Baudelaire, autre lecteur, disait avec son autorité proverbiale : «Le poète est ce qu’il veut». La sentence résume assez bien la manière de Byron, fuyant le confort britannique pour se frotter aux aventures, femmes et peuples opprimés, qui le réclamaient. Ode to Venice m’a rappelé les pages où Gautier conspue, vers 1850, l’occupation autrichienne. Qu’il est douloureux le « harsh sound of the barbarian drum » ! La ville humiliée, envahie de musique militaire n’a plus que son lion bâillonné pour pleurer. Quelques années plus tôt, véritable anticipation du destin de Byron, The Giaour versait des larmes de colère sur la Grèce avilie par les Turcs et affaiblie par la désunion. Du combat de l’infidèle et d’Hassan, qui a fait noyer la belle Leila pour avoir succombé à l’étranger, sont sortis de merveilleux Delacroix. Mais Pavans nous oblige à nous souvenir que le poème de Byron s’enroule, jusqu’à son dénouement sublime, sur la culpabilité du Giaour, dont le désir a fait couler trop de sang. N’oublions pas non plus que les images de la mer indomptable s’enflent de résonances guerrières et métaphysiques : « Aussi loin que le vent peut emporter l’écume / S’étend notre empire ; là est notre demeure ! » Away ! Away ! citait Hugo en exergue à son propre Mazeppa, autre poème qu’on lira ici avec feu. SG / Lord Byron, Le Corsaire et autres poèmes orientaux, édition bilingue présentée et traduite par Jean Pavans, 11,20€.
Jean Pavans, dont j’ai chanté ici les hautes vertus de traducteur, écrivain et connaisseur du romantisme, nous gratifie d’une nouvelle édition, bilingue, des grands poèmes orientaux de Byron, ceux-là mêmes qui ensorcelèrent, telle la mer notre Anglais voyageur, Hugo, Delacroix, Géricault, Gautier, Berlioz et, plus tard, Barbey d’Aurevilly, Mallarmé… Baudelaire, autre lecteur, disait avec son autorité proverbiale : «Le poète est ce qu’il veut». La sentence résume assez bien la manière de Byron, fuyant le confort britannique pour se frotter aux aventures, femmes et peuples opprimés, qui le réclamaient. Ode to Venice m’a rappelé les pages où Gautier conspue, vers 1850, l’occupation autrichienne. Qu’il est douloureux le « harsh sound of the barbarian drum » ! La ville humiliée, envahie de musique militaire n’a plus que son lion bâillonné pour pleurer. Quelques années plus tôt, véritable anticipation du destin de Byron, The Giaour versait des larmes de colère sur la Grèce avilie par les Turcs et affaiblie par la désunion. Du combat de l’infidèle et d’Hassan, qui a fait noyer la belle Leila pour avoir succombé à l’étranger, sont sortis de merveilleux Delacroix. Mais Pavans nous oblige à nous souvenir que le poème de Byron s’enroule, jusqu’à son dénouement sublime, sur la culpabilité du Giaour, dont le désir a fait couler trop de sang. N’oublions pas non plus que les images de la mer indomptable s’enflent de résonances guerrières et métaphysiques : « Aussi loin que le vent peut emporter l’écume / S’étend notre empire ; là est notre demeure ! » Away ! Away ! citait Hugo en exergue à son propre Mazeppa, autre poème qu’on lira ici avec feu. SG / Lord Byron, Le Corsaire et autres poèmes orientaux, édition bilingue présentée et traduite par Jean Pavans, 11,20€.
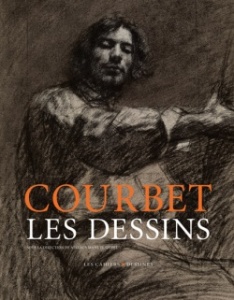 Du nouveau sur Courbet, il en surgit sans cesse. Année anniversaire oblige, Thierry Savatier dresse un bilan plus qu’utile en postface à la cinquième édition de son désormais incontournable opus sur L’Origine du monde (Bartillat, 20€), tableau que nous avons vu récemment dans l’exposition Freud de Jean Clair, parfaitement servi par le propos et son espace dédié, mais qu’il n’aurait pas été absurde d’accrocher dans Préhistoire (voir plus bas). La principale découverte la concernant récemment, pour revenir à cette image inouïe du sexe heureux, nous la devons à Claude Schopp et à son merveilleux livre sur le modèle de ce mont de Vénus sans collier. Nous en avons parlé ici, en temps utile. Il est un autre domaine qui demandait à être proprement réexaminé, ce sont les dessins de Courbet, et notamment ses feuilles et carnets de jeunesse. Que le futur révolutionnaire, réalisme et politique, eut des débuts timorés, incertains, et d’autant plus passionnants ! La publication qu’a dirigée Niklaus Manuel Güdel force l’admiration. Bien qu’il contienne des feuilles dont l’autographie reste discutable, l’ouvrage rassemble un matériel et un nombre de spécialistes très spectaculaires. Les fusains profonds de la grande période de création, vers 1850, tranchent sur les timides essais graphiques du début, ils ne doivent pas dissimuler la perpétuation d’une veine sentimentale où se dévoile un pan de la nature peu glosé de l’artiste. L’ensemble est introduit pas un texte décisif de Louis-Antoine Prat. SG / Niklaus Manuel Güdel (dir.), Les dessins de Gustave Courbet, Beaux Livres – Albums, 42€.
Du nouveau sur Courbet, il en surgit sans cesse. Année anniversaire oblige, Thierry Savatier dresse un bilan plus qu’utile en postface à la cinquième édition de son désormais incontournable opus sur L’Origine du monde (Bartillat, 20€), tableau que nous avons vu récemment dans l’exposition Freud de Jean Clair, parfaitement servi par le propos et son espace dédié, mais qu’il n’aurait pas été absurde d’accrocher dans Préhistoire (voir plus bas). La principale découverte la concernant récemment, pour revenir à cette image inouïe du sexe heureux, nous la devons à Claude Schopp et à son merveilleux livre sur le modèle de ce mont de Vénus sans collier. Nous en avons parlé ici, en temps utile. Il est un autre domaine qui demandait à être proprement réexaminé, ce sont les dessins de Courbet, et notamment ses feuilles et carnets de jeunesse. Que le futur révolutionnaire, réalisme et politique, eut des débuts timorés, incertains, et d’autant plus passionnants ! La publication qu’a dirigée Niklaus Manuel Güdel force l’admiration. Bien qu’il contienne des feuilles dont l’autographie reste discutable, l’ouvrage rassemble un matériel et un nombre de spécialistes très spectaculaires. Les fusains profonds de la grande période de création, vers 1850, tranchent sur les timides essais graphiques du début, ils ne doivent pas dissimuler la perpétuation d’une veine sentimentale où se dévoile un pan de la nature peu glosé de l’artiste. L’ensemble est introduit pas un texte décisif de Louis-Antoine Prat. SG / Niklaus Manuel Güdel (dir.), Les dessins de Gustave Courbet, Beaux Livres – Albums, 42€.
 Théorème, son plus beau film avec Accattone, se préparait à bousculer les écrans italiens et le milieu du cinéma, encore assez hostile au-delà des Alpes. Fellini, le faux frère, Visconti, le révolutionnaire de salon… Pasolini est soucieux, anxieux en cet été 68, il a détesté l’explosion de mai. Derrière l’apparence d’une révolte authentique, il perçoit le chahut de petits bourgeois qui se plient au consumérisme et à l’individualisme sécessionniste, plus proches de l’American way of life que de la révolution comment il l’entend. Cette révolution-là déplaît à la gauche italienne sans rassurer la droite. Pasolini théorise une nouvelle forme de conservatisme, anticapitaliste, soucieuse de l’héritage rural que « les glorieuses » ont profondément abîmé, et des liens intergénérationnels. Le jeunisme à cheveux longs et la diabolisation des « flics » le révulsent, sa « révolution n’a pas pour objectif d’abolir le passé » (Olivier Rey). Il avait déjà compris que la destruction de toute norme commune, de toute continuité historique, de toute autorité politique et spirituelle, ne constituerait pas l’horizon possible des démocraties sociales. On y est… Avant de s’exprimer dans Ecrits corsaires et Lettres luthériennes, ses articles de presse des années 1973-75, il aura collaboré à Tempo, l’équivalent Mondadori de Life à partir d’août 1968. Son rejet de l’époque, qu’il juge toutefois avec la compassion d’un catholique hétérodoxe, a trouvé l’espace adapté aux chroniques douces-amères qu’il mêle de poésies. On le voit dialoguer avec Bertolucci, Moravia, Morante, ou Cohn-Bendit, qu’il perce à jour immédiatement. L’agonie des cultures populaires, grand thème de son cinéma, et le coût anthropologique du « progrès » le préoccupent autant que les mensonges d’Etat (qui auront raison de lui, contrairement à la thèse du crime sexuel qui, commode, a longtemps prévalu). En 1968-69, on le traite de fasciste, pardi ! PPP renvoie le compliment avec l’humour cinglant qui est le sien. Le vrai dieu du cinéma italien, à égalité avec Rossellini, ne croyait pas que le chaos nous sauverait. SG / Pier Paolo Pasolini, Le Chaos, traduit de l’italien et annoté par Philippe Di Meo, préface Olivier Rey, R§N Editions, 2018, 19,90€.
Théorème, son plus beau film avec Accattone, se préparait à bousculer les écrans italiens et le milieu du cinéma, encore assez hostile au-delà des Alpes. Fellini, le faux frère, Visconti, le révolutionnaire de salon… Pasolini est soucieux, anxieux en cet été 68, il a détesté l’explosion de mai. Derrière l’apparence d’une révolte authentique, il perçoit le chahut de petits bourgeois qui se plient au consumérisme et à l’individualisme sécessionniste, plus proches de l’American way of life que de la révolution comment il l’entend. Cette révolution-là déplaît à la gauche italienne sans rassurer la droite. Pasolini théorise une nouvelle forme de conservatisme, anticapitaliste, soucieuse de l’héritage rural que « les glorieuses » ont profondément abîmé, et des liens intergénérationnels. Le jeunisme à cheveux longs et la diabolisation des « flics » le révulsent, sa « révolution n’a pas pour objectif d’abolir le passé » (Olivier Rey). Il avait déjà compris que la destruction de toute norme commune, de toute continuité historique, de toute autorité politique et spirituelle, ne constituerait pas l’horizon possible des démocraties sociales. On y est… Avant de s’exprimer dans Ecrits corsaires et Lettres luthériennes, ses articles de presse des années 1973-75, il aura collaboré à Tempo, l’équivalent Mondadori de Life à partir d’août 1968. Son rejet de l’époque, qu’il juge toutefois avec la compassion d’un catholique hétérodoxe, a trouvé l’espace adapté aux chroniques douces-amères qu’il mêle de poésies. On le voit dialoguer avec Bertolucci, Moravia, Morante, ou Cohn-Bendit, qu’il perce à jour immédiatement. L’agonie des cultures populaires, grand thème de son cinéma, et le coût anthropologique du « progrès » le préoccupent autant que les mensonges d’Etat (qui auront raison de lui, contrairement à la thèse du crime sexuel qui, commode, a longtemps prévalu). En 1968-69, on le traite de fasciste, pardi ! PPP renvoie le compliment avec l’humour cinglant qui est le sien. Le vrai dieu du cinéma italien, à égalité avec Rossellini, ne croyait pas que le chaos nous sauverait. SG / Pier Paolo Pasolini, Le Chaos, traduit de l’italien et annoté par Philippe Di Meo, préface Olivier Rey, R§N Editions, 2018, 19,90€.
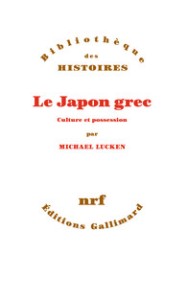 Il est des livres qui rapprochent les temps et les mondes. Peut-on rêver plus grand écart que celui qui sépare, à première vue, le Japon du XXe siècle et la Grèce antique ? Ma surprise à la réception du livre de Michael Lucken venait du conditionnement culturel qui est le nôtre et qu’il commence par déconstruire. En effet, il est difficile a priori de partager l’héritage d’Homère et du Parthénon avec l’Asie de tous les lointains… Force est donc de lutter parfois contre le sentiment de propriété, de relativiser les filiations ethnique et linguistique, cela peut conduire à la (re)découverte d’autres parentés philosophiques, éthiques et artistiques. Mais fallait-il autant souligner, façon Sartre et Foucault, que la culture classique a servi ici et là de moyen de domination ? Peut-on raisonnablement tenir pour équivalents l’expansion des Jésuites et, par exemple, l’impérialisme des Japonais ? En ce premier XXe siècle, l’Empire du Levant ne s’est pas privé d’invoquer les justes fureurs de Mars, voire les fourberies de Jupiter. Au même moment, et en écho aux théories de Winckelmann, intellectuels et artistes japonais considéraient que les conditions indispensables à un nouveau « miracle grec » étaient réunies sur leur terre, depuis le contexte insulaire jusqu’à la race d’acier qu’incarnait la population native aux strictes valeurs. L’envoi de la Vénus de Milo, cadeau diplomatique de Malraux et du Louvre, confirmera, en 1964, un processus d’incubation qui toucha la peinture, la poésie et bientôt les dessins animés. Dans les années 1860, quand l’ère Meiji opte pour une occidentalisation à tout crin, les Japonais accédaient aux Grecs par Byron et Platon ; un siècle plus tard, le lénifiant Miyazaki semble plus populaire qu’Ozu, Kurosawa et Mishima… Une fois sorti de ce livre qui respire le savoir et l’intelligence, on rêve de sa réédition aussi illustrée que la pinacothèque disparue d’Athènes. SG / Michael Lucken, Le Japon grec. Culture et possession, Gallimard, Bibliothèque des histoires, 22,50€
Il est des livres qui rapprochent les temps et les mondes. Peut-on rêver plus grand écart que celui qui sépare, à première vue, le Japon du XXe siècle et la Grèce antique ? Ma surprise à la réception du livre de Michael Lucken venait du conditionnement culturel qui est le nôtre et qu’il commence par déconstruire. En effet, il est difficile a priori de partager l’héritage d’Homère et du Parthénon avec l’Asie de tous les lointains… Force est donc de lutter parfois contre le sentiment de propriété, de relativiser les filiations ethnique et linguistique, cela peut conduire à la (re)découverte d’autres parentés philosophiques, éthiques et artistiques. Mais fallait-il autant souligner, façon Sartre et Foucault, que la culture classique a servi ici et là de moyen de domination ? Peut-on raisonnablement tenir pour équivalents l’expansion des Jésuites et, par exemple, l’impérialisme des Japonais ? En ce premier XXe siècle, l’Empire du Levant ne s’est pas privé d’invoquer les justes fureurs de Mars, voire les fourberies de Jupiter. Au même moment, et en écho aux théories de Winckelmann, intellectuels et artistes japonais considéraient que les conditions indispensables à un nouveau « miracle grec » étaient réunies sur leur terre, depuis le contexte insulaire jusqu’à la race d’acier qu’incarnait la population native aux strictes valeurs. L’envoi de la Vénus de Milo, cadeau diplomatique de Malraux et du Louvre, confirmera, en 1964, un processus d’incubation qui toucha la peinture, la poésie et bientôt les dessins animés. Dans les années 1860, quand l’ère Meiji opte pour une occidentalisation à tout crin, les Japonais accédaient aux Grecs par Byron et Platon ; un siècle plus tard, le lénifiant Miyazaki semble plus populaire qu’Ozu, Kurosawa et Mishima… Une fois sorti de ce livre qui respire le savoir et l’intelligence, on rêve de sa réédition aussi illustrée que la pinacothèque disparue d’Athènes. SG / Michael Lucken, Le Japon grec. Culture et possession, Gallimard, Bibliothèque des histoires, 22,50€
 L’invention de la préhistoire ne se fit pas en un jour, il fallut près d’un siècle pour que s’établisse définitivement la conscience d’un temps premier, d’avant le temps connu. L’immense appel d’air, en conflit ouvert avec l’explication biblique du monde, débute à l’époque de Buffon. Une nouvelle lecture de l’univers et de l’humanité se met en place à partir des observations de la géologie, de la paléontologie et du désir de se doter de nouvelles origines dans le deuil des anciennes. De la préhistoire, science balbutiante au XVIIIe siècle, naît le vertige de « l’immémorial », écrit Rémi Labrusse, concurrent d’abord souterrain au primitivisme gréco-romain des années 1780-1820. Les vestiges préhistoriques s’accumulant, se diversifiant et se précisant, comme le montre excellemment l’exposition du Centre Pompidou, ils provoquent une réaction dès la fin du XIXe siècle, marquée par Darwin, le recul du catholicisme et ce nationalisme, souvent laïc, qui part en quête d’un socle plus ancien que les cathédrales. Ossements, outils et
L’invention de la préhistoire ne se fit pas en un jour, il fallut près d’un siècle pour que s’établisse définitivement la conscience d’un temps premier, d’avant le temps connu. L’immense appel d’air, en conflit ouvert avec l’explication biblique du monde, débute à l’époque de Buffon. Une nouvelle lecture de l’univers et de l’humanité se met en place à partir des observations de la géologie, de la paléontologie et du désir de se doter de nouvelles origines dans le deuil des anciennes. De la préhistoire, science balbutiante au XVIIIe siècle, naît le vertige de « l’immémorial », écrit Rémi Labrusse, concurrent d’abord souterrain au primitivisme gréco-romain des années 1780-1820. Les vestiges préhistoriques s’accumulant, se diversifiant et se précisant, comme le montre excellemment l’exposition du Centre Pompidou, ils provoquent une réaction dès la fin du XIXe siècle, marquée par Darwin, le recul du catholicisme et ce nationalisme, souvent laïc, qui part en quête d’un socle plus ancien que les cathédrales. Ossements, outils et  armes, statuaire sexuée et violence rupestre donnent corps à cet « énigme moderne », pour le dire comme les commissaires. Elle a pris la forme des tableaux de Cormon, le maître de Lautrec et Van Gogh, avant de fusionner avec tout le primitivisme de l’art du XXe siècle. Au Centre Pompidou, Dubuffet, Giacometti, Picasso en sont les hérauts, parmi bien d’autres, superbement confrontés aux témoignages multiséculaires. L’affolement des sabliers nous précipite dans l’enfance, sans compter le clin d’œil final. Passons sur la double absence de certains Américains, tel Motherwell qui visita Lascaux, et du Masson des années 1950, que le retour d’exil a ramené dans l’orbe de Bataille, de Lacan, et dont la peinture fait alors cohabiter, entre Éros et fascination chtonienne, cavernes, sources vives, et sexe. SG / Préhistoire. Une énigme moderne, Cécile Debray, Rémi Labrusse et Maria Stavrinaki (dir.), Editions Centre Pompidou, 39,90€ / Rémi Labrusse, Préhistoire. L’envers du temps, Hazan, 39,95€
armes, statuaire sexuée et violence rupestre donnent corps à cet « énigme moderne », pour le dire comme les commissaires. Elle a pris la forme des tableaux de Cormon, le maître de Lautrec et Van Gogh, avant de fusionner avec tout le primitivisme de l’art du XXe siècle. Au Centre Pompidou, Dubuffet, Giacometti, Picasso en sont les hérauts, parmi bien d’autres, superbement confrontés aux témoignages multiséculaires. L’affolement des sabliers nous précipite dans l’enfance, sans compter le clin d’œil final. Passons sur la double absence de certains Américains, tel Motherwell qui visita Lascaux, et du Masson des années 1950, que le retour d’exil a ramené dans l’orbe de Bataille, de Lacan, et dont la peinture fait alors cohabiter, entre Éros et fascination chtonienne, cavernes, sources vives, et sexe. SG / Préhistoire. Une énigme moderne, Cécile Debray, Rémi Labrusse et Maria Stavrinaki (dir.), Editions Centre Pompidou, 39,90€ / Rémi Labrusse, Préhistoire. L’envers du temps, Hazan, 39,95€
 « Le Baedeker du romantisme » : c’est l’abbé Brémond, dans la Revue des deux mondes de janvier 1908, qui a le mieux fixé la teneur du meilleur livre de Barrès (André Breton ne s’y est pas trompé), Du sang, de la volupté et de la mort. Le culte du moi se calme et le patriotisme ne gonfle pas le torse au-delà du raisonnable. Ce « petit livre sensuel et mélancolique », petit par la taille, sonne Midi le juste. Nous sommes en 1894 et l’écrivain, du haut de ses 32 ans, s’offre une moisson de textes voyageurs parmi ses articles et nouvelles récentes. Il n’est bruit alors que de Barrès et de son emprise magnétique. « Prince de la jeunesse » (Paul Adam), il la pousse à « s’examiner avec franchise », écrit le mallarméen Camille Mauclair. Un peu refroidi par ses déboires politiques depuis le fiasco du général Boulanger, laissant à d’autres le soin de soutenir son antiparlementarisme, mais très éloigné des « frivoles de l’anarchie à la mode », Barrès repart, par l’imagination, en Italie et surtout dans sa « brûlante » Espagne, « le pays le plus effréné du monde ». C’était celle de Gautier et Baudelaire, qu’il ne cite pas. Michel Leymarie, brillant préfacier de cette réédition, n’ignore pas cette parenté, empreinte des étranges charmes de la Décadence fin de siècle. La préface de Gautier aux Fleurs du Mal et A rebours ont été le lait nourricier du premier Barrès. Sa visite sévillane aux Valdes Leal de l’Hospice de la Charité, où repose Don Juan, confirme une cordée. Du reste, pour revenir à l’abbé Brémond, Du sang, de la volupté et de mort traverse le romantisme lui-même : l’auteur se demande, excellente question, pourquoi il subit encore les agitations de cœur et d’âme des hommes de 1820-1830. C’est, dit-il, que Lamartine, Musset, Byron et Chateaubriand, loin de pleurnicher sur leur compte ou de trop s’aimer, loin donc de la vulgate maurrassienne, s’étaient fixés un tout autre « devoir », celui d’entraîner les lecteurs dans le bel univers de leur imagination. Quand on voyage, on marche toujours un peu, plus ou moins éveillé, dans son rêve. SG / Maurice Barrès, Du sang, de la volupté et de la mort, préface de Michel Leymarie, Omnia Poche / Bartillat, 12€.
« Le Baedeker du romantisme » : c’est l’abbé Brémond, dans la Revue des deux mondes de janvier 1908, qui a le mieux fixé la teneur du meilleur livre de Barrès (André Breton ne s’y est pas trompé), Du sang, de la volupté et de la mort. Le culte du moi se calme et le patriotisme ne gonfle pas le torse au-delà du raisonnable. Ce « petit livre sensuel et mélancolique », petit par la taille, sonne Midi le juste. Nous sommes en 1894 et l’écrivain, du haut de ses 32 ans, s’offre une moisson de textes voyageurs parmi ses articles et nouvelles récentes. Il n’est bruit alors que de Barrès et de son emprise magnétique. « Prince de la jeunesse » (Paul Adam), il la pousse à « s’examiner avec franchise », écrit le mallarméen Camille Mauclair. Un peu refroidi par ses déboires politiques depuis le fiasco du général Boulanger, laissant à d’autres le soin de soutenir son antiparlementarisme, mais très éloigné des « frivoles de l’anarchie à la mode », Barrès repart, par l’imagination, en Italie et surtout dans sa « brûlante » Espagne, « le pays le plus effréné du monde ». C’était celle de Gautier et Baudelaire, qu’il ne cite pas. Michel Leymarie, brillant préfacier de cette réédition, n’ignore pas cette parenté, empreinte des étranges charmes de la Décadence fin de siècle. La préface de Gautier aux Fleurs du Mal et A rebours ont été le lait nourricier du premier Barrès. Sa visite sévillane aux Valdes Leal de l’Hospice de la Charité, où repose Don Juan, confirme une cordée. Du reste, pour revenir à l’abbé Brémond, Du sang, de la volupté et de mort traverse le romantisme lui-même : l’auteur se demande, excellente question, pourquoi il subit encore les agitations de cœur et d’âme des hommes de 1820-1830. C’est, dit-il, que Lamartine, Musset, Byron et Chateaubriand, loin de pleurnicher sur leur compte ou de trop s’aimer, loin donc de la vulgate maurrassienne, s’étaient fixés un tout autre « devoir », celui d’entraîner les lecteurs dans le bel univers de leur imagination. Quand on voyage, on marche toujours un peu, plus ou moins éveillé, dans son rêve. SG / Maurice Barrès, Du sang, de la volupté et de la mort, préface de Michel Leymarie, Omnia Poche / Bartillat, 12€.
 Comme le rappelle Patrick Besnier, le meilleur connaisseur d’Henri de Régnier, la cité de Titien et de Tiepolo brillait d’une double lumière aux abords de 1900. En écho aux notes crépusculaires de certains de leurs prédécesseurs immédiats, D’Annunzio, Barrès et Thomas Mann célébraient l’agonie définitive de Venise, non sans raisons, mais de façon trop catégorique. Régnier, qui découvre la Sérénissime en 1899, à 35 ans, cherche d’emblée à se prémunir contre l’idée de la belle moribonde et l’horreur du tourisme de masse naissant. Quelques-unes de ses recettes viennent de l’Italia de Gautier, auxquelles Morand, sur le tard, continuait à se reporter. Partir au hasard, sans guide, ni itinéraire préétabli, en faisait partie. L’autre était de fuir les lieux saturés de la curiosité obligée. La Venise de Régnier a les couleurs de Pietro Longhi et de Casanova, qu’il adule à défaut de pouvoir croiser Vivaldi, toujours en attente de résurrection musicologique. L’Altana ou la vie vénitienne, superbe promenade dans le temps et l’espace de 1928, montre qu’il ne s’est pas précipité et qu’il s’est gardé d’ajouter, par besoin d’argent, un livre plein de molles et narcissiques rêveries sur le bonheur de « mourir là ». En disciple de Mallarmé, pour qui le vrai poète et le vrai peintre devaient savoir regarder et dire le réel, Henri arpente calli et canaux le crayon à la main, le plus loin possible des « barques chantantes » et des indiscrets visiteurs. Entre son premier séjour, à l’invitation de la comtesse de la Baume et d’Augustine Bulteau, qui venait de perdre son cher Jean de Tinan, et le dernier, en 1924, Régnier n’a cessé d’épouser « la vie vénitienne », la laissant descendre en lui, pour parler comme son cher Proust. Ce dernier aurait adoré la première phrase de L’Altana, petit bijou de provocation mouchetée : « S’il ne manque point d’un certain ridicule à écrire un livre sur Venise, le risque en est compensé par le plaisir qu’il y a à le courir. » SG / Henri de Régnier, L’Altana ou la vie vénitienne 1899-1924, édition établie, présentée et annotée par Patrick Besnier, Omnia Poche / Bartillat, 12€.
Comme le rappelle Patrick Besnier, le meilleur connaisseur d’Henri de Régnier, la cité de Titien et de Tiepolo brillait d’une double lumière aux abords de 1900. En écho aux notes crépusculaires de certains de leurs prédécesseurs immédiats, D’Annunzio, Barrès et Thomas Mann célébraient l’agonie définitive de Venise, non sans raisons, mais de façon trop catégorique. Régnier, qui découvre la Sérénissime en 1899, à 35 ans, cherche d’emblée à se prémunir contre l’idée de la belle moribonde et l’horreur du tourisme de masse naissant. Quelques-unes de ses recettes viennent de l’Italia de Gautier, auxquelles Morand, sur le tard, continuait à se reporter. Partir au hasard, sans guide, ni itinéraire préétabli, en faisait partie. L’autre était de fuir les lieux saturés de la curiosité obligée. La Venise de Régnier a les couleurs de Pietro Longhi et de Casanova, qu’il adule à défaut de pouvoir croiser Vivaldi, toujours en attente de résurrection musicologique. L’Altana ou la vie vénitienne, superbe promenade dans le temps et l’espace de 1928, montre qu’il ne s’est pas précipité et qu’il s’est gardé d’ajouter, par besoin d’argent, un livre plein de molles et narcissiques rêveries sur le bonheur de « mourir là ». En disciple de Mallarmé, pour qui le vrai poète et le vrai peintre devaient savoir regarder et dire le réel, Henri arpente calli et canaux le crayon à la main, le plus loin possible des « barques chantantes » et des indiscrets visiteurs. Entre son premier séjour, à l’invitation de la comtesse de la Baume et d’Augustine Bulteau, qui venait de perdre son cher Jean de Tinan, et le dernier, en 1924, Régnier n’a cessé d’épouser « la vie vénitienne », la laissant descendre en lui, pour parler comme son cher Proust. Ce dernier aurait adoré la première phrase de L’Altana, petit bijou de provocation mouchetée : « S’il ne manque point d’un certain ridicule à écrire un livre sur Venise, le risque en est compensé par le plaisir qu’il y a à le courir. » SG / Henri de Régnier, L’Altana ou la vie vénitienne 1899-1924, édition établie, présentée et annotée par Patrick Besnier, Omnia Poche / Bartillat, 12€.
 « Je m’attache très facilement », aimait à dire Romain Gary (1914-1980). L’inverse n’est pas moins vrai, puisque ce bel enfant, né parmi les Juifs de Lituanie, et donc promis à l’exil, a roulé sa bosse sous toutes les latitudes et qu’il se suicida, un 2 décembre, de la manière la plus virile. Les jeunes d’aujourd’hui le dévorent, continuent à voir en lui un frère d’armes, il leur semble que Romain Gary, l’aventurier de la France libre, l’amant de Jean Seberg et le trublion du landernau littéraire, a ouvert la voie à plus d’une des causes où ils tentent désespérément de se construire en se donnant un avenir. Mais l’idolâtrie se paie aussi d’un peu d’amnésie. Son image de résistant de la première heure, d’écolo précoce, de pourfendeur de l’Amérique de Nixon, avait donc besoin d’être corrigée. Utile, à maints égards, s’avère donc la lecture de l’album de la Pléiade. Très illustré, il pointe, à son insu, le narcissisme du personnage, son ego à double tranchant. Sans doute destructeur pour l’entourage, il l’aveugle un peu sur ses vrais qualités d’écrivain ou de cinéaste. Rappelons-nous La Promesse de l’aube (1960) et la prédiction de la « maman », jouissant par avance d’un nouveau D’Annunzio. Mais, grâce à Dieu, il y avait aussi de l’autodérision en Romain Gary, et le courage de penser à contre-courant. Bien dans sa judéité et sa francité, il regarde d’un mauvais œil, depuis l’Amérique des années 1960, se mettre en place l’idéologie de l’anti-racisme. On sait ce que vaudront à Jean Seberg ses liens avec les Black Panthers. La morale diversitaire, Gary le pressent, dissimule sous ses bons sentiments et sa morale réparatrice un autre visage. Celui-ci aura mis un demi-siècle à se dévoiler entièrement. Pour avoir dénoncé le Vietnam, les ghettos noirs et pris « la défense des éléphants » (perle de Kléber Haedens, qui détesta Les Racines du ciel), Romain Gary est à relire avec finesse. SG / Maxime Decout, Album Romain Gary, Gallimard, publié à l’occasion de la Quinzaine de la Pléiade 2019.
« Je m’attache très facilement », aimait à dire Romain Gary (1914-1980). L’inverse n’est pas moins vrai, puisque ce bel enfant, né parmi les Juifs de Lituanie, et donc promis à l’exil, a roulé sa bosse sous toutes les latitudes et qu’il se suicida, un 2 décembre, de la manière la plus virile. Les jeunes d’aujourd’hui le dévorent, continuent à voir en lui un frère d’armes, il leur semble que Romain Gary, l’aventurier de la France libre, l’amant de Jean Seberg et le trublion du landernau littéraire, a ouvert la voie à plus d’une des causes où ils tentent désespérément de se construire en se donnant un avenir. Mais l’idolâtrie se paie aussi d’un peu d’amnésie. Son image de résistant de la première heure, d’écolo précoce, de pourfendeur de l’Amérique de Nixon, avait donc besoin d’être corrigée. Utile, à maints égards, s’avère donc la lecture de l’album de la Pléiade. Très illustré, il pointe, à son insu, le narcissisme du personnage, son ego à double tranchant. Sans doute destructeur pour l’entourage, il l’aveugle un peu sur ses vrais qualités d’écrivain ou de cinéaste. Rappelons-nous La Promesse de l’aube (1960) et la prédiction de la « maman », jouissant par avance d’un nouveau D’Annunzio. Mais, grâce à Dieu, il y avait aussi de l’autodérision en Romain Gary, et le courage de penser à contre-courant. Bien dans sa judéité et sa francité, il regarde d’un mauvais œil, depuis l’Amérique des années 1960, se mettre en place l’idéologie de l’anti-racisme. On sait ce que vaudront à Jean Seberg ses liens avec les Black Panthers. La morale diversitaire, Gary le pressent, dissimule sous ses bons sentiments et sa morale réparatrice un autre visage. Celui-ci aura mis un demi-siècle à se dévoiler entièrement. Pour avoir dénoncé le Vietnam, les ghettos noirs et pris « la défense des éléphants » (perle de Kléber Haedens, qui détesta Les Racines du ciel), Romain Gary est à relire avec finesse. SG / Maxime Decout, Album Romain Gary, Gallimard, publié à l’occasion de la Quinzaine de la Pléiade 2019.
 Les poètes de notre temps seraient-ils les derniers à lever les yeux au ciel, ou à ne pas téléphoner devant les tableaux ? Du bleu, Daniel Kay connaît et avoue la force magnétique, il s’y livre, que la couleur céleste de Fra Angelico se déploie, au-dessus de nos têtes ou à la surface de la toile. Sa poésie, toute de concision, aime la note concrète, le contact de la vie, l’élévation aussi, elle n’est pas descriptive, ni prescriptive, pour autant. Le Cygne de Baudelaire, citée de faon oblique, signale sans doute un domaine de prédilection commun, le verbe concentré que partage également les peintres entre lesquelles se promènent ses Vies silencieuses. Giotto, Baugin, Poussin, Rembrandt, Chardin… Peu d’inflation baroque. Il faut faire parler, à la bonne hauteur, le spectacle des choses ou des êtres qui ne se savent pas appelés à témoigner de leur grandeur ignorée. Humilité et noblesse cessent d’être contraires au royaume des vrais témoins. Exemple, la Mort de la Vierge d’un certain Caravaggio : « Le carnet de commandes stipulait / en gros caractères l’exécution d’une dormition, / Transitus Beata Mariae Virginis, / et non pas une Vierge en grande tenue d’Ophélie. / Or, à l’affût des flashes, la robe ravivait dans le noir / le sang interminable et ébloui des noyés. » Daniel Kay pensait-il à Manet lorsque le Voile de Véronique lui est apparue dans la muleta du torero ? Je serai prêt à le parier. SG / Daniel Kay, Vies silencieuses, Gallimard, 14,50€.
Les poètes de notre temps seraient-ils les derniers à lever les yeux au ciel, ou à ne pas téléphoner devant les tableaux ? Du bleu, Daniel Kay connaît et avoue la force magnétique, il s’y livre, que la couleur céleste de Fra Angelico se déploie, au-dessus de nos têtes ou à la surface de la toile. Sa poésie, toute de concision, aime la note concrète, le contact de la vie, l’élévation aussi, elle n’est pas descriptive, ni prescriptive, pour autant. Le Cygne de Baudelaire, citée de faon oblique, signale sans doute un domaine de prédilection commun, le verbe concentré que partage également les peintres entre lesquelles se promènent ses Vies silencieuses. Giotto, Baugin, Poussin, Rembrandt, Chardin… Peu d’inflation baroque. Il faut faire parler, à la bonne hauteur, le spectacle des choses ou des êtres qui ne se savent pas appelés à témoigner de leur grandeur ignorée. Humilité et noblesse cessent d’être contraires au royaume des vrais témoins. Exemple, la Mort de la Vierge d’un certain Caravaggio : « Le carnet de commandes stipulait / en gros caractères l’exécution d’une dormition, / Transitus Beata Mariae Virginis, / et non pas une Vierge en grande tenue d’Ophélie. / Or, à l’affût des flashes, la robe ravivait dans le noir / le sang interminable et ébloui des noyés. » Daniel Kay pensait-il à Manet lorsque le Voile de Véronique lui est apparue dans la muleta du torero ? Je serai prêt à le parier. SG / Daniel Kay, Vies silencieuses, Gallimard, 14,50€.
Nota bene : Ce post est le dernier à être publié sur lemonde.fr !