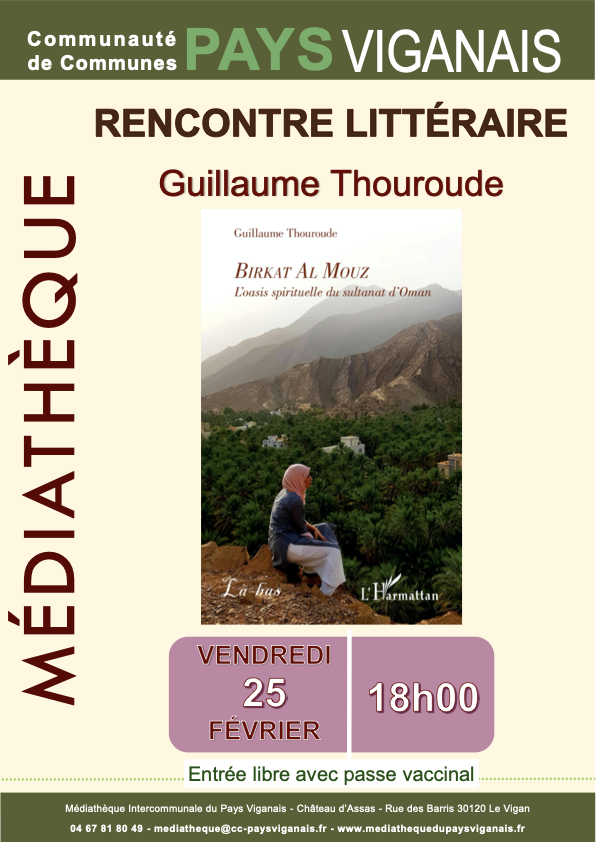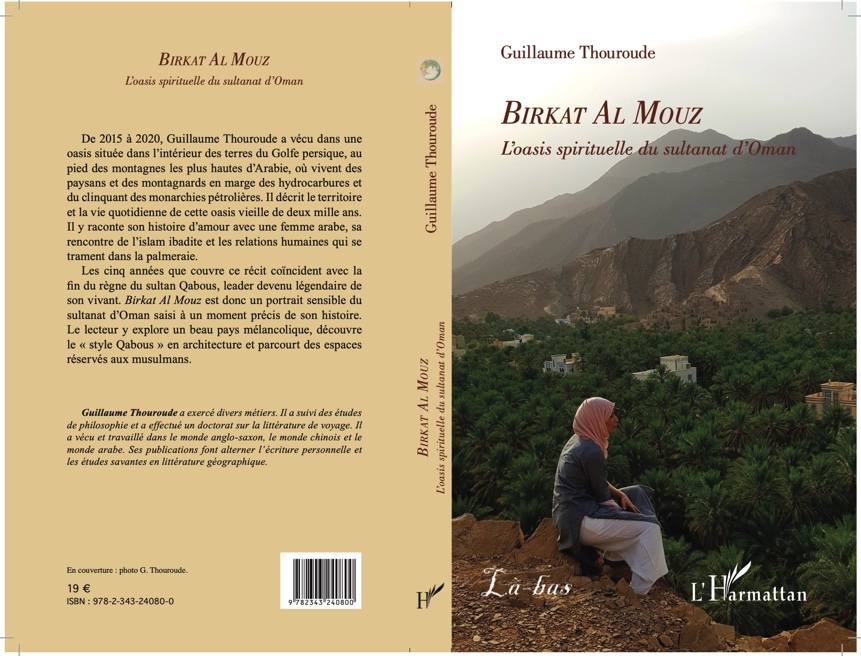Avant l’âge de quarante ans, je ne crois pas avoir suscité de jalousie. Avant de travailler dans une université du sultanat d’Oman, je ne me suis jamais plaint de l’envie des autres. Or, ce qui s’est passé dans ma vie, entre 2015 et 2020, fut tout à fait exceptionnel à cet égard et probablement unique dans une vie de sage précaire.
La jalousie a grandi par degrés et fut de plus en plus destructrice. Mais elle atteignit un pic fin 2017 et se stabilisa sur un plateau jusqu’à mon éviction finale de l’université. Pour comprendre l’évolution de la jalousie, je suis obligé de me remémorer les principales étapes de mon parcours en Oman. Je dois préciser que la conscience de la jalousie des autres ne m’apparut que bien trop tard, à partir de son pic de fin 2017, parce que plusieurs personnes me le disaient avec insistance.
Je dois préciser aussi une chose importante : la plupart des réalisations que je relate n’avaient jamais eu lieu dans la section de français, ni même dans l’histoire des études des langues étrangères. Par exemple, quand je dis que j’ai été invité pour être « keynote speaker » dans une université européenne, il faut comprendre que personne n’avait jamais reçu une marque de reconnaissance équivalente depuis la création du département des langues étrangères. C’était nouveau et presque scandaleux dans ce contexte.
- À mon arrivée, on enviait peut-être le fait que je sois docteur dans un département qui en comptait peu, chercheur actif dans un groupe qui publiait peu de livres et d’articles, tout en étant aussi populaire que les autres avec les étudiants.
- L’Institut français de Mascate m’invita fin 2015 à donner une conférence sur la littérature, ce qui me distingua. Aucun collègue ne fit le déplacement, excepté ma supérieure directe, la chef de section.
- Avec le professeur de lettres du Lycée français de Mascate, nous lançons une action pédagogique avec croisement de classes sur des textes littéraires, et échanges entre étudiants omanais et élèves français. Partenariat bien vu par la hiérarchie des deux établissements.
- Alors que mes collègues affirmaient que la recherche était impossible dans cette université, que d’autres avaient essayé en vain, j’ai quand même organisé un petit colloque avec des participants de plusieurs pays. Je surmontais les difficultés administratives, la hiérarchie ne me mettaient pas de bâtons dans les roues. Je reçus même une subvention de plus de mille euros pour cet événement. Je suis dans le deuxième semestre de ma première année : nous organisons la première session de ce colloque qui est un gentil succès.
- La hiérarchie de la faculté me nomme président de la commission de la recherche au sein du département des langues étrangères.
- Sur ces entrefaites, une jeune femme tunisienne arrive dans notre département, tellement ravissante que tout le monde lui fait la cour, moi aussi. Elle passe du temps avec moi. Parfois elle me demande ce que je pense d’un tel ou d’un tel. Elle me confie que mes collègues disent du mal de moi. Ils lui disent que je ne suis pas un vrai chercheur, que mes publications sont pourries et que le livre que je promets ne paraîtra jamais car je ne suis qu’un beau parleur.
- La ravissante Tunisienne et moi-même profitons des vacances d’été 2016 pour nous marier et nous revenons à l’université en septembre avec ce nouveau statut marital. Rage de tous ceux qui draguaient ma belle, et malaise parmi celles qui, peut-être, voyaient en moi un célibataire envisageable.
- Novembre 2016 : j’organise sur le campus la deuxième session de mon colloque avec la présence d’un grand professeur venu d’Angleterre, qui attire à nous l’attention des huiles de la faculté. Succès sur toute la ligne. La jalousie commence à se faire sentir et se traduit par des vexations diverses, des pressions inutiles et des remarques acerbes.
- Le partenariat avec le Lycée français se passe très bien, mais des tensions s’accroissent à mon endroit sans que je comprenne ce qui se passe.
- Court voyage à Paris. Je suis invité à un colloque à la Sorbonne sur l’oeuvre de Jean Rolin.
- Début 2017. Je fais paraître un article de recherche sur Fabula.
- C’en est trop, mes collègues se liguent contre moi pour me faire chuter alors que je suis au même niveau qu’eux. Les provocations s’enchaînent sans que je prenne conscience de cela et, plutôt que de faire profil bas, je réponds aux provocations, ce qui déclenche une procédure de plainte contre moi. Je me défends, cherche de l’aide dans la hiérarchie et remporte la partie. La DRH m’assure du soutien total de la haute administration. Ce soutien est évidemment à double tranchant : certains voudront se venger.
- Fin de l’année universitaire. On cherche à m’humilier en distribuant les emplois du temps de manière injuste, sans que je sois consulté, alors que tous les collègues sont consultés et obtiennent satisfaction. On me met dans une sorte de placard. Heureusement, mon épouse reste mon plus grand soutien dans l’épreuve et nous montrons elle et moi une image de couple uni, ce qui agace.
- La rentrée suivante se passe tranquillement, les vacances ont calmé tout le monde. Ce ne sera que de courte durée. Octobre 2017 : mon épouse organise une fête surprise pour la parution de mon livre aux éditions de La Sorbonne. C’est là que j’ai vu la jalousie sur le visage de mes collègues pour la première fois.
- Le Chancelier me nomme Vice-Doyen de la faculté, en charge de la recherche et des études supérieures. La jalousie est alors devenue incandescente. Tout ce que je touche prend feu. Aux yeux de certains, je suis un adversaire, voire un ennemi. Je suis trop accaparé par mes nouvelles responsabilités pour m’en rendre compte.
- Fin 2017, je me retrouve donc catapulté assez haut dans l’organigramme, au-dessus de tous ceux qui me voulaient du mal. La jalousie prend alors d’autres formes. Dorénavant, je serai superbement ignoré, snobé. Quand je prends la parole en public, certains quitteront la salle ostensiblement. D’autres feront tout pour éviter les procédures administratives prises en charge par le bureau que je dirige, mettant à mal leurs propres projets. Naturellement, je serai tenu pour responsable de leurs éventuels échecs.
- 2018 : Je reçois des coups de toute part mais ceux-ci ne sont pas tous dus à la jalousie. Certains veulent ma place. Procès en illégitimité. On m’accuse d’être « un espion ». Des complots se forment contre moi, mais cela dépasse de beaucoup les cercles restreints où j’évoluais depuis août 2015. Plus je réussis dans mon action, plus on cherche à me nuire. Mais est-ce une expression de la jalousie ? Je ne sais pas.
- Mars 2018, je suis invité en tant qu’écrivain et chercheur à une « Rencontre littéraire francophone » organisé par le Lycée français, en partenariat avec l’ambassade, l’AEFE, l’Institut français et des mécènes privés. C’est dans le cadre d’une action culturelle assez large. Présence de l’ambassadeur himself et des huiles de la francophonie en Oman. Trois visages ornent l’affiche, dont le mien. J’invite tous mes collègues français et francophones, car ce sera l’occasion pour eux de rencontrer le nouvel ambassadeur et d’autres personnes. Personne ne se déplacera, à part ma femme et quelques étudiants.
- Mes étudiants écrivent et mettent en scène une pièce de théâtre en français. C’est une première dans l’histoire de l’université mais cela n’attire aucun commentaire de la part des enseignants. Les représentations en revanche sont louées par la hiérarchie et jusqu’à la diplomatie française ainsi que les acteurs de la francophonie du pays.
- Invitations en cascade à venir donner des conférences, suite à la parution de mon livre qui connaît une belle carrière : Doha (Qatar), Paris (France), Ratisbonne (Allemagne), Jaen (Espagne). Je m’arrange pour ne pas rater de cours et pour n’en annuler aucun, mais j’entends dire que mes voyages sont des privilèges.
- 2019 connaît son lot de bonnes nouvelles qui creusent ma tombe : publication d’un collectif que j’avais dirigé sur l’œuvre de Jean Rolin. Voyage tous frais payés en Australie pour un colloque.
- Invitation officielle pour être « Keynote speaker » dans une grande université britannique, dans le cadre d’un colloque. En français, on peut traduire cela par « orateur principal », mais c’est moins institutionnalisé que dans le monde anglo-saxon, où le fait d’être keynote speaker est une vraie marque de reconnaissance dans une carrière.
- J’essaie de mettre sur pied un colloque à Nizwa pour faire briller la faculté. On me bloque de toute part. Je dois abandonner après des mois de préparation. Victoire des envieux qui ont réussi à tirer la faculté vers le bas et faire régner l’inertie.
- Je postule pour une promotion universitaire. Mon dossier est recevable car il est reconnu comme complet. Ma promotion est rejetée au motif que la publication de livres ne compte pas pour la promotion. Le rejet de ma candidature est confirmé en appel. Jubilation des envieux qui voient là la preuve du mauvais niveau de mes recherches.
- Tout ce que je propose pour améliorer le niveau de français de nos étudiants est rejeté systématiquement, mais remplacé par aucune autre proposition alternative. Nous voyons couler le niveau de nos étudiants sans réaction. Ils échouent aux tests de langue de type DELF et nous restons sans réponse. Dans ce contexte, se distinguer est perçu comme arrogant.
- Quand je suis nommé chef de la section de français, certains refusent même de participer aux réunions d’équipe et l’hostilité devient palpable, hargneuse. En revanche, il n’y a pas de conflit ni de plaintes. Il s’agit d’une attitude « passive agressive » qui a pour but de me faire échouer, comme ces joueurs de football qui font exprès de perdre des matchs pour se débarrasser de leur entraîneur. Je fais preuve de patience avec mes collègues et ne leur fais aucun reproche. Je me débrouille. Je trouve d’autres appuis et travaille avec les étudiants. La réussite de certaines actions avec les étudiants me valent alors une mise à mort à base de mensonges, de calomnies et de harcèlement.
Mes jours étaient comptés à partir de l’été 2020 puisque le doyen quittait la direction de la faculté. Il me convoqua pour m’annoncer qu’il jetait l’éponge et qu’il se recentrait sur d’autres activités moins énergivores et plus gratifiantes. Je ne saurai jamais les vraies raisons derrière sa décision de partir. Il me confia alors que le nouveau doyen changerait son équipe et choisirait d’autres vice-doyens. C’est un peu comme un remaniement ministériel.
Mes responsabilités au sein de la direction de la faculté m’occupaient trop l’esprit pour que je prête attention aux phénomènes d’envie et de commérage. Dès que je fus démis de mes fonctions de vice-doyen, ce fut un déchainement contre moi. Les gens pouvaient enfin me piétiner en toute tranquillité. J’étais lâché, apparemment, par la hiérarchie. J’avais perdu mon Mojo. Le nouveau doyen avait entendu parler de moi en bien et en mal, il me harcela en toute quiétude.
Ce n’est pas à cause de la jalousie que j’ai perdu mon emploi. Je raconterai mon exclusion une autre fois car c’est une affaire sans lien avec mon action, et sans lien avec les relations interpersonnelles. S’il n’y avait pas eu cet événement extérieur qui a causé le limogeage de plusieurs personnes, je n’aurais pas perdu mon emploi. En revanche, la jalousie a accompagné mes jours pendant cinq ans en Oman et je n’ai pas su m’en extirper. Elle n’existait pas avant et elle a disparu après.