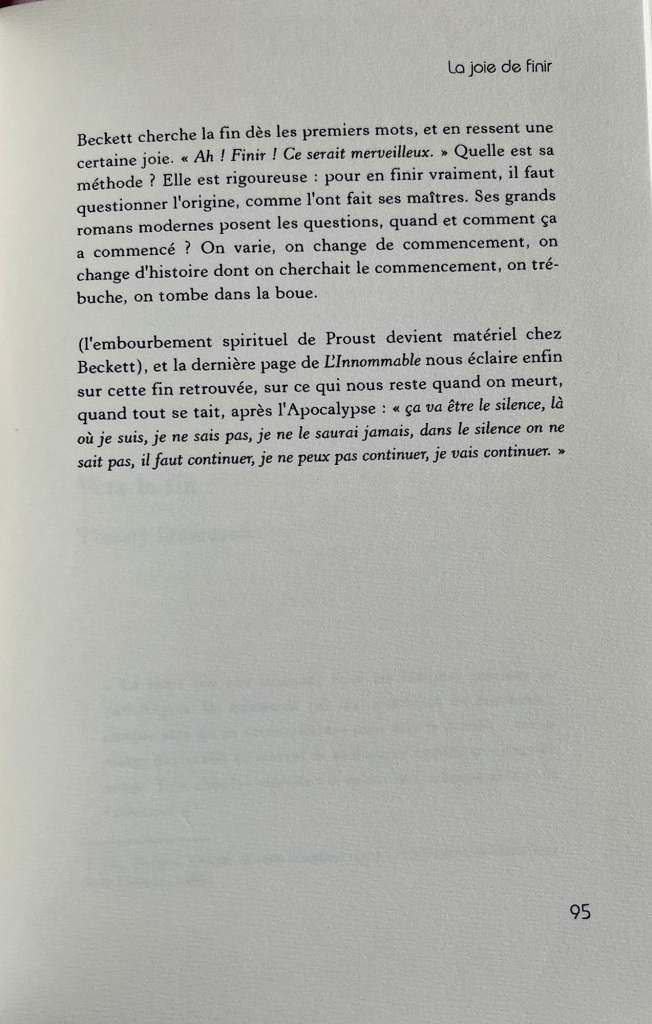Ma moitié a enfin acheté une bicyclette, alléluia. Notre appartement est à dix minutes de son campus, je trouvais un peu dommage de la conduire chaque jour en voiture au travail, quand il y avait la possibilité d’éviter le trafic. Le trajet à vélo est tellement agréable, pourquoi se priver d’une jouissance à portée de mollet ? Dimanche, j’ai pris sa bécane et suis allé en repérage tout seul et le bonheur que j’ai eu de voler au-dessus de la route était intact, inchangé depuis l’âge immémorial où mon frère Antoine m’avait appris à en faire.
À mon retour Hajer a enfourché son vélo pour faire le chemin à son tour et je l’accompagnais en courant à travers le parc qui jouxte la voie ferrée où nous habitons. Je faisais du sport car pendant le ramadan il est important de ne pas perdre du muscle, le jeûne pourrait nous inciter à éviter l’exercice.
J’ai couru jusqu’à une borne de vélos de location, j’en ai loué un et j’ai roulé avec Hajer. La joie complexe que me donne ce moyen de transport m’a rappelé l’existence d’un très beau livre collectif sur les voyages cyclopédiques, dont je rassemblais quelques idées en roulant.
Je me disais : mais il faut absolument que je parle de ce livre sur mon blog, que ne l’ai-je déjà fait ?
Encore des textes de recherche en littérature de voyage qui valent la peine d’être lus : le numéro 4 de la collection Voyages contemporains, consacré aux récits d’aventures à bicyclettes. Sous la direction de Raphaël Piguet, ce collectif est un excellent moyen de prendre conscience de la spécificité du voyage à vélo, du génie propre de la vélocipédie, quand cette dernière s’incarne dans un récit.
Mais le domaine proprement viatico-littéraire des récits de voyage à vélo demeure pratiquement inexploré. (…) On subodore par conséquent que l’engin, indigne du voyage, l’est tout autant de la littérature. On en revient à la question lancinante du complexe d’infériorité de la bécane.
Raphaël Piguet, Voyages cyclistes, introduction, p. 15.
D’un complexe d’infériorité, on ne se sort jamais tout à fait. Il n’est pas faux que le cyclotourisme sera toujours marqué par une impossible reconnaissance face aux deux extrêmes indépassables : la marche à pied et la motorisation. On ne peut pas aller plus lentement qu’à pied, ni plus vite qu’en avion (ou en fusée). Entre les deux, le vélo ne peut qu’être lesté d’un statut hybride.
Raphaël Piguet réfute cette infériorité et discute intelligemment de ce que Claude Reichler appelle l’ « avantage ontologique » de la marche à pied. Pour lui le vélo est encore plus avantagé ontologiquement « en ce sens qu’il présente un taux optimum de distance parcourue par rapport à l’énergie dépensée » (p. 18).
L’opposition du vélo avec la marche court sur l’ensemble du livre. Liouba Bischoff se moque gentiment de tous les marcheurs qui romantisent leurs randonnées en élevant la lenteur au rang de supériorité morale. Dans son article intitulé « La vitesse réhabilitée par Emmanuel Ruben et Jean-Acier Danès », Bischoff valorise la vitesse qu’apporte le vélo en proposant de sortir des alternatives binaires de type vrai/faux voyage, authentique/inauthentique, etc.
Le caractère machinique de la bicyclette est ce qui me paraît le plus intéressant dans cette affaire. Elle se situe à égale distance de la marche qui permet d’aller partout (mais lentement), et de la moto qui permet d’aller vite (mais sur des lignes prédéterminées). Un détracteur pourrait dire que le vélo combine les deux lacunes : aller plus lentement que les autres véhicules, et en plus sans liberté car cantonné (commes les autres véhicules) sur des routes goudronnées.
Or, selon moi, la beauté du voyage à vélo vient justement de sa modestie, de son caractère hybride et suranné. Il ne peut se mesurer à aucun champion de la liberté de mouvement, ni à aucun frimeur de la route interminable. C’est son entre-deux qui m’émeut, ainsi que son côté homme-machine. Le cycliste n’est ni flâneur ni rugissant, il met son corps en adéquation d’une machinerie peu complexe et géniale, réparable à l’infini. Il se rend esclave d’une machine qui le rend heureux, tellement heureux qu’il n’a même pas besoin de regarder le paysage. Le voyageur cycliste ne fait que peu de pauses, à la différence du marcheur, et ne se prélasse pas non plus dans la contemplation des pays qui defilent, comme le fait le passager du train. C’est lui qui me plaît le plus, ce voyageur sans organe qui fait corps avec sa machine et qui n’a plus besoin de contempler. Dans une perspective deleuzienne, je dirais que le vélo évacue l’extériorité du voyage, et grâce à cela, grâce à la machine qui dicte sa loi à l’organisme, le vélo se débarrasse de ses vieilles illusions que sont la contemplation bourgeoise, le point de vue dominateur et la saisie impériale du paysage.
Contre la posture romantique du marcheur qui se met à l’écoute des rythmes de la création, nos deux écrivains cyclistes ne se posent pas en récepteurs passifs d’un discours qui seraient inscrits dans les choses
Liouba Bischoff, « La vitesse réhabilitée », p. 226.
Je ne suis pas objectif dans mon appréciation car je suis le président du fan club de Liouba Bischoff. Tout ce qu’écrit cette trentenaire, prof à l’ENS de Lyon, m’enchante.
Il ne faut pas oublier les autres contributions de ce volume, toutes très intéressantes : Philipe Antoine, Gilles Louÿs et les autres. J’en ferai un autre billet de blog pour ne pas être trop long aujourd’hui.