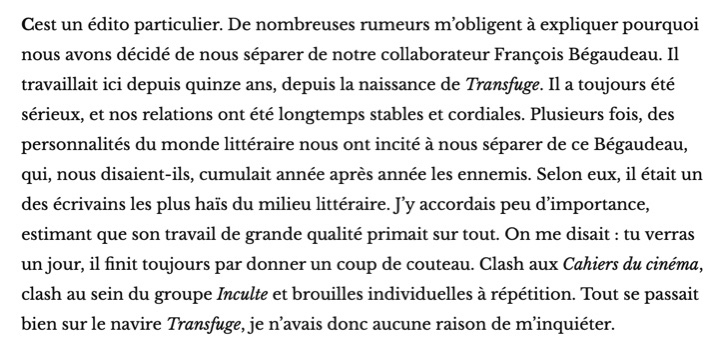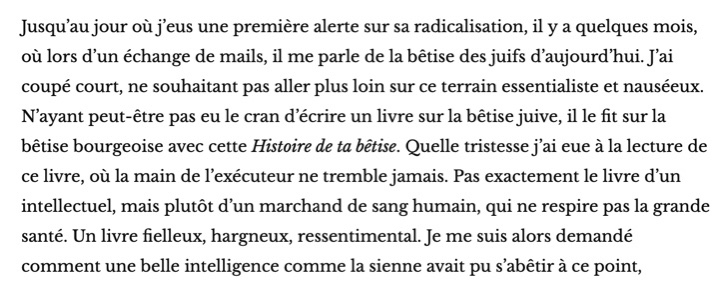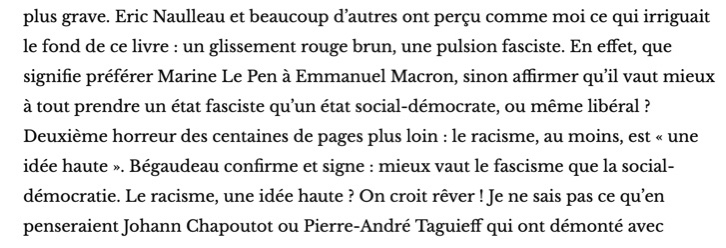Ce livre de la fondatrice des Indigènes de la république, publié en 2016, est très court, assez dense, et stimulant pour l’esprit. Dès son chapitre introductif, « Fusillez Sartre », elle relance la réflexion sartrienne sur la colonisation pour la titiller de l’intérieur.
Les Blancs, les Juifs et nous (La Fabrique éditons, 2016) est un bon essai car il a été longuement réfléchi et a été écrit avec soin. En tant que lecteur, je me sens respecté. En tant que Blanc, je ne me sens pas insulté. En tant que Français non plus.
À la différence des intellectuels de plateaux télé qui pondent cinq livres par an, probablement aidés par l’IA ou des auteurs sous-traitants, Houria Bouteldja publie un livre tous les dix ans. Elle assume la radicalité la plus grande et écrit en sachant qu’elle ne sera ni publiée, ni diffusée, ni lue, ni aimée. Elle est donc légère comme le mistral et peut laisser libre cours à cette voix qui la travaille. Elle s’est dit : je vais écrire un seul livre, et si je meurs, des gens liront ceci seulement, c’est mon testament, voici ce que j’ai à dire après 40 ans de réflexions, de militantisme et de travail. Qui suis-je ? Une femme arabe française musulmane… Je vais écrire ce qu’a à dire une musulmane française aujourd’hui.
Elle va droit au but et s’adresse aux forces en présence : les Blancs. Sans peur, elle désigne une opposition « nous/vous » et va construire ses chapitres sur cette dichotomie.
1. Vous les Blancs
2. Vous les Juifs
3. Nous les femmes indigènes
4. Nous les indigènes
Voilà, une fois qu’on aura bien explicité qui « nous » sommes et qui « vous » êtes, on y verra plus clair et le livre sera fait. Les bases seront posées pour établir les conditions d’un rapprochement entre nous tous, voire d’une nouvelle forme d’amour.
Sous-titre du livre : Vers une politique de l’amour révolutionnaire.
On est bien loin des accusations de racisme et d’antisémitisme, mais cela, je suggère de le laisser aux parasites des plateaux télé.
Pour parler des Blancs, elle commence avec le cogito cartésien et se demande qui est ce « je » qui pense et qui, de ce fait, est. Les premières pages ne sont pas originales et la deconstruction de Descates ne m’a jamais paru stimulante.
Ce « je » est conquérant. Il est armé. Il a d’un côté la puissance de feu, de l’autre la Bible. C’est un prédateur. Ses victoires l’enivrent. « Nous devons nous rendre maîtres et possesseurs de la nature », poursuit Descartes.
Les Blancs, p. 29.
C’est faux. Descartes n’a jamais dit cela, le prof de philo en moi se révolte et voudrait faire un petit cours. Descartes a exactement écrit ceci et il a voulu dire cela, rien à voir avec le contexte colonial du XVIIe siècle. Or, ce qui compte quand on lit Houria Bouteldja n’est pas ce qu’a voulu dire Descartes mais ce que veut dire Houria Bouteldja. Alors écoutons. Lisons.
Parler des Blancs est difficile en France, car la culture républicaine a décidé d’invisibiliser ce que tout le monde voit. Non pas la couleur de peau, mais la concomitance entre des couleurs et des statuts sociaux. Des phénomènes de privilèges que notre idéologie ne reconnaît pas en installant un paravent appelé « universalisme ». François Bégaudeau explique à sa manière comment les jeunes professeurs blancs étaient missionnés pour aller civiliser les classes populaires dans les quartiers défavorisés:
Pour peu qu’on les aide à atteindre un niveau de vie décent, les Arabes deviendront des Blancs comme les autres. Dans une société parfaite, ils seraient cultivés, politisés, bons élèves, buveurs de Ricard. Ils seraient nous. Ils seraient universels et l’universel c’est nous.
F. Bégaudeau, Deux singes, 2011, p. 224-225.
Bégaudeau non plus ne recule pas devant la notion de blanchité :
Dans cent ans il n’y aura plus de Blancs sur la planète. Découvrant cette drôle de race dans des films, les humains d’alors écarquilleront les yeux comme mes élèves quand je leur ai fait écouter un florilège de morceaux de rock.
F. Bégaudeau, Deux singes, 231.
Pour l’instant, les Blancs existent toujours et ils gouvernent le monde. Houria Bouteldja parle des Blancs avec un mélange de colère et de tendresse. Elle explique par exemple que la grande puissance des vainqueurs est de se rendre plus blancs que blanc, innocent :
Je vous vois, je vous fréquente, je vous observe. Vous portez tous ce visage de l’innocence. C’est là votre victoire ultime. Avoir réussi à vous innocenter.
Les blancs, p.30
Un livre écrit par fulgurances.
Passages propres à l’essai, le genre littéraire inventé par Michel de Montaigne, au XVIe siècle. Rien n’est plus beau que l’essai. L’auteur tente quelque chose, il bricole, construit un texte avec des bouts d’argumentation, des lambeaux de souvenirs, des sensations, des citations.
Comment comprendre par exemple la déclaration d’un président iranien sur l’absence d’homosexualité en Iran ? Il y aurait deux manières. La première est celle de la belle âme qui donne des leçons d’occidentalisme aux lecteurs français en parlant des femmes perses, comme M. Désérable l’a fait avec profit. La deuxième est de prendre cette phrase absurde comme une performance quasi artistique, un geste d’outrance absurde qui met en crise le régime d’innocence des Blancs :
Elles font mal aux tympans ces paroles. Mais elles sont foudroyantes et d’une mauvaise foi exquise. Pour les apprécier il faut être un peu lanceur de chaussures. Une émotion de minables, il faut avouer.
Les Blancs, p. 33
Si Bouteldja est meilleure écrivaine que Désérable, c’est que le jeune homme n’est en recherche que d’émotions respectables, centristes, adoubées par la vieille presse laïque. On ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments de vieux centristes (je dis ça, je fais mon essayiste à la Bouteldja).
Le chapitre sur les juifs est bien entendu inflammable. Elle sait que le sujet sent le soufre alors elle y va, parce qu’elle ne va pas rester toute sa vie muette devant les intimidations qui s’érigent en obligations de se taire. Elle fait l’hypothèse que « les juifs » sont utilisés par « les blancs » pour accomplir plusieurs tâches en Europe et en Orient. Ils forment une communauté tampon entre les seigneurs (blancs) et les parias (africains), et ils sont le bras armé des maîtres pour imposer l’empire en Orient. Bouteldja est impressionnée par le génie du mal des Blancs qui, non contents d’asservir, réussissent à faire d’une communauté colonisée le bourreau d’une autre, avec les armes mêmes de leur idéal colonialiste :
Ils sont forts n’est-ce pas ? Je le concède volontiers, j’admire nos oppresseurs. (…) Ils ont réussi à vous faire troquer votre religion, votre histoire et vos mémoires contre une idéologie coloniale.
Les Juifs, p. 53
L’admiration pour le génie du mal est un classique de l’art du pamphlet.
Et la place du massacre des juifs ? Cet événement historique, selon l’écrivaine, a été transformé par les Blancs, sous la pression de leur culpabilité, en un temple sacré où ils puisent leur sentiment de dignité, et à l’aune duquel ils jugent celle des autres. Ils ont commis le crime antijuif ultime, par quoi ils retirent de la mémoire qu’ils en cultivent une supériorité morale sur les autres, en conséquence de quoi ils accusent les musulmans d’être antisémites, afin d’armer les juifs désireux de brutaliser les arabes. Tour de passe-passe génial.
Lorsqu’ils s’en prennent à la mémoire du génocide, ils touchent à quelque chose de bien plus sensible que la mémoire des Juifs. Ils s’en prennent au temple du sacré : la bonne conscience blanche. Le lieu à partir duquel l’Occident confisque l’éthique humaine et en fait son monopole (…) Le foyer de la dignité blanche. Le bunker de l’humanisme abstrait. L’étalon à partir duquel se mesure le niveau de civisation des subalternes.
Les Juifs, p. 67.
J’adore l’expression « bunker de l’humanisme abstrait », qui naturellement renvoie au Descartes volontairement mal compris du début de l’essai.
Le contresens du début (sur le « je » du Discours de la méthode) n’était pas une lecture défectueuse de la philosophie classique, mais une machine de guerre microscopique, moléculaire, employée pour ébranler la grande statue de marbre blanc qu’est la métaphysique : superstructure que les dominants hissent comme idéal universel, dans le but de rendre leur position hégémonique aussi naturel que l’ordre des saisons.