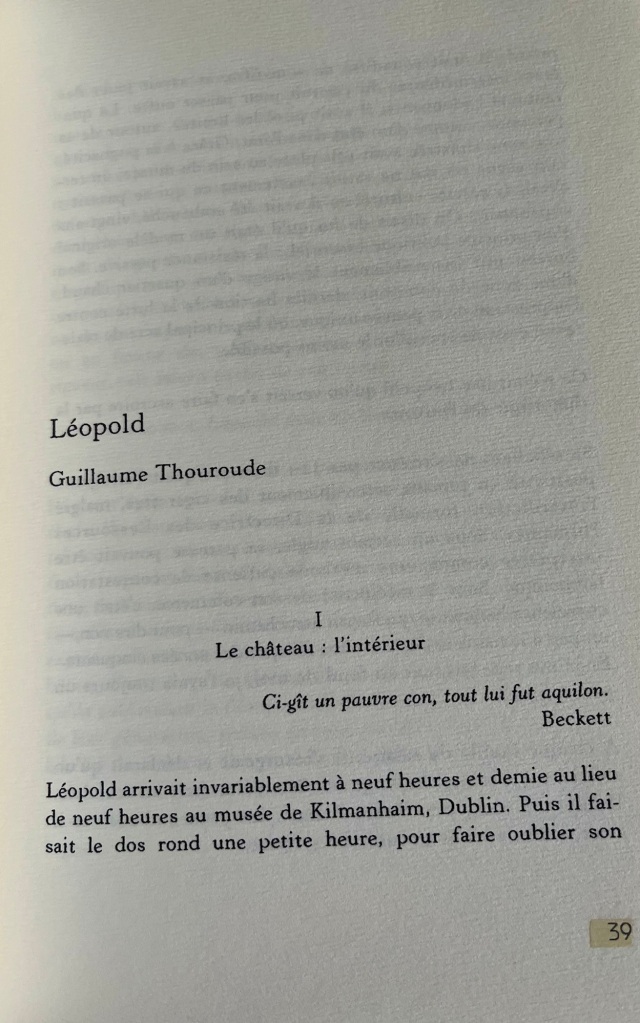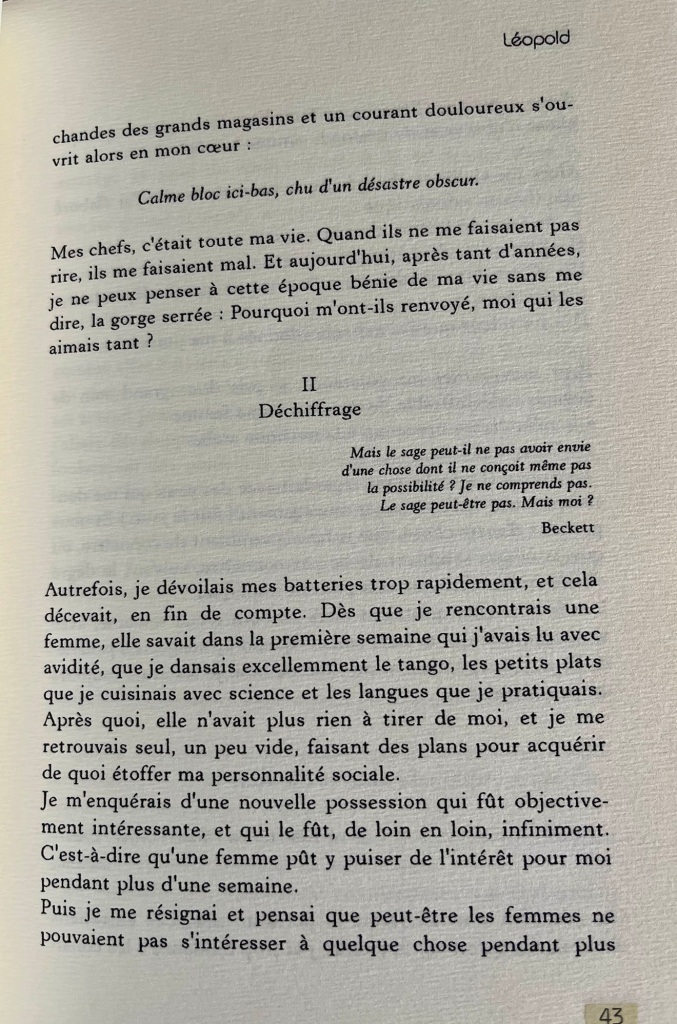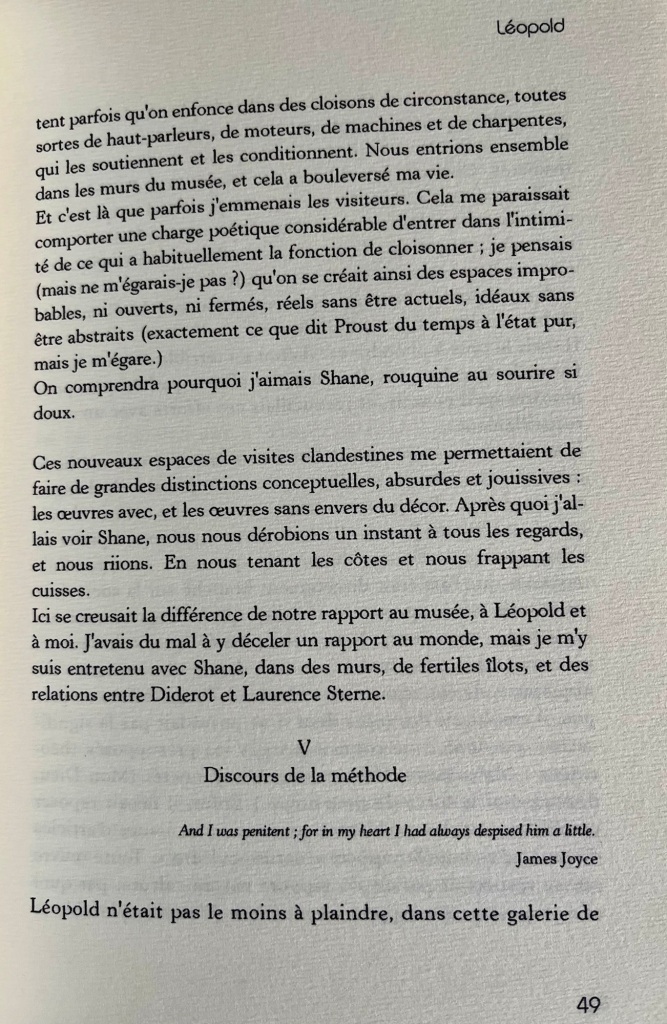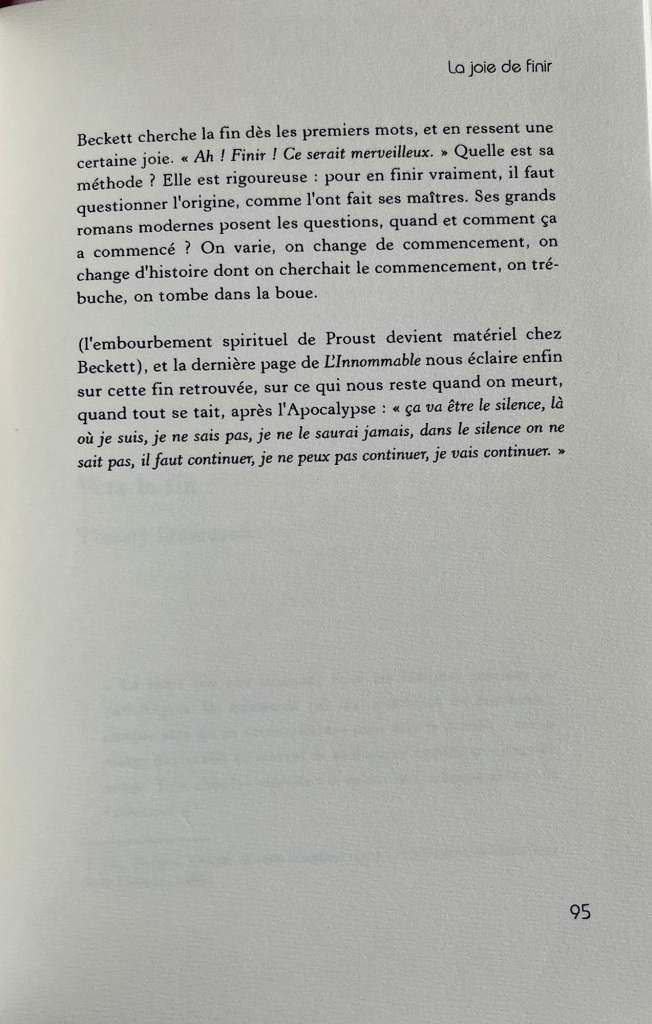Le sage précaire n’aurait jamais été ni aussi sage ni aussi précaire s’il n’avait pas occupé cette place spécifique dans sa fratrie.
Je suis le dernier né d’une lignée de quatre garçons, et après moi est arrivée ma sœur. Il ne fait pas de doute que mes frères et sœurs ont formé une structure symbolique qui a déterminé ma personnalité et mon rapport au monde.
Quand vous cherchez à vous comprendre, analysez votre place dans la famille.
Ma sœur fut le pôle douceur et humanité de mon existence. Avec elle pas de dispute, pas de colère, pas de drame.
Mes frères furent en revanche la grosse masse au-dessus de moi qui me montrait la voie en m’en interdisant l’accès. Mais en même temps mes frères furent un rempart de protection inexpugnable.
Moi, petit garçon, je n’avais même pas besoin de savoir me défendre. Les harceleurs et les bizuteurs me voyaient auréolé d’une armée de frères avec qui on ne badine pas. Les grands embêtaient mes amis plutôt que moi. Une fois un gars du village m’a tapé sur un terrain de football. Je me suis laissé faire car il ne faisait pas mal et que je voulais retourner au match. Il était plus âgé que moi, la préséance voulait qu’il me dominât. Il a dû se prendre une chasse monumentale chez lui car il n’a jamais recommencé et a toujours joué au football avec moi malgré mon jeune âge. On ne bat pas un petit Thouroude.
Une autre fois, un grand du collège me faisait peur car il était très laid et me maltraitait avec des gestes de petit caïd. Mon frère Jean-Baptiste, alerté par mon père, est venu vers lui en l’appelant par son surnom « le pisseux » : l’adolescent est parti en courant et ne m’a plus jamais importuné.
Mes frères avaient ce pouvoir magique de faire disparaître le danger sur mon chemin.
Cela explique je crois mon rapport décontracté au monde et au voyage. Je n’ai presque jamais peur et ne pense jamais qu’il pourrait m’arriver un malheur. Même les hommes qui me regardent salement, je les aborde avec un sourire et les mains ouvertes. Cette confiance en l’humanité et cette légèreté face aux responsabilités, je les dois à mes frères et sœurs. Ils m’ont encadré de manière protectrice.
D’un autre côté ils me disaient que j’étais trop petit pour comprendre et j’ai intégré cette variable. Je me perçois donc comme petit, capable de peu, et je mets toujours la barre très bas quand je me lance dans une entreprise. Par exemple, quand je suis parti vivre à l’étranger, personne ne croyait que je réussirais et moi pas plus que les autres. Mon objectif était de tenir trois mois. Quand, dans les pubs de Dublin, je rencontrais des jeunes qui avaient passé six mois en Irlande, j’étais éperdu d’admiration.
Rien n’est plus éloigné du sage précaire que les ambitieux adeptes d’aphorismes. Il faut viser les étoiles car au pire, en cas d’échec, tu atteindras la lune. Le sage précaire ne vise ni la lune ni les étoiles. Ses ambitions sont terre à terre et il ne se croit jamais supérieur aux autres. Quand il est supérieur aux autres, c’est temporaire, c’est dû à ses efforts et non à son talent, et il endosse la responsabilité afférente sans orgueil particulier. Ce que les autres voient comme de l’arrogance est simplement de l’impolitesse mêlée à de l’assurance enfantine. Je sais faire cela car je l’ai déjà fait, nul besoin de prétendre autre chose.
Quand on est un petit frère, on est donc modeste dans ses objectifs mais fier dans ses maigres réussites. Clamer sa fierté quand on a sauté des obstacles est davantage une manifestation de joie que de prétention. Tu as vu le but que j’ai mis ? Les grands frères haussent les épaules car on ne complimente pas dans la famille, ce sont les femmes qui complimentent, mais le petit frère puise en lui-même sa validation. Je suis devenu cet adulte plein d’assurance, qui ne se croit pas capable de grandes choses mais qui sait reconnaître ce qu’il a fait de bien, sans attendre qu’on le lui dise. Au football, j’étais donc le capitaine de mon équipe, sans avoir jamais ambitionné de l’être.