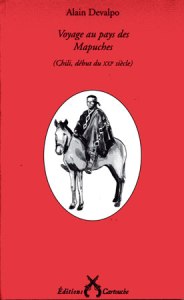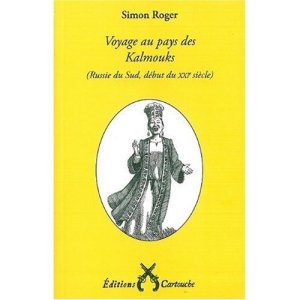Ceci est un vers du grand poète irlandais, W.B. Yeats : A terrible beauty is born. Il avait écrit cela en 1916, après le choc que causa en lui le soulèvement de Pâques qui vit un groupe d’insurgés prendre la Poste centrale de Dublin et déclarer l’indépendance de l’Irlande.
Lui, Yeats, est déjà assez vieux et n’est pas exactement un révolutionnaire. Mais il a toujours milité pour une Irlande autonome et culturellement renaissante. Il ne peut donc pas être contre ce soulèvement armé. Mais il ne peut pas non plus se sentir adapté à cette violence. Comment peut-on sacrifier des vies de jeunes gens doués et prometteurs, pour une cause politique ? Yeats traduit cette contradiction, cet effroi qui le prend devant ces insurgés qui sacrifient leur vie par cette formule qui revient à la fin de chaque strophe de son poème : A terrible beauty is born.
Curieusement, ces fêtes de début d’année 2012 sont pour moi sous le signe de ce poème. C’est d’abord le titre qui a été donné à la Biennale d’art contemporain de Lyon, que j’ai visitée pendant quelques jours. Je ne suis toujours pas sûr de comprendre le sens de ce titre.
Ensuite, cela fait écho à des lectures que j’ai faites pendant ces vacances. Retour à Kyllibegs, de Sorj Chalandon (Grasset, 2011, grand prix de l’académie française) est l’histoire d’un responsable de l’IRA qui a été assassiné en 2006, quelque temps après avoir avoué qu’il avait trahi le mouvement pendant plus de vingt ans. Ce que j’ai apprécié dans le travail de Chalandon, c’est qu’il avait déjà écrit un livre, en 2007, qui racontait l’histoire du même bonhomme. Dans Mon traître (2007) l’histoire est racontée du point de vue d’un Français naïf et idéaliste, alors que dans Retour à Killybegs, c’est le traître qui raconte sa vie à a première personne.
Chalandon cite lui aussi le poème de Yeats, en anglais, et donne à un chapitre ce titre : Une terrible beauté est née.
Fatalement, c’est une phrase qui m’a été inspirée par une des photos de la jeune Chinoise dont je parle dans le billet précédent. Sur son profil de réseau social, je la vois arborer un sourire énigmatique, sur fond de chute du Niagara : A Terrible Beauty is Born.
C’est un poème énigmatique que je lis et relis. En anglais, en français, en anglais encore. Je ne suis pas sûr de la traduction française que j’ai, et pourtant elle réussit bien à faire passer le trouble de Yeats :
« Je les ai rencontrés à la tombée du jour,
Qui venaient avec des visages éclatants
De leur comptoir, de leur bureau, parmi les grises
Maisons du dix-huitième siècle.
J’ai passé avec un salut de la tête
Ou des mots polis dépourvus de sens,
Ou bien je me suis attardé un instant et j’ai dit
Des mots polis dépourvus de sens,
Ou avant même d’avoir fini j’ai pensé
A quelque histoire plaisante, ou à un bon mot,
Destinés à distraire une connaissance
Au club, au coin du feu,
Parce que j’étais sûr qu’eux et moi
Nous jouions dans la même farce:
Tout est changé, changé du tout au tout :
Une beauté terrible est née. »
C’est cela, la beauté terrible qui fait irruption. C’est l’irruption de la réalité dans la farce que nous pensions jouer.