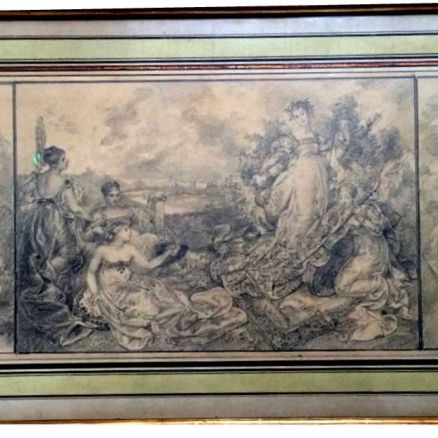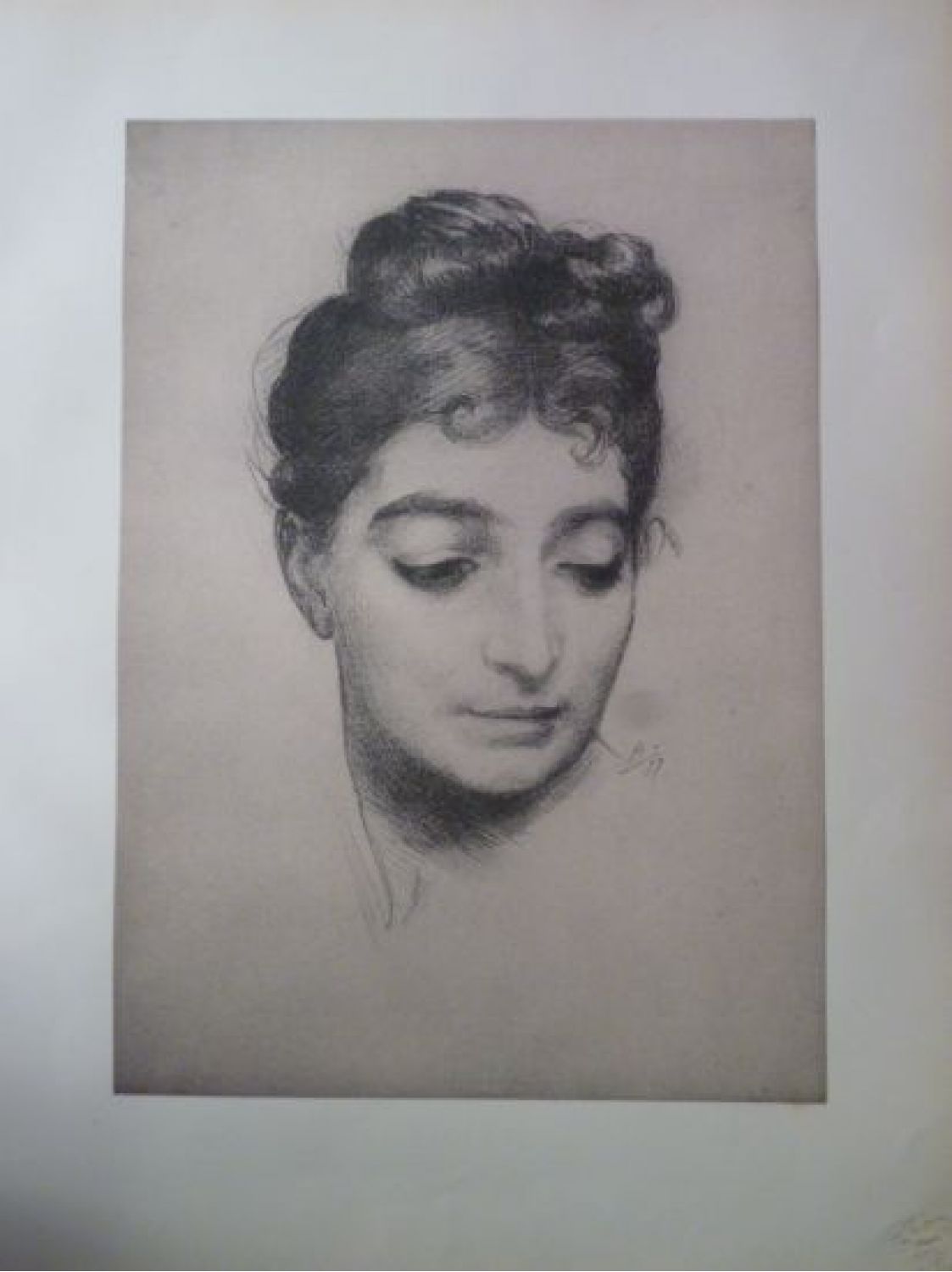
En 2017, lors d’une conférence sur la photographe madame Disdéri que je faisais en Bretagne-Nord à l’invitation de l’association d’histoire locale, précisément à Landunvez en Argenton lieu de naissance de Marie Quivoron, le responsable M. Paul Mével m’a engagée à faire une recherche sur cette artiste connue sous son nom d’épouse Marie Bracquemond, une des femmes peintres impressionnistes. Je me suis plongée dans sa biographie et j’ai contacté un descendant de la famille qui, souffrant, n’a pu m’aider dans ma quête d’informations. Monsieur Jean-Paul Bouillon lui aussi bien occupé n’a pu répondre à mes multiples questions dans un premier temps mais c’est aujourd’hui en janvier 2020 chose faite. J’ai également visité les lieux de Corrèze où Marie a vécu, interrogé les occupants actuels de Bonnaigue et du château de la Chabanne. J’ ai pris contact avec différents musées Morlaix, Amiens, Rouen, Orsay entre autres et j’ai navigué sur internet pour y trouver des traces sur Gallica, sur les sites de ventes et d’enchères. Devant l’omniprésence du masculin j’ai tenté de retrouver les réseaux féminins et de remettre en lumière les femmes et les femmes artistes dans l’entourage de Marie mais les traces conservées étant, dans leur grande majorité, issues du monde masculin toujours présent dans l’espace public cela s’est avéré très difficile et peu productif.. La vente le 30 avril 2024 du fonds familial de la famille Jundt par la maison Artcurial et le catalogue établi par Edouard Ambroselli et appuyé par des sources manuscrites vient mettre fin à certaines de mes hypothèses. Je modifie donc mon article pour certains passages.
Marie-Françoise Bastit-Lesourd, septembre 2017- mars 2024, notice en évolution
mfrancoisebastit@gmail.com
Revue d’histoire de la Corrèze Les mille -et-une sources, bulletin n°127, mars 2018, p.48-55, « Marie Bracquemond et la Corrèze » par M-F Bastit-Lesourd Conférence sur Marie Bracquemond : le samedi 21 septembre 2019 à Landunvez en Argenton -29- par M-F Bastit-Lesourd 1841 année qui voit l’invention du tube de peinture qui va modifier les pratiques des artistes et surtout leur permettre de quitter les ateliers pour le plein-air et apporter des vues neuves sur le monde.Marie Quivoron naît le 1er décembre 1840 à Landunvez en Finistère Nord. Elle débute au salon des Beaux-arts à 18 ans et poursuit une carrière tranquille touchant à divers mediums: l’aquarelle, la gravure, la peinture à l’huile mais également la peinture sur faïence.
Les recherches sur les femmes l’ont fait ressortir de l’ombre et aujourd’hui elle est au nombre des quatre femmes reconnues comme peintres impressionnistes avec Berthe Morisot, Mary Cassatt et Eva Gonzalès.
Marie est depuis 1869 l’épouse du peintre et graveur Félix Bracquemond. Il s’éteint en 1914 et elle lui survit deux ans et meurt à son tour dans leur maison de Sèvres. Leur fils Pierre né en 1870 a laissé des souvenirs qui sont son propre roman familial influencé par les dernières années de ses parents et sont à prendre avec du recul. Un autre breton, le critique Gustave Geffroy, a beaucoup apprécié le travail de Marie et œuvré pour sa reconnaissance mais sa perception de la femme et de l’artiste est à moduler. Il possédait personnellement deux tableaux de Marie. Dans son ouvrage sur C. Monet, sa vie, son temps son œuvre, il ne peut s’empêcher de placer Marie en position d’élève de ce dernier: « Marie B. qui fut une impressionniste pure aussitôt qu’elle eut compris la leçon de C. Monet ». Marie éprouva une grande et solide amitié pour Monet et eut sans doute avec lui de nombreux échanges sur leurs pratiques respectives mais elle était peintre à part entière.Mes recherches ont porté sur la jeunesse de Marie et une analyse des différentes données ainsi que de ses œuvres pour tenter d’éclaircir sa biographie et apporter un regard neuf sur sa personnalité bien malmenée par des propos s’apparentant à la vision traditionnelle de « l’artiste maudit » doublés d’une vision machiste de sa production comme pour ses consœurs.
Je pose ici un certain nombre d’hypothèses qui pourront servir d’ouvertures pour mieux cerner ses réseaux amicaux en venant peut-être se recouper avec d’autres connaissances et ouvrir de nouvelles pistes de compréhension de sa vie et de son œuvre.
Pour l’heure mes recherches ne portent pas en détail sur les multiples facettes de Marie car elle excellait dans plusieurs domaines comme celui de la faïence. Je cite ici Clara Erskine Clement, autrice de « Femmes dans les arts plastiques du septième au vingtième siècle de notre ère», paru en 1904 et qui parlait de l’étonnante capacité de Marie Bracquemond:
“… Madame Bracquemond a eu la facilité d’employer si bien les couleurs de la faïence qu’elle a produit une netteté et une richesse que d’autres artistes n’ont pas atteintes. Les progrès réalisés dans la faïence Haviland dans les années 70 étaient dus en grande partie à Madame Bracquemond, dont les pièces étaient presque toujours vendues à l’atelier avant d’être renvoyées, tant son succès était grand… ».
 Femme à la mandoline; RMN Musée Limoges coll Haviland
Femme à la mandoline; RMN Musée Limoges coll Haviland
Il serait juste que le versant de Marie comme chercheuse de nouvelles techniques ou de nouveaux procédés soit reconnu et mis en valeur car ses talents allaient bien au-delà de la peinture où les historiens l’ont cantonnée. Les panneaux « Muses des arts et des lettres » dont nous ne connaissons à ce jour que les cartons préparatoires sont bien mentionnés à l’époque comme une innovation artistique due à Marie Bracquemond.
-
En dehors du panneau de Madame Bracquemond qui est un essai destiné à montrer un procédé de décoration nouveau en céramique, de décoration sans reflets c’est-à-dire sans déformation des objets par la lumière, en dehors de ce panneau nous n’avons pas fait une seule pièce pour l’exposition. lettre de Ch. Haviland à Adrien Dubouché.
Préliminaire et doutes
Lorsqu’à la suite du décès de sa mère, Pierre Bracquemond fait l’inventaire de l’atelier, il appose des annotations sur certains dessins mais de toute évidence il le fait parfois sans vérification ou connaissance réelle. Ainsi il note : « dessin de sa sœur » ou « portrait de Louise » alors que peu de ressemblances viennent étayer ses dires. De même il donne pour le catalogue de l’exposition de 1919 une photographie qui au vu entre autre du costume féminin, ne peut être un portrait de sa mère mais serait un portrait d’Aline Pasquiou, sa grand-mère maternelle.
De plus depuis les années dix-neuf-cent-quatre-vingt où la mode a remis les Bracquemond en avant, il semblerait que les attributions entre Félix, Marie et Pierre soient parfois confuses.
Je pose également l’hypothèse que plusieurs œuvres visibles sur internet dont certaines vendues aux enchères ne sont pas de sa main.Le pastel sur toile « Nu dans un intérieur »
représente une femme nue tenant des fleurs et se reflétant en abyme dans le miroir d’une armoire. Il serait daté de 1911 (6,2×54,2) et a été vendu chez Christie’s en 2008 et serait à ce jour aux Etats-Unis: il ne peut être selon nous être de la main de Marie Bracquemond qui n’a jamais produit de nus de sa longue carrière, et qui à cette date est âgée de 71 ans et ne semble plus productive depuis plusieurs années déjà. Par contre le style est tout à fait celui de son fils Pierre. La signature serait donc à vérifier ainsi la figuration possible de cette œuvre au catalogue de l’exposition de Pierre Bracquemond à la galerie Bernheim jeune en 1912.
Dans la même veine, Le « Repos du modèle » qui lui est aussi parfois attribué est également plus certainement de la main de Pierre que de celle de Marie qui n’a pas appris le Nu à la différence des élèves du peintre Chaplin comme Mary Cassatt et Eva Gonzalès.
D’autres tableaux ont été attribués à Félix or pour ceux-là aussi au regard des dates et du style il est plus plausible qu’ils soient de la main de Pierre.
Portrait du professeur Demons
Tableau vendu aux enchères en 2016 à Clermont-Ferrand puis en juin 2018 à Drouot Paris comme un portrait de la main de Marie. Peut-être le même que celui mis aux enchères à Marseille en mars 2017 « Portrait d’homme accoudé », SBD MarieB. Portrait du Professeur Demons
Huile sur toile d’origine, 47 x 33 cm, signée en bas à droite « Marie B 1886 ».
Porte sur le châssis l’inscription au crayon et date « Demons par Marie Bracquemond Sèvres 1886 ».
Portrait du Professeur Demons
Huile sur toile d’origine, 47 x 33 cm, signée en bas à droite « Marie B 1886 ».
Porte sur le châssis l’inscription au crayon et date « Demons par Marie Bracquemond Sèvres 1886 ».
Ce tableau « n’apparaît pas rattachable par le style » à diverses productions de Marie Bracquemond. La palette colorée est plus que sobre alors que se déroule la dernière exposition impressionniste en 1886 à laquelle Marie participe avec plusieurs toiles de styles différents. Dans le même temps, de nouvelles démarches picturales sont en marche: le pointillisme avec Seurat et le Symbolisme. Il est dit également qu’à cette période Emile Gauguin aurait influencé Marie pour la préparation de ses toiles. Ce portrait serait-il vraiment de sa main?
Le fond sombre verdâtre sur lequel se détache l’homme n’évoque en rien le travail de la couleur à la manière impressionniste dont Marie fait preuve dans d’autres tableaux datés de la même période. Ceci me questionne beaucoup mais n’ayant pas vu les signatures et dates il m’est difficile de porter plus avant mon opinion.
Les annotations au crayon posent questions car le chirurgien réputé Jean-Octave-Albert Demons (1842-1920) est docteur en médecine de la Faculté de Paris en 1868 (« Des kystes du plancher de la bouche confondus sous le nom de grenouillette ») et chirurgien des hôpitaux de Bordeaux l’année suivante, ville où il passe le restant de sa vie. 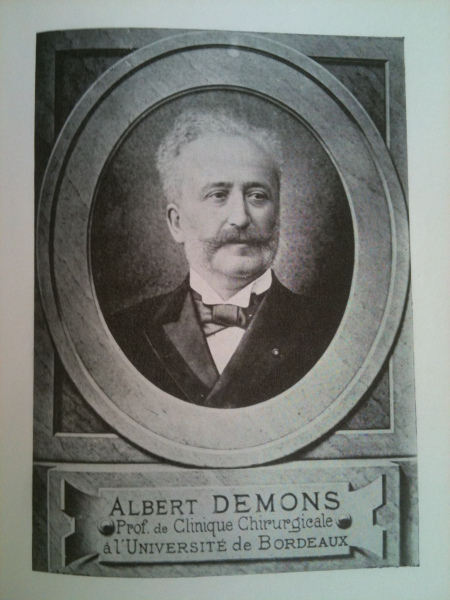 Du même âge quasiment que Marie, il n’est donc âgé que de 44 ans en 1886 et en pleine maturité comme ci-dessus, il ne peut avoir l’air du vieillard représenté. Son portrait est celui d’un homme moustachu et non barbu mais il est vrai que cela n’est pas une preuve.
Du même âge quasiment que Marie, il n’est donc âgé que de 44 ans en 1886 et en pleine maturité comme ci-dessus, il ne peut avoir l’air du vieillard représenté. Son portrait est celui d’un homme moustachu et non barbu mais il est vrai que cela n’est pas une preuve.
Mais dans ce cas quels peuvent être les circuits amicaux l’ayant conduite à Bordeaux? Les incohérences entre dates et âges sont majeures. Si la date est exacte le personnage pourrait-il un autre homme portant le même patronyme?
J’ai également exploré la piste du théologien protestant Frédéric François Desmons également franc-maçon né en 1832 et décédé en 1910 mais en 1886 il est âgé de cinquante quatre ans et ses portraits diffèrent de celui du tableau. Toujours dans une tentative d’éclaircissement de ce tableau je me suis intéressée à la décoration à la boutonnière du personnage. Le site des bénéficiaires de la Légion d’Honneur donne un « Demons Etienne Gustave né en 1820 et décédé en 1898, marié à Bordeaux en 1850 à Marie Marguerite Elisabeth Tandonnet ( ? famille du fouriériste Eugène Tandonnet) et veuf en 1863. Officier de la compagnie de Gendarmerie du Rhône il semble vivre à Paris 100 rue de la Boétie lorsqu’il se voit attribuer en 1877 la distinction d’officier de la L-H. Son âge est compatible avec celui du portraituré par M.B. De plus la mention manuscrite ne mentionnerait pas le titre de « Pr » ou « Professeur ». Bémols: il figure en tenue civile mais peut-être est-il retiré de ses fonctions en 1886? A suivre… Je relève pour comparaison stylistique un tableau d’A. Renoir ami de Marie qui présente quelques ressemblances de style pictural, de gamme colorée et de posture du sujet . Il représente Madame LeCoeur, dame âgée de la famille de l’épouse de Renoir et qui pourrait également être la même personne que la vieille dame au chat, dessin par Marie.B.
 Madame C. Lecoeur par A. Renoir
1: 1866 2. 1886
Madame C. Lecoeur par A. Renoir
1: 1866 2. 1886
 Mais tous les tableaux signés « Marie B. » sont-ils attribuables à Marie Bracquemond?
–Vente du 19 déc 2018 à Paris, ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE, YVES SAINT LAURENT – UN DIABLE À PARIS, ART CONTEMPORAIN : 19 décembre 2018 à 14h30: CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE VENTES à Paris
lot 11: ATTRIBUE A MARIE BRACQUEMOND (1840-1916) SANS TITRE Huile sur toile 25 x 28 cm – estimé entre 5000€ et 7000€.
Mais tous les tableaux signés « Marie B. » sont-ils attribuables à Marie Bracquemond?
–Vente du 19 déc 2018 à Paris, ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE, YVES SAINT LAURENT – UN DIABLE À PARIS, ART CONTEMPORAIN : 19 décembre 2018 à 14h30: CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE VENTES à Paris
lot 11: ATTRIBUE A MARIE BRACQUEMOND (1840-1916) SANS TITRE Huile sur toile 25 x 28 cm – estimé entre 5000€ et 7000€.
Ce tableau mis aux enchères en 2018 est-il une « copie »?, une « ébauche »? du tableau intitulé « Sur la terrasse à Sèvres » et conservé au Petit Palais de Genève (fermé à ce jour). Nous y voyons un personnage masculin au centre entouré de deux figures féminines, à gauche dans une tenue rose et à droite dans une tenue blanche. Louise, demi-sœur de Marie aurait posé pour les deux. L’homme au centre a été un temps supposé être l’artiste Fantin-Latour.

Les deux tableaux sont très différents par le traitement de la touche. Le fond aussi est différent avec un paysage de Sèvres pour le tableau initial, des fleurs et au loin des collines pour le second. Une certaine maladresse dans le dessin et dans les proportions de celui mis en vente à ce jour tout comme une touche agitée et raide, introduisent du doute, selon ma perception, quant à y voir une production de Marie.
L
 Le tableau « Les Iris » de la galerie Heim à Bâle, me questionne tout autant car peint à larges touches grasses, longues et vibrantes, il n’a pas son équivalent dans la production de Marie. B. mais s’apparenterait plutôt au style et à la palette colorée de son grand ami Monet auquel elle est très attaché et qui adopte ce mode stylistique après son retour de Belle-Île.
Le fond sombre verdâtre pourrait évoquer pour la palette le tableau dit du Pr Demons mis en vente récemment.
Le tableau « Les Iris » de la galerie Heim à Bâle, me questionne tout autant car peint à larges touches grasses, longues et vibrantes, il n’a pas son équivalent dans la production de Marie. B. mais s’apparenterait plutôt au style et à la palette colorée de son grand ami Monet auquel elle est très attaché et qui adopte ce mode stylistique après son retour de Belle-Île.
Le fond sombre verdâtre pourrait évoquer pour la palette le tableau dit du Pr Demons mis en vente récemment.
 Plantes sur un rebord de fenêtre par M.B. pour comparaison de la touche et ici du peu de matière avec Les Iris
Plantes sur un rebord de fenêtre par M.B. pour comparaison de la touche et ici du peu de matière avec Les Iris
Le tableau « Le (la?) peintre à son chevalet «
Huile sur panneau de 21×12 vendu aux enchères le 12 février 2009 à Paris est attribué à Marie Bracquemond mais sur le site il n’est pas fait mention de date ou de signature. Une signature semble cependant figurer sur le tableau mais ce serait à confirmer. Il s’ agit d’une étude préparatoire et non d’une peinture achevée et il serait donc surprenant que Marie ait apposé sa signature sur une ébauche alors même que ses toiles les plus connues ne sont ni signées ni datées.
Une femme brune, de profil, vêtue d’une robe à manches « gigot », vêtement qui connaît son apogée entre 1890 et 1895. Le tableau est dit dater de ca 1890 et c’est donc bien en adéquation avec le costume. Mais s’agit-il d’un autoportrait? ou bien d’un portrait représentant une amie de Marie? Elle aurait une cinquantaine d’années à l’époque.
La peintre vêtue d’un tablier rouge réalise un petit format ce dont Marie est coutumière. Par contre étrangement la scène n’est pas située dans un intérieur bourgeois mais dans un décor de type monumental avec en fond une sorte de colonne antique. Or plusieurs biographes ont écrit que Marie peignait chez elle n’ayant pas d’atelier, profitant alors de celui de son époux. Au début de sa carrière sa formation classique de dessin lui avait fait produire ce genre de formes antiques.
Un dessin portant le monogramme de Marie se rapproche de ce tableau par le décor architectural d’arrière plan. Il représente une jeune femme assise sur un fauteuil et il est dit que Louise serait le modèle mais cela semble improbable ou alors ce dessin daterait des tout débuts de la carrière de Marie. Le costume de la femme n’a rien à voir avec la mode du tableau de la femme peignant.
Ces indices pourraient laisser à penser qu’il s’agit bien dans ce cas d’une œuvre attribuable à Marie Bracquemond mais pourtant il semble bien qu’à cette date Marie avait plus ou moins renoncé à la peinture et selon nous un doute est permis.
Marie Caroline Quivoron voit le jour au bord de la mer le 1er décembre 1840 mais nous ne connaissons pas de peintures ou dessins ayant un lien avec la Bretagne que ce soit pour des vues maritimes ou des paysages de l’intérieur des terres. Elle ne serait donc jamais revenue dans sa région natale après l’avoir quittée dans sa prime jeunesse. Les données biographiques se trouvent maintenant en fin de cet articleMarie Pasquiou-Quivoron, ses débuts
Au début de sa carrière d’artiste Marie signe du double nom « Pasquiou-Quivoron » or Pasquiou est le patronyme de sa mère avant son mariage avec Théodore Quivoron. Ces variations du nom laissent à penser qu’Aline vivait sous ce nom de Pasquiou qui s’imposait de fait à ses enfants.
Les documents sur lesquels je me suis appuyée sont les catalogues des salons mais bien souvent ils comportent des erreurs sur le patronyme ou les prénoms attribués à Marie ou encore sur son lieu de naissance et nous pouvons nous interroger sur la fiabilité des données. Pourquoi la ville d’Albi est-elle donnée comme lieu de naissance alors que rien n’est dit d’un séjour dans cette région au niveau du récit familial? Mais son prénom Caroline est aussi transformé en « Antonine ». Aline aurait-elle choisi de brouiller les pistes de la naissance de sa fille en donnant un lieu fantaisiste?
Marie expose au Salon des Beaux-arts en 1857 ou 1859 selon les sources. Elle aurait donc soit 18 ans soit 19 ans et demi et à l’époque elle vit à Étampes où elle est sans doute arrivée avec sa mère vers 1855 après un temps à Paris. Lors de la vente du fonds Bracquemond en avril 2024 figure un portrait de Marie toute jeune fille entre quatorze ou quinze ans. Il est titré possiblement « Autoportrait » mais non signé. Je pencherais pour l’hypothèse vu la maîtrise de la composition et des couleurs qu’il s’agit de son portrait par l’ami d’Aline Pasquiou, le peintre Cantien Auguste Vassor car en 1854 ou 1855 il est peu probable que Marie ait acquis une telle aisance et maîtrise de son talent. .Les réseaux breton, normand et fouriériste
Ils s’entrecroisent et se recoupent et ne peuvent rester ignorés dans la formation de Marie.
- Armand-Félix Jobbé Duval 1821-1889, breton et fouriériste
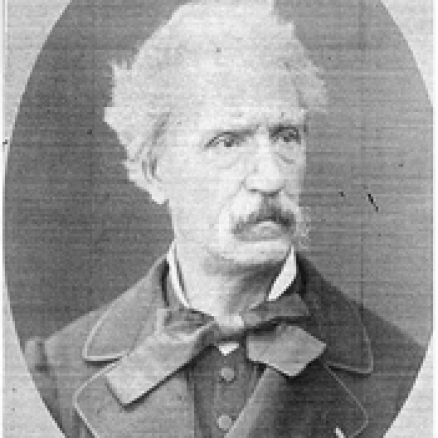 Félix Jobbé-Duval
Félix Jobbé-Duval
Jobbé-Duval revenait régulièrement dans sa famille rennaise et était un ami de jeunesse du poète Leconte Delisle, également fouriériste. Ces jeunes gens vivaient à Rennes, fréquentaient les mêmes cafés et lieux de divertissement qu’Emile Langlois et son frère et se sont assurément retrouvés à Paris mais les biographies ne retiennent en général que les proches ayant eu une reconnaissance sociale et ce ne fut pas le cas d’Emile Langlois dont le parcours reste totalement dans l’ombre. Augustin Charles, un frère de Félix Jobbé-Duval, est agent de change à Brest et depuis 1846, l’époux de Jenny Le Gall de Kerven née en 1819 comme Aline Pasquiou, mère de Marie Quivoron et dont elle pourrait avoir été l’amie de jeunesse.
Au sein de l’atelier parisien du peintre Paul Delaroche, Armand Félix Jobbé-Duval fait la connaissance d’Alfred Jacquemart qui devient son beau-frère en 1850 mais s’oriente vers la sculpture alors que Jobbé-Duval entre dans l’atelier du peintre Gleyre ouvert à partir de 1843. [Jacquemart est un des fidèles amis de Félix Bracquemond : attention il s’agit de Jules. Jacquemart, Jules Ferdinand (03–09–1837 – 26–09–1880), graveur. ] Les courriers de Fantin-Latour à son ami le peintre allemand Schoelderer mentionnent dès 1858 le peintre et graveur Frédéric Régamey. D’une famille d’artistes, il est lui aussi un fouriériste actif tout comme son frère Félix.
Jobbé-Duval est également franc-maçon de la loge des « Zélés philanthropes ».-
Horace Le Coq de Boisbaudran
-
Il [Lecoq de Boisbaudran] enseigne le dessin de 1841 à 1869 à l’École spéciale de dessin et de mathématiques, dite « petite École », actuelle École nationale supérieure des arts décoratifs. Titulaire en 1844, il s’abstient dès lors d’exposer sa peinture, afin d’éviter que le style du professeur n’entrave le développement des élèves : « Le maître de l’art enseigne par ses œuvres, le professeur par la parole et la méthode »; Sa méthode de l’éducation à la mémoire pittoresque. Avec quelque difficulté, il fait ensuite admettre son programme à la petite École. Ses cours de dessin de mémoire du jeudi après-midi ont beaucoup de succès et sont suivis par de nombreux jeunes artistes. Il emmène aussi ses élèves observer et dessiner en extérieur, contre la méthode courante de l’Académie. Cependant, il n’obtient qu’en 1863 la permission d’ouvrir un atelier pour l’enseignement du dessin de mémoire à l’École des arts décoratifs, dont il devient le directeur de 1866 à 1869.Son apport à la pédagogie réside dans sa méthode novatrice de l’apprentissage du dessin de mémoire, consistant à demander à l’élève d’observer un objet puis de le dessiner de mémoire. Il expose sa méthode dès 1847 et la présente à l’Académie des Beaux-arts en 1854.• Horace Lecoq de Boibaudran, « Éducation de la mémoire pittoresque », La Phalange, Paris, vol. 6, t. 2, 1847, p. 354-366 (lire en ligne [archive]) ; imprimé à part en 1848.
Le réseau féminin: Fanny Chéron (1830- ?) et Victoria Dubourg (1840- )
Fanny Chéron 1830- ??
Fanny Chéron, femme peintre d’origine normande reçoit une éducation soignée et apprend l’anglais comme ses frères dont l’un porte d’ailleurs le prénom d’Edwin. Suite à la ruine de son père, Fanny fut obligée de vivre de sa peinture, et elle pourrait avoir croisé la route de Marie car Fanny était également copiste au Louvre et donnait des cours de dessin. C’est cette artiste qui forma la jeune Victoria Dubourg Les amitiés et relations féminines sont donc à lire en filigrane puisque les documents conservés sont si minces sinon totalement absents de l’histoire de la peinture.
Fanny Chéron suivit aussi l’enseignement de Jean Hilaire Belloc (1786-1866) qui déléguait la direction des cours de dessin pour jeunes filles à sa sœur, Jeanne Belloc (1811-1889), épouse de Georges Bibron. Jeanne (ou Jenny) Belloc, est peintre miniaturiste de genre et de portraits et lithographe et débute au Salon de 1835 puis continue d’exposer jusqu’en 1868 ; elle expose également à Londres (1871). Louise Belloc (1822-1895), fille de la féministe Louise Swanton-Belloc et élève de son père Jean et de sa tante Jenny, expose au Salon des portraits en miniature à partir de 1845. Elle épouse M. Redelsperger.
Fanny reçoit aussi l’enseignement du talentueux peintre, aquarelliste et pastelliste Alphonse Galbrund (1810-1885), conservateur du musée du Havre à partir de 1870. On peut penser que cela fut autour de ses 13 ou 15 ans soit entre 1843 1845 . Ce dernier réalisa un portrait de madame Degas et un portrait de Degas enfant, preuve de liens anciens entre ces artistes et familles de négociants ou banquiers. Amédée Chéron, père de Fanny, bibliophile mais également partisan des utopies de l’époque, saint-simonisme et fouriérisme, fréquente le salon de Louise Colet (1810-1876) où il retrouve d’autres sympathisants de ces doctrines. Louise Colet républicaine convaincue attire nombre de personnalités du monde politique dans son salon et Fanny participe à ces réunions en compagnie de son père. Elle y fait la connaissance du poète fouriériste Leconte Delisle et en serait tombée amoureuse. Fanny réalise en 1852 un portrait de la fille de Louise Colet, Henriette âgée de douze ans.
Fanny Chéron expose au Salon en 1850 (elle a 20 ans ; Son père meurt en 1854), puis de 1864 à 1883 elle réalise principalement des portraits dessinés. Elle finira dans la misère et vendra pour survivre un buste de son grand-père œuvre du sculpteur Pigalle son ami.
Pourquoi réduire ces artistes à leur art et ignorer leurs engagements en particulier politiques surtout pour les femmes? Fanny Chéron côtoyait dans les salons tous ces hommes politiques et elle a pu y croiser d’autres jeunes femmes comme Victoria Dubourg. C’est la facilité pour les biographes de s’en tenir aux lieux de pratique artistique comme le Louvre comme lieu de rencontres entre artistes sans questionner les centres d’intérêts de ces artistes femmes.- Amédée Chéron est un républicain militant et en 1848 il s’engage à fond dans le mouvement révolutionnaire ce qui le conduira à la ruine. Fanny aurait vu alors ses fiançailles rompues et dès ce moment ou en 1854 après le décès de son père elle se trouve dans l’obligation de gagner sa vie. Fanny ouvre alors un cours de dessin pour jeunes filles que Victoria Dubourg future épouse de Fantin-Latour a fréquenté. Si les parents de Fanny se sont trouvés à un moment dans l’indigence, il n’en est pas de même pour d’autres membres de la famille qui ont continué d’évoluer dans les sphères de la bourgeoisie très aisée. Une sœur de Fanny épouse Boussaye possède au moins deux domaines dont à Marly, la propriété dite « Le château des Délices » détruit en 1955. L’un des oncles par alliance de Fanny, Nicolas Bazin amateur d’art et collectionneur installé ensuite en Anjou fut élève du peintre Cogniet. es questionnements l’existence de liens entre les familles
- Les frères de Fanny, Georges et Charles Chéron nés respectivement en 1839 et 1840 ont été les condisciples de Stéphane Mallarmé. En 1898 ou 1911 Fanny Chéron offre au musée Percheron deux tableaux de ses frères [1]. Une de ses nièces Anne Louise Cécile Chéron née à Mortagne en 1841 est également artiste peintre, céramiste. Peut-être formée à ses débuts par Fanny, elle est ensuite selon la notice du Salon, élève de messieurs P. Flandrin (Paul Flandrin 1811-1902), Montfort (Antoine Alphonse Montfort 1802-1884? ), Vidal (Louis Vidal 1831-1892 dit Vidal-Navatel?) et Brunel-Roque (Léon Brunel-Rocque 1822- ?, attaché à la manufacture de Sèvres comme peintre de figures). Cécile meurt en 1911.
-
Victoria Dubourg 1840-
Marie PASQUIOU-QUIVORON et ses maîtres : Ingres, Vassor, Signol, Laugée et Merle
« Le choix du maître est toujours soigneusement réfléchi et relève pleinement de la stratégie professionnelle, car c’est moins le maître lui-même que l’on choisit, avec son caractère ou ses méthodes particulières, que le « nom du maître », sorte de bannière sous laquelle le jeune artiste choisit de s’enrôler pour le reste de sa carrière ». Séverine Sofio, Artistes femmes. La parenthèse enchantée XVIIIe-XIXe siècles, CNRS édition, 2016.
Pour l’exposition de 1859, Marie donne pour maîtres et formateurs les noms conjoints d’Ingres et d’Auguste Vassor (sic Vassort ou Wassor dans plusieurs catalogues).
Norbert Hache et Mathilde Ramel son épouse
 Norbert Hache par son beau-frère Ingres RMN Orsay ; graphites sur papier
Norbert Hache par son beau-frère Ingres RMN Orsay ; graphites sur papier
Le point commun entre ces deux artistes Ingres et Wassor est un médecin d’Etampes, Norbert Hache, chirurgien-en-chef de l’hôpital de la ville (alors en Seine-et-Oise) pendant vingt ans, poste qu’il quitte pour s’installer à Paris au début des années 1850. Il ouvre un cabinet rue de Lille, où il a pour voisin les Ingres et en 1856 le docteur Hache épouse Mathilde Ramel sœur de Delphine, et devient ainsi le beau-frère du peintre. 
Nous pourrions imaginer que Marie vivait avec sa famille dans le même quartier et que peut-être comme certains l’ont pensé des raisons de santé les ont amenés à se rencontrer mais une autre piste est à explorer, celle du fouriérisme. En effet tout comme Félix Armand Jobbé-Duval, Norbert Hache est un fouriériste convaincu et engagé, membre actif de l’Ecole sociétaire, souscripteur de la colonie du Sig en Algérie et tout porte à croire qu’Aline Pasquiou adhérait aux mêmes idées socialistes. Quand à Aline Pasquiou, elle ne résidait pas encore à Étampes lorsque le docteur Hache était chirurgien à l’hôpital de la ville. Leur rencontre serait parisienne ou se serait produite lorsque Hache avait l’occasion de revenir à Étampes retrouver ses amis dont le peintre Auguste Cantien Vassor. Une autre hypothèse pourrait être que ce soit chez les Hache qu’Aline ait fait la connaissance de Vassor et soit tombée amoureuse de cet homme.
Ingres
Grâce à Jean-Paul Bouillon biographe des Bracquemond qui a eu l’opportunité de consulter des archives familiales, nous constatons que le contact entre Marie et Ingres ne s’est pas bien passé, ce dernier souhaitant cantonner les femmes dans le registre des fleurs et des natures mortes alors que la jeune fille avait comme modèle de référence la femme peintre Rosa Bonheur (ou Bonheure) dont le talent n’était absolument pas reconnu par le vieux maître. Installée après 1860 à By en forêt de Fontainebleau, Rosa Bonheur se rendait fréquemment à Paris où elle avait conservé un pied-à-terre et y poursuivait ses engagements envers l’instruction des filles avec un groupe de femmes proches du saint-simonisme et du fouriérisme dont Eugénie Niboyet, Elisa Lemonnier, madame Souvestre… Aline Pasquiou était-elle proche de ces femmes engagées pour l’éducation des filles? Dans sa jeunesse Marie montre donc un caractère affirmé, une grande détermination à vivre son art suivant sa volonté et elle n’a pu le faire au regard de l’époque sans avoir le soutien de sa famille. Sa mère l’a donc soutenue pour franchir le pas d’une pratique artistique de loisir à une pratique professionnelle de la peinture.« Je dois admettre que la sévérité de M. Ingres me terrifia. Ingres pense qu’une femme manque de la conduite et de la persévérance requises par la peinture et veut les limiter aux fleurs, fruits et natures mortes, portrait de scènes de genre… Il admit alors que j’étais plus avancée qu’aucun des élèves de M. Flandrin. Il me fit promettre de revenir le voir. Il prit ma main en signe d’encouragement et m’encouragea à observer la nature ».Elle conclut en affirmant ses choix et sa personnalité et se désengageant des propos du vieux maître misogyne.
« Depuis quand je pense chaque jour à cette visite il me reste une idée forte qui dépasse tous les obstacles : je veux peindre mais pas des fleurs mais pour exprimer les sentiments que l’art m’inspire et contre lequel M. Ingres ne pourra aller. Mais cela n’arrivera pas en un an, les choses s’installent progressivement et pour cela je ne retournerai pas voir M. Ingres « .Si l’on en croit ses propos, Marie n’a donc pas reçu l’enseignement direct d’Ingres car il n’est question que d’une unique visite mais elle a utilisé son nom à des fins stratégiques de visibilité sur la place artistique. Ingres (1780-1867) à l’époque de la rencontre avec Marie est un vieillard octogénaire et il est peu probable qu’il ait poursuivi encore à cet âge avancé une activité régulière d’enseignement et Marie n’a bénéficié que d’un conseil tout à fait banal sans aucune originalité personnalisée. Le critique d’art Louis Vauxcelles dans un article de la revue L’Exelsior de 1919 écrivant à propos du couple Bracquemond différencie bien Félix qui fut élève de Joseph Guichard disciple d’Ingres et ayant gardé tout au long de sa vie une grande fidélité à son enseignement et d’autre part, Marie qui simplement reçut « les conseils du maître ». Suivant une mention trouvée sur le site des Archives nationales où de toute évidence le patronyme de Marie a été tronqué, il se pourrait que des liens plus serrés aient existé avec madame Ingres? Le rôle de Mathilde Ramel la sœur de madame Ingres et qui est l’épouse du docteur Hache, fouriériste étampois, serait à préciser mais une fois de plus les réseaux féminins sont occultés.
 Delphine Ramel épouse x2 de Dominique Ingres
Delphine Ramel épouse x2 de Dominique Ingres
La copie de l’autoportrait d’Ingres par Mlle Pasquio (sic) achetée à Mme veuve Ingres est attribuée au musée de Versailles. [1 p.] (11 février 1878). https://francearchives.fr/fr/findingaid/6ced148ed4c3900200812e797bcfdcfd7084e1feM.B aurait donc été autorisée par Ingres et/son épouse à copier un autoportait d’Ingres ce qui renforce l’idée du réseau féminin.
Laugée, Signol et Merle
Par contre Marie a travaillé avec deux élèves de l’atelier d’Ingres qu’elle mentionne par la suite comme « maîtres ». Le premier Désiré Laugée (1823-1896) est devenu un ami car il est témoin en 1869 pour son mariage avec Bracquemond. Désiré Laugée est également un ami très proche d’Hélène d’Espagnac (que je suppose être la comtesse de Luchaire) et de son époux Durand de Neuville car il est témoin pour les déclarations des naissances de leurs deux enfants. Ceci serait une nouvelle preuve des liens entre ces artistes. Il est l’époux depuis 1850 de Célestine Malézieux d’une famille de peintres. Pour le deuxième il s’agit d’Emile Signol, peintre de thèmes religieux. Marie signe à l’époque du nom de «Pasquiou-Quivoron » (alors même que son nom est « Quivoron »). Le dernier Hugues Merle, est un portraitiste reconnu qui réalise également des peintures religieuses et historiques. Né le 28 avril 1822 à La Sône (Isère), et mort le 16 mars 1881 à Paris, il est l’élève de Léon Cogniet à l’École des beaux-arts de Paris. Peintre de genre et portraitiste, il traite des sujets moraux ou sentimentaux. Il expose au Salon à partir de 1847 et remporte des médailles de 2e classe aux Salons de 1861 et 1863. Grâce à ces récompenses sa notoriété croît et il ouvre un atelier pour jeunes filles que Marie a donc sans doute fréquenté. La jeune et talentueuse américaine Elizabeth-Jane Gardner suit l’enseignement de H. Merle vers 1864-1866. La peinture de Merle comme celle de ces deux jeunes femmes est à l’époque très lisse et maîtrisée ne laissant pas voir les coups de pinceaux. Marie après une période transitoire adoptera plus tard un autre style plus proche des impressionnistes avec une touche plus visible et nerveuse mais toujours contrôlée. Il peint des portraits de Paul Durand-Ruel et de sa femme Eva Lafon qui meurt à trente ans après avoir donné naissance à cinq enfants. Durand-Ruel, ne se remariera pas. Ceci confirmerait que Marie et sa mère fréquentaient le milieu artistique parisien depuis leur retour de Corrèze.Vassor 1805-1861 et Etampes
Les biographes de Marie la font vivre à Étampes puis rejoindre la capitale et y débuter sa carrière or l’étude des recensements d’Étampes ne fait pas apparaître la famille aux patronymes Langlois, Quivoron ou Pasquiou en 1856 mais seulement au suivant en 1861. L’adresse qu’elle donne lors de son inscription au Salon de 1859 est à Étampes. Son séjour dans cette ville aurait été d’environ six ans au maximum (selon nos déductions: de 1856 après le passage de l’agent recenseur ou en 1857 à début 1862). Il est difficile de déterminer les dates exactes de certaines œuvres car les différents catalogues ne s’accordent pas sur les années. Salon de 1859: elle expose « Portrait de la famille de l’auteur » sous le nom de Pasquioux(sic), élève de Vassort(sic) et Ingres. Mais prénom faux: « Marie Antonine »! Le catalogue donne deux adresses : à Etampes, 72 rue St Jacques et à Paris chez M. Pierre Faubonne, doreur sur bois et marchand de tableaux, 6 rue de L’arbre-sec dans le 9ème arrondissement. La personnalité de sa mère et le milieu que fréquente Aline Pasquiou en ce milieu du 19ème siècle sont sûrement à la base de l’introduction de Marie dans le monde de la peinture de l’époque mais à notre grand regret rien de connu pour nous éclairer et nous en sommes réduits aux hypothèses par recoupements. Une hypothèse serait qu’Aline Pasquiou séparée d’Emile Langlois a noué une relation avec Auguste Vassor à Paris et l’a rejoint à Étampes, Marie profitant de ses conseils pour compléter sa formation. Par contre étant toujours officiellement l’épouse de Quivoron, Aline ne peut officialiser ce nouvel engagement et se perd dans des questions d’identité en reprenant celles du couple de ses propres parents. Cela ne peut avoir été sans conséquences psychologiques pour Marie et les autres enfants. Par le recensement nous trouvons donc Aline et trois enfants en 1861, au 72 de la rue St Jacques. Étrangement, Aline est inscrite sous les patronymes de ses propres parents « Pasquiou née Perrein », son âge est de 43 ans et les enfants sont inscrits sous celui de Pasquiou. Outre Louise, onze ans, il apparaît un autre enfant, Emile 16 ans, donc né en fin 1844 ou 1845. Quel devenir pour ce demi-frère ? Mystère absolu. Mes recherches n’ont rien donné si ce n’est qu’il n’est ni né, ni mort à Saint-Fréjoux. Lors du recensement suivant de 1866, la famille ne figure plus au nombre des habitants d’Etampes. Madame Pierrette Chantôme-Doyon dans son article paru dans la revue Le graveur parle d’un tableau conservé dans la demeure corrézienne, signé « Marie Pasquiou Quivoron » figurant un jeune garçon chevauchant dans la lande et dans lequel elle a cru voir le portrait de Pierre Bracquemond adolescent. Il s’agirait selon nous d’Emile le demi-frère de Marie car après son mariage en 1869, celle-ci ne signe plus que de son nom marital : «Marie Bracquemond » ou «MarieB ». Le peintre ami de Marie, Auguste Cantien Vassor, est enseignant au collège de la ville. Dans sa jeunesse il s’était formé comme tant d’autres jeunes gens dans l’atelier de Léon Cogniet où il avait eu comme condisciple et ami le peintre Ernest Meissonnier qui venait ensuite parfois lui rendre visite à Étampes. Vassor dans sa jeunesse avait un atelier à Paris au 7 rue du Petit-Bourbon dans le 1er arrondissement et selon le conservateur du musée intercommunal d’Etampes, il a exposé par deux seules et uniques fois, aux salons de 1838 et 1840. Une possible amitié a été évoquée par les historiens étampois entre Vassor et l’artiste Louise Desnos née Robin (1807-187?) qui aurait réalisé un portrait d’Auguste Vassor en 1838. Cette femme portraitiste eut de nombreuses commandes officielles, entre-autres le portrait de Louis-Philippe, mais comme pour tant de femmes nous n’avons trouvé que peu de renseignements sur son parcours. Aurait-elle pu jouer un rôle dans la formation de Marie? Vassor outre son activité d’enseignement restaurait des tableaux d’églises ou de particuliers. Grâce aux souvenirs du peintre Amédée Besnus, nous avons quelques indications sur Vassor mais quasiment rien d’autre sur celui qui fut un des formateurs de Marie et qu’elle a choisi d’honorer en le mentionnant comme « maître » en reconnaissance de son enseignement à la différence d’Ingres plutôt choisi pour des questions stratégiques. Amédée Besnus (1831-1909) fut l’élève de Vassor et dans son ouvrage Mes relations d’artiste, il évoque Marie Bracquemond. Elle est plus jeune que lui et ils se sont rencontrés dans cette ville d’Etampes lorsque Besnus revenait visiter sa famille. Dès 1852, Besnus fréquente le village de Bourron en forêt de Fontainebleau dont Marlotte est un hameau attenant tout comme un autre élève de Vassor le peintre Oscar Tartarat. Aquafortiste, Besnus eut l’occasion de fréquenter Félix Bracquemond. Madame Pierrette Chantôme (1930- ??) relate dans un article que selon ce qui lui a été raconté dans la famille, ce serait Besnus qui fut à l’origine de la rencontre entre Marie et Félix Bracquemond. C’est aussi ce que G. Geffroy relate dans sa préface en 1919 sur la base des mêmes sources filiales. A propos de Marie, Besnus parle d’une « femme modeste n’exposant pas ses œuvres autant qu’elles le mériteraient« . Pour lui comme pour Marie, leur première exposition au Salon date de 1859. Suivant Amédée Besnus, Auguste Vassor recevait chez lui d’autres artistes que Marie a pu croiser et dont elle a pu recevoir des conseils. Le peintre Louis Désiré Barré (1821-1881) ancien élève d’Eugène Dévéria a travaillé tout jeune comme peintre de fleurs pour la manufacture de Sèvres. Nicolas Moreau peintre de scènes de chasse n’aura pas eu d’influence à priori sur la formation de Marie. Besnus cite encore comme amis de Vassor « l’architecte réputé, A. Magne » puis Elias Robert, le statuaire et enfin le paysagiste Gabriel Chardin. Il est important de ne pas sèchement réduire la vie intellectuelle et artistique que vécut Marie à Étampes à des cours reçus de la part d’un « vieux peintre », enseignant du collège et restaurateur de tableaux pour améliorer son quotidien. Avec d’autres amis peintres de la région, Vassor pratiquait aussi la peinture en plein-air, sur le motif mais Marie ne semble pas avoir eu le temps de profiter de cette pratique.Ce bon père Vassort avait pour principe, s’autorisant en cela du vieux Siméon Chardin, qu’il adorait, de faire tenir alternativement à ses élèves le crayon et le pinceau, trouvant que le dessin et la couleur devaient toujours marcher de pair. […]Elle (Marie) suivit aussi les conseils de M. Ingres et sut concilier avec une rare mesure la rigidité inexorable du dessin avec les opulences de la palette comme l’attestent de beaux portraits que signeraient sans hésitations certains maîtres coloristes d’aujourd’hui. Malheureusement sa trop grande modestie l’empêche de les envoyer à nos salons annuels, où ils auraient le succès qu’ils méritent».[1][1] A. Besnus, idem, p.63 Vassor est un artiste dont Besnus dit qu’il faisait travailler conjointement le dessin et la couleur et n’était pas l’esclave d’une unique manière de pratiquer. Cette formation est donc bien antérieure à la rencontre de Marie et de Bracquemond qui rédigea en 1885 un ouvrage Du dessin et de la couleur sur ce thème. Auguste Vassor décède en octobre 1861 à cinquante-six ans mettant fin à l’enseignement que Marie recevait de sa part. Cette disparition provoque le retour de Marie et sa famille sur la capitale. Vassor était resté officiellement célibataire. Quelques années après, le mari d’Aline et père de Marie, Théodore Quivoron, meurt à Lannion le 25 mai 1864. Aline est enfin veuve mais ne se remariera pas. Elle touche une petite pension insuffisante pour assurer l’éducation de ses enfants et Marie est dans l’obligation de travailler et de vivre de sa peinture. Edouard Béliard, un autre peintre lié au groupe des impressionnistes est originaire d’Etampes par sa famille maternelle et il serait intéressant de trouver des liens avec les précédents, Vassor et Besnus qui pourraient également expliquer la rencontre de Marie avec Félix Bracquemond entre 1862 et 1866 date de leurs fiançailles et surtout son implication dans le groupe dit « des impressionnistes ». Béliard est très proche de Camille Pissarro entre autres mais aussi d’ Edouard Manet et il expose avec le groupe de la première heure en 1874 bien que ses paysages soient plus de l’Ecole de Barbizon que des avancées picturales de l’impressionnisme.
Marie aurait exposé en 1857 pour la première fois avec deux dessins mais il n’en est pas trouvé mention sur le catalogue et selon une autre source en 1859 dans la catégorie « Peinture ». Le tableau retenu porte le titre de « Famille de l’auteur » et d’en avoir connaissance nous éclairerait sur sa composition.
Ses premiers tableaux (dont l’un conservé au musée des Beaux-arts de Rouen intitulé « Fauconnerie ») sont des huiles sur toile de style troubadour qui n’ont rien à voir avec l’impressionnisme mais montrent déjà sa maîtrise des couleurs et un dessin très classique. Elle a également réalisé un tableau sur le même thème historique où nous voyons un page faisant la lecture à une dame en hennin allongée sur un lit de bois devant une cheminée renaissance d’où monte un filet de fumée. Les couleurs sont chaudes et lumineuses et Marie traite habilement différents rendus de matières: la pierre, le bois, les tissus ou la fourrure, les fleurs…
D’une inspiration différente mais dans le même style le tableau de « La Japonaise » également très coloré date de la même période et montre l’intérêt précoce de Marie pour le thème asiatique avant sa rencontre avec Bracquemond.
Les années parisiennes de 1862 à 1869
De retour à Paris, Marie et sa famille s’installent d’abord 1 rue d’Enfer (de nos jours boulevard Raspail) et ceci jusqu’en 1867. Cette adresse serait alors plutôt un atelier d’artistes qu’un domicile. Puis Marie donne pour adresse le 19 rue de l’Université, dans un immeuble cossu aux larges baies vitrées permettant la pratique de la peinture. A ce même numéro 19, le peintre Gabriel Lefébure avait son atelier en 1849 et, portraitiste talentueux, il y représentait des jeunes gens proches du milieu breton : le poète Evariste Boulay-Paty un ancien étudiant de Rennes, le peintre saint-simonien anglo-français Peter Hawke pour ne citer qu’eux.
Une aquarelle de Veules-en-Caux conservée dans la famille (cf catalogue 2024), signée et datée « 65 » nous renseigne sur les fréquentations d’Aline Pasquiou et sa fille qui fréquentent ce lieu de villégiature du pays cauchois tout comme tant d’autres artistes de l’époque.Hommes de lettres et artistes affluent : Chintreuil, de Cock, Harpignies, Mélingue, Michelet, Meurice, Victor Hugo, les Frères Goncourt, Coppée, Richepin, drainent vers le village la société parisienne qui découvre un lieu de villégiature tranquille à deux pas de la capitale. Les jolies villas de style balnéaire voient le jour. site de la mairie de Veules
Marie enseignante
Nous ne savons pas si Marie eut des élèves à son domicile par contre elle enseigne dans une école du 14è arrondissement à moins qu’il ne s’agisse de sa mère Aline Quivoron/Pasquiou?
1870: Mention de Pasquiou Quivoron Marie, peintre artiste 19 rue de l’Université Et de madame Quivoron, Hôtel de Bourgogne, rue de l’école de médecine 16 [3]Annuaire du commerce et de l’industrie 1864, catégorie « peintre artiste » p. 1214 et Ecoles et cours publiés dans l’annuaire de 1870 publié par la Gazette des B-A p. 238: 14ème arr, 36 rue Delambre, école de Mme Berecka (née Emilie Troué[1]), directrice, madame Quivoron maîtresse. Cours pour les jeunes filles le jeudi de 8h et demi à midi et demi. Page 51, Marie apparait dans la rubrique « peintres » sous le nom de Pasquiou Quivorou(sic) 19 rue de l’Université élève de Signol et Laugée.
Marie copiste
Ses références et son talent font que Marie est sélectionnée par le directeur du Louvre Émilien de Nieuwerkerke (1811-1891) comme copiste professionnelle et plusieurs de ses réalisations sont acquises par l’Etat et mises en dépôt dans des établissements de province[1]. La mairie de Vitry-le-François reçut en dépôt en 1863 ou 1864 un tableau représentant l’Impératrice Eugénie, portrait à mi-corps, copie de l’artiste Winterhalter, qui fut payé à Marie pour la somme de 600F. A ce jour sa localisation est inconnue tout comme celui semblable d’un portrait à mi-corps de l’impératrice que reçut la ville de Morlaix en 1866. La peintre Fanny Chéron réalisa elle un portrait de l’Empereur qui fut, tout comme celui de Marie, mis en dépôt à la mairie de Morlaix. Je présume que Marie Pasquiou-Quivoron était très proche de Fanny Chéron et Victoria Dubourg qu’elle croisait dans les galeries du Louvre où elles copiaient les anciens maîtres. Ces jeunes femmes copistes professionnelles demandaient parfois des autorisations pour une présence très matinale dans les galeries afin d’honorer dans les temps impartis les commandes qui leur étaient faites, tout en assurant ensuite dans la journée des heures d’enseignement ou autres activités rémunératrices.
En 1868, Marie reçoit deux commandes, l’une qui lui est payée 1200 francs pour un portrait en pieds de l’Impératrice Eugénie mais dont nous ne savons rien de la destination. L’autre commande destinée à la chapelle de l’église St Eloi nouvellement construite à Paris est celle de la copie d’un tableau de Lesueur représentant Jésus apparaissant sous la figure d’un jardinier à Marie-Madeleine[2].
En Bretagne, l’église de Plouha -22- reconstruite en 1860 recèle également une copie de « Christ cruxifié » par le peintre espagnol Vélasquez de la main de Marie. Elle est encore visible de nos jours dans l’une des chapelles. (visite et photo M-F B en 2023)
On peut citer, parmi les articles sur les femmes artistes et les jeunes femmes peintres copistes, celui que publie le critique Léon Lagrange en 1860 à propos de la nécessité de cantonner chaque sexe dans les pratiques qui lui conviennent et qui se clôt sur l’idée qu’au fond, la présence des femmes dans les arts est globalement néfaste:
recèle également une copie de « Christ cruxifié » par le peintre espagnol Vélasquez de la main de Marie. Elle est encore visible de nos jours dans l’une des chapelles. (visite et photo M-F B en 2023)
On peut citer, parmi les articles sur les femmes artistes et les jeunes femmes peintres copistes, celui que publie le critique Léon Lagrange en 1860 à propos de la nécessité de cantonner chaque sexe dans les pratiques qui lui conviennent et qui se clôt sur l’idée qu’au fond, la présence des femmes dans les arts est globalement néfaste:
« N’y a-t-il pas déjà des femmes peintres, et n’y en a-t-il pas déjà trop ? Allez au Louvre un jour d’étude ; ce ne sont que jupons perchés sur les échelles, ce ne sont que mains féminines brossant avec ardeur d’immenses toiles, dont le moindre inconvénient est de populariser les fadeurs du Guide et de Mignard, aux dépens des saines beautés de Raphaël et de Poussin. » [3][1] Base Joconde dossier Marie Bracquemond F/21/169 [2] Duplessy, Eugène (1860-1939). Paris religieux. Guide artistique, historique et pratique dans les églises, chapelles, pèlerinages et oeuvres de Paris.1900.
Les amies possibles de Marie à Paris avant son mariage
Les jeunes femmes qui suivent ont eu des trajectoires différentes. Certaines comme Marie Bracquemond, Berthe Morisot et Eva Gonzalès ont pu mener leur carrière même après leur mariage alors que d’autres comme Edma Morisot ont totalement abandonné les pinceaux une fois mariées. Victoria Dubourg n’est plus qu’une ombre cachée par le nom de Fantin-Latour tout comme Estelle Gautier aquarelliste ou encore Pauline Croizette peintre et miniaturiste tombées dans les oubliettes de l’histoire de l’art comme tant d’autres artistes femmes. D’autres, veuves ou célibataires ou ayant mené une vie plus libre, hors des convenances comme Adèle Colonna d’Affry, Mary Cassatt ou Judith Gautier ont réussi à connaître une certaine gloire dans leurs domaines respectifs mais qui connait Julia Mullem ou Mûlheim? Marie Blanc, Joséphine Houssay ? Victorine Meurent qui fut modèle pour des amis de Marie, Manet, Stevens profite depuis peu de la recherche sur les peintresses du 19ème pour se voir reconnue en tant qu’artiste.
Toutes ces femmes auraient pu figurer sur un tableau à la manière de celui de Fantin-Latour regroupant ses compagnons artistes dans une composition faisant exclusivement l’apologie du masculin.
Judith Gautier, écrivaine et musicienne et Estelle Gautier-Bergerat, peintre
Judith fille ainée de Théophile Gautier et Ernesta Grisi est née en 1845 et sa jeune sœur Estelle en 1848.En 1867 sous le pseudonyme de « Judith Walter », Judith Gautier publie « Le collier de jade ». Elle et sa sœur Estelle avaient appris le chinois avec un réfugié hébergé par leur père. Ce livre par la suite réédité et illustré par Lucien Pissarro, un autre proche des Bracquemond, connut un grand succès dès sa parution et nous pouvons penser que le modèle du tableau de Marie intitulé tantôt « La Mandarine », tantôt « La Japonaise » est le portrait de sa jeune amie Judith. Grande, mince au teint très clair et avec une longue et épaisse chevelure noire, la jeune femme adorait se déguiser et n’avait pas besoin de s’affubler d’une perruque comme Camille Doncieux, compagne et modèle de Claude Monet avant de devenir son épouse en 1870 et qu’il représente en costume de japonaise en 1875. Judith avait découvert la culture japonaise en 1862 à l’exposition universelle de Londres où elle s’était rendue avec son père puis le Japon avait conquis les français lors de l’exposition universelle de Paris en 1867.
Marie fait en 1867 le portrait d’une joueuse de luth à manche court, le « Biwa » que les japonais ont créé à partir d’un instrument chinois. Quelque peu fantaisiste, le décor est plus japonisant que chinois. Les couleurs sont chaudes et lumineuses.
Quand les hommes comme Félix Bracquemond et ses amis sont présentés comme quasiment les découvreurs du Japon, c’est oublier qu’en parallèle sinon même antérieurement, des femmes comme Judith et Estelle s’intéressaient à l’Asie et ses différentes cultures.
Estelle Gautier la plus jeune des deux sœurs peignait et réalisait des pastels après avoir été formée à l’Ecole impériale de dessin des sœurs Bonheur. A ce jour, malgré les recherches de ses descendants, il est impossible de trouver une de ses réalisations et d’avoir une idée de sa production. Elle exposa pourtant au salon des femmes artistes à plusieurs reprises dans les années 1880 et à la galerie Berheim jeune en 1891. Elle est l’épouse d’Emile Bergerat, rédacteur en chef de la revue La Vie moderne dans laquelle paraissent des gravures de Marie Bracquemond et de son époux Félix ce qui conforte l’idée de liens serrés entre ces jeunes femmes.
Berthe Morisot peintre
Rien ne transparaît dans les biographies d’une amitié entre ces deux artistes or tant de points les réunissent qu’il est d’évidence que durant leurs vies Marie et Berthe se sont fréquentées même si cela n’est pas allé jusqu’à l’amitié. Pour la dernière exposition des impressionnistes en 1886, elles sont les deux seules femmes peintres exposantes[1]. Et pourtant Dominique Bona mentionne les courriers entre Berthe et une amie restée anonyme laissant la porte ouverte à la réalité de notre idée.
Berthe Morisot et sa sœur Edma ont vécu une vie de jeunes bourgeoises à Passy mais leurs parents ont voulu pour leurs filles une formation de qualité et leurs talents et volonté ont fait le reste les propulsant au devant de la scène artistique. Les mémoires du peintre J. E. Blanche qui les a fréquentées durant sa jeunesse replacent un certain nombre de choses, en particulier il inverse à l’avantage de Berthe Morisot la problématique de l’inspiration entre Edouard Manet et la jeune artiste ce qu’un historien ne peut s’empêcher de trouver « curieux ». Louis Vauxcelles écrit ainsi à propos de Berthe Morisot :
- « A ce propos il convient de noter la curieuse remarque de M. Blanche, observant que Berthe Morisot a bien plus influencé son illustre beau-frère qu’elle ne se soumit à sa discipline. C’est elle la première du groupe impressionniste qui, peignant en son atelier-salon de la rue Villejust éclairé non du Nord mais du plein midi, adopta la lumière « décolorante », supprimant les oppositions d’ombre et de demi-teinte, choisissant résolument pour y détacher ses figures, une égale valeur claire. »[1]
Dans le cas des femmes, c’est une position toute masculine de ne voir qu’une direction descendante de l’homme comme le maître dépositaire du savoir et le distribuant envers les femmes qui sont systématiquement cantonnées dans une posture infantilisante d’élèves. Merci à l’écrivain d’art et peintre portraitiste Jacques-Emile Blanche de reconnaître la créativité et l’originalité de Berthe Morisot et ses consœurs.
Le peintre Degas également estime que Manet s’est fréquemment inspiré d’autres artistes.Berthe reçut également pendant six mois des leçons de sculpture d’Aimé Millet un fervent républicain ami de ses parents. Souvent il est évoqué l’amitié des Morisot avec le peintre Jean-François Millet mais son homonyme fut aussi présent dans la formation de la jeune femme. Selon Dominique Bona, M. Morisot et son fils auraient été politiquement du côté des conservateurs mais les amitiés du père de Berthe sont très éclectiques et bien souvent engagées à gauche.
[1] Louis Vauxcelles, Histoire générale de l’art français de la Révolution à nos jours, Paris, 1923. [1] Le nom de « Marquise de Rambures » est parfois cité mais sans que les œuvres exposées soient mentionnées.La comtesse Colonna née Adèle d’Affry sculptrice et peintre
Nous faisons l’hypothèse que cette artiste, tout d’abord sculptrice sous le nom de «Marcello» puis peintre lorsque la tuberculose l’affaiblit, est très proche de Marie Bracquemond. Nous voyons son portrait dans la gravure à l’eau-forte de Marie titrée « Le Peintre » où une jeune femme perchée sur un haut tabouret s’atèle à une composition d’envergure qui pourrait être le tableau d’Adèle Colonna intitulé « La conjuration de Fiesque » et qui fut refusé au salon de 1878.
Mary Cassatt peintre
Cette jeune américaine qui fréquente le peintre Degas est représentée par ce dernier dans un tableau ne la mettant absolument pas en valeur, penchée en avant et ayant des airs de diseuse de « bonne aventure », tableau qu’elle détestait. Sa chevelure blond vénitien, ses yeux clairs nous ont laissé à penser un temps qu’elle aurait pu être l’une des « Trois Grâces » figurées par Marie Bracquemond. Selon des descriptions de contemporains, Mary était maigre, « mesurait autour d’un mètre-soixante-dix et avait les cheveux châtain clair et un menton pointu » et dès lors que nous avons trouvé cela, nous avons éliminé cette possibilité car les compagnes qui entourent Marie Bracquemond sont de taille plus petite que la sienne.
Thérèse et Rosalie Riesener, peintres
Thérèse née en 1840 et Rosalie née en 1843. Ces deux sœurs qui n’ont pas poursuivi de carrière artistique étaient très proches des sœurs Morisot puis de Marie Cassatt.
Au nombre des couples de sœurs pouvant avoir inspiré Marie pour son tableau porteur du titre « Deux sœurs » nous envisagerons tout comme pour les sœurs Grisi ou les sœurs Morisot qu’elles aient pu servir de modèle à Marie.
Victoria Dubourg peintre de fleurs, musicienne, pianiste
Autre étrangeté à ce jour jamais relevé par les biographes de Fantin-Latour qui laissent plus ou moins de côté sa talentueuse épouse Victoria Dubourg, Victor, le père de celle-ci puis sa mère, Françoise Bienvenu, vivent et décèdent tous deux dans les années 1890 à cette même adresse du 19 rue de l’université dans le 7ème arrondissement. Nous ne pouvons nous empêcher de penser à des liens très privilégiés entre les deux jeunes femmes et leurs familles. Coïncidence: Marie et Victoria sont toutes deux nées le même jour, le 1er décembre 1840. La première dans un couple légitime mais qui se défait peu de temps après sa naissance alors que Victoria naît hors mariage, et ses parents régularisent leur union en mars 1843. Toutes deux ont des sœurs plus jeunes d’une dizaine d’années qui leur serviront de modèles. Le père de Victoria et Charlotte est docteur en médecine et a exercé un temps en Allemagne à Francfort au moins jusque vers 1864 car il est mentionné dans la London gazette du 15 avril pour son invention « Improvements in gas burners ». La famille Dubourg ne serait donc revenue à Paris qu’après cette date mais je n’ai pas trouvé leur adresse. Ce n’est qu’après 1873 qu’ils s’installent au 19 rue de l’Université reprenant peut-être le logement laissé vacant par le départ pour Sèvres de Marie, son époux et leur fils Pierre avec Louise sa demi-sœur trois ou quatre ans après la naissance de Pierre. C’est l’adresse de Victoria lors de son mariage avec Fantin-Latour.
Tout comme Mary Cassatt, Victoria est peinte par Edgar Degas dans une posture ne la mettant absolument pas en valeur, l’air affalée en avant et vêtue d’une robe marron lui donnant l’air d’ « un gros tas ». L’amitié de Degas prend d’étranges détours pour les femmes de son groupe d’artistes car entre autres, Edouard Manet choqué par le portrait que Degas fit de lui et de son épouse Suzanne Leenhof découpa la toile pour supprimer le profil de cette dernière. Marie Bracquemond semble avoir échappé à son pinceau peu bienveillant car nous ne connaissons pas de portrait d’elle par Degas. Un courrier entre….. laisse sous-entendre que Marie n’appréciait pas plus que cela le vieux maître.
[1] Marie Bonne Emilie Troué née à Sens-Yonne- le 14 juillet 1822. Travaille à la Banque de France à Paris entre 1872 et 1881. Elle épouse Napoléon Vincent Berecki, conducteur des ponts et chaussées né le 28 mai 1808 à Vingrany (Pologne) Décédé le 17 août 1877. Ils ont deux enfants. [2] Annuaire du commerce et de l’industrie 1864, p.1214. [3] Annuaire-almanach du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration : ou almanach des 500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers : Firmin Didot et Bottin réunis, Paris, 1870.[4] Madame Louise Thoret, également connue comme copiste sous le nom de Mademoiselle Gauldrée-Boilleau. Née le 9 décembre 1828 –vue 241- chez ses grands-parents maternels à Toulouse (31). Décédée le 3 septembre 1912 – Cherbourg (50), à l’âge de 83 ans ; Artiste peintre, directrice de l’Ecole de dessin de la rue du Vieux-Colombier. Mariée le 20 mars 1854 avec François Charles Thoret polytechnicien. Son père Jean-Baptiste-Charles Gauldrée – Boilleau (9 Novembre 1782 Saint-Omer- 4 Decembre 1857 Paris ) avait dirigé le régiment d’artillerie à pieds de Rennes de 1816 pendant quelques années.
Victorine Meurent 1844-1927
Victorine Louise Meurent est connue pour avoir été le modèle de Manet et avoir commencé à poser pour lui en 1862 mais également avoir été une peintresse reconnue au XIXème. Je me suis plongée aussi dans sa biographie mais encore une fois beaucoup d’incertitudes ou de propos sur sa formation la positionnant en dépendance par rapport à ceux qui la faisaient poser dans leurs ateliers: Alfred Stevens, Manet, tous des proches des Bracquemond et il me semble donc que les unes comme les autres de ces femmes avaient au minimum entendu parler les unes des autres. Je m’interroge sur une amitié possible entre Victorine et Marie et pose au nombre des hypothèses du tableau « Portrait à la croix » conservé à Rouen celle que Victorine soit l’autrice de ce portrait de Marie. Pour cela je mets en comparaison la touche du portrait de Victorine « autoportrait présenté au salon en 1876.
Victorine est la fille de Jean-Louis-Etienne Meurent et Louise Thérèse Lemesre (selon l’acte de décès de Victorine). Son père aurait été brunisseur de bronze ou ciseleur et sa mère « blanchisseuse- modéliste » (sic modiste ou modèle?). Elle a pu recevoir un premier enseignement au dessin par son père. Elle est aussi musicienne et joue de la guitare ce qui dénote un milieu simple mais avec une certaine culture et ouverture au monde. Le biographe de Manet évoque également son intérêt pour la littérature et plusieurs artistes ayant fait poser Victorine à commencer par Manet l’ont représentée un livre à la main indiquant par cela qu’elle était sans doute une grande lectrice. Tabarant dit également que toute jeune elle dessinait cela même avant de peindre.
Marie. Les expositions de 1857 à 1869
Des dates qui ne coïncident pas toujours1859 « Portrait de la famille de l’auteur ». n° 2328
-
- Pasquioux Antonine Marie née à Alby(sic) Tarn; élève de MM. Vassort et Ingres ; à Etampes rue Saint Jacques 72 et à Paris chez M. Faubonne, rue de L’arbre-sec, 6 ; n° 2328 « Portrait de la famille de l’auteur »[1].
1862
Un tableau présenté dans un article de J-P. Bouillon nous permet de mettre un visage sur Aline Pasquiou représentée par sa fille en tenue de deuil. Il n’est malheureusement pas daté mais signé « Pasquiou-Quivoron », il pourrait alors correspondre à l’un des tableaux exposés par Marie au salon de 1865 sous le simple titre « Portrait » ou « Portrait de femme » et témoigner de la perte par Aline Pasquiou de son ami Vassor ou encore de celle de son fils Emile.
Les deux femmes se ressemblent beaucoup, brunes aux sourcils fournis, traces au niveau des populations côtières des échanges commerciaux entre la Bretagne et le Sud comme il en existe en toponymie : « La pointe des espagnols » ou autres dénominations. Marie a cependant un visage plus rond que sa mère dont les traits sont quelques peu durs avec de hautes pommettes et une grande bouche. 

Une photographie représentant une femme brune en noir avec une mantille est supposée depuis le catalogue de l’exposition de 1919, être un portrait de Marie et figure comme tel dans le dossier de la BnF ou Wikipedia. Cette photographie est parfois estimée dater autour de 1890, or un détail vestimentaire comme celui des manches bouffantes évoque plus la mode féminine antérieure à 1865, année qui voit un grand changement du costume féminin. Marie Bracquemond ne saurait porter un tel costume dans la maturité. De plus le décor est celui de l’atelier du photographe Eugène Disdéri qui utilise cette colonne tronquée avec un macaron à visage de femme entre 1857 environ et 1861/1863 pour ses mises en scènes.
La photographie pas plus que la tenue vestimentaire austère et sombre n’évoquent une jeune fille entre dix-sept et vingt-un ou vingt-deux ans. Ce serait selon nous, un portrait de sa mère Aline car très proche du tableau mentionné ci-dessus. Je trouve en mars 2020 une image illustrant un article de Louis Vauxcelles à propos de l’exposition de 1919 et étrangement alors qu’il s’agit de la même femme que sur la photographie, celle de la revue est plus nette. Le visage de la femme y est plus rond, la bouche également lui donnant un air plus jeune et offrant une réelle ressemblance avec par exemple le portrait de Marie par Félix Bracquemond figurant au début de cet article. Mais il était courant à l’époque que les photographies soient retouchées rendant plus complexe l’identification des personnages.
1863
Marie n’est pas mentionnée dans le numéro conservé à la BnF de la Revue nationale et étrangère politique scientifique et littéraire qui ne concerne que le début de l’année 1863 et est donc antérieur au Salon.1864: « Deux sœurs, portrait »n°1482.
Au Salon dite « élève de Signol et Laugée », Marie expose « Deux sœurs », portrait apprécié par le critique Charles Asselineau qui commente le Salon de 1864 dans la Revue nationale et étrangère politique scientifique et littéraire
« Je ne veux pas manquer non plus de mentionner un très beau portrait de mademoiselle Marie Pasquioux(sic); le modèle est fort joli et la peinture a une décision et un entrain qui manque ordinairement au talent des femmes »
[2]. L’ouvrage de compilation paru en 1977 pour les Salons de 1673 à 1881 donne pour l’année 1864 le tableau « Deux sœurs, portraits » par Mlle Pasquioux (Marie Antoine ( née à Albi, élève de Laugée), n°1482.
Et j’interroge l’hypothèse que son tableau « Deux sœurs » exposé au salon de 1864 si ce n’est Marie et sa sœur Louise, pourrait être la représentation de Victoria et Charlotte mais elles sont peut-être encore en Allemagne à l’époque. Une autre hypothèse m’oriente vers la piste des sœurs Gautier Judith et Estelle, filles de Théophile et Ernesta Grisi qui font partie des mêmes cercles. Elles resteront des proches de la famille Bracquemond jusqu’au niveau de la fille de Pierre, Marthe, organiste et compositrice. Cela pourrait également correspondre aux sœurs Gonzalès, Eva et Jeanne….
1865: « Portrait de madame D. » n°1655 et « Fleurs de lin » n°1656
Marie se déclare « élève de Signol, Laugée et Merle » se désengageant totalement d’une référence à Ingres. Dans certains catalogues le titre proposé est simplement « Portrait de femme » . Qui peut-être cette « Madame D. » ? Madame Durand épouse de Charles dit Carolus Durand? , madame Durand dit de Neuville ou un portrait de commande? ….. L’initiale ne correspond pas aux patronymes de sa mère Aline Pasquiou/Perrein épouse Quivoron et doit donc correspondre à un autre modèle En 1865 suivant un autre catalogue c’est cette année là que Marie expose le tableau « Le supplice de Tantale » donné comme exposé en 1867. En 1865 Zola publie un article sur « Germinie Lacerteux ».1866: « Portrait de M+++ », n°1500.
Tel que noté le portrait devrait être celui d’un homme? Pothey en 1868 note simplement « Portrait » Tout comme le catalogue précédent, Emile Zola dans sa critique du Salon de 1866[3] mentionne :- Pasquiou-Quivoron, (Mlle. Marie) 1bd d’Enfer, catégorie peinture : 1500 – Portrait de M****.
En 1866 son futur époux Félix Bracquemond expose sous le numéro 252, le portrait de facture très classique de « Madame Granger-Meurice ». Manet, Zola fréquentent également dans ces années le salon artistique et littéraire de madame Meurice musicienne de talent mais qui est également peintre.
1867, « Le Supplice de Tantale », n°1186, tableau non localisé.
- « Le supplice de Tantale » catégorie peinture n°1186, Pasquiou-Quivoron (Melle Marie), 1 bd d’Enfer, élève de MM. Signol, Laugée, Merle[4]. Pourrait-être une scène animalière.
- « La Japonaise » tableau signé et daté de cette année 1867 est exposé quelques années plus tard au salon de Vichy en août 1870 sous le titre « La Mandarine »[5] et fut considéré par le critique local comme « la plus belle pièce de l’exposition ».

On y retrouve des ressemblances avec ses premiers tableaux de style troubadour comme le traitement du sol, un certain maniérisme du sujet et toujours un très grand sens de la couleur. Le peintre Alfred Stevens réalise un tableau dans le même esprit japonisant avec un travail des tissus et également des couleurs franches et brillantes. Son personnage est plus sinueux mais les couleurs sont toutes aussi chargées en pigments. ‘photo dossier M.B. Orsay
Un peintre dont le nom revient dans la biographie des Bracquemond, Gustave Jundt expose lui aussi au salon de Vichy[6] un tableau dont le titre n’est pas sans rappeler l’un de ceux de Marie Bracquemond « Marguerite » et représente une jeune fille couronnée de bleuets. Je remarque que nombre de tableaux de Marie portent des titres identiques à ceux d’autres artistes de son entourage ce qui dénote peut-être une imagination et inventivité limitée de sa part.
1868 « Cervantès concevant Don Quichotte dans sa prison », tableau
Attention deux numéros différents : 1927 ou 418, différence suivant qu’il d’agit d’une huile sur toile ou d’une eau-forte ? Son tableau est remarqué par plusieurs critiques. En 1868, le critique d’art Pothey écrit à son propos un article élogieux dans la revue Les Salons, dessins autographes : Exposition des beaux-arts, Paris, sur le tableau de Cervantès concevant Don Quichotte dans sa prison :Nous remarquons que la ponctuation sème le doute sur les datations en particulier celle du « Supplice de Tantale » et que les titres sont imprécis. Ernest Fillonneau écrit dans le Moniteur des Arts du 22 mai 1868 un article sur Melle Pasquiou-Quivoron:Le tableau satirique de Mlle Pasquiou-Quivoron nous représente l’illustre écrivain, qui de son temps était appelé calomniateur et misérable, évoquant ce type de loyauté, d’humanité et de bonne foi accompagné de son serviteur si bon, si gai, si sage(…) Absorbé par une énorme contention d’esprit, Cervantès dans une attitude pleine de naturel aperçoit les deux figures de ses héros penchés sur leurs célèbres montures (…) Ce charmant tableau appartient à M. Damas-Hinard dont on connaît le goût juste et sain pour tout ce qui concerne les Beaux-arts. Professeur de dessin dans les écoles de la ville de Paris, élève distinguée de MM. Signol et Laugée, Mlle Pasquiou-Quivoron a exposé au Salon de 1864 : « Deux sœurs, portraits » et en 1865, « Portrait de femme » (sic); « Fleurs de lin » en 1866 (donc des fleurs bleues). Un « Portrait » en 1867. « Le supplice de Tantale ».[7]
Une jeune et habile artiste que les amateurs ont vu depuis quelques années travailler assiduement au Louvre a exposé un « Don Quichotte » . Ce tableau que lui a acheté immédiatement M. Damas-Hinard […] brille par une légèreté de touche, une solidité de couleur et une vérité de tons qui l’ont déjà fait remarquer(quoique trop petit de cadre selon nous et placé trop haut par un grand nombre d’appréciateurs distingués…Henri Rochefort du Figaro mentionne dans sa critique le même tableau :
-
Je vois sous le numéro 1927 un tableau signé de mademoiselle Pasquiou-Quivoron et représentant Cervantès dans sa prison concevant Don Quichotte, lequel tableau très fin de ton et peint avec une énergie bien rare dans un pinceau féminin ne contient aucune guitare[9].
Au salon de 1867 ou 1868 Marie expose une eau-forte[10], « Le rêve de Cervantès » (n°418)
1868
Marie n’expose pas? Suivant le catalogue du salon de 1868 Marie n’apparaît ni au patronyme Pasquiou ni à celui de Quivoron et donc attention à certaines datations. Par contre nous relevons le nom d’une jeune fille de Saint-Fréjoux, la jeune Antoinette de Serravalle. Elle est la fille d’Hersilie Bourlin, la propriétaire de Bonnaigue où Marie passa une partie de son enfance. Antoinette ne fait référence à aucun « maître » et présente deux portraits. A la rubrique dessin, un portrait de son frère aux deux crayons (n°2594) et en peinture un portrait de « Mlle Marie M ». Ce qui pose question c’est que dans la correspondance de Théophile Gautier, tome 10, 1868-1869, p.[11] il est mentionné « un portrait de Mlle Marie P. » et je n’ai pu m’empêcher de faire l’hypothèse qu’il s’agissait de « Marie Pasquiou » et que les mères des deux jeunes filles avaient gardé des liens très forts malgré les malversations d’Emile Langlois qui avaient abouti à la reprise du domaine par Hersilie Bourlin et son époux de Serravalle.
Hélène de Sahuguet d’Amarzit d’Espagnac expose également sous son nom d’épouse, Durand.1869 : année de son mariage
Le Salon s’ouvre au printemps 1869 quelques mois avant son mariage et au catalogue[12] Marie figure dans la catégorie « dessins, aquarelles… »,
- Melle Pasquiou Marie élève de Laugier(sic ? Laugée?) et Signol, 19 rue de l’université, n°3028 « portrait de Mlle L. ».
La toile provient de l’atelier du marchand parisien de toiles à peindre et couleurs fines « Deforge »[14] ce qui daterait son acquisition plus aux alentours de 1863 et de fait peut-être la réalisation du tableau au milieu des années soixante sinon avant, la maison devenant « Carpentier successeur Deforge » après 1865. Le critique d’art[15] de la Revue de la Normandie commentant le salon de Rouen ironise sur la figure des personnages et en particulier du jeune page mais reconnaît à l’artiste un don pour le travail de la couleur.
Le numéro inscrit sur le tableau est le 463 et ne correspond pas à celui cité par la revue, le 288 mais est celui de l’entrée du tableau dans les collections du musée. 1869 Tableau « Lecture sous Charles VIII » n°287Transportons-nous à la cour d’Ysabeau de Bavière et demandons à Mlle Marie Pasquiou de quoi rient si narquoisement son riche fauconnier et sa superbe dame (n°288). Le fauconnier trouverait-il que sa compagne a un peu l’air d’une fermière cauchoise endimanchée ? Et celle-ci se dirait-elle que la pose dégingandée et les chausses à la poulaine du jeune seigneur auraient un riche succès à la foire de Saint-Cloud ? Mystère. Toujours est-il que si la mise en action pêche la couleur est chaude et la touche fine.[16]
De la même période et dans un style similaire date le tableau au décor médiéval représentant une femme en hennin allongée devant une grande cheminée de style renaissance d’où monte un filet de fumée. Elle écoute un jeune page lui faire la lecture. Les couleurs sont chaudes et le personnage du page en tenue plus sombre participe à la mise en profondeur. Le peintre A. Besnus, ami de Marie, commente le Salon cette année-là et lui consacre quelques mots :
« Une lecture sous Charles VII, petite toile d’une coloration discrète bien appropriée au sujet par madame Bracquemond ». [1] Salon de 1875 par Amédée Besnus, Alcan-Lévy, Paris, préface d’Eugène Montrosier, p.26.
Le titre « La lecture » et le numéro 287[17] laissent à penser que ces deux tableaux de style troubadour ont été conjointement exposés sans doute tous les deux à Rouen en 1869, seul le premier ayant été retenu par le comité d’organisation pour être au tirage de la loterie organisée. Le second, aurait été exposé de nouveau au Salon en 1875 sous le titre « La lecture » selon Jean-Paul Bouillon. Dans les deux tableaux, Marie fait preuve de son habileté à traiter les différentes matières, bois, pierre, tissus et fourrures à la manière des maîtres anciens mais ces deux tableaux historiques n’ont rien à voir avec ce qu’elle pratique après 1870.
« Portrait de jeune fille » : Louise ?Louise ne ressemble pas du tout à Marie qui est brune aux yeux bruns comme leur mère. Châtain clair aux yeux gris-bleu, avec un nez un peu épaté, Louise sert fréquemment de modèle à Marie tout comme ce fut le cas pour d’autres femmes peintres qui trouvaient dans leur entourage familial les modèles qu’elles ne pouvaient payer. Le tableau de Louise sur un fond assez sombre est vivant animé avec un côté intimiste et nous offre le visage d’une jeune fille au sortir de l’adolescence regardant la vie avec assurance. Nous situerions sa réalisation dans les années 1862/1863 vu l’âge du modèle. Déjà Marie montre son plaisir à reproduire les tissus et son travail de la couleur blanche.
[1] Explication des ouvrages de peinture et dessins, sculpture, architecture et gravure des artistes … Salon. Numéro du 13 avril 1859 dans la catégorie Peinture, page 288Pourquoi Rouen ? Quels réseaux font que Marie expose dans cette ville ? Son amitié avec Monet qui revenait souvent dans sa famille à Rouen ou chez sa tante à Sainte-Adresse. C’est en 1867 qu’il peint le tableau « La terrasse à Sainte Adresse ».
? Des amitiés féminines non identifiées ? L’épouse de Toulmouche née Lecadre qui est une parente de Claude Monet ? [2] Revue nationale et étrangère, politique, scientifique et littéraire / publiée par M. Charpentier, Éditeur : (Paris), 1864-0, T XVII, mai 1864, p. 298 ; Gallica [3] Emile Zola Paris, Salon de 1866, Explication des ouvrages de peinture exposés au Palais des Champs-Elysées le 1er mai 1866. [4] Explication des ouvrages de peinture et dessins, sculpture, architecture et gravure des artistes vivans…Salon des artistes français. 13 avril 1867. [5] Reproduction photographiée dans le dossier Marie Bracquemond du service de documentation du musée d’Orsay.Fiche Orsay date 1867 signée M. Pasquiou-Quivoron ; 71×42,5 cm. Toile vendue en 1998 au Royaume-Uni ; [6] Le Constitutionnel, 7 août 1870, Louis Enault, Les arts en province. [7] Les Salons, dessins autographes : Exposition des beaux-arts, Paris, 1868, A. Pothey, Éditeur : Joseph Kugelmann (Paris), 2 août 1868, 160 pages de croquis originaux. P. 123-124.Gallica [8] Catalogue des objets d’art et d’ameublement, bijoux, orfèvrerie…, bronzes, sièges, meubles…, dont la vente [aura lieu] par suite du décès de madame veuve Charles Poussielgue… / [expert] Mannheim – 1909. Gallica. Charles Poussielgue 1840-1903, Rue de Cassette, 15, Paris 6ème arr ; libraire-éditeur. [9] Figaro, Journal non politique du 25 mai 1868. [10] Idem [11] Lettre du 8 mars 1868 de Louis Bellaguet à Th. Gautier pour recommander « Antoinette de Serravalle fille d’un ami qui débute cette année 1868 au salon ». Correspondance de Théophile Gautier T. 10, 1868-1869 (p.90-91) [12] Page 420 du catalogue de 1869 [13] Le tableau comporte en bas à gauche le n°463 or le critique d’art local note comme numéro le 288. [14] Renseignement figurant sur la fiche aimablement transmise par le musée des Beaux-arts de Rouen. [15] E. Lepinois, La revue de la Normandie, 1869, T1, p.313 [16] Idem [17] A un chiffre près c’est celui du tableau « Fauconnerie », 288. Auraient-ils été exposés conjointement ?Marie, son mariage, Paris
Marie Bracquemond de 1869 à 1872 Paris
Marie épouse l’artiste peintre et graveur, Félix Bracquemond qui lui aurait été présenté par le peintre Amédée Besnus, un ami commun, ancien élève d’Auguste Vassor. Aline Pasquiou selon Pierre Bracquemond n’aurait pas envisagé d’un bon œil l’union de sa fille avec Bracquemond sans que les raisons nous soient connues.
![Bracquemond Félix 1868 par in L'Artiste___journal_de_la_[...]_bpt6k4860974](https://ellesaussi.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/03/bracquemond-felix-1868-par-in-lartiste___journal_de_la_._bpt6k4860974.jpeg?resize=438%2C438) 1868 Félix Bracquemond par son ami le graveur Rajon
1868 Félix Bracquemond par son ami le graveur Rajon
Par son mariage, Marie Quivoron devient Marie Bracquemond et signe désormais ainsi ses œuvres. Le 5 août 1869, le couple se marie à Paris en l’église de Saint Thomas d’Aquin dans le 7ème arrondissement, entouré de très nombreux amis du monde des arts et de la littérature mais sans doute aussi de Bretagne et de Corrèze.
Le célèbre aquafortiste Félix Braquemond, dont le talent a illustré les œuvres de tant d’hommes de lettres, se marie il épouse Mlle Quivoron C’était hier le mariage de M. Bracquemond avec Mlle Marie Quivoron. (A midi St Thomas d’Acquin voyait arriver une foule de peintres, de littérateurs .. et d’amis des mariés si sympathiques tous les deux ) Mlle Marie Quivoron aussi fait de la peinture, et ce sera un vrai ménage d’artistes.
- Les témoins sont Edmond Pénauille artiste peintre, 39 ans; Emile Renard artiste peintre 40 ans demeurant à Sèvres 9 rue Brongniard. Ces deux premiers selon l’usage seraient les témoins du marié et les deux suivants ceux de Marie: Désirée Laugée artiste peintre 46 ans, chevalier de la L.H., demeurant bd Lannes à Passy-Paris 16ème et Amable Ferdinand Sauvage employé, 43 ans, 116 rue de Grenelle. Ce dernier travaille donc à la mairie du 7ème arrondissement et n’a pas de liens avérés avec Marie ou sa famille laissant entrevoir un certain isolement social en tout cas du côté masculin.
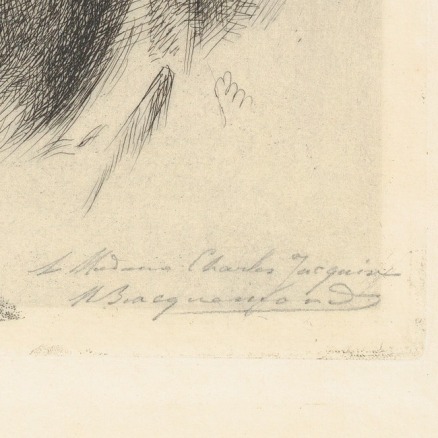 Signatures et monogramme de Marie après son mariage
Signatures et monogramme de Marie après son mariage
Le jeune couple s’installe dans l’appartement du 19 rue de l’Université où Marie vivait précédemment avec sa mère et sa demi-sœur Louise. Il semble que ces dernières se soient installées dans l’hôtel de Bourgogne rue de l’Ecole de Médecine, puis réfugiées en province car le jeune couple y vit seul lors des événements de 1870. Lors de la guerre de 1870, Théophile Gautier et ses deux sœurs logent également rue de l’Université.
Au 19 rue de l’Université ils ont pour voisin le peintre Léon Mayer et Marie continue d’enseigner le dessin. Non loin dans la rue vit Antoine Lascoux juge d’instruction qui a poursuivi le salon musical que tenait son père et où se retrouvaient de nombreux peintres amis de Bracquemond et son épouse qui eux aussi appréciaient Wagner. Fantin-Latour, Bazille, Maître, venaient y écouter jouer Schuman, Brahms et Wagner .
Une fois mariée, Marie ne devient pas uniquement une femme au foyer mais poursuit ses activités professionnelles. Son époux est alors vu par l’un de ses amis comme un homme avenant, de bon caractère ne ressemblant pas à l’homme déjà âgé, souffrant et au caractère emporté de type « soupe-au-lait », sinon même violent verbalement envers ses amis. C’est ce qui est le plus souvent retenu par les biographes suite aux écrits de son fils Pierre rapportant des discussions dominicales vives et animées entre Félix et ses invités.
Un grand nombre d’écrits récents reprennent des propos plus anciens en les amplifiant, les tordant pour donner de Marie l’image d’une artiste sans force de caractère, brimée par son époux mais pourtant d’autres parlent de sa fierté laissant à entendre qu’elle avait conscience de son talent même si elle gardait une certaine modestie seyant à son statut d’épouse dans la société bourgeoise du 19ème siècle.Bracquemond sur le plan des affinités politiques est proche des républicains et porta intérêt au positivisme d’Auguste Comte qui tout comme le fouriérisme donne une place privilégiée à la femme et il faut reconnaître que Marie a pu poursuivre sa carrière sans être obligée d’abandonner sa pratique artistique. Selon moi les causes de son repli tardif sont à creuser. Côté artistique Bracquemond abandonne la peinture pour se consacrer à la gravure dont il devient l’un des maîtres. Son réseau amical est vaste et il fréquente les cafés à la mode avec ses très nombreux amis. En cela son modèle de vie est conforme à de nombreux bourgeois du 19è siècle qui vivent deux vies en parallèle et après leurs sorties entre hommes retrouvent leurs épouses au foyer familial. Félix et Marie au début de leur union sont un jeune couple menant une vie animée en compagnie de leurs très nombreux amis et amies bien loin de ce que retiendra leur fils Pierre des années plus tard. Ils participent tous deux à des sorties au théâtre, à des soirées déguisées, des concerts et fréquentent les salons à la mode. Ils aiment la musique et tout particulièrement Berlioz et mènent une vie à mi-chemin entre bohême et bourgeois établis.
Lorsque Félix Bracquemond apprend qu’il va être père, il est ravi et créé pour le futur enfant un lit décoré. Le 21 juin 1870, Marie met au monde un fils, Pierre Jacques. A la mairie du 7ème arrondissement lors de la déclaration de naissance, Félix est accompagné de deux hommes dont les prénoms respectifs sont donnés au garçonnet, « Pierre » comme Pierre-Edmond Hédouin, un peintre lithographe né en 1820 en Normandie et qui réside au 68 de la rue de l’Université et en second « Jacques » comme Jacques Guiot, trente-et-un ans, employé de la mairie du 7ème arrondissement de Paris, 116 rue de Grenelle. Ceci laisse à penser au peu de choix de la part de Marie pour les prénoms de son fils! La mère de l’enfant est désignée comme « sans profession » alors même qu’elle enseignait. Hédouin est un ami des peintres Adolphe Leleux et Charles Chaplin et surtout il pratique depuis 1845 la gravure à l’eau-forte et son talent est hautement reconnu. Il est possible que Félix Bracquemond ait bénéficié de ses conseils et lui montre sa reconnaissance en attribuant à son enfant le prénom de Pierre. Trois jours avant l’accouchement, le peintre Claude Monet pour lequel Marie éprouve un grand attachement, épouse sa compagne de longue date, Camille Doncieux et ils se réfugient ensuite à Trouville. Marie et Félix n’auront que ce seul fils et la santé de la jeune femme aurait été affectée par les conditions de la naissance. De ce constat il est souvent déduit qu’elle avait une santé fragile depuis l’accouchement. Mais est-ce cela qui fit qu’ils n’eurent qu’un enfant? La syphilis provoquait également stérilité masculine ou féminine ou encore des fausses-couches chez les femmes et parfois déficience intellectuelle ou handicap sensoriel chez les enfants. Ces moments intimes de la vie des femmes font rarement l’objet de l’histoire et pourtant combien d’entre elles ont vu leur vie impactée par ce fléau!
En mars 1871, Ernest le frère de Marie – que probablement elle n’a jamais rencontré- qui naviguait au commerce comme ses ancêtres bretons meurt à Gibraltar. En fut-elle touchée si elle fut au courant de ce décès ? Que lui avait raconté sa mère sur sa jeunesse et son mariage avec Théodore Quivoron et sur ce garçon qu’elle avait abandonné pour suivre son amant Emile Langlois ? Les nouvelles mettant beaucoup de temps pour faire le tour de la planète, celle du décès d’Ernest joua t’elle un rôle dans la disparition d’Aline qui meurt à Riom quelques mois plus tard en novembre 1871? 
Aline repose seule sous une toute simple pierre tombale dans l’ancien cimetière de Riom. Nous n’en saurons rien. Pourquoi Riom? Dans cette ville vit une famille ayant des alliances avec la ville de Lesneven en Bretagne. L’absence de renseignements sur Aline Pasquiou et son réseau amical nous limite dans la compréhension d’une grande part de la vie de Marie.
Louise semble avoir été très affectée par la perte de sa mère. La question se pose aussi de l’autre fils d’Aline et Langlois, Emile dont nous ne savons rien hormis sa présence à Etampes en 1861. Serait-il disparu lors des affrontements de la Commune de Paris ou bien aurait-il rejoint son père en Algérie? Encore le plus grand mystère de ce côté mais tout cela ne peut avoir été sans conséquences préjudiciables pour le psychisme de Marie bien qu’à cette époque elle soit portée par le positif de sa relation avec Félix son époux et la naissance de son fils Pierre.
La guerre contre les prussiens et la Commune bousculent la vie des Bracquemond. Leur amie Euphrosine Gilles, épouse du critique d’art Burty depuis 1864, raconte dans les souvenirs d’E. de Goncourt une anecdote qui se passa durant la commune et à laquelle Marie fut confrontée en tant qu’enseignante.Puis elle me raconte une scène brutale et stupide faite à Mme Bracquemond, qui est professeur dans une école de dessin, une scène faite, en présence de ses élèves, par un délégué et une déléguée de la Commune. Or, le délégué est un peintre en bâtiment, et la déléguée sa femme. Journal des Goncourt, 2ème tome.Cette famille Burty est au nombre des très proches amis des Bracquemond. Les deux filles du couple, Madeleine née en 1860 avant le mariage de ses parents et la petite Renée-Solange née le 13 juin 1868 ont peut-être servi de modèle à Marie pour certains portraits. Burty et sa famille sont intimement liés au collectionneur limougeois Adrien Dubouché qui est le parrain de la petite Solange et est lui-même proche de Jules Jacquemard. Renée-Solange meurt toute jeune mais sa sœur Madeleine comptera toujours beaucoup pour les Bracquemond.
 Madeleine Burty par Desboutin mine de plomb sur papier
Madeleine Burty par Desboutin mine de plomb sur papier
Marie et Félix vivent quelques années à Paris avec Louise. C’est à cette époque selon Janine Bailly-Hertzberg dans son Dictionnaire de l’estampe en France 1830-1950 paru en 1985 que Bracquemond réalise une eau-forte représentant les deux sœurs au jardin d’acclimatation. La première épreuve est en noir et blanc mais en 1873 il réalise un tirage expérimental en couleur. Marie y apparaît vêtue de sombre admirant des faisans dans un enclos alors que Louise vêtue de blanc se tient en retrait, l’air triste et absent.


Toujours au fait des modernités, Félix se lance dans la mode du style « japonisant » ou « chinois » et Marie n’est pas en reste. Son tableau « la Mandarine » est sa participation à cet engouement pour l’Asie. Ce tableau est exposé en 1870 au salon de Vichy et le journaliste relatant la manifestation (qui précise bien ne pas connaître l’artiste) estime qu’il s’agit du « plus beau morceau de l’exposition ».
La mode du japonisme gagne plusieurs artistes et ainsi Claude Monet lui aussi quelques années après en 1876, peint sa première épouse Camille Doncieux, en « geisha » vêtue d’un kimono et tenant un éventail. Cette mode des éventails peints est très présente dans l’œuvre des artistes de l’époque et bien sur dans celle de Marie lorsqu’elle dessine et grave son autoportrait dit « en espagnole » alors que son costume est une tenue du quotidien mais aussi dans nombre de ses portraits de femmes. Leur ami et voisin E. Renard réalise de splendides éventails. Marie réalisa elle aussi ce type d’ouvrage cependant aucune réalisation n’est conservée.
Jules Jacquemard, Philippe Burty, Henri Fantin-Latour et Félix Bracquemond, forment une société qui se donne le nom de « Jing Lar » . Ils font aussi partie du groupe des « Vilains bonshommes ». Ce qui apparaît, c’est que ces amis n’avaient pas mis de côté leurs sorties entre hommes et que conformément aux pratiques bourgeoises du dix-neuvième siècle, ils menaient bien souvent double vie ayant sans doute comme du temps de leur célibat une ou plusieurs maîtresses. C’est peut-être ce qu’Aline Pasquiou entrevoyait avec appréhension comme vie future pour sa fille avec Félix Bracquemond et émettait alors de grandes réticences devant l’engagement de Marie comme, selon J-P. Bouillon, le rapporte son petit-fils Pierre dans ses mémoires sans d’ailleurs préciser les raisons de cette opposition.
Alphonse Hirsch peintre et graveur né en 1832 est également un des neuf fondateurs du groupe Jing Lar. Il a pour sœur Jenny née en 1835, épouse d’Eugène Manuel, et militante féministe. Je n’ai pas encore trouvé ses liens avec les femmes œuvrant pour l’instruction des filles à cette période. Quelle place pourrait tenir Aline Pasquiou dans cette mouvance ? Le frère aîné, Emile Hirsch, peintre verrier né en 1834 est de confession israélite puis se convertit au protestantisme lors de son mariage avec Marie Person ou de Person et enfin au catholicisme lors de son second mariage. Isabelle, sœur de Marie Person épouse en 1857 Théodore Croc, un notaire breton de Plouneour-Trez, Sa fille Elisabeth épouse un breton Victor Thésée étudiant en médecine breton originaire de Lesneven qui étudia la médecine à l’université catholique de Lille ce qui nous questionne sur les liens avec la Bretagne et les influences politiques des protagonistes.
Marie, sa vie à Sèvres
Après la guerre de 1870 Félix Bracquemond fait un séjour de deux mois à Londres. Il est peu probable que Marie, jeune mère en charge d’un petit enfant l’ait suivi pour ce voyage. A son retour Félix est embauché à la Manufacture de Sèvres et la famille s’installe dans cette ville tout d’abord 11 rue Potin puis rue Brancas quelques années plus tard. Contrairement à ce qui est écrit Louise ne vit pas avec eux mais occupe un logement indépendant rue Brancas. Ensuite elle disparaît du recensement sans que nous sachions où elle s’installe mais peut-être est-elle tout simplement sur Paris. La vente en 2016 d’une eau-forte de Félix représentant Marie dessinant sa sœur sur la terrasse comporte la mention de « décembre 1876 » ce qui nous permet de mieux définir le physique de chacune des deux sœurs pour mieux les identifier et en particulier Louise dans son rôle de modèle et aider à la datation des tableaux de Marie. Au vu de la tenue peu hivernale des deux femmes et du feuillage des arbres, le dessin préparatoire de Bracquemond pour cette gravure date assurément de quelques mois auparavant. La gravure est publiée dans la revue L’Art en 1879. Georges Lechevallier-Chevignard (1878-1945), ancien directeur de la manufacture de Sèvres donne pour dates « De 1871 à 1872 » comme étant celles où Félix Bracquemond est employé comme chef d’atelier à la manufacture. Ensuite, selon une biographie de la famille Haviland, Bracquemond est embauché par Charles Haviland qui lui confie la responsabilité de l’atelier parisien connu sous le nom d’Atelier d’Auteuil .
Approche tout à fait inédite et commercialement risquée Charles décide de faire appel à un « Artiste », Félix Bracquemond, alors chef de l’atelier de peinture à la Manufacture de Sèvres. Il l’embauche et lui confie, le 1 juillet 1872, la « Direction d’Art » d’un atelier de création et d’impression de décors, situé 116, rue Michel Ange à Paris et que l’on appelle l’Atelier d’Auteuil. Sa mission est double : mettre au point une technique nouvelle afin d’abaisser le prix de revient et créer des décors inédits à forte valeur artistique.
Selon Jean-Paul Bouillon c’est tantôt Charles tantôt Théodore qui embauche Félix Bracquemond mais il semblerait que ce dernier ait été envoyé aux Etats-Unis de 1870 environ jusqu’en 1879 et donc si, comme il le mentionne, Marie fit le portrait de madame Théodore née Julie Dannat, ce fut donc après 1879 ou lors d’un séjour parisien car Théodore revenait régulièrement en France puisqu’il se marie religieusement en 1874 en l’église de la Sainte Famille.
La famille Bracquemond n’apparait pas au recensement de Sèvres pendant un temps et serait donc peut-être revenue un temps sur Paris ce qui correspondrait à la période de l’atelier d’Auteuil.
Sèvres emploie de très nombreux artistes qui vivent dans la ville et Marie a tout loisir de se faire son propre réseau d’amies sans compter les épouses des collègues et relations de son époux Félix. Ce dernier d’ailleurs, bien que cela ne soit jamais mentionné, avait sans doute comme nombre de ses amis un pied-à-terre à Paris. Il poursuit en effet une vie où Marie tient peu de place, continuant à fréquenter les cafés et autres lieux d’artistes où une épouse honorable ne peut se montrer. Mais peut-être Félix était-il plus « sage » que ses amis car pour lui nous n’avons pas trouvé trace de noms de modèles ou de maîtresses…
Marie collabore aussi aux activités artistiques de Félix et leur œuvre est commune pour un certain nombre de productions. Son propre monogramme est « MB » et celui de son époux un simple « B ».
Les frères Dammouse quittent également Sèvres pour l’atelier d’Auteuil mais Albert garde son atelier 12 rue des Fontaines.
Félix Bracquemond est reconnu comme s’étant intéressé à l’art de la photographie et cela peut tout aussi bien avoir été le cas pour Marie comme le prouvent plusieurs des vues en plongée de ses tableaux.
Georges Lechevallier-Chevignard (1878-1945), ancien directeur de la manufacture de Sèvres donne pour dates « De 1871 à 1872 » comme étant celles où Félix Bracquemond est employé comme chef d’atelier à la manufacture. Ensuite, selon une biographie de la famille Haviland, Bracquemond est embauché par Charles Haviland qui lui confie la responsabilité de l’atelier parisien connu sous le nom d’Atelier d’Auteuil .
Approche tout à fait inédite et commercialement risquée Charles décide de faire appel à un « Artiste », Félix Bracquemond, alors chef de l’atelier de peinture à la Manufacture de Sèvres. Il l’embauche et lui confie, le 1 juillet 1872, la « Direction d’Art » d’un atelier de création et d’impression de décors, situé 116, rue Michel Ange à Paris et que l’on appelle l’Atelier d’Auteuil. Sa mission est double : mettre au point une technique nouvelle afin d’abaisser le prix de revient et créer des décors inédits à forte valeur artistique.
Selon Jean-Paul Bouillon c’est tantôt Charles tantôt Théodore qui embauche Félix Bracquemond mais il semblerait que ce dernier ait été envoyé aux Etats-Unis de 1870 environ jusqu’en 1879 et donc si, comme il le mentionne, Marie fit le portrait de madame Théodore née Julie Dannat, ce fut donc après 1879 ou lors d’un séjour parisien car Théodore revenait régulièrement en France puisqu’il se marie religieusement en 1874 en l’église de la Sainte Famille.
La famille Bracquemond n’apparait pas au recensement de Sèvres pendant un temps et serait donc peut-être revenue un temps sur Paris ce qui correspondrait à la période de l’atelier d’Auteuil.
Sèvres emploie de très nombreux artistes qui vivent dans la ville et Marie a tout loisir de se faire son propre réseau d’amies sans compter les épouses des collègues et relations de son époux Félix. Ce dernier d’ailleurs, bien que cela ne soit jamais mentionné, avait sans doute comme nombre de ses amis un pied-à-terre à Paris. Il poursuit en effet une vie où Marie tient peu de place, continuant à fréquenter les cafés et autres lieux d’artistes où une épouse honorable ne peut se montrer. Mais peut-être Félix était-il plus « sage » que ses amis car pour lui nous n’avons pas trouvé trace de noms de modèles ou de maîtresses…
Marie collabore aussi aux activités artistiques de Félix et leur œuvre est commune pour un certain nombre de productions. Son propre monogramme est « MB » et celui de son époux un simple « B ».
Les frères Dammouse quittent également Sèvres pour l’atelier d’Auteuil mais Albert garde son atelier 12 rue des Fontaines.
Félix Bracquemond est reconnu comme s’étant intéressé à l’art de la photographie et cela peut tout aussi bien avoir été le cas pour Marie comme le prouvent plusieurs des vues en plongée de ses tableaux.
Cependant, grâce à ses notices détaillées, le texte permet de suivre l’évolution des techniques de la reproduction photographique et devient le complément indispensable des bilans établis récemment sur le même thème par la Bibliothèque nationale et plusieurs musées parisiens. Il apporte aussi d’intéressantes précisions sur la personnalité de plusieurs pionniers de la photographie (Victor Regnault, Louis Robert, Aguado, Félix Bracquemond) qui furent loin d’être seulement des amateurs ou des curieux. Notre collègue F. Jayot montre bien, à travers la qualité des tirages et la précision des cadrages, que le souci de l’expérimentation et la passion de la recherche comptèrent autant, pour ces défricheurs, que leur sensibilité propre face à cette nouvelle technique. Une part importante de l’exposition a été consacrée à Victor Regnault, savant injustement méconnu, à qui l’on doit pourtant plusieurs découvertes déterminantes pour le progrès de la chimie et de la physique contemporaine, qui fut administrateur de la Manufacture de Sèvres et président de la Société française de Photographie. G.Weill. Weill Georges. Jayot (Franz), « Les débuts de la photographie à Sèvres », 1985. In: La Gazette des archives, n°132, 1986. p. 108; https://www.persee.fr/
La grande période créative de Marie se déroule sur un peu plus d’une quinzaine d’années après son mariage et la naissance de son fils.
Marie et la faïence; les amis de Sèvres
Les familles Renard et Dammouse
Charles Haviland, désireux de moderniser la production des porcelaines de la manufacture Haviland de Limoges, a confié la direction de l’atelier de la rue d’Auteuil à Bracquemond. Celui-ci évitant de faire appel uniquement à des céramistes de métier, s’adresse à des peintres pour produire des œuvres d’art uniques et réaliser de véritables peintures sur faïence décorées à la barbotine. Cette technique de décor a été mise au point par Ernest Chaplet à la manufacture Laurin de Bourg-la-Reine.Albert Dammouse, 1848-1926, né le 22 octobre 1848 dans le quartier de Belleville dans une famille d’artistes, il meurt à Sèvres (Hauts-de-Seine) en 1926. Édouard Alexandre Dammouse (28/10/1850-24/01/1903) est le deuxième fils de Pierre Adolphe Dammouse employé comme sculpteur et décorateur à la Manufacture de Sèvres (né à Paris le 3 avril 1817) et de Rose Victoire Papy mariés le 5 avril 1845 à Paris 2eme arr ancien. Dès 1872, Édouard Dammouse travaille également aux côtés de céramistes. Il aurait commencé véritablement son enseignement artistique auprès de Félix Bracquemond, peintre de genre, aquarelliste, pastelliste et graveur et perfectionné sa technique de peinture aux côtés de Marie Bracquemond, épouse de son maître et aussi artiste. Leur sœur Gabrielle Claire née en 1854 est également artiste peintre et elle épouse en 1874 Jules François Celos, un peintre employé de la manufacture. Albert rencontre un grand succès en exposant à l’Exposition universelle de 1878. Il épouse en 1879 à Sèvres le 30 juillet la jeune Marie Renard vingt-huit ans dont le père est « artiste dessinateur » à la manufacture. Outre son oncle maternel Pierre Papy, les témoins sont les peintres François Bonvin pour Albert et pour la mariée, Félix Bracquemond, et Alexandre Paul Avisse.
 Madame Albert Dammouse née Marie Renard et sa fille Jeanne par le sculpteur alsacien Ringel
Madame Albert Dammouse née Marie Renard et sa fille Jeanne par le sculpteur alsacien Ringel
 Dessin préparatoire pour le tableau dit « Les Trois grâces ». Marie Renard pourrait être la femme de gauche.
En 1871, Albert crée un atelier à Sèvres qu’il gardera jusqu’à sa mort en 1926. Il y fabrique de la porcelaine qu’il décore au grand feu ainsi que des grès et des faïences.
Dessin préparatoire pour le tableau dit « Les Trois grâces ». Marie Renard pourrait être la femme de gauche.
En 1871, Albert crée un atelier à Sèvres qu’il gardera jusqu’à sa mort en 1926. Il y fabrique de la porcelaine qu’il décore au grand feu ainsi que des grès et des faïences.
En 1874, il commence une collaboration avec la Manufacture Pouyat et Dubreuil et obtient une médaille d’or à l’Union centrale des arts décoratifs. À partir de 1875, il collabore avec le peintre Félix Bracquemond (1833-1914), avec lequel il va créer le célèbre Service aux Oiseaux. Rassemblant une centaine de pièces, l’exposition pose la question de l’impressionnisme en céramique. Dirigé par le graveur Félix BRACQUEMOND, l’atelier parisien d’AUTEUIL, laboratoire expérimental de la manufacture HAVILAND de LIMOGES, produit, de 1872 à 1881, des faïences décorées à la barbotine par des peintres qui se regrouperont pour plusieurs sous le vocable d’impressionnistes. A l’aide d’argile liquide colorée appliquée au pinceau, les peintres de céramiques transcrivent comme sur une toile, dans une touche divisée en empâtements colorés, le moment fugitif et les effets de lumière des paysages. Outre Félix BRACQUEMOND, son directeur artistique, l’atelier d’AUTEUIL réunissait des artistes tels que : Ernest CHAPLET, Marie BRACQUEMOND, Edouard DAMMOUSE, Charles MIDOUX ou Jean-Paul AUBE (sculpteur).WikipédiaAvec son époux et différents amis de ce dernier comme leur témoin de mariage, le peintre Renard, Marie s’essaie et avec succès aux arts décoratifs. Félix et elle dessinent puis réalisent des assiettes pour le service dit « Service aux rubans » et dans ses croquis Marie fait preuve vivacité et de souplesse.
Le service à « fleurs et rubans » est le dernier des grands services décorés d’après des modèles de Félix Bracquemond. Il fut édité par la manufacture de Creil et Montereau sous la raison sociale Barluet et Cie (1879), puis en porcelaine dure par Haviland (1883). Ce service de table se composait d’une trentaine de pièces de forme, de douze assiettes plates et creuses ornées d’un motif floral unique ainsi que de douze assiettes à dessert à motif triple (ruban, fleur, oiseau). Contrairement au service « Rousseau », l’inspiration du décor n’est pas japonisante.Marie réalise également de grands panneaux pour le faïencier Haviland dont les dessins préparatoires seront exposés lors de la première exposition impressionniste à laquelle elle participe qui est la 4è ou 5è du groupe.
« Après avoir travaillé pour une manufacture de porcelaine de Sèvres en 1870, Félix accepte en 1872 le poste de directeur artistique d’un atelier parisien du manufacturier limougeaud Haviland jusqu’en 1881 date à laquelle il cesse de s’intéresser à la céramique ».Jean-Paul Bouillon, le spécialiste de l’œuvre de Bracquemond, note dans la préface du catalogue de l’exposition « Félix Bracquemond et les arts décoratifs – Du japonisme à l’’Art nouveau » Musée national de la Porcelaine Adrien-Dubouché à Limoges (avril – juillet 2005) :
« L’extraordinaire Service à fleurs et rubans de 1879 et dont les planches étaient exposées au 5ème Salon des Impressionnistes … son jeté d’arabesques ou son « coup de fouet » supposé « précurseur »… témoigne avant tout d’une continuité, et de la cohérence d’une personnalité ».Bibl.: Jean-Paul Bouillon, Félix Bracquemond 1833-1914 Graveur et céramiste, Aimery Somogy Editions, 2003, 111p
« (Bracquemond) expose une série d’eaux fortes d’une rare précision, inspirées par dessins japonais et servant de modèles pour la décoration de faïences » note Charles Ephrussi (Gazette des Beaux-arts, juin 1880, p.488). Il fut diffusé uniquement entre 1884 et 1889, excepté une réédition dans les années 1980 pour le centenaire de la maison Haviland.Béraldi dans son ouvrage sur Les Graveurs du 19ème siècle[1] et l’inventaire de l’œuvre de Félix Bracquemond, relève à propos du service à fleurs et rubans que « pour ce même service, Madame Bracquemond a composé et gravé douze sujets pour assiettes représentant des scènes parisiennes d’une grande fantaisie décorative »
 La Fleuriste ou la Jardinière.
Pour ma part il me semble que ces figures ont un aspect simplifié sinon simpliste et un côté « caricature ». Je n’y vois pas d’évolution du style de Marie.B. qui garde ici un côté « naïf ». Je trouve beaucoup plus intéressantes les poteries émaillées représentant des personnages sur une face et un travail de la couleur plein de subtilité. (images trouvées sur sites de ventes)
La Fleuriste ou la Jardinière.
Pour ma part il me semble que ces figures ont un aspect simplifié sinon simpliste et un côté « caricature ». Je n’y vois pas d’évolution du style de Marie.B. qui garde ici un côté « naïf ». Je trouve beaucoup plus intéressantes les poteries émaillées représentant des personnages sur une face et un travail de la couleur plein de subtilité. (images trouvées sur sites de ventes)

 Valtesse de la Bigne par H. Gervex pour comparaison
Valtesse de la Bigne par H. Gervex pour comparaison


 SOURCES
141 V. Cossy, « Femmes et création littéraire au XIXe siècle ou comment réconcilier des contraires » in Fidecaro A., Lachat S. (eds.) Profession : créatrice, La place des femmes dans le champ artistique. Antipodes, Lausanne, 2007, pp. 49-72 et E. Showalter, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Bronte to Lessing, Princeton, Princeton Univ. Press, 1977)
[1] Béraldi, Les graveurs du 19ème siècle. Guide de l’amateur d’estampes modernes, tome III, 1885, p.152
A l’Exposition universelle de 1878, Marie présente un grand panneau décoratif en céramique, Les Muses des Arts et des Lettres.
SOURCES
141 V. Cossy, « Femmes et création littéraire au XIXe siècle ou comment réconcilier des contraires » in Fidecaro A., Lachat S. (eds.) Profession : créatrice, La place des femmes dans le champ artistique. Antipodes, Lausanne, 2007, pp. 49-72 et E. Showalter, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Bronte to Lessing, Princeton, Princeton Univ. Press, 1977)
[1] Béraldi, Les graveurs du 19ème siècle. Guide de l’amateur d’estampes modernes, tome III, 1885, p.152
A l’Exposition universelle de 1878, Marie présente un grand panneau décoratif en céramique, Les Muses des Arts et des Lettres.
Dans la salle suivante, nous trouvons les cartons dessinés par Mlle Braquemont(sic), pour le grand carrelage céramique que M. Haviland avait exposé l’en dernier au Champ de-Mars. Ces cartons représentent les Muses des arts; ils ont une grande tournure. La figure de la Danse mérite surtout qu’on la loue. C’est une étude charmante, d’un mouvement souple, gracieux, virginal et d’une physionomie si joliment avenante .Elle aurait été remarquée à cette occasion par Edgar Degas, et est invitée à exposer les cartons de ce panneau et un plat en faïence à la IVe manifestation impressionniste de 1879. Selon G. Geffroy dans sa préface du catalogue de l’exposition de 1919 le panneau serait parti pour les États-Unis. A ce jour la trace en est perdue. Mais Marie appréciait-elle Degas ? Dans un courrier non daté E. Degas dit à Bracquemond qu’il préfèrerait s’entretenir seul avec lui de peur de déranger son épouse. Il évoque également les cartons de Marie précisant qu’elle ne doit pas s’inquiéter qu’ils seront en bonne place. Degas parle également d’une exposition d’éventails à laquelle il participe tout comme Pissarro et mademoiselle Morisot et madame Bracquemond . Cette exposition pourrait donc s’être déroulée avant 1874 date où Berthe devient madame Manet mais ceci n’est pas une certitude certains usages faisant que le nom de jeune fille perdurait d’autant plus que Berthe Morisot à l’inverse de Marie conserva son patronyme de naissance pour signer ses œuvres. D’après le catalogue de l’exposition de 1919, Marie aurait également réalisé un panneau sur le thème de « Paul et Virginie », propriété de la famille Haviland.
- Henry Havard, “L’Exposition des artistes indépendants,” Le Siècle (April 27, 1879), cité dans l’ouvrage de Dewitt, Les dessins dans les expos impressionnistes.
- Lettres de Degas, Grasset, 2011. Extrait lettre XVII à « Mon cher Bracquemond ».
Fig. 18, Marie Quiveron Bracquemond, Plaque avec Figure allégorique, ca.1879. Manufacture Haviland, Atelier d’Auteuil.Collection privée. Une dernière note sur cette exposition est la révélation des œuvres de Marie Quiveron (sic), l’épouse de Félix Bracquemond, qui a abandonné une carrière prometteuse en tant que peintre de figurines après son mariage. Sur l’affichage sont deux grandes assiettes, chacune décorée avec une figure féminine en costume médiéval ou allégorique (figure 18). L’étiquette pour l’un d’eux appelle la figure une reine, mais la couronne de fleurs qu’elle porte n’est pas nécessairement un attribut royal. Les dessins originaux de Quiveron pour les assiettes montrent des contours fermes dans un style académique traditionnel. Bien que dans ses peintures, elle ait répondu aux couleurs et aux techniques de surface impressionnistes, ses figures conservent leur volume et leur contour acéré dans un effet plus comparable à Caillebotte ou Renoir du milieu des années 1880 qu’à l’impressionnisme dominant des années 1870.Dans ces assiettes aussi, des couleurs brillantes prédominent, mais les figures soigneusement dessinées sont en accord avec le style des peintures de personnages connues de Quiveron vers 1880. Cela pourrait-il être le plat exposé au salon impressionniste de 1880 ?? « Carnet de route: Normandie impressionniste »: un carnet de voyage historique et artistique par James Rubin
Les dames de Sèvres, des artistes talentueuses
Le monde masculin et ses amitiés occupent toute la scène publique et laissent totalement dans l’ombre les réseaux féminins de ces artistes talentueuses qui vivent dans leur sillage. Nous avons tenté de mettre un peu d’éclairage sur ces femmes qui n’étaient pas confinées à leurs vies de femmes d’intérieur mais exerçaient leur art aussi d’une manière professionnelle. La peinture sur faïence fait souvent partie des enseignements délivrés aux jeunes filles dans les écoles de dessin à visée professionnalisante et à la manufacture de Sèvres un grand nombre de femmes y travaillaient comme artistes ou exécutantes. Nous avons tenté d’en ressortir quelques unes ayant pu jouer un rôle dans l’environnement de Marie.Eléonore Légérot ép Escallier 1827-1897
Née à Poligny dans le Jura, Eléonore Légerot aurait reçu ses premiers enseignements de Charles Paul Paris (époux de sa sœur aînée), propriétaire et peintre dons nous n’avons pas trouvé trace. Il est dit qu’elle aurait suivi les cours de l’école des Beaux-arts de Dijon mais il est peu probable que la province ait plus ouvert ses portes aux filles que la capitale! Mariée à dix-neuf ans en 1846 avec Augustin Escallier, elle gagne la capitale vers 1855 et commence à exposer au salon en 1857. Elle travaille avec le faïencier Théodore Deck et se représente dans cette activité dans un autoportrait présenté au salon de 1863. Félix Bracquemond a travaillé dans l’atelier parisien de Deck dans les années soixante. Eléonore est très talentueuse et entre à la manufacture de Sèvres où elle devient professeure. Lorsque Marie arrive à Sèvres elle fréquente assurément cette grande artiste et grâce aux rares exemples de faïences conservées nous voyons qu’elle transposait sa pratique de peinture sur ses faïences tout comme Eléonore Escallier. Cette dernière a une force vitale d’énergie créatrice qui donne des œuvres puissantes, originales et Marie ne tient pas la comparaison même si elle semble plus libérée que dans la peinture sur chevalet. Autoportrait Eléonore Légérot-Escallier
« Encensée par la presse, de renommée internationale, Escallier expose à maintes reprises : Salons de Paris, expositions Universelles de 1867 et 1878 à Paris ; enfin la ville d’Anvers honore son œuvre par une rétrospective en 1885 et lui décerne la médaille d’or. L’artiste repose au cimetière de Sèvres ».
Autoportrait Eléonore Légérot-Escallier
« Encensée par la presse, de renommée internationale, Escallier expose à maintes reprises : Salons de Paris, expositions Universelles de 1867 et 1878 à Paris ; enfin la ville d’Anvers honore son œuvre par une rétrospective en 1885 et lui décerne la médaille d’or. L’artiste repose au cimetière de Sèvres ».
Camille Nélaton ép Moreau 1840-1888
Cette jeune femme issue de la bourgeoisie aisée, initialement élève d’Auguste Bonheur, a croisé Eléonore Escallier chez Théodore Deck. Félix Bracquemond a aussi travaillé quelques temps après 1860 chez le faïencier Th. Deck. Elle est du même âge que Marie et liée à la famille Riesener également du réseau Bracquemond.Wikipédia : En 1858, elle épouse Adolphe Moreau fils (1827-1882), conseiller d’État et collectionneur, qui va l’encourager et même l’assister dans ses créations. Elle expose ses huiles sur toile au Salon de 1865 à 1881. Elle connaît un large succès avec ses faïences, exécutées à partir de terre de Bourg-la-Reine, ainsi que des céramiques, qui sont recherchées par les collectionneurs français et étrangers de son vivant, comme Nathaniel de Rothschild. Dès 1860 elle s’imprègne du japonisme et fait partie de cette première génération de peintres sur faïence à signer leurs œuvres qui resteront au stade de la production artisanale : chaque pièce est unique.
Madame Léon Cladel
Madame Carrier-Belleuse née
Julie Velten ép Favre 1833-1895
Veuve en 1880. Directrice de l’Ecole Normale de Sèvres en 1880 à partir de la création. Marie a peint des aquarelles ou toiles des jardins de l’école de Sèvres. Fréquentait-elle la directrice et sa famille ?Madame Simonnet et sa fille Jeanne
Marie Pauline Beaudet est l’épouse du peintre Lucien Simonnet (22/11/1849-16/04/1926) qui fut élève à l’école des Beaux-arts de Paris de Gustave Boulanger et de Jules Lefêvre. Peintre sur porcelaine il est également connu pour ses paysages dans le style de l’école de Barbizon. Il réalise de nombreux tableaux de paysages de Bretagne et expose au salon des artistes français de 1882 à 1925. Si je cite ce couple c’est que Lucien Simonnet[1] fut le témoin déclarant le décès de Marie en janvier 1916 et que leur fille Jeanne (1879-1950) devint à son tour artiste après avoir reçu l’enseignement de son père mais également pour la gravure celui de Félix Bracquemond. Marie n’est pas mentionnée dans les biographies de cette femme qui expose au salon des Femmes peintres. Pour l’heure je n’ai encore rien trouvé sur cette famille et en particulier sur madame Simonnet qui fut assurément au nombre des amis très proches du couple Bracquemond à Sèvres et des artistes du domaine de la faïence comme les frères Dammouse. Marie Pauline Beaudet est peut-être l’une des femmes encadrant Marie dans le tableau des Trois Grâces ? Après un temps sur Paris la famille s’installe à Sèvres. [1] Né à Paris le 22 novembre 1849. Il décède en 1926, 141 Grande rue à Sèvres mais est dit domicilié 3 rue des Rouilles et veuf de Marie Beaudet. Pour cette dernière nous n’avons aucun renseignement biographique.Marie la maturité
La grande période créative de Marie se déroule sur un peu plus d’une quinzaine d’années après son mariage et la naissance de son fils.« Les joueuses de jacquet »
Selon Pierre Bracquemond le tableau « Les joueuses de jacquet » aurait été commencé par Marie peu après l’arrivée du couple à Sèvres et donc suivant les données ci-dessus courant 1871 ou 1872. Ce tableau nous semble être une transition dans le style de Marie vers moins d’académisme mais l’improbable tapis oriental est encore une fois présent dans la composition qui est cependant beaucoup moins figée que les précédents tableaux de Marie. Les personnages sont dans la lumière d’une clairière et l’atmosphère est vaporeuse, moins apprêtée. Comme inspiré d’une vue photographique en plongée, deux jeunes femmes jouent au jacquet au milieu d’une forêt suggérée de manière floue relevant encore une fois du décor peint d’atelier photographique. Une femme blonde vêtue de rose et une brune s’apprêtant à lancer les dés sont encore vêtues de toilettes des années soixante-dix. Nous ne reconnaissons pas Louise alors quelles ont pu être les amies ayant posé pour ce tableau ?
La peintre Eva Gonzalès réalise en 1879 un tableau dans le même esprit mais plus réaliste. 
Deux jeunes femmes sont dans un sous-bois à l’automne, l’une brune dans une tenue sombre est allongée sur le sol, appuyée sur un coude et s’abrite sous une ombrelle de dentelle tandis que l’autre, blonde, vêtue d’une robe rose et d’un mantelet bleu est plongée dans un livre, un chien couché à ses pieds.
Les deux femmes se seraient-elles amusées à interpréter chacune à leur manière un moment d’amitié vécue ?« Les passagers de l’Hirondelle »; « Le Pilote » ca 1876/1878
« L’Hirondelle », ce bateau à vapeur qui remontait la Seine a inspiré Marie Bracquemond pour un sujet d’extérieur. Ce tableau est sans doute celui titré « Le Pilote » au catalogue de 1919, ceci en raison du personnage situé à l’arrière plan en costume de « capitaine de navire ».
Un couple appuyé au bastingage est saisi dans un moment d’échange intime. C’est cet instant de retour d’une journée à la campagne entre amis que Marie a saisi dans une rapide esquisse à l’aquarelle. Et pourquoi ne s’agirait-il pas de Monet et Camille Doncieux? Ce qui m’a conduit vers cette hypothèse ce sont les tableaux de Monet avec une jeune femme à l’ombrelle verte identique. Ce tableau de Monet daterait de 1886. Alice Hoschédé aurait confirmé que le modèle du tableau était bien C. Doncieux or elle meurt en 1879 et la date pour ces raisons et aussi le fait que ce tableau figure à l’exposition de 1880 est erronée et il faudrait plutôt retenir 1876 ou 1878 maximum, Camille étant ensuite affaiblie. La scène est très structurée par la lisse de la rambarde qui prend une place majeure dans l’eau-forte réalisée ensuite. Ce découpage de la surface de la toile ne lui est pas propre, Monet, Caillebotte entre autres ont utilisé le même procédé. Une aquarelle préparatrice a été mise en vente en 2019 sur internet mais attribuée à Félix Bracquemond.
Exposé au palais Galliera le 10 mars 1970 sous le n°27 « La promenade en bateau, M. et Mme Sisley » . Ce titre est cité à partir de 1962.
« Etude d’après nature »; avant 1880
Ce tableau présenté à l’exposition de 1880 est selon moi le plus vivant produit par Marie pourtant grâce aux dessins préparatoires nous voyons combien Marie laisse peu de place à un travail sur le vif. Comme dans un jeu « trouvez les sept différences » entre deux images nous constatons que Marie apporte différentes modifications entre les diverses étapes aboutissant au tableau final et ceci est vrai pour plusieurs de ses œuvres. Se pourrait-il que ce tableau soit celui intitulé « L’aquarelliste » lors de l’exposition de 1919?
De ce tableau émane une joie de vivre tant par les couleurs chaudes, le cadre fleuri que par le personnage central de la jeune femme. Le peintre Alfred Stevens fait avec Marie Blanc son épouse, l’acquisition en 1875 d’une propriété avec un parc en plein cœur de Paris où ils vivent quelques années avec leurs quatre enfants. Je pense que le modèle pourrait être soit Catherine la fille du peintre soit autre hypothèse que nous privilégions, celle que la jeune Madeleine Burty tant appréciée des amis de ses parents ait posé pour Stevens. Un portrait à la cire par Henry Cros de Madeleine jeune offre beaucoup de similitudes avec le portrait peint par Marie et nous savons par des courriers de Félix Bracquemond à Charles Haviland devenu en 1879 l’époux de Madeleine combien les Bracquemond se préoccupent de leur jeune amie.

Alfred Stevens Album Manet Gallica Erwin Hanfstaengl phot
Ce peintre belge[1] a tenu une place importante dans le cœur de Marie et sa pratique artistique. Après un travail de comparaison je présume que c’est lui le peintre qui, à l’abri d’une ombrelle, peint une jeune fille joyeuse et dansante dans un jardin fleuri. Marie et Stevens ont en commun leur goût pour la peinture des costumes féminins, des étoffes et le blanc vaporeux. E. Ambroselli dans le catalogue de la vente d’avril 2024 propose le nom de James Tissot peintre né à Nantes et ami de Félix.
-
À partir de 1883, saisi d’un doute devant la montée de l’impressionnisme, Stevens a reconsidéré sa peinture et a réalisé des paysages impressionnistes
-
C’est encore par l’intermédiaire d’Alfred Stevens que Manet va faire la connaissance du marchand de tableaux Paul Durand-Ruel, et de son cercle de relations : Degas, Morisot. Tout-Paris fréquente désormais l’atelier de Stevens situé d’abord rue Laval, puis rue des Martyrs et à partir de 1880, rue de Calais. Les Goncourt qui lui rendent souvent visite décrivent le luxe dans lequel il vit. À cette même époque, Stevens a créé un atelier de peinture pour dames avenue Frochot, fréquenté par Sarah Bernhardt dont le peintre fera le portrait. La mort de Manet, en 1883 va beaucoup l’affecter. Stevens traverse une période de doute devant l’arrivée de l’impressionnisme. Commence alors une période de recherche dans laquelle Berthe Morisot joue un rôle prépondérant. 17 Dans les années 1880 Stevens traverse une crise morale qui l’amène à remettre en question tout ce qu’il fait. Élève d’Ingres, souvent proche de Gustave Courbet, ou de Manet avec Ophelia. Le Bouquet effeuillé, 1867, huile sur toile, 70,5 × 51 cm, Musées royaux des beaux-arts de Belgique 18, il a peint jusque-là avec une rigueur qu’il abandonne parfois sous l’influence d’autres peintres. C’est le cas de La Jeune mère, 1868, huile sur toile, 39,37 × 29,21 cm Dumbarton Oaks Museum, Washington DC19 qui rappelle au style de Berthe Morisot 10.
[1] Marjan Sterckx, exhibition review of “Alfred Stevens,” Nineteenth-Century Art Worldwide 9, no. 1 (Spring 2010), http://www.19thc-artworldwide.org/spring10/alfred-stevens (accessed March 17, 2019).
1881, la sculptrice Hélène Bertaux (1825-1909) fonde avec d’autres femmes artistes la société de l’Union des femmes peintres et sculpteurs (UFPS). La peintre Louise Catherine Breslau (1856-1927) mais aussi plus proche du réseau de Marie, la sculptrice et céramiste Charlotte Besnard née Dubray(1854-1931) qui a travaillé pour certaines œuvres avec Albert Dammouse en sont également membres. Albert Besnard a fait le portrait de Charlotte lisant dans un fauteuil vers 1890.
- – Félix BRACQUEMOND Paris 1833 † 1914- 106 – La Terrasse. (Sèvres vue de la villa Brancas). 1876. H250(295)x L352(430)mm. Eau-forte originale, sur papier vergé. I.F.F Après 1800, n°377. Béraldi, n°215. Epreuve de l’état définitif (VIII ème sur VIII), avec la lettre et publié dans « L’Art ». Signée, titrée et datée « Xbre 1876 » à la pointe dans la planche. Imprimée chez Salmon. Marges. 350 €. Galerie Martinez.
- – Archives de Haute-Vienne, fonds Haviland, 23 J 617 Photographies de modèles. [s. d.] 1876 – Vases d’Auteuil : 22 pl. photographiques noir et blanc, 22 x 26 cm [s. d.] ; 105 J Fonds Nicole Marić-Haviland (1872-2012) Répertoire numérique détaillé des archives de Paul Burty Haviland, Suzanne Lalique, Nicole Marić-Haviland, et des familles Haviland et Lalique par Anne Gérardot conservatrice du patrimoine Limoges 2016
- – Jean-Paul Bouillon, Women impressionnists, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Eva Gonzales, Marie Bracquemond. sous la direction de Pamela Ivinski, avril 2008.
- – http://www.museeprotestant.org/notice/haviland-une-famille-de-porcelainiers/
- – http://archives.haute-vienne.fr/_depot_ad87/ 105 J Fonds Nicole Marić-Haviland (1872-2012) Répertoire numérique détaillé des archives de Paul Burty Haviland, Suzanne Lalique, Nicole Marić-Haviland, et des familles Haviland et Lalique par Anne Gérardot conservatrice du patrimoine Limoges 2016. Julie Margaret Dannat née aux Etats-unis en 1852.
- – Jean-Paul Bouillon, Idem, p. 286
Louise au jardin avec un bouquet de violettes à la ceinture
Le portrait dit de « Louise au jardin » avec un bouquet de violettes à la ceinture et le portrait dit de « La dame en blanc » offrent des similitudes mais la figure féminine est très différente. Si pour « Louise au jardin » nous sommes face à une jeune fille au visage arrondi, aux cheveux encore libres, « la dame en blanc » donne, comme le titre qui lui est attribué, la vision d’une « femme » à la lourde chevelure relevée en chignon. De plus cette dernière a un air triste sinon même maladif avec des yeux tombants. S’agit-il dans les deux cas de Louise comme modèle ? Si oui que s’est-il passé entre ces deux moments et combien de temps s’est-il écoulé ? L’absence de datation des tableaux ne nous aide pas. La gravure de Félix Bracquemond « Au jardin d’acclimatation » qui pour l’épreuve en noir et blanc date d’avant 1873, nous montre une Louise chapeautée avec une coiffure élaborée et l’air lointain et distant, toujours vêtue de blanc virginal alors que Marie est en tenue sombre éclairée d’une touche de couleur pouvant indiquer une tenue de deuil d’un an environ faisant suite au décès d’Aline fin 1871. Marie est brune aux yeux sombres comme leur mère et Louise ne lui ressemble pas du tout. Châtain clair aux yeux gris-bleu, elle est atteinte de myopie ce qui pourrait expliquer son regard perdu sur certains tableaux. Ce tableau « Louise au jardin » ne semble pas avoir été exposé. Une question ; le modèle est-il réellement Louise ? ou bien la jeune Madeleine Burty pourrait-elle avoir posé pour ce tableau ? Cette hypothèse au vu d’un dessin de Madeleine me paraît tout à fait plausible. Le 5 septembre 1879, Camille Doncieux l’épouse de Claude Monet s’éteint après des années de souffrance laissant orphelins Jean et Michel nés en 1867 et 1878. Camille aurait souffert d’un cancer de l’utérus mais plusieurs biographes questionnent également à cette époque où la contraception n’existait pas, les conséquences d’un ou plusieurs avortements que la malheureuse jeune femme aurait pu subir. Rien ne nous est dit des amitiés féminines et nous ne savons rien de liens ayant pu exister entre Marie et la compagne de Monet pour lequel elle éprouvait une grande admiration en tant qu’artiste mais aussi une amitié à toute épreuve.1874 « Marguerite »
En 1874 , Marie expose de nouveau au Salon des Beaux-arts un tableau intitulé « Marguerite », n°249, tableau lumineux selon Frédéric Régamey directeur d’une revue d’art à la brève existence, Paris à l’eau-forte. Actualité, curiosité, fantaisie (1) et qui dans le numéro d’avril fait l’éloge du tableau de Marie, « une figure blanche couchée sous des arbres en fleurs éblouissante de clarté ». Le modèle se prénommerait sans doute «Marguerite» car au singulier; nous en déduisons alors qu’il ne s’agit pas des fleurs. En 2021 vente aux enchères d’un tableau provenant d’une descendante de la famille qui correspond à ce descriptif. Sous des pommiers en fleurs une jeune femme en robe blanche de style moyenâgeux est étendue dans un pré parsemé de pâquerettes que tout bon botaniste ne confondrait pas avec des marguerites ou reines marguerites! Le paysage est évocateur de la Normandie et pourrait avoir été peint lors d’un séjour à la ferme de Saint Siméon où Bracquemond et ses amis peintres aimaient à se retrouver. Marie BRACQUEMOND vente Drouot du 10 décembre 2021
Marie BRACQUEMOND vente Drouot du 10 décembre 2021
 Ce tableau reprend la posture du modèle d’un tableau de Gustave Jundt (1830-1884° exposé au salon de 1870 n°1484 et titré « Bords de rivière ». Il a représenté une jeune femme allongée et appuyée sur ses coudes sur un ponton surplombant une petite rivière dans un décor de verdure qui dissimule le bas de son corps mais la ressemblance est frappante.
Ce tableau reprend la posture du modèle d’un tableau de Gustave Jundt (1830-1884° exposé au salon de 1870 n°1484 et titré « Bords de rivière ». Il a représenté une jeune femme allongée et appuyée sur ses coudes sur un ponton surplombant une petite rivière dans un décor de verdure qui dissimule le bas de son corps mais la ressemblance est frappante.
- (1) Revue d’art hebdomadaire française créée par Richard Lesclide et Frédéric Régamey en mars 1873 et disparue fin décembre 1876 après 187 numéros.
1875
Une lecture sous Charles VII ou La Lecture
L’année suivante en 1875, Marie renouvelle sa participation au Salon avec un tableau intitulé « La Lecture » ou selon A. Besnus commentateur du salon, « Une lecture sous Charles VII », n°287. Les quatre années suivantes Marie travaille et produit énormément mais elle n’expose plus au Salon. Plusieurs œuvres de Marie donnent à voir un aspect de sa personnalité peu mis en avant par les différentes biographies. S’il est certain qu’elle avait gardé de sa formation classique un goût de la minutie que l’on voit quasiment dans toutes ses huiles, ses autres types de productions laissent poindre un côté plus vivant plus spontané et parfois même un ton humoristique. L’ « autoportrait » de Marie nous offre la vision d’une jeune femme qui regarde la vie bien en face et qui, sans doute est discrète, mais en aucun cas n’est effacée ni soumise. Ne serait-il pas plus tardif ? Acquis par le musée des B-A de Rouen
Marie mêle régulièrement les genres et les styles, tantôt retrouvant sa formation classique, tantôt s’inspirant des œuvres de ses ami-e-s Ce tableau est peint à touches nerveuses et souples loin de l’académisme et de la sobriété de couleurs de ces deux portraits que sont celui de son fils en chemise blanche et celui conservé dans la famille Delavilléon. Pierre, en chemise blanche, aurait 5 ou 6 ans environ donc peint vers 1875/1876
Acquis par le musée des B-A de Rouen
Marie mêle régulièrement les genres et les styles, tantôt retrouvant sa formation classique, tantôt s’inspirant des œuvres de ses ami-e-s Ce tableau est peint à touches nerveuses et souples loin de l’académisme et de la sobriété de couleurs de ces deux portraits que sont celui de son fils en chemise blanche et celui conservé dans la famille Delavilléon. Pierre, en chemise blanche, aurait 5 ou 6 ans environ donc peint vers 1875/1876

 Pour comparaison: Portrait d’une dame figurant sur le site d’Artus Delavilleon, artiste, et customisé par ses soins. Possiblement de la main de M.B. signature en rouge HG.
Pour comparaison: Portrait d’une dame figurant sur le site d’Artus Delavilleon, artiste, et customisé par ses soins. Possiblement de la main de M.B. signature en rouge HG.
1880-1889 Les années impressionnistes
Pour sa deuxième participation au salon impressionniste de 1880, Marie expose plusieurs œuvres preuve d’une activité intense dans les mois et années qui précèdent. Avec « Portrait » qui serait le fameux tableau « La Dame en blanc » à confronter avec catalogue vente 2024 (à faire) , les visiteurs peuvent admirer « L’Hirondelle » et « Etude d’après nature », ces derniers d’une facture moins convenue témoignant d’une période heureuse qui se traduit par des tableaux plus lumineux, plus vivants. Nous la retrouvons ensuite au Salon des indépendants qui prend le nom de Salon des impressionnistes et qui n’accepte d’exposer que des artistes n’ayant pas postulé au Salon des Beaux-arts. Elle participe en 1879 à la 5ème exposition avec un plat en faïence et surtout le carton préparatoire du grand panneau expérimental de la maison Haviland exposé l’année précédente lors de l’Exposition universelle de Paris. Le sujet en est « Les muses des Arts et des Lettres » et nous pouvons lire que le peintre Degas plein d’admiration pour la composition du panneau aurait insisté dans un courrier adressé à Félix (mais sans date), pour que Marie rejoigne le groupe des exposants mais Berthe Morisot au caractère plus trempé que Marie est peut-être pour quelque chose dans la présence de son amie ! Dans cette composition Marie laisse libre-cours à son goût pour les costumes féminins et les jeux de drapés comme dans ses tableaux « Louise au jardin » et « La Dame en blanc ». Nous y retrouvons également pour son travail sur les matières la présence d’un tapis comme élément de décor. A la différence de tant d’œuvres de sa main, elle signe ici de son nom entier « Bracquemond » précédé de l’initiale « M » tout comme dans sa jeunesse elle signait « Pasquiou Quivoron ». Ceci nous questionne sur le pourquoi tant de dessins ou tableaux ne comportent pour signature que « Marie B ». Le tableau dit « Les Trois Grâces » existe en deux versions: l’une de petites dimensions à l’état d’ébauche et la seconde plus achevée dans laquelle Marie procède par petites touches vibrantes qui évoqueraient presque le travail de Van Gogh. Le tableau figurait dans la collection de Gustave Geffroy et après acquisition par l’Etat fut mis en dépôt à la mairie de Chemillé -49 – avant de réintégrer la capitale. Il est daté d’environ 1880. Les deux tableaux présentent de légères différences en particulier sur les costumes des femmes mais également dans leurs postures. Marie s’est représentée au centre, majestueuse, hiératique et entourée de deux amies dont l’une est enceinte et qui apportent du dynamisme à la scène par leurs gestes plus spontanés. Elles semblent poser pour un photographe dans un moment de complicité amicale. Toutes trois sont en tenues estivales dans un jardin mais l’environnement paysager tient peu de place en comparaison des figures. Les couleurs et les touches sont beaucoup plus toniques dans l’étude préparatoire. Le portrait dit « autoportrait à la croix » pourrait dater de la même période car Marie dans les deux tableaux a agrémenté sa coiffure de fleurs ou rubans rouges. Un dessin préparatoire pour la figure de gauche est conservé au musée d’Orsay. 1881, la sculptrice Hélène Bertaux (1825-1909) fonde avec d’autres femmes artistes la société de l’Union des femmes peintres et sculpteurs (UFPS): la peintre Louise Catherine Breslau (1856-1927) mais aussi plus proche du réseau de Marie, la sculptrice et céramiste Charlotte Besnard née Dubray(1854-1931) qui a travaillé pour certaines œuvres avec Albert Dammouse.Tableau « Sur la terrasse à Sèvres », ca 1880. Petit-Palais, Genève
L’hypothèse que l’homme du trio soit le peintre Fantin-Latour ne tient pas au vu des comparaisons des visages ni par rapport à la date présumée du tableau.
Je proposerais plutôt que le personnage masculin soit Lucien Pissarro par comparaison des yeux et de l’oreille. Lucien est né en 1863 si la datation du tableau se situe bien autour de 1880, il est donc âgé d’environ dix-huit ou vingt (en 1883). Les Bracquemond sont très proches de Camille Pissarro et son épouse Julie Vellay. Entre 1866 et 1869 puis 1872 et 1882 les Pissarro vivent à Pontoise puis non loin, à Osny de fin 1882 à 1884, date où ils partent à Eragny et cela serait tout à fait plausible. Si le tableau est antérieur il faut chercher d’autres pistes.
 Pendant les cinq années qui suivent, Marie n’expose rien ni au Salon des Beaux-arts ni avec le groupe impressionniste. Que se passe-t-il dans sa vie ?
Cette période qui suit sa participation à la 5ème exposition impressionniste de 1880 est marquée par son absence lors des autres expositions. Pourtant ce serait pendant ce temps qu’elle réalise plusieurs œuvres majeures telles que « Le Goûter » ou « Sur la terrasse de la villa Brancas » et « Sous la lampe ».
Dans un style nouveau dans sa pratique et s’apparentant aux impressionnistes, Marie peint son fils «Pierre à sa table de travail », tableau signé et daté de 1881 qui nous montre un jeune garçon d’une dizaine d’années assis à son bureau devant un livre mais dans une position manquant totalement de naturel de la même veine que « La Dame en blanc » ou « Jeune fille dans un jardin » . Même si un rai de lumière éclaire le sol et que derrière l’enfant une fenêtre ouvre sur un bois, la tonalité est sombre et l’ambiance générale stricte sinon triste à l’image du visage de Pierre et est proche en traitement des effets de lumière et du massif arboré du tableau « Les Joueuses de jacquet » qui date de la précédente décennie. Ce tableau daté 1881 n’aurait donc pu figurer à l’exposition de 1880. La datation et le style une fois de plus posent question au regard du tableau des « Trois Grâces » aux touches vibrantes pour capter la lumière
Le Gaulois du 25 février 1882 mentionne une œuvre de Marie intitulée « Février », peinture ou dessin, cela est peu clair.
Les années quatre-vingt sont des années noires sur le plan amical avec les décès d’Edouard Manet rongé par la syphilis puis celui d’Eva Gonzalès des suites de son accouchement. Si certains biographes évoquent la présence de Marie dans les derniers moments de Manet, rien ne nous est dit du chagrin qu’elle éprouva avec la mort de sa jeune amie, artiste prometteuse qui fut élève de Manet mais s’affirma très rapidement en tant qu’artiste avec toute son originalité.
Son grand ami Claude Monet après le décès de sa première épouse en 1879, s’est installé à Giverny avec ses deux fils, sa compagne Alice Hoschédé et ses six enfants mais Camille Doncieux a sûrement beaucoup compté dans la vie de Marie qui depuis toujours a beaucoup d’admiration pour Monet dont elle était très proche et avec lequel elle a partagé beaucoup de choses tant au plan amical qu’au plan artistique.
Grâce aux dessins de Marie nous prenons connaissance de ses nouvelles amies, des femmes plus jeunes qu’elle et plus liées au monde de la gravure qu’à celui de la peinture et dont elle fait le portrait comme Mathilde Gavet Béraldi (1857-1940) qui est depuis le 6 décembre 1880, l’épouse de l’écrivain d’art Angelo Ferdinand dit Henri Béraldi également bibliophile et graveur. Le dessin est signé « Marie B. » juste au-dessus de la main droite de la jeune femme.
Un dessin daté de 1888 où une jeune femme respire le parfum des roses d’un rosier est annoté de la main de Pierre Bracquemond sur l’envers comme étant madame Béraldi. Ces dessins pourraient-ils être des travaux préparatoires des gravures intitulées « Au jardin » ou encore « L’Odorat ». Mathilde Gavet-Béraldi semble avoir beaucoup compté pour Marie et est la mère de cinq enfants qui ont pu servir de modèles pour les portraits d’enfants mentionnés au catalogue de 1919.
A Madame Charles Jacquin, épouse du graveur et collectionneur d’estampes japonaises, Marie offre un dessin de sa sœur Louise avec une dédicace. Cette femme qui reste dissimulée derrière l’identité de son époux se nomme Anna Mélanie Sophie Laisné mais nous n’avons pour l’heure rien trouvé sur sa personne et le rôle qu’elle a pu jouer auprès de Marie. Charles Jacquin fut avoué mais également un photographe de renom et le couple possédait une importante collection d’arts asiatiques dont madame Jacquin fit don au musée Guimet après le décès de son époux.
Marie fait également le portrait de madame Pierre Guy-Pellion (31/12/1845 Lyon), née Louise Frébault (fille d’Elie Frébault et Pauline Bernhart-Mayer) dont le mari est un bibliophile réputé. Pierre Zaccone, homme de lettres, époux de Mélanie Prêcheur et âgé de soixante cinq ans lors du mariage Pellion/Frébault est témoin au titre d’ami tout comme Jules Jacques Veyrassat (1828-1893) artiste peintre et graveur. Zaccone né en 1818 à Douai est venu ensuite du fait des affectations de son père en Bretagne où il s’est fixé. Proche de l’écrivain Emile Souvestre il s’installe à Paris et devient ensuite un feuilletoniste de talent. La vie d’Aline Pasquiou mère de Marie Bracquemond aurait pu faire l’objet de l’un de ses romans feuilletons. Ses attaches morlaisiennes ont pu le mettre en relation avec Gustave Geffroy dont la famille est également enracinée à la région de Morlaix. Marie a donc effectué le portrait de cette jeune femme au plus tôt en 1885.
Pendant les cinq années qui suivent, Marie n’expose rien ni au Salon des Beaux-arts ni avec le groupe impressionniste. Que se passe-t-il dans sa vie ?
Cette période qui suit sa participation à la 5ème exposition impressionniste de 1880 est marquée par son absence lors des autres expositions. Pourtant ce serait pendant ce temps qu’elle réalise plusieurs œuvres majeures telles que « Le Goûter » ou « Sur la terrasse de la villa Brancas » et « Sous la lampe ».
Dans un style nouveau dans sa pratique et s’apparentant aux impressionnistes, Marie peint son fils «Pierre à sa table de travail », tableau signé et daté de 1881 qui nous montre un jeune garçon d’une dizaine d’années assis à son bureau devant un livre mais dans une position manquant totalement de naturel de la même veine que « La Dame en blanc » ou « Jeune fille dans un jardin » . Même si un rai de lumière éclaire le sol et que derrière l’enfant une fenêtre ouvre sur un bois, la tonalité est sombre et l’ambiance générale stricte sinon triste à l’image du visage de Pierre et est proche en traitement des effets de lumière et du massif arboré du tableau « Les Joueuses de jacquet » qui date de la précédente décennie. Ce tableau daté 1881 n’aurait donc pu figurer à l’exposition de 1880. La datation et le style une fois de plus posent question au regard du tableau des « Trois Grâces » aux touches vibrantes pour capter la lumière
Le Gaulois du 25 février 1882 mentionne une œuvre de Marie intitulée « Février », peinture ou dessin, cela est peu clair.
Les années quatre-vingt sont des années noires sur le plan amical avec les décès d’Edouard Manet rongé par la syphilis puis celui d’Eva Gonzalès des suites de son accouchement. Si certains biographes évoquent la présence de Marie dans les derniers moments de Manet, rien ne nous est dit du chagrin qu’elle éprouva avec la mort de sa jeune amie, artiste prometteuse qui fut élève de Manet mais s’affirma très rapidement en tant qu’artiste avec toute son originalité.
Son grand ami Claude Monet après le décès de sa première épouse en 1879, s’est installé à Giverny avec ses deux fils, sa compagne Alice Hoschédé et ses six enfants mais Camille Doncieux a sûrement beaucoup compté dans la vie de Marie qui depuis toujours a beaucoup d’admiration pour Monet dont elle était très proche et avec lequel elle a partagé beaucoup de choses tant au plan amical qu’au plan artistique.
Grâce aux dessins de Marie nous prenons connaissance de ses nouvelles amies, des femmes plus jeunes qu’elle et plus liées au monde de la gravure qu’à celui de la peinture et dont elle fait le portrait comme Mathilde Gavet Béraldi (1857-1940) qui est depuis le 6 décembre 1880, l’épouse de l’écrivain d’art Angelo Ferdinand dit Henri Béraldi également bibliophile et graveur. Le dessin est signé « Marie B. » juste au-dessus de la main droite de la jeune femme.
Un dessin daté de 1888 où une jeune femme respire le parfum des roses d’un rosier est annoté de la main de Pierre Bracquemond sur l’envers comme étant madame Béraldi. Ces dessins pourraient-ils être des travaux préparatoires des gravures intitulées « Au jardin » ou encore « L’Odorat ». Mathilde Gavet-Béraldi semble avoir beaucoup compté pour Marie et est la mère de cinq enfants qui ont pu servir de modèles pour les portraits d’enfants mentionnés au catalogue de 1919.
A Madame Charles Jacquin, épouse du graveur et collectionneur d’estampes japonaises, Marie offre un dessin de sa sœur Louise avec une dédicace. Cette femme qui reste dissimulée derrière l’identité de son époux se nomme Anna Mélanie Sophie Laisné mais nous n’avons pour l’heure rien trouvé sur sa personne et le rôle qu’elle a pu jouer auprès de Marie. Charles Jacquin fut avoué mais également un photographe de renom et le couple possédait une importante collection d’arts asiatiques dont madame Jacquin fit don au musée Guimet après le décès de son époux.
Marie fait également le portrait de madame Pierre Guy-Pellion (31/12/1845 Lyon), née Louise Frébault (fille d’Elie Frébault et Pauline Bernhart-Mayer) dont le mari est un bibliophile réputé. Pierre Zaccone, homme de lettres, époux de Mélanie Prêcheur et âgé de soixante cinq ans lors du mariage Pellion/Frébault est témoin au titre d’ami tout comme Jules Jacques Veyrassat (1828-1893) artiste peintre et graveur. Zaccone né en 1818 à Douai est venu ensuite du fait des affectations de son père en Bretagne où il s’est fixé. Proche de l’écrivain Emile Souvestre il s’installe à Paris et devient ensuite un feuilletoniste de talent. La vie d’Aline Pasquiou mère de Marie Bracquemond aurait pu faire l’objet de l’un de ses romans feuilletons. Ses attaches morlaisiennes ont pu le mettre en relation avec Gustave Geffroy dont la famille est également enracinée à la région de Morlaix. Marie a donc effectué le portrait de cette jeune femme au plus tôt en 1885.
1886 : une année charnière
Vers 1886/1887, Pierre, le fils de Marie et Félix a seize ans. Félix est toujours pris par ses multiples activités et ses nombreux amis. Qu’en est-il advenu du rapport de Marie à la peinture et à la création? Étrangement un grand nombre de toiles toutes plus différentes les unes des autres qui lui sont attribuées sont datées de cette période de rupture. En 1886 le groupe dit des « impressionnistes » éclate. Il s’avérait avant tout être un groupe d’artistes motivés par des recherches picturales mais chacun y gardait sa personnalité. Dans cette période de nouvelles pratiques s’élaborent et nous ne savons pas grand chose du goût de Marie pour le pointillisme initié par Seurat duquel son ami Pissarro se rapproche ou de ses réactions face au symbolisme. Ce serait vers cette époque selon Pierre (ou ce que les biographes en ont déduit) que des dissensions seraient apparues au sein du couple Bracquemond et que les critiques de son époux auraient amené Marie à se replier et abandonner progressivement la peinture. Félix Bracquemond est toujours hyper-actif et conduit mille projets. Il publie en 1886 un ouvrage intitulé Du dessin et de la couleur, très apprécié par Vincent van Gogh et une Etude sur la gravure sur bois et la lithographie. Plusieurs biographes ont interprété que Félix Bracquemond aurait mal supporté le lien de sa femme avec le groupe des impressionnistes or lui même en était très proche. Il semblerait que le tournant de 1886 qui marque la rupture du groupe et l’apparition de nouvelles tendances soit aussi le fait de Marie mais pour quelles raisons ?« La lettre, madame Bénédict » signé « Marie B » et daté 1886
Ce tableau dans un style impressionniste est censé représenter « madame Bénédict » mais qui est cette femme d’une quarantaine d’année environ? S’agit-il d’une commande ou bien du portrait d’une amie de Marie ? Serait-ce la même femme la « Grâce » de gauche du tableau « Les trois Grâces » dont un dessin préparatoire avec un détail du visage montre une femme au nez un peu « cassé », nez qui peut également correspondre à Marie Renard?
Mon hypothèse est qu’il s’agit de Valentine Le Mancel née en 1853 et épouse de Léonce Bénédite depuis juin 1884. Valentine fut élevée par Georges Lafenestre (1837- ), le second mari de sa mère. Lafenestre était proche des parnassiens et donc le poète Leconte Delisle et ses amis bretons sont encore non loin.
Benedite est nommé directeur adjoint du musée du Luxembourg en 1886 après avoir travaillé au musée de Versailles. Il est un proche de longue date de Félix Bracquemond puisqu’il est un des membres fondateurs de la société dite du « Jing-Lar » qui réunissait pour un dîner mensuel chez Marc-Louis Solon, alors directeur de la manufacture de Sèvres, ces amis républicains et amateurs d’art japonais entre août 1868 et mars 1869[1]. Par d’autres dessins de Marie comme ceux de madame Béraldi née Mathilde Gravet nous voyons bien que des amitiés se nouaient aussi au niveau des épouses.
Les deux filles du couple portent les prénoms d’Eva et Rosa qui nous évoquent deux femmes peintres, Eva Gonzalès-Guerard et Rosa Bonheur ! Mais peut être est-ce là pure coïncidence !
[1] http://ccfjt.com/meiji150eme/dossier-le-japonisme/Le tableau « La lettre » signé « Marie B. » et daté « 86 », offre de nombreux points de ressemblance avec les œuvres d’autres artistes. Gauguin a peint en 1878, son épouse Mette cousant dans une position similaire, de profil le visage penché vers son ouvrage. Mary Cassatt a aussi peint plusieurs portraits de femmes lisant un livre ou une lettre. Gustave Caillebotte également en 1880 a traité ce thème comme tant d’autres artistes. Le personnage est entouré de fleurs et lumière et profondeur créées par la fenêtre ouvrant sur un paysage. Il pourrait avoir été exposé en 1962 également sous le titre « Près de la fenêtre ». Un tableau de Claude Monet porte un titre similaire. Marie par la profusion de fleurs au premier plan à gauche donne l’impression que son personnage est en extérieur alors qu’elle lit près d’une fenêtre qui laisse passer une lumière tamisée par un store demi-abaissé. La femme rousse ou châtain clair d’une quarantaine d’années est absorbée dans la lecture de la lettre qu’elle vient de recevoir. L’atmosphère est très douce tant par la lumière que par les bouquets aux teintes pastel qui occupent la partie gauche du tableau. Rien à voir avec la crudité de la lumière du tableau de son fils et de Louise dans le jardin peint à la même période.
« Félix Bracquemond dans son atelier » signé ; daté et exposé en 1886
De Félix un seul portrait peint par son épouse le représentant debout dans son atelier, le regard fixé sur une planche d’eau-forte.  Ce tableau qui fut présenté au salon des impressionnistes de 1886 est dans une facture très classique et sans lien pictural avec l’impressionnisme. Autre étrangeté selon l’ouvrage « Women impressionnist » ce tableau est une peinture sur bois. Il est signé et daté 1886 et Félix Bracquemond porte la barbe comme sur la photographie de famille de 1886. Par contre, le travail de la lumière et le style de Marie nous évoquent beaucoup le tableau de « Pierre assis à sa table de travail » et âgé d’une dizaine d’années donc plutôt réalisé vers 1881.
Ce tableau qui fut présenté au salon des impressionnistes de 1886 est dans une facture très classique et sans lien pictural avec l’impressionnisme. Autre étrangeté selon l’ouvrage « Women impressionnist » ce tableau est une peinture sur bois. Il est signé et daté 1886 et Félix Bracquemond porte la barbe comme sur la photographie de famille de 1886. Par contre, le travail de la lumière et le style de Marie nous évoquent beaucoup le tableau de « Pierre assis à sa table de travail » et âgé d’une dizaine d’années donc plutôt réalisé vers 1881.
« Sous la lampe » ou « On vient d’allumer la lampe », Félix et son épouse chez eux à Sèvres
Après études comparatives, j’affirme affirme que Marie a également représenté son époux dans le tableau intitulé « On vient d’allumer la lampe » ou encore « Sous la lampe » et parfois « Le couple Sisley chez les Bracquemond ».
Cette proposition que ce soit les encore Sisley qui soient représentés dînant chez les Bracquemond date sans doute de 1960 et du critique Roger Marx. Une photographie conservée au service de documentation du musée d’Orsay consulté en 2018 prouve que le personnage masculin est indéniablement Félix.
Côté droit du tableau, un couple est attablé dans la lumière du soir diffusée par une lampe en opaline à la couleur verte très affirmée. Au second plan, sur un fond flouté, un vaisselier garni de plats et d’assiettes, l’homme est quelque peu dissimulé par la vapeur s’échappant de la soupière posée entre les deux protagonistes. La partie gauche du tableau est une nature morte, sujet de prédilection des impressionnistes.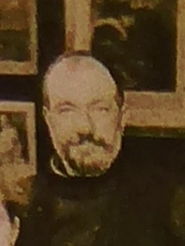
Nous remarquons que le service de table représenté n’est pas l’un de ceux créés par Félix et son épouse mais est l’œuvre d’Edouard Dammouse, un ami de longue date du couple Bracquemond depuis la période de l’atelier d’Auteuil et des créations en faïence de Marie. Marie s’est représentée dans une jolie robe aux teintes assorties à ce service et signe de ce fait un accord, une entente avec Dammouse. Étrangement elle ne porte pas d’alliance mais le bracelet à son poignet se retrouve sur de nombreux dessins. Peu de choses sur la vie d’Edouard Dammouse qui en 1903 est dit célibataire lors de son décès à son domicile 24 Sente de la Grande Haie à Sèvres mais qui fut très présent au moins sur le plan artistique dans la vie de Marie après 1870. Aurait-il été à l’origine de la jalousie mentionnée par leur fils Pierre et dont certains biographes ont transformé l’idée en jalousie par rapport à la notoriété d’artiste de Marie ?
Marie occupe le premier plan à droite mais s’est peinte vue de dos et de trois- quart offrant son profil gauche. Du coup son regard n’est pas tourné vers son époux mais vers la gauche comme vers un personnage extérieur à la scène. Félix est en haut, au centre de la composition mais hors de la lumière de la lampe et dans la vapeur qui monte de la soupière ses traits sont estompés comme dans les paysages de la Renaissance italienne pour marquer profondeur et éloignement mais pourquoi pas également mise à distance dans la vie réelle ? Dans le fond indistinct un vaisselier occupe la scène. Dans la composition mon regard est attiré et en même temps interrogé par un objet symbole d’une époque, le moulin à café. Pourquoi une telle importance lui est-elle attribuée par Marie?
Sa signature en rouge est placée en haut à droite. La touche vibrante et orientée suivant le dessin, les ombres colorées et le travail de la lumière sont tout à fait dans la veine impressionniste et par ce tableau Marie peut réellement compter au nombre des artistes de ce mouvement alors que son tableau le plus connu « La Dame en blanc » et qui fait sa réputation n’est pas « impressionniste ». A la même époque Signac peint lui aussi une scène autour d’une table dans la lumière du jour et par touches pointillistes.
Depuis les années 1960 et le critique Roger Marx, il est fréquemment dit que le couple attablé serait celui de Sisley et son épouse. L’analyse des portraits de Sisley ne va pas dans ce sens. Pour son épouse un portrait de profil ne permet pas non plus de conclure en ce sens. A travers l’étude des traits physiques du personnage masculin, j’ai tout d’abord émis deux hypothèses mais après la consultation du dossier Bracquemond au musée d’Orsay, je suis venue à une autre version dont nous pouvons être sûrs. Ma première hypothèse avant cette découverte était que l’homme ayant servi de modèle à Marie Bracquemond pouvait être le peintre, caricaturiste Félix Régamey (1844-1907) ancien élève de Lecoq de Boisbaudran comme ses deux frères et fouriériste. Tout comme Burty, Rimbaud, Verlaine et bien sûr Bracquemond, Régamey fréquentait les mêmes cafés et faisait partie de plusieurs sociétés dont celle des « Dîners des vilains bonhommes ». Il est aussi passionné d’art asiatique et japonais et ami de Guimet avec lequel il fait un voyage en Asie. Caillebotte présenta des toiles lors des expositions impressionnistes qui eurent lieu en 1876, 1877, 1879, 1880 et 1882. Il n’expose pas en 1886 pour le dernier accrochage du groupe. Sa compagne, Anne-Marie Hagen alias Charlotte Berthier est une amie d’Aline Charigot 1859-1915, amie et modèle puis épouse de Pierre Renoir. Il possédait au moins une œuvre de Marie dans sa collection (laquelle ?) mais qui ne fut pas au nombre des trente-huit toiles acceptées par l’état du legs Caillebotte aux musées nationaux. Martial frère de Gustave Caillebotte avait fait une sélection de soixante-sept tableaux ce qui laisse à comprendre que d’autres sont restés dans la famille ou ont été vendus dont celui ou ceux de Marie. Les trente-et-un tableaux refusés sont pour la plupart achetés par le Docteur Barnes, un américain de Philadelphie qui se constitue ainsi une des plus belles collections mondiales privées consacrée à l’impressionnisme. Mais en fait aucune de ces pistes n’a de réalité ! En dernière hypothèse après y avoir vu un discret autoportrait de Marie, brune au nez un peu busqué et avec des cernes marqués nous avons évolué vers l’idée que Marie s’est représentée en compagnie de son époux Félix. Le couple baigne dans une douce lumière et la vapeur qui s’échappe de la soupière bleue instaure un faible écran entre eux, créant la profondeur. Sous l’œil admiratif de l’homme, la femme vue de dos et de trois-quarts ne nous livre qu’un profil peu distinct. Elle est vêtue d’une jolie robe colorée sans afféterie bien différente des tissus travaillés par Marie pendant de sa période des années 70. Cette scène d’intimité familiale est dans la veine des impressionnistes. Sur la table un ramequin bleu contient quelques mets indistincts et rappelle le petit tableau daté de 1887 où Marie, cette fois, présente des crevettes sur un papier de couleur dorée et le ravier bleu contient du beurre. Certains ont voulu voir dans le choix de ce thème une réponse à la nature morte aux fraises d’Edouard Manet. Peut-être, mais le dialogue entre les deux artistes serait bien distendu car Manet est mort depuis avril 1883. Pour moi en tant que bretonne, j’y verrais l’évocation de son pays natal où nous ne savons pas si elle eut l’occasion de retourner en dehors de séjours avec des amis vers Saint-Enogat ou au Mont St Michel, lieu pittoresque dont son mari a tiré une eau-forte en 1895. Selon Pierre Bracquemond, Marie aurait initialement peint des bijoux dans un coquillage ce qui aurait déplu à son époux et qu’elle aurait secondairement transformés en crevettes dans un papier. Pierre évoque aussi des échanges verbaux très animés entre les époux laissant à entendre que Marie n’était pas dans la soumission mais savait affirmer son point de vue face à un homme dont l’attitude dictatoriale et peut-être tyrannique allait en augmentant avec l’avancée en âge. Sylvie Buisson comme tant d’autres dans son livre « Femmes artistes » renforce encore une fois de plus Marie dans un rôle passif alors que de toute évidence elle ne l’était pas. Dans leur couple, G. Geffroy reconnaît leur entente et l’aptitude qu’avait Marie à calmer les emportements de son époux par ses mots apaisants. La vision que Pierre a transmis de sa mère d’une femme soumise, affaiblie par la maladie et faisant passer les tâches domestiques avant son art est reprise et amplifiée par les biographes qui ont écrit sur Marie Bracquemond mais nous questionnons fortement cette interprétation filiale. La photographie datée d’août 1886 et conservée au musée d’Orsay représentant la famille Bracquemond et Louise Quivoron offre un visage de Félix Bracquemond et l’identification du personnage masculin s’est imposée à nous.
 Le visage plein, le crâne dégarni et une barbe similaire nous prouvent qu’il s’agit bien du même homme et il est sans fondement d’aller questionner les représentations amicales des Bracquemond alors que ce tableau est la représentation d’un moment d’intimité familiale par Marie dans une période bénéfique pour elle et sa peinture. Nous ne pouvons que constater la fragilité des témoignages familiaux car même leurs descendants n’ont pas gardé en mémoire le visage de Félix dans la maturité et ont participé à l’hypothèse que le couple figuré soit celui des Sisley.
Nous remarquons que le service de table représenté n’est pas l’un de ceux créés par Félix et son épouse mais est l’œuvre d’Edouard Dammouse, un ami de longue date du couple Bracquemond depuis la période de l’atelier d’Auteuil et des créations en faïence de Marie. Marie s’est représentée dans une jolie robe aux teintes assorties à ce service et signe de ce fait un accord, une entente avec Dammouse. Etrangement elle ne porte pas d’alliance mais le bracelet à son poignet se retrouve sur de nombreux dessins. Peu de choses sur la vie d’Edouard Dammouse qui en 1903 est dit célibataire lors de son décès à son domicile 24 Sente de la Grande Haie à Sèvres mais qui fut très présent au moins sur le plan artistique dans la vie de Marie après 1870. Aurait-il été à l’origine de la jalousie mentionnée par leur fils Pierre et dont certains biographes ont transformé l’idée en jalousie par rapport à la notoriété d’artiste de Marie ?
Ce tableau pourrait simplement s’intituler « Repas du soir » ou « La table familiale ».
Marie occupe le premier plan à droite mais s’est peinte vue de dos et de trois- quart offrant son profil gauche et du coup son regard n’est pas tourné vers son époux mais vers la gauche comme vers un personnage extérieur à la scène. Félix est en haut, au centre de la composition mais hors de la lumière de la lampe et dans la vapeur qui monte de la soupière. Ses traits sont estompés comme dans les paysages de la Renaissance italienne pour marquer profondeur et éloignement mais pourquoi pas également mise à distance dans la vie réelle ? Dans le fond indistinct un vaisselier occupe la scène. La signature de Marie en rouge est placée en haut à droite. La touche vibrante et orientée suivant le dessin, les ombres colorées et le travail de la lumière sont tout à fait dans la veine impressionniste et par ce tableau Marie peut réellement compter au nombre des artistes de ce mouvement alors que son tableau le plus connu « La Dame en blanc » et qui fait sa réputation n’a rien d’« impressionniste ».
Il est très difficile de suivre Marie dans une évolution. Un vrai caméléon !
Elle semble faire des retours en arrière ou avoir des styles très différents pour une même époque et cela est confusant pour une analyse de son œuvre d’autant plus que sa production est limitée. De même ses signatures sont très variables et traduisent peut-être un état psychique dont il est difficile de se faire une idée faute d’éléments rapportés par son entourage familial ou amical.
Plusieurs tableaux de Marie sont datés entre 1875 et 1889 donnant l’idée d’une période faste de sa créativité alors que généralement il lui est attribué une certaine lenteur de production à l’inverse des autres femmes peintres impressionnistes. Cette source se tarit ensuite.
La Lettre 1886
Le tableau « La lettre » signé « Marie B. » et daté « 86 », censé représenter une certaine « madame Bénédict » sur laquelle nous n’avons pas réussi à trouver de renseignements offre de nombreux points de ressemblance avec les œuvres d’autres artistes. Gauguin a peint en 1878, son épouse Mette cousant dans une position similaire, de profil le visage penché vers son ouvrage. Mary Cassatt a aussi peint plusieurs portraits de femmes lisant un livre ou une lettre. Gustave Caillebotte également en 1880 a traité ce thème comme tant d’autres artistes. Le personnage est entouré de fleurs. Lumière et profondeur sont créées par la fenêtre ouvrant sur un paysage. Il pourrait avoir été exposé en 1962 également sous le titre « Près de la fenêtre ». Un tableau de Claude Monet porte un titre similaire. Marie par la profusion de fleurs au premier plan à gauche donne l’impression que son personnage est en extérieur alors qu’elle lit près d’une fenêtre qui laisse passer une lumière tamisée par un store demi-abaissé. La femme rousse d’une quarantaine d’années est absorbée dans la lecture de la lettre qu’elle vient de recevoir. L’atmosphère est très douce tant par la lumière que par les bouquets aux teintes pastel qui occupent la partie gauche du tableau. Rien à voir avec la crudité du tableau de son fils et de Louise dans le jardin.
Après recherches et réflexion nous faisons la supposition que la femme représentée pourrait être Valentine Le Mancel née le 28 mai 1853 qui épouse le 12 juin 1884 Léonce Bénédite conservateur de musée et très proche du réseau de Félix Bracquemond, les deux épouses pouvant de leur côté avoir noué des liens amicaux. Les deux filles du couple portent les prénoms d’Eva et Rosa qui nous évoquent deux femmes peintres, Eva Gonzalès-Guerard et Rosa Bonheur ! Mais peut être est-ce là pure coïncidence !
En octobre 1886 le critique Félix Fénéon parle dédaigneusement du travail de Marie et de ses ‘imagettes » dans une plaquette intitulée « Les impressionnistes de 1886 » parue aux publications de La Vogue qui reprend deux articles précédents de juin et juillet 1886 en y mêlant quelques phrases de « L’impressionnisme aux Tuileries » publié dans L’Art moderne de Bruxelles du 19 septembre de cette même année:
Le visage plein, le crâne dégarni et une barbe similaire nous prouvent qu’il s’agit bien du même homme et il est sans fondement d’aller questionner les représentations amicales des Bracquemond alors que ce tableau est la représentation d’un moment d’intimité familiale par Marie dans une période bénéfique pour elle et sa peinture. Nous ne pouvons que constater la fragilité des témoignages familiaux car même leurs descendants n’ont pas gardé en mémoire le visage de Félix dans la maturité et ont participé à l’hypothèse que le couple figuré soit celui des Sisley.
Nous remarquons que le service de table représenté n’est pas l’un de ceux créés par Félix et son épouse mais est l’œuvre d’Edouard Dammouse, un ami de longue date du couple Bracquemond depuis la période de l’atelier d’Auteuil et des créations en faïence de Marie. Marie s’est représentée dans une jolie robe aux teintes assorties à ce service et signe de ce fait un accord, une entente avec Dammouse. Etrangement elle ne porte pas d’alliance mais le bracelet à son poignet se retrouve sur de nombreux dessins. Peu de choses sur la vie d’Edouard Dammouse qui en 1903 est dit célibataire lors de son décès à son domicile 24 Sente de la Grande Haie à Sèvres mais qui fut très présent au moins sur le plan artistique dans la vie de Marie après 1870. Aurait-il été à l’origine de la jalousie mentionnée par leur fils Pierre et dont certains biographes ont transformé l’idée en jalousie par rapport à la notoriété d’artiste de Marie ?
Ce tableau pourrait simplement s’intituler « Repas du soir » ou « La table familiale ».
Marie occupe le premier plan à droite mais s’est peinte vue de dos et de trois- quart offrant son profil gauche et du coup son regard n’est pas tourné vers son époux mais vers la gauche comme vers un personnage extérieur à la scène. Félix est en haut, au centre de la composition mais hors de la lumière de la lampe et dans la vapeur qui monte de la soupière. Ses traits sont estompés comme dans les paysages de la Renaissance italienne pour marquer profondeur et éloignement mais pourquoi pas également mise à distance dans la vie réelle ? Dans le fond indistinct un vaisselier occupe la scène. La signature de Marie en rouge est placée en haut à droite. La touche vibrante et orientée suivant le dessin, les ombres colorées et le travail de la lumière sont tout à fait dans la veine impressionniste et par ce tableau Marie peut réellement compter au nombre des artistes de ce mouvement alors que son tableau le plus connu « La Dame en blanc » et qui fait sa réputation n’a rien d’« impressionniste ».
Il est très difficile de suivre Marie dans une évolution. Un vrai caméléon !
Elle semble faire des retours en arrière ou avoir des styles très différents pour une même époque et cela est confusant pour une analyse de son œuvre d’autant plus que sa production est limitée. De même ses signatures sont très variables et traduisent peut-être un état psychique dont il est difficile de se faire une idée faute d’éléments rapportés par son entourage familial ou amical.
Plusieurs tableaux de Marie sont datés entre 1875 et 1889 donnant l’idée d’une période faste de sa créativité alors que généralement il lui est attribué une certaine lenteur de production à l’inverse des autres femmes peintres impressionnistes. Cette source se tarit ensuite.
La Lettre 1886
Le tableau « La lettre » signé « Marie B. » et daté « 86 », censé représenter une certaine « madame Bénédict » sur laquelle nous n’avons pas réussi à trouver de renseignements offre de nombreux points de ressemblance avec les œuvres d’autres artistes. Gauguin a peint en 1878, son épouse Mette cousant dans une position similaire, de profil le visage penché vers son ouvrage. Mary Cassatt a aussi peint plusieurs portraits de femmes lisant un livre ou une lettre. Gustave Caillebotte également en 1880 a traité ce thème comme tant d’autres artistes. Le personnage est entouré de fleurs. Lumière et profondeur sont créées par la fenêtre ouvrant sur un paysage. Il pourrait avoir été exposé en 1962 également sous le titre « Près de la fenêtre ». Un tableau de Claude Monet porte un titre similaire. Marie par la profusion de fleurs au premier plan à gauche donne l’impression que son personnage est en extérieur alors qu’elle lit près d’une fenêtre qui laisse passer une lumière tamisée par un store demi-abaissé. La femme rousse d’une quarantaine d’années est absorbée dans la lecture de la lettre qu’elle vient de recevoir. L’atmosphère est très douce tant par la lumière que par les bouquets aux teintes pastel qui occupent la partie gauche du tableau. Rien à voir avec la crudité du tableau de son fils et de Louise dans le jardin.
Après recherches et réflexion nous faisons la supposition que la femme représentée pourrait être Valentine Le Mancel née le 28 mai 1853 qui épouse le 12 juin 1884 Léonce Bénédite conservateur de musée et très proche du réseau de Félix Bracquemond, les deux épouses pouvant de leur côté avoir noué des liens amicaux. Les deux filles du couple portent les prénoms d’Eva et Rosa qui nous évoquent deux femmes peintres, Eva Gonzalès-Guerard et Rosa Bonheur ! Mais peut être est-ce là pure coïncidence !
En octobre 1886 le critique Félix Fénéon parle dédaigneusement du travail de Marie et de ses ‘imagettes » dans une plaquette intitulée « Les impressionnistes de 1886 » parue aux publications de La Vogue qui reprend deux articles précédents de juin et juillet 1886 en y mêlant quelques phrases de « L’impressionnisme aux Tuileries » publié dans L’Art moderne de Bruxelles du 19 septembre de cette même année:
« Madame Marie Bracquemond qui convie le fusain, l’huile, et tout à la confection de ses imagettes ».
Après 1886
« Les crevettes » signé « Marie.B » et daté 1887 en haut à droite
 En 1887 Marie réalise le petit tableau intitulé « Les crevettes », qui selon Pierre semble avoir été source de conflit entre les deux époux. Initialement Marie aurait représenté des bijoux dans un coquillage dont la portée symbolique et la sensualité du sujet n’ont sans doute pas échappé à son époux lequel selon leur fils n’aurait pas supporté cette affirmation de sa féminité par Marie Félix prétextant selon Pierre que peindre des bijoux ne correspondait pas à leurs valeurs. Elle aurait donc modifié son projet et réalisé ces crevettes dans un ramequin.
En 1887 Marie réalise le petit tableau intitulé « Les crevettes », qui selon Pierre semble avoir été source de conflit entre les deux époux. Initialement Marie aurait représenté des bijoux dans un coquillage dont la portée symbolique et la sensualité du sujet n’ont sans doute pas échappé à son époux lequel selon leur fils n’aurait pas supporté cette affirmation de sa féminité par Marie Félix prétextant selon Pierre que peindre des bijoux ne correspondait pas à leurs valeurs. Elle aurait donc modifié son projet et réalisé ces crevettes dans un ramequin.
Les dernières années 1890-1916
Ce serait autour de 1890 qu’après un temps d’harmonie au sein du couple, la zizanie se soit progressivement installée avec en toile de fond leur avancée en âge et la progression de la maladie nerveuse. Il faut également tenir compte que la majeure partie des données biographiques sur Marie passe par le filtre de son fils. Pierre semble dans un grand attachement à sa mère et avoir eu du mal à se positionner face à son père envers lequel il éprouve du ressentiment. Il affirme des prises de positions qui n’ont d’autre fondement que sa propre perception du caractère de ce dernier. D’autres membres de leur entourage amical renvoient une image de Félix « discuteur », « batailleur » aimant les joutes verbales mais dont les emportements ne tenaient pas dans la durée.Félix Bracquemond que j’ai beaucoup connu, pour lequel j’ai eu et j’ai gardé admiration et amitié, était un terrible maître, à la fois discuteur et autoritaire. Il adorait la discussion, et cela commençait toujours bien avec lui, par des sourires et des malices, mais il avait cette faiblesse de vouloir avoir toujours trop raison, et pour peu qu’on lui tînt tête, cela finissait par des arrêts terribles, rendus avec une fureur croissante. Avec combien de ses amis ne s’est-il pas brouillé à mort, quitte à ne plus y penser quand l’ami revenait le dimanche suivant à l’heure du déjeuner, qui se passait d’une façon charmante en attendant le recommencement des querelles au dessert. G. GeffroyEntre le tableau représentant Louise et Pierre dans un jardin pouvant être daté de l’été 1886 et le portrait ovale de sa sœur en 1898 nous n’avons pas recueilli d’autres portraits de la main de Marie. Douze ans séparent ces deux derniers tableaux et les styles sont totalement différents. Le premier reprend différentes périodes et les couleurs du massif de fleurs sont d’un rouge saturé à la limite de l’agressif peu habituel chez Marie mais qui rappelle certains tableaux de Monet datés des années 1874/1875. Un tel travail de la lumière en extérieur est inhabituel dans l’œuvre de Marie. Le deuxième ressemble beaucoup à des tableaux de Besnard tant par le style que la palette colorée. Encore une fois nous sommes interrogative quant aux différences de styles de Marie et à sa capacité à travailler « à la manière de » ce qui donne des tableaux très différents que sa production limitée en nombre n’aide pas à classer par périodes définissables aisément. Jean-Paul Bouillon relève également ces inspirations stylistiques si différentes qui rendent l’analyse de son parcours des plus ardues. En 1889 Marie expose plusieurs eaux fortes à Paris et la revue Art et critique du 18 janvier 1890 indique qu’ « à la suite de l’exposition des peintres graveurs chez Durand-Ruel, l’Etat a acheté différentes œuvres parmi lesquelles des études d’enfants par Madame Bracquemond ». Marie n’est pas encore grand-mère et s’est inspirée d’enfants de son entourage tout comme son amie Mary Cassatt. Les Benedite sont parents de deux petites filles qui ont pu jouer les modèles pour Marie. Jeanne née en 1879, fille de leurs amis de Sèvres Lucien et Marie Simonnet peut avoir aussi servi de modèle à Marie. Pour cette période nous relevons qu’en 1890, à la galerie Durand-Ruel lors de l’exposition de gravures et eaux fortes qui avait pour invitée la « Royal Society of painters and etchers engravers », Marie présente 4 peintures et 5 eaux fortes 1890 année où est vivement discutée l’acquisition par l’Etat du fameux tableau L’Olympia de leur ancien ami Edouard Manet et pour que son talent soit enfin exposé, les Bracquemond souscrivent pour l’acquisition de l’œuvre à hauteur de cinquante francs. Leurs amis Renoir, Pissarro entre autres font de même. En 1890 le critique Dargenty regrette que les 2 toiles lumineuses (Mais lesquelles ?) de Marie Bracquemond soient perchées si haut à l’expo galerie Durand-Ruel ;
Revue d’aujourd’hui, chronique d’art par G. Geffroy : « Portraits de femmes gravés à l’eau-forte en traits d’une suprême élégance et 4 peintures où les figures et les paysages sont évoqués en fins modèles, en lumineuses apparitions »;La revue hebdomadaire Art et critique, revue littéraire dramatique et musicale du 18 janvier 1890 mentionne sous la plume du critique Jules Antoine à propos de la deuxième exposition des peintres-graveurs à la galerie Durand-Ruel :
[…] des « eaux fortes et pointes sèches : études d’enfants » par madame Bracquemond qui expose aux côtés de Camille Pissarro, Marie Cassatt et d’Albert Besnard entre autres. Le salon « Blanc est noir » est annoncé pour octobre exceptionnellement cette année. Page 303 nous apprenons que suite à l’exposition, l’Etat a fait l’acquisition dans la catégorie « eaux fortes et pointes sèches » d’ »Etudes d’enfants « par madame Bracquemond. A ce jour nous ignorons leur localisation. Mme Bracquemond s’élève aussi au dessus de l’idéal artistique ordinaire à son sexe ; ses peintures manquent de virilité dans l’aspect général, mais les eaux fortes sont très crânes d’allure; le Portrait de l’auteur, celui de J.U. Gustave Geffroy, la scène de Germinie Lacerteux, comme les œuvres de Mlle Cassatt, seraient capables de me convertir à la cause de la supériorité féminine, si ces dames avaient beaucoup d’imitatrices.L’art moderne de Bruxelles de 1890 évoque les acquisitions par l’Etat français d’œuvres déjà vues à Bruxelles et pour Marie Bracquemond, eaux fortes et pointes sèches, « études et portraits » et le dessin « La Cueillette de fruits » monogrammé 1880 ; serait-ce le même que « La Cueilleuse de pommes » également exposé en aquarelle ?? Une huile représentant l’intérieur de la demeure de La Chabanne datée de 1895 et fut exposée à la rétrospective de Mortagne-au-Perche en 1972. Le style de Marie serait alors « assagi » et « mondain ». Mais encore une fois ne serait-ce pas l’œuvre de son fils? Suivant l’inventaire de son atelier en 1919, elle aurait accumulé un certain nombre de toiles restées inachevées. Certains biographes ont voulu y voir l’intervention de son époux opposé à de nouveaux choix stylistiques et ont fait de Marie une victime de l’autoritarisme de Bracquemond mais est-ce cela la vraie raison ? Son tableau de Pierre et Louise n’a rien d’engagé et ne motiverait pas à-priori les attaques de son mari. Le nom d’un collectionneur ayant prêté une œuvre en sa possession pour l’exposition de 1919 nous donne une indication sur les troubles de santé dont Marie pouvait être affectée. Le docteur Jules Batuaud est réputé pour soigner les maladies nerveuses des femmes et ce prêt est la preuve qu’il eut Marie pour patiente. Rappelons-nous que le docteur Sigmund Freud proposait une nouvelle approche des maladies féminines à l’époque nommées «Hystérie » par un travail sur l’inconscient. Batuaud et son maître le docteur Chéron avaient inventé des instruments pour combattre la « neurasthénie génitale féminine» et pour ce faire pratiquaient le curetage de l’utérus chez les femmes. Ils estimaient qu’il fallait également soigner conjointement la névrose neurasthénique. Il est donc certain que Marie était atteinte depuis la fin des années quatre-vingt d’une pathologie qui faisait obstacle à sa créativité et que la supposée attitude dictatoriale de son époux sur laquelle tant de biographes et pseudo féministes se sont jetés n’y est que pour une part dans sa mise en retrait et que Félix mériterait une réhabilitation même si il avait assurément un caractère autoritaire et difficile et bien que ce soit lui qui ait transmis la syphilis à son épouse. L’École des beaux-arts et l’École des arts décoratifs deviennent accessibles aux femmes dans les années 1890, les travaux d’art féminins sont considérés comme une source honorable de revenus et font l’objet d’un intérêt plutôt bienveillant, quoique souvent condescendant, limitant la production des artistes femmes à l’utilitaire des besoins féminins. Ainsi, une première grande exposition en 1892 au Palais de l’industrie, sous le commissariat de l’UCAD, est consacrée aux arts de la femme. En 1893, l’Exposition universelle de Chicago accueille le « Woman’s Building », une exposition féminine dont la section française est organisée par Mme Pégard , future initiatrice du Comité des dames de l’UCAD.
[…]Alors que la première exposition des arts de la femme de 1892 était plutôt consacrée à des industries artistiques au service des femmes – vêtements, bijoux, fleurs artificielles… – celle de 1895 est davantage tournée vers les artistes femmes, même si les industriels ne sont pas absents .En 1893 Marie Bracquemond fait partie des trente artistes femmes françaises sélectionnées pour l’exposition universelle de Chicago qui a choisi de réserver un pavillon dédié à « La Femme ». Elle y expose une eau-forte représentant son ami « Gustave Geffroy » et une seconde de « madame Béraldi » . Mary Cassatt, elle, peint une fresque pour le hall d’Honneur intitulée « La Femme moderne » .
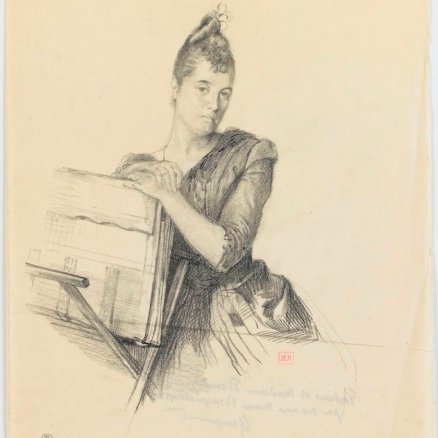 Félix Bracquemond à côté de ses travaux de gravure poursuit ses créations diverses dans le domaine des arts décoratifs. Il est contacté par le mécène et collectionneur le baron Vitta qui se fait construire et aménager par ses amis artistes, une splendide villa à Evian. Outre Bracquemond d’autres proches de ce dernier sont présents sur le chantier de « La Sapinière » dont Albert Dammouse et Besnard.
Que fait Marie pendant ce temps ? C’est sans doute de cette époque que nous pouvons dater les aquarelles de la région de Divonne-les-Bains sur le plateau de Gex proche du lac Léman et du Jura où elle suit une cure dans un établissement pour des troubles nerveux. Le docteur Jules Batuaud qui la suit et son épouse sont en 1902 tous deux amateurs d’art et au nombre des correspondants de Rodin.
Félix Bracquemond à côté de ses travaux de gravure poursuit ses créations diverses dans le domaine des arts décoratifs. Il est contacté par le mécène et collectionneur le baron Vitta qui se fait construire et aménager par ses amis artistes, une splendide villa à Evian. Outre Bracquemond d’autres proches de ce dernier sont présents sur le chantier de « La Sapinière » dont Albert Dammouse et Besnard.
Que fait Marie pendant ce temps ? C’est sans doute de cette époque que nous pouvons dater les aquarelles de la région de Divonne-les-Bains sur le plateau de Gex proche du lac Léman et du Jura où elle suit une cure dans un établissement pour des troubles nerveux. Le docteur Jules Batuaud qui la suit et son épouse sont en 1902 tous deux amateurs d’art et au nombre des correspondants de Rodin.
 Cette aquarelle de paysage très souple et fluide diffère beaucoup de celle représentant une vue des jardins de La Chabanne en Corrèze très colorée mais plus minutieuse et concentrée dans son geste. Encore une fois nous sommes confrontés à de grandes variations dans les productions de M.B. et ceci est porteur d’interrogations sur sa pratique et ses styles.
Besnard et son épouse, séduits par la région achètent une propriété à Talloires sur les bords du lac d’Annecy mais les descendants de la famille que nous avons interrogés ne conservent pas trace d’un séjour des Bracquemond. Déjà âgés et en mauvaise santé tout déplacement semble compliqué pour eux comme le relate Jean-Paul Bouillon dans son texte, «Une visite des Bracquemond chez Latouche » et même si invités, ils n’ont probablement pas rendu visite à leurs anciens amis dans leur nouvelle propriété.
Cette aquarelle de paysage très souple et fluide diffère beaucoup de celle représentant une vue des jardins de La Chabanne en Corrèze très colorée mais plus minutieuse et concentrée dans son geste. Encore une fois nous sommes confrontés à de grandes variations dans les productions de M.B. et ceci est porteur d’interrogations sur sa pratique et ses styles.
Besnard et son épouse, séduits par la région achètent une propriété à Talloires sur les bords du lac d’Annecy mais les descendants de la famille que nous avons interrogés ne conservent pas trace d’un séjour des Bracquemond. Déjà âgés et en mauvaise santé tout déplacement semble compliqué pour eux comme le relate Jean-Paul Bouillon dans son texte, «Une visite des Bracquemond chez Latouche » et même si invités, ils n’ont probablement pas rendu visite à leurs anciens amis dans leur nouvelle propriété.
Marie lithographe
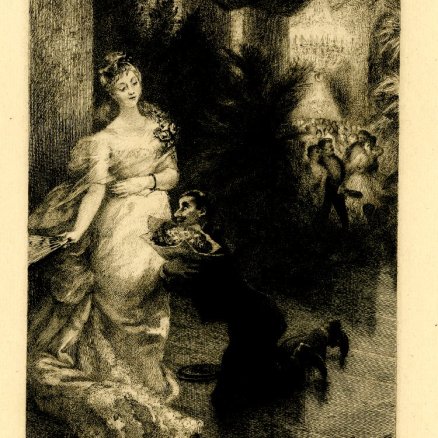 La première eau forte de M.B. date de 1866 ou 1867 donc avant son mariage avec Félix. B. Est-ce lui qui l’a initiée à cette pratique? A l’époque il est encore tourné vers la peinture et réalise son tableau très conventionnel « Portrait de Madame Meurice », elle-même peintre.
Outre les expositions déjà mentionnées ci-dessus en 1889 et 1890 nous relevons les expositions suivantes:
La première eau forte de M.B. date de 1866 ou 1867 donc avant son mariage avec Félix. B. Est-ce lui qui l’a initiée à cette pratique? A l’époque il est encore tourné vers la peinture et réalise son tableau très conventionnel « Portrait de Madame Meurice », elle-même peintre.
Outre les expositions déjà mentionnées ci-dessus en 1889 et 1890 nous relevons les expositions suivantes:
- Catalogue de lithographies et eaux fortes modernes vente du 4/5 mars 1891 coll Ph. Burty n°93 par Marie Bracquemond: « Portrait de jeune homme »; « Jeune femme assise tenant un éventail »; « Une salle d’hôpital ». (BnF 4D2593(F,5) in-8
- Eaux fortes exposition Bernheim 1919
- – Germinie Lacerteux : cela correspond à l’eau-forte mise en vente sous les différents titres « L’Hôpital » ou « Une Visite à l’hôpital ».
- – Le Petit malade : son fils en costume de collégien sur une chaise longue.
- – Le Tableau : pas de descriptif. Cela pourrait-il être le portrait d’une femme peignant un tableau de grandes dimensions ?
- – Portrait de Gustave Geffroy : sera exposé aux E-U en 1893.
- – Portrait de Melle Quivoron : Lequel? un des portraits de Louise de face comme celui offert avec dédicace à Mme Jacquin ?
- – Portrait de Marie Bracquemond. : Marie « en espagnole » avec un éventail ?? un exemplaire sur papier japon mis en vente le 25 novembre 1913 (cat des estampes XVI à XIX 1913.
- – Portrait de Mme Béraldi : Deux versions conservées l’une où Mme Béraldi est appuyée sur un carton à dessin ou celle de ¾ sans décor ?
- – Portrait de Mme Guy-Pellion : Pas trouvé de portrait de cette femme née Louise Berault pour identification
- – Les Ballons : Rien trouvé pouvant correspondre à ce titre. Allusion aux ballons pendant la guerre de 1870? ou jeux d’enfants?

 Encore une œuvre en écho avec un travail de Renoir qui lui aussi a représenté avec le même cadrage une jeune femme dont la modèle serait la jeune Suzanne Valadon. La version de Marie est une version plus marquée socialement par sa représentation de la situation des jeunes femmes pauvres qui tentent de gagner misérablement leur vie.
Encore une œuvre en écho avec un travail de Renoir qui lui aussi a représenté avec le même cadrage une jeune femme dont la modèle serait la jeune Suzanne Valadon. La version de Marie est une version plus marquée socialement par sa représentation de la situation des jeunes femmes pauvres qui tentent de gagner misérablement leur vie.
Les années de silence
En fait en analysant ses œuvres, peintures, dessins et eaux fortes, il semblerait que Marie Bracquemond ait cessé de peindre quelques années après 1886 ce qui expliquerait la présence de toiles de facture non récentes lors de la dernières exposition du groupe des impressionnistes ou de sa participation à l’exposition de Chicago.
La maladie Comme nombre de ses amis dont plusieurs en sont morts prématurément, Félix Bracquemond souffre des dégâts de la syphilis et d’ataxie motrice ce qui a réduit sa mobilité. Une photographie prise par Dornac en septembre 1904 dans la série qu’il fit des personnalités sur leur lieu de vie, montre une importante dégradation physique depuis 1886, avec un homme au visage vieilli et émacié alors qu’il n’a que soixante ans. Il se tient droit mais s’appuie sur deux cannes. Pour contrer la douleur à l’époque, l’usage des opiacés est une des solutions mais Pierre leur fils reste muet sur les problèmes de santé de ses parents car Marie avait sûrement été contaminée et était éprouvée dans son corps elle aussi. Ceci expliquerait peut-être que sous l’effet de la douleur physique, elle se laissait aller à des réactions verbales plus ou moins violentes peu en rapport avec son caractère initial comme le rapporte leur fils. La syphilis provoque aussi des troubles de l’humeur et du comportement dont elle pouvait souffrir mais sur lesquels la famille a jeté un voile de silence. Il m’est venu une hypothèse sur de possibles difficultés psychiques de Marie et pourquoi pas une maladie qui auraient fait que Félix ait voulu tenir les visiteurs à l’écart de son épouse dans un souci de protection et non pas de réclusion. Le critique d’art Léandre Vaillat écrit le 12 avril 1907 un article sur Félix Bracquemond et son caractère :Sa franchise l’incite parfois à une rudesse qui n’est pas le fait d’un pédant autoritaire, mais d’une autorité sûre et d’une conviction qui méprise « les faiseurs » et les bavards. Mais ce n’est qu’un éclat, presqu’aussitôt il s’apaise [et fixant l’intérieur…] en son fond il est bon, très bon même d’une sensibilité qui ne s’épuise pas en trémolos attendrissants mais qui se contient et se révèle malgré lui, d’un geste, d’un mot échappé par hasard .Le 18 juin 1897 Marie et Félix se déplacent jusqu’à Paris pour assister au mariage de leur fils. Pierre épouse Constance Aline Renée Marguerite Barbedette fille d’un notable de La Rochelle, député à Paris et féru de musique, collaborateur de la revue musicale Le Ménestrel . Cette passion de la musique se retrouve chez la petite Marthe Aline Marie Louise qui naît moins d’un an après à Paris, le 9 avril 1898 . C’est elle qui insistera lors de l’exposition de Mortagne-au Perche en 1972 pour que le nom de Marie Bracquemond et ses œuvres figurent aux côtés de ceux de Félix lors de la rétrospective qui lui fut consacrée. Le couple de Pierre Bracquemond ne tiendra pas dans la durée. Frédéric un frère d’Aline Barbedette mort en 1927 repose au cimetière de Saint-Fréjoux.
Derniers temps de vie
Félix bien que très handicapé sur le plan moteur reste toujours actif intellectuellement et reçoit amis et « élèves » à leur domicile rue Brancas mais Jean-Paul Bouillon décrit un couple de personnes âgées craignant les déplacements et les limitant dans la mesure du possible, tout changement prenant des proportions exagérées. Cela est vrai en particulier, selon lui, pour Marie dont le côté anxieux l’empêcherait même de faire des choix de couleurs pour ses tenues vestimentaires qu’elle limite au noir pour éviter toute source de questionnement et d’angoisse preuve que la maladie était à l’œuvre. Ce doute permanent qui était vrai pour sa vie quotidienne l’était sûrement pour ses choix artistiques et l’a contrainte à laisser tant d’œuvres en l’état d’inachèvement sans avoir pu poser la touche finale. Toujours passionné par les arts décoratifs ou ornementaux, Félix se tourne dans les dernières années vers la tapisserie. Gustave Geffroy l’ami et défenseur de Marie est maintenant directeur des Gobelins. Une tapisserie très colorée est attribuée pour son carton à Félix mais je relève que le titre, « L’Odorat » est aussi celui d’une eau-forte de Marie!
En 1899 1900 selon l’article de Maurice Guillemot nous apprenons que Félix fut gravement malade et dut garder la chambre. Et Félix est suffisamment remis de ses problèmes de santé de l’hiver précédent pour se rendre à l’exposition dont il a laissé au moins une aquarelle mise en vente sur internet en 2019. Il collabore également à l’ouvrage L’Art à l’Exposition universelle consacré aux Beaux-arts et aux Arts décoratifs. Jules Comte (dir.). L’Art à l’Exposition universelle de 1900. Paris, Librairie de l’Art Ancien et Moderne, décembre 1900; Ouvrage illustré de cent-une planches gravées ou lithographiées hors-texte et signées Boilvin, Bracquemond, Fantin-Latour, Daniel Vierge…
De Marie nous ne savons si elle l’accompagnait pour cette visite.Lorsque le journaliste le rencontre Félix a toujours l’esprit bien vif mais est handicapé et ne se déplace qu’avec deux cannes. Le couple possède un grand chien, un bull noir.
- Derrière la Manufacture, et en face de l’Ecole normale d’où sortent les Sévriennes, la rue de Brancas monte en tournant jusqu’au sommet du côteau d’où l’on voit, à l’horizon, Paris; à mi-chemin, une maisonnette dont le numéro est caché par les lierres et les glycines, apparaît avec, au bout de la terrasse, un grand atelier à la galerie de bois surplombant les presses ; c’est là qu’habite le vieux maître. Au coup de sonnette, apparaît avec des abois un bull noir, et de la terrasse, M. Bracquemond me jette sa clef pour ouvrir ; très bien remis de la maladie qui l’a tenu prisonnier de la chambre pendant 1899 et 1900, il a une bonne figure de santé sous sa calotte de soie noire, mais ce sont les jambes qui ne vont plus, il marche avec deux cannes et à pas lents. Les yeux sont pâles derrière ‘ses lunettes, la face un peu creusée sous la barbe grisonnante, le rire toujours franc et sonore ; le vieux graveur passe tout son temps à écrire maintenant, et les tables sont encombrées de feuillets noircis, qu’il ne numérote pas, qu’il ramasse en tas, les classant ensuite. Par les allées du parc de Saint-Cloud où la nature s’éveille au premier soleil du printemps, nous cheminons en devisant ou mieux je l’écoute parler, nous invoquons les souvenirs de Sèvres où il reste seul maintenant que sont disparus Troyon, Cladel, Champfleury. Carrier-Belleuse, Rodolphe Bresdin, et la conversation émue va aussi à Mme Marie Bracquemond, artiste de grand talent, aquafortiste (son portrait, la scène de Germinie Lacerteux, etc.) et peintre lumineux, vibrant, intense;
in L’Art et les artistes, 1905, article de Maurice Guillemot
Toujours passionné par les arts décoratifs ou ornementaux, Félix se tourne dans les dernières années vers la tapisserie. Gustave Geffroy l’ami et défenseur de Marie est maintenant directeur des Gobelins. Une tapisserie très colorée est attribuée pour son carton à Félix mais je relève que le titre, « L’Odorat » est aussi celui d’une eau-forte de Marie! 1907 le 12 avril, Léandre Vaillat écrit :« La villa Brancas contient des crayons infiniment souples, de fraîches aquarelles et des toiles qui révèlent en madame Bracquemond dont je déplore la réserve un des meilleurs peintres féminins »[1].Félix Bracquemond meurt le 27 octobre 1914 à quatre vingt un ans. Sa disparition passe quelque peu inaperçue dans le contexte du conflit franco-allemand débutant mais les journaux font part de celle de Marie qui ne lui survit pas longtemps et s’éteint le 17 janvier 1916 à l’aube de ses soixante seize ans, un mois et demi après avoir fêté son anniversaire. Tout comme pour Félix, un des déclarants du décès est le peintre Lucien Simmonet (22/11/1849-16/04/1926) ancien élève de Jules Lefêvre et de Gustave Boulanger aux Beaux-arts de Paris. Peintre à la manufacture de Sèvres il est également paysagiste dans le style de l’école de Barbizon et a produit plusieurs vues de Bretagne. Simonnet est alors veuf de Marie Pauline Beaudet et le père de Jeanne née en 1879. Jeanne reçoit l’enseignement de son père et de Félix Bracquemond (mais sans doute aussi les conseils et l’enseignement de Marie qui pratique peinture et gravure ) pour la pratique de la gravure et devient une artiste reconnue. Sa belle-fille Marguerite et sa petite-fille Marthe qui a maintenant dix-huit ans et est devenue une musicienne accomplie, sont aux côtés de Marie depuis son veuvage. Son fils Pierre était loin de Paris, pris par le service militaire en ces temps de conflit franco-allemand. Félix et Marie reposent tous les deux au cimetière de Sèvres dans la tombe numéro 47 mais étrangement leurs noms n’apparaissent pas. Est enterré à leurs côtés Pierre Jundt, professeur d’allemand et homme de Lettres qui fut également maire de la ville de Sèvres. Fils d’André Jundt pasteur originaire de Belfort, il a un lien de famille avec un ancien ami des Bracquemond, Gustave Adolphe Jundt (1830-1884), peintre et graveur. Théodore Jundt 1828-1898, frère de Gustave est le père d’André et il était proche d’artistes d’origine alsacienne comme Bartholdi qui fit la stèle de Gustave au cimetière Montparnasse. Gustave Jundt est resté célibataire. Dans sa jeunesse il était très lié au poète Leconte Delisle mais je n’ai rien trouvé sur son appartenance possible au fouriérisme. Marthe se marie une première fois le 3 juillet 1920 et elle également n’aura qu’une unique fille, Nadine Angot. Après un divorce en 1924, Marthe se remarie à Saint Fréjoux et devient madame Henriod. Elle décède en 1973 à Moutiers-au-Perche et elle a grandement contribué à la reconnaissance du talent de son ancêtre en faisant que Marie Bracquemond soit représentée lors d’une rétrospective sur Félix Bracquemond en Normandie en 1972. De nos jours le château de la Chabanne est la propriété de la famille Jundt après une alliance entre l’unique fille de Marthe Bracquemond, Nadine Angot et Pierre Jundt.
L’après 1916, les expositions
Comment au vu de ces erreurs de la part de Pierre Bracquemond qui a laissé passer cette confusion entre sa grand-mère et sa mère se fier au catalogue de l’œuvre de sa mère établi par ses soins? C’est lui qui a souvent annoté les dessins mais ses remarques sont-elles toujours fiables ? Tout de suite après la guerre dont il est revenu vivant, Pierre Bracquemond veut faire connaître au public l’œuvre de sa mère. Il monte une exposition à la galerie Bernheim jeune et en établit le catalogue. Le fidèle ami de Marie, le breton Gustave Geffroy rédige la préface mais elle comporte un certain nombre d’inexactitudes. D’abord le lieu de naissance indiqué à Morlaix tout comme la date de 1841, erreurs qui perdurent souvent dans les biographies de l’artiste. Ajoutons la photographie comme représentant Marie jeune selon Geffroy : « belle comme un beau tableau, où la jeune femme est rayonnante de vie, d’intelligence, de la splendide ardeur de vivre ». Or ceci prouve seulement que Pierre a donné une supposée photographie de sa mère jeune sur laquelle le critique s’est enflammé car il faudrait plutôt y voir un portrait de sa grand-mère Aline Pasquiou. Catalogues des peintures, aquarelles, dessins et eaux-fortes de Marie Bracquemond : [exposés du 19 au 31 mai 1919 chez MM. Bernheim-jeune et Cie] ; préface de Gustave Geffroy ; Dans la préface à l’exposition de Marie Bracquemond à la galerie Bernheim de 1919, Geffroy reprend des propos tenus en 1893 :« Il y a une parenté avec la peinture du siècle dernier, une continuation d’art sans imitation dans l’ajouté d’un sentiment très vif de la modernité d’une originalité rapide et franche ».
1919 Exposition galerie Bernheim jeune
Œuvres de Marie Bracquemond (1841-1916) : exposées du 19 au 31 mai 1919, chez Bernheim Jeune. L’exposition présente un certain nombre d’œuvres issues de l’atelier de Marie. Je mets mes remarques personnelles en italiqueMarie contrairement à son ami Claude Monet ne titrait généralement pas ses œuvres ce qui explique les titres différents qui sont donnés aux tableaux et induisent parfois de la confusion. Les intitulés tels « esquisse » ou « étude » ne nous permettent pas de savoir si ce sont des peintures préparatoires comme il en existe pour « Les Trois Grâces » ou comme celle trouvée sur internet mais attribuée à Félix pour « Les Passagers de l’Hirondelle » encore appelée « La Promenade en bateau » (mais dont nous ne voyons pas quel numéro pourrait correspondre dans la liste à moins que ce ne fut « Le Pilote »).
Des quatre-vingt dix numéros attribués et conservés dans l’atelier, il en a été déduit que c’était là tout l’œuvre de Marie, « une centaine de toiles » mais d’autres tableaux ont pu être offerts, vendus…et nous n’en trouverons trace que difficilement ou par le hasard. De ces toiles inconnues certains font des possibles découvertes mais il y a tout lieu d’être vigilant et critique car son nom semble parfois utilisé sans fondement.
Catalogue des œuvres de Marie Bracquemond établi par son fils Pierre et préfacé par G. Geffroy
Peintures
- La Dame en blanc : Louise en blanc
- Sur la terrasse à Sèvres = Le trio avec deux femmes et un homme au centre
- Près de la fenêtre ; un tableau de Monet porte le même titre.
- Avenue de Bellevue sous la neige
- Portrait de Pierre Bracquemond: lequel?
- Chrysanthèmes : autre numéro avec titre similaire
- Roses : même titre n°69
- Le Goûter ; ce titre n’apparaît pas dans les expos antérieures = sans doute « La Tasse de café ».
- La partie de jacquet :
- L’Aquarelliste ; Homme? femme?
- Portrait de Marie Bracquemond ; pourquoi n’est-il pas mentionné « Autoportrait » par M.B ? Le portrait de Rouen est-il de sa main ? La formule induit le doute
- Portrait de Félix Bracquemond = sans doute « Félix dans son atelier »
- On vient d’allumer la lampe ; autres titres « Sous la lampe » et « le Couple Sisley »
- Portrait de Pierre Bracquemond: à quel âge?
- Bouquet
- Esquisse d’après une aquarelle de G. Moreau
- Dans le jardin ; Serait-ce le tableau d’une jeune fille sur un banc avec un bouquet de violettes à la ceinture ? Aucun autre titre ne correspond à ce tableau
- Esquisse du tableau « Sur la terrasse à Sèvres ».= Le Trio?
- Vue du haut Sèvres:
- Vue de Paris : non identifié
- Etude d’arbres en fleurs ; pour l’un de ses tableaux connus ? ex le peintre du tableau aussi appelé « Etude d’après nature » ? ou pour « Marguerite?
- Bouquet près de la fenêtre
- Fleurs dans un vase : pourrait correspondre aux iris dans un vase ?
- Panier de fraises ; une eau-forte en fut tirée ?
- Etude : Côteau de Sèvres
- La route des jardies
- Etude à Sèvres
- Au soleil ; même titre n°86
- Pêches ; documentation Orsay: vente d’une « nature morte aux pêches »
- Etude d’arbres
- Etude pour « le Goûter »
- Etude pour « Près de la fenêtre » : quel peut être le tableau correspondant à ce titre?
- Etude de matin
- Femme lisant ; serait-ce celui là le tableau dit «Madame Bénédict» ? et non celui « Près de la fenêtre»? ou le tableau conservé dans la famille et mis en vente en 2021?
- L’allée de rhododendrons
- La pêche aux écrevisses; un dessin paru dans La Vie moderne numéro du 26 août 1882
- Etude « femme cousant » ; dans le dossier d’Orsay des croquis de trois femmes cousant sous le titre étude de « couturières » monogramme de Félix mais peu en rapport avec ses centres d’intérêts.
- Etude de femme = ?
- Etude pour « La Tasse de café » : non identifié. Peut-être autre titre pour « Le Goûter »?
- Le Peintre ; homme ou femme ? Cela peut-il être le tableau du peintre peignant une jeune fille appuyée sur une ombrelle rouge dans un jardin ? ou tableau d’une femme devant un chevalet avec une grande toile ? ou femme peintre devant un petit format avec une colonne antique en arrière plan?
- Etude d’homme cf n°47; A retrouver pour confrontation avec le tableau dit du Professeur Demons
- Au bord du ruisseau
- Dans un jardin
- Verger à la Chabanne
- Terrasse à la Chabanne ; cf n°75
- Le Pilote ; Titre énigmatique. Qu’est-ce que ce terme peut évoquer ? un enfant conduisant une voiture jouet ? un conducteur de ? plus sûrement Le tableau du navire « l’Hirondelle » .
- Etude d’homme cf n°41. A retrouver pour confrontation avec le tableau dit du Professeur Demons
- Au bord de la Seine
- Etude pour « la Partie de jacquet » :
- La Tricoteuse :
- Femme en rose
- Une allée à la Chabanne
- Sur l’étang
- Portrait de jeune femme = ?
- Anémones
- Etude
- Etude
- Etude
- Projet de tableau « Le jet d’eau »
- Projet de tableau « Le Bain »
- Etude de fleurs; A remarquer que le mot « Iris » n’apparaît jamais dans cette liste
- Roses ; même titre n° 7
- Pivoines
- Femme et fleurs ; un texte fait mention d’une femme respirant des roses en buisson = à retrouver; voir eau forte
- étude pour le portrait blanc : La dame en blanc ?
- Petite femme rose n° 51 titre un peu similaire
- Première communion
- Sur la terrasse de la Chabanne: cf n°45
- Etude pour « Le Goûter »
- La tasse de café :
- Esquisse de « Sur la terrasse à Sèvres »
- Crevettes :
- Narcisses et anémones
- Esquisse de « L’Arbre de Noël »= ??
- Projet de tableau = pas de description
- Bertrand et Raton d’après G. Moreau ; scène animalière deux singes
- Etude de tête, pastel = unique mention d’un pastel dans l’inventaire.
- La Promenade
- Au soleil ; même titre que le n°28
- Les Trois Grâces de 1880 : appartient à M. G. Geffroy
- Reines- marguerites, appartient à M. Gustave Geffroy
- Chrysanthèmes, appartient au docteur Batuaud ; même titre que le n°6
- Portrait de Mme Théodore Haviland, appartient à Mme Haviland : Marie aurait donc également fréquenté le jeune frère de Charles et son épouse depuis 1876, Julia Dannat née aux E-U en 1852. Elle meurt en 1930.
Aquarelles
- Le Mont-Dore
- Solitude
- Portrait de la comtesse Bony de Lavigne ; erreur sur le patronyme = Bony de Lavergne, famille originaire de la région de Limoges et de Metz ; Léopold Bony de Lavergne né en 1857, sculpteur réalise le buste du poète parnassien Léon Dierckx ami de Félix B. et membre des Zutistes
- Etude pour le Mont-Dore
- Le jardin à l’école normale de Sèvres.
- Une allée de l’école normale
- Quatre petites études de femmes
- Au bord du ruisseau: serait-ce une variante du dessin La Pêche aux écrevisses ca 1880?
- L’écharpe violette ? deux esquisses d’une femme vue de dos. dossier Orsay?
- Etude
- L’allée fleurie
- Femme en deuil ? femme plutôt blonde avec une frange = Louise?
- Etude
- Etude
- Etude de fillette
- Etude de femme
- Au bord du ruisseau cf n°98 catégorie « peintures »?
- Cueillette de fruits : autre titre possible « La cueillette de pommes » ? Existe aussi en dessin : La cueillette de fruits, Mine graphite 30,5 x 22,5 cm Monogrammé et daté: MB 1880 vente
Dessins
- Le mur du parc
- La crèche
- La poésie = Etude préparatoire pour le panneau de faïence de 1878 ?
- La Foire de Saint-Cloud
- Etude pour « Les Gants » = ?
- Etude
- Etude
- Etude de jeune homme
- Portrait de Marie Bracquemond : par ?
- Portrait de Marie Bracquemond : par?
- Portrait de madame Chaudesaigues =
- Portrait de Mlle Quivoron
- Portrait de Mlle Quivoron
- Sur la branche
- Etude de visage ; Serait-ce le dessin « Sainte Cécile » cité dans La Vie moderne du 6 décembre 1879?
- La Danse : dessin préparatoire pour le panneau Haviland?
- Etude de robe
- page d’album
- page d’album
- Projet pour un plat
- croquis
- Près de la fenêtre dessin préparatoire au tableau « La Lecture ou Mme Beneditte » ? ou tableau inconnu ?
- Les Beaux-arts, projet de décoration
Eaux-fortes
- Germinie Lacerteux : cela pourrait-il correspondre à l’eau-forte mise en vente sous les titres « L’Hôpital » ou « Une Visite à l’hôpital » par rapport à la description en ?? par le critique xxx de Germinie Lacerteux et des rideaux comme dans une salle d’hôpital
- Le Petit malade : = son fils en costume de collégien sur une chaise longue
- Le Tableau : pas de descriptif. Cela pourrait-il être le portrait d’une femme peignant un tableau de grandes dimensions ?
- Portrait de Gustave Geffroy : sera exposé aux E-U en 1890. Il existerait 2 versions
- Portrait de Melle Quivoron : Lequel ? un des portraits de Louise de face comme celui offert avec dédicace à Mme Jacquin, née Camille Marthe Geneviève Redouin mariée à Paris en 1888 ?
- Portrait de Marie Bracquemond. : Marie semi allongée avec un éventail ?? un exemplaire sur papier japon mis en vente le 25 novembre 1913 (cat des estampes XVI à XIX 1913
- Portrait de Mme Béraldi : Deux versions conservées l’une où Mme Béraldi est appuyée sur un carton à dessin ou celle de ¾ sans décor ?
- Portrait de Mme Guy-Pellion : Pas trouvé de portrait de cette femme née Louise Berault pour identification
- Les Ballons : Rien trouvé pouvant correspondre à ce titre. Allusion aux ballons pendant la guerre de 1870? ou jeux d’enfants?
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Marie dans la presse et expositions
- Le journal La Vie moderne dans son édition du 6 décembre 1879 fait mention du dessin de « Sainte Cécile » par Mme Bracquemond, p.3.
- Art et critique (Paris. 1889) – 1889-1892, 18 janvier 1890, Gallica • eaux fortes et pointes sèches : études d’enfants par Mme Bracquemond; eaux fortes et pointes sèches par M. Albert Besnard (…) Mme Bracquemond s’élève aussi au-dessus de l’idéal artistique ordinaire à son sexe (…)
- La Presse du 24 mai 1919 p. 2 Gallica. Clément-Janin dans le Moniteur du Puy-de-Dôme mentionne 2 aquarelles sur l’Auvergne «Le Mont Dore» et «Etude pour le Mont Dore». Le Moniteur du Puy-de-Dôme 64ème année n° 169 ? du 30 mai 1919, Journal républicain
- L’Auvergne aux Salons, Article de Clément-Janin.
— A ajouter : à l’exposition posthume de Mme Marie Bracquemond, chez Bernheim jeune, deux superbes aquarelles intitulées : « Le Mont-Dore » et « Etude pour le Mont-Dore ». Mme Bracquemond vivait à l’ombre de la gloire de son mari, mais elle possédait une rare sensibilité et s’épanchait en silence dans des pages de premier ordre, dont la légèreté de touche, la transparence de matière montrent que depuis longtemps elle avait poursuivi les recherches d’harmonie si en faveur aujourd’hui. Mme Bracquemond (1811-1910)-sic- comptera dans l’histoire de la peinture contemporaine, à côté de miss Mary Cassatt et de Berthe Morisot.
- Article d’Edmond Epardaud dans Le Figaro 22 mai 1919 Le FIGARO du 22 mai 1919 : LA VIE ARTISTIQUE, Expositions
Il faut marquer cette semaine d’une pierre blanche. Voici toujours des expositions. Mais il en est deux ou trois vraiment remarquables et même supérieures. Deux talents féminins triomphent. L’un disparu et inconnu, l’autre en pleine évolution et déjà apprécié à sa valeur. MME Marie Bracquemond. Ce fut une grande artiste. Peu de gens s’en doutèrent, presque, tous l’avaient oublié personne plus de nos jours ne le savait. Femme du graveur et du théoricien célèbre, exquise nature de dessinateur et de peintre, Marie Bracquemond semble avoir voulu éviter la renommée avec une grâce farouche. Peut-être voulait-elle se tenir dans l’ombre un peu impérieuse de son mari. Peut-être la finesse même de son organisation craignait-elle le jour brutal sous lequel le public voit toujours les confidences d’une âme. Toujours est-il qu’à part une furtive apparition aux Indépendants de 1879, on ne put jamais connaître l’originalité et le charme de son œuvre. A présent, Marie Bracquemond n’est plus, et la lumière ne peut plus rien contre cette réserve parfaite. Au contraire, elle consacre en même temps qu’elle révèle. L’œuvre réunie à la galerie Bernheim Jeune enchantera. Fleurs, portraits féminins, recherches de toute sorte, révèlent une artiste moins nerveuse que Berthe Morisot, plus tendre que miss Cassatt, mais aussi personnelle, aussi attirante que l’une et l’autre de ces grandes figures. « La Dame en blanc », pour ne citer qu’une œuvre, est digne du musée, où elle recevrait l’hommage de bien dès admirations et de bien des rêveries.
- Journal des débats politiques et littéraires du 26 mai 1919
Article de ++ Une pieuse pensée a fait réunir les ouvrages d’une artiste décédée il y a trois ans et dont le talent a égalé la discrétion Marie Bracquemond, femme de Félix Bracquemond, mère de Pierre Bracquemond. L’exposition de la galerie Bernheim est une surprise délectable. Combien de personnes se rappelleront, avant d’y entrer, que Mme Marie Bracquemond, savante élève d’Ingres, prit part en 1879 et en 1880 aux expositions des Indépendants avec Mary Cassatt, Berthe Morisot, Degas, Monet, Cals, Raffaelli, Gauguin, Forain, Lebourg ? Il faut lire les lignes pénétrantes que Gustave Geffroy a écrites au catalogue et qui sont l’émouvante histoire de ce talent exquis, de cette vie retirée. Après 1880, Mme Bracquemond n’abandonna pas l’art, « mais elle ne recourut à lui, pour lui confier ses goûts passionnés de la nature et de la vie, que par intermittences son destin fut ainsi ‘. Ce que Mme Bracquemond montrait en 1879, c’est le carton d’une composition décorative exécutée en faïence l’an précédent, les A~tfscs ef les .Ar~, aujourd’hui au musée de Philadelphie. En 1880, c’est cette Dame en blanc, portrait « qui fit sensation auprès des artistes, et qui a gardé, comme on le voit rue Richepanse, sa délicatesse magistrale. Il suffirait, ce portrait, si clair et si fin dans ses tons, si expressif dans sa grâce, à témoigner d’une sensibilité et d’un esprit également rares. Gustave Geffroy y observe avec justesse « une parenté avec l’art du dix-huitième siècle, une continuation d’art sans imitation, avec l’ajouté logique d’un sentiment vif de la modernité ». En d’autres peintures de Mme’ Marie Bracquemond, je vois 1’influence de la saine technique d’un Courbet. Jamais élève d’Ingres ne fut plus éprise de recherche libre. La Terrasse de la Villa Brancas, montrée aussi en 1880; Z.M y/’OM. Grdcc~’ marquent un renouvellement de vision Mme Bracquemond a découvert par une confrontation de l’art et de !a nature quelles lois exactes règlent la distribution de la couleur et sa combinaison avec la lumière chez les peintres impressionnistes. Elle divise le ton, tout en laissant au dessin une secrète plénitude. Quel musée nous gardera le Go;?La même sensibilité, le même esprit, !a même subtilité d’œil, on les retrouve aux aquarelles de l’artiste il en est de délicieuses: futures, paysages, où la lumière et l’air sont la plus douce nature. D’autre part, Mme Bracquemond, élève, pour la gravure, de l’admirable maître que fut Félix Bracquemond, élève d’Ingres lui aussi, avait conquis elle-même la maîtrise dans l’eau-forte, comme l’attestent de souples et pensifs portraits.1920
- Chronique des arts 31 mai 1920 : acquisition par le musée du Luxembourg pour 4000f d’un tableau de Marie Bracquemond et pour la réouverture du musée des B-A de la ville de Paris un tableau de Marie Bracquemond est exposé dans la même salle que Marie Cassatt Acquisition par le musée des B-A de la ville de Paris de « la Dame en blanc » pour 4000F ;
- La vie artistique. 1re [-8e] série / Gustave Geffroy E. Dentu (H. Floury) (Paris), 1892-1903, Goncourt, Edmond de (1822-1896), Préfacier. •Bracquemond (Mme), p. 323
[…] avec d’exquises pointes-sèches, Mme Marie Bracquemond, avec ses portraits de femmes gravés à l’eau-forte en traits d’une suprême élégance, et quatre peintures, où les figures et les paysages sont évoqués en fins modelés, en lumineuses apparitions…Il faut ensuite attendre quatorze ans pour que le travail de Marie Bracquemond soit de nouveau mis en valeur. 1934 Ce sont les femmes membres de l’Union des Femmes Peintres et Sculpteurs qui organisent une exposition. Jeanne Simmonet de Sèvres, peintre et graveuse en est membre. Salon de 1934 exposition de l’Union des artistes femmes peintres et sculpteurs : Les artistes Marie Bracquemond en peinture et Camille Claudel en sculpture sont conjointement exposées sans que nous sachions si elles ont eu des liens alors que leurs compagnons étaient des connaissances sinon même des amis de longue date. Toutes deux sont ensuite tombées dans l’oubli avant de revenir sur le devant de la scène dans le mouvement contemporain de remise à l’honneur des artistes femmes. Toutes deux ont eu à pâtir de la mise en place de l’effacement des femmes qui a débuté à la Révolution française pour s’amplifier tout au long du dix-neuvième siècle et auquel seulement quelques rares femmes ont pu se soustraire. Pourtant les amis de Félix Bracquemond avaient presque tous pour épouses ou compagnes des femmes artistes de grande valeur que Marie fréquentait ou bien tenait en amitié : Suzanne la femme de Manet, Victoria Dubourg, Marie Cazin, Eva Gonzalès,…et tant d’autres dont la postérité n’a pas retenu les talents. Commentaires :
- Le Bulletin de l’art ancien et moderne, supplément de la Revue de l’art ancien et moderne de juillet 1934, p.298, Gallica :
« Si le groupe féminin qui s’accroit chaque année sous l’active présidence de madame (Marie-Anne) Camax-Zaegger s’est souvenue de Marie Bracquemond -1841-1916- si personnellement « fantinesque » en quelques toiles d’une facture vibrante et d’un sentiment vaporeux… »
-
- La vie moderne, Salon des femmes artistes modernes 1934
« La rétrospective 1934 des plus belles sculptures de Camille Claudel et celle des très précieuses toiles de Marie Bracquemond […] le vernissage aura lieu le jeudi 24 mai à la Maison de France, 101 avenue des Champs Elysées ».
- Arts, sciences et lettres, revue illustrée, organe officiel de l’Union internationale des arts décoratifs, juin 1934.
- René Barrotte pour Paris Presse et L’Intransigeant du 14 avril 1962 :
Le monde et la ville : Trente toiles ou aquarelles de Marie Bracquemond à la galerie Bernheim jeune : « Suite charmante de compositions de plein air, « Sur la terrasse », « Près de la fenêtre », « L’avenue Bellevue sous la neige ».Claude Roger Marx dans le Figaro littéraire du 14 avril 1962 énonce l’hypothèse de Fantin-Latour et du couple Sisley comme ayant servi de modèles à Marie. Jean-Marc Campagne, critique d’art pour le Candide du 26 avril 1962 reprend la thèse que ce sont les peintres Fantin-Latour et Sisley et son épouse qui ont servi de modèles à Marie Bracquemond. Les tableaux cités sont « Sous la lampe », « La Lecture », « Panier de fraises » (non mentionné au catalogue de 1919). Le tableau « Près de la fenêtre » est sans doute le tableau également connu sous le titre « La Lettre ou Madame Benedicte »(sic, Benedite). En 2021, suite au décès d’une descendante de Marie Bracquemond deux œuvres de Marie sont mises en vente sur le marché de l’art. Le tableau « Jeune fille allongée sous un pommier en fleurs » Provenance : Marie Bracquemond. Puis par descendance jusqu’au propriétaire actuel. Restaurations. Le deuxième tableau « Femme lisant » non signé mais attribué à Marie Bracquemond. (Par ?? )
DESCRIPTION ; Marie BRACQUEMOND (1841-1916); Femme lisant Huile sur toile, non signée. Haut. 92 – Larg. 73 cm Provenance : Marie Bracquemond. Puis par descendance jusqu’au propriétaire actuel. Exposition : Bernheim-Jeune, Œuvres de Marie Bracquemond, 19-31 mai 1919, n° 34; Restaurations.;Mais s’agit-il de ce tableau qui figure lors de cette exposition car ce thème de femme lisant un livre ou bien un courrier est récurrent dans l’œuvre de Marie et sans données complémentaires je réserve mon jugement d’autant plus que le tableau ne comporte pas de signature. Tableau dans des teintes pastels et dont la moitié gauche est occupée par un énorme bouquet qui rappelle un peu la disposition du portrait de Pierre peignant à sa table. La femme à la chevelure châtain clair est jeune et vêtue de blanc. Représentée de profil elle est très concentrée sur sa lecture. J’y trouve une ressemblance certaine avec le portrait de Pierre Bracquemond et sa famille conservé au musée de La Rochelle daté de 1902 et je proposerais que la jeune femme figurée ici soit Aline Barbedette autour de 1902.

2023

Avril 2024
Eléments biographiques
Marie, sa famille son enfance
Marie vient au monde sur la côte de Bretagne Nord à Argenton, petit port de la commune de Landunvez le 1er décembre 1840. Elle a été précédée par un garçon prénommé Ernest, né le 28 mai 1839. Leurs parents, Théodore et Aline se sont mariés à Lannion le 7 mai 1838. C’est une fillette toute brune au type espagnol. Du côté de la famille du père, des maîtres de barques, capitaines possédant leur propre navire et faisant du commerce côtier en particulier le négoce des vins de Bordeaux. Théodore Quivoron le père de Marie est né le 8 février 1810 à Landunvez. Il est lui aussi capitaine comme son propre père et l’un de ses frères est négociant en vins. Théodore décède le 25 mai 1864 dans sa demeure de Lannion (Bretagne), à l’âge de 54 ans sans que nous sachions s’il avait gardé un quelconque lien avec sa fille ou son épouse Aline.
Aline Pasquiou, sa mère, naît le 24 avril 1819 à Lannion dans une famille aisée. Son père Louis est huissier royal, audiencier auprès du tribunal et du côté maternel, des juristes ou des négociants en draps mais aussi bien sûr des marins. Yves Perrein, son ancêtre côté maternel né en 1777, était marin au commerce et capitaine de navires pratiquant le commerce triangulaire et la traite des africains, source de revenus importants même si peu de négociants armèrent des navires à cette navigation sur cette portion de côte bretonne à la différence de la région de Saint-Malo. Marie-Hélène Perrein meurt rapidement laissant sa petite Aline orpheline. Louis Pasquiou (1786- 1831 ) se remarie à Laouenec à côté de Perros-Guirec le 17 février 1824 avec Marie Louise Crechriou (1800-1831) qui est cultivatrice mais tous deux décèdent à quelques jours d’intervalle au printemps 1831 peut-être lors de l’épidémie de choléra qui se propagea en Bretagne faisant un nombre incalculable de victimes dans les villes côtières laissant Aline totalement seule à treize ans sans appuis familiaux proches. Aline Pasquiou a sûrement reçu une bonne instruction et peut-être pratiquait-elle également le dessin ou l’aquarelle ou encore la musique comme nombre de jeunes filles de la bourgeoisie trégoroise inscrites dans un pensionnat.
Dans cette vieille société, qui a inspiré plus d’un regret à l’auteur de la Vie de Jésus, on ne laissait pas grand chose au hasard et les unions s’appuyaient d’ordinaire sur des relations anciennes et sur une considération réciproque. Filles et garçons» soumis aux volontés de leurs parents, considéraient le mariage moins comme une affaire de sentiment que comme un établissement. Léon Dubreuil Annales de Bretagne, 1947, « La famille maternelle de Renan ».
Des amitiés qu’Aline a nouées pendant ces années de jeunesse rien ne nous est parvenu mais j’ai cependant tenté d’identifier quelques hypothétiques liens.
Henriette Renan 1811-1861 Sœur d’Ernest Renan, elle est plus âgée qu’Aline. La famille maternelle des Renan était originaire de Lannion et le père capitaine au cabotage donc du même groupe socio-culturel que celui des Pasquiou/Perrein où s’entrecroisent noblesse désargentée et négociants ou hommes de loi. Elles ont pu se fréquenter dans la même institution religieuse ou dans la ville jusqu’en 1835. A cette date Henriette prend un poste d’institutrice à Paris après avoir créé à Lannion un cours privé pour jeunes filles qui ferme assez rapidement mais dans lequel –pourquoi pas ?- Aline a pu être inscrite. Les familles Renan, Féger et Perrein étaient du même milieu de la bourgeoisie commerçante mais également la famille de l’épouse d’Emile Langlois le futur compagnon d’Aline, les Prigent. On relève d’ailleurs des alliances antérieures Pasquiou/Prigent.
Ce réseau lannionais a t’il été activé par Aline lorsqu’elle a rejoint la capitale après ses quelques années corréziennes? Le patronyme Geffroy du critique d’art ami de Marie Bracquemond se retrouve lui aussi dans les mariages de la côte trégorroise.
Caroline Josèphe Marie de Penguern 1816 Sœur du littérateur Jean-Marie de Penguern, Caroline est née le 16 juin 1816 à Morlaix mais la famille vit plusieurs années à Lannion où leur père siège comme président au tribunal de 1818 à 1843. De par la profession de leurs pères respectifs et leurs âges proches il est plus que probable que les deux jeunes filles et leurs familles se fréquentaient. Jean-Marie a étudié à Rennes où il a vécu jusqu’en 1839 et fréquenté les jeunes intellectuels de la ville dont l’homonyme du futur compagnon d’Aline, Emile Langlois, écrivain et musicien qui tenta sa chance à Paris où il décède. Caroline épouse le 21 août 1837 à Lannion Auguste L’Hostis, employé des contributions indirectes mais pour l’heure nous perdons toute trace du couple.
Emilie dite Jenny Le Gall de Kerven 1819 Née à Brest, elle épouse le 20 avril 1846 dans cette même ville Augustin François René Charles Jobbé-Duval (1818-1902), agent de change dont le père avait été nommé géomètre en Bretagne Nord. Le peintre Félix Jobbé-Duval n’est jamais cité comme un proche des Bracquemond et pourtant leurs réseaux amicaux se recoupent. Lors de son mariage le 7 mai 1838, Aline est donc orpheline de mère et de père. Selon Pierre Bracquemond son petit-fils qui ne l’aura pas connue plus d’un an, le mariage aurait été arrangé comme cela était alors pratique courante. Un cousin Perrein du côté maternel d’Aline, capitaine également, est marié à une jeune femme de Landunvez et pourrait avoir été l’intermédiaire de cette union qui va conduire la jeune citadine dans une maison de pierres face à la mer et un isolement et une solitude qui lui auront sans doute été difficiles à supporter. Le mariage ne va pas durer et selon Pierre, Théodore Quivoron serait parti en expédition aux Marquises peu de temps après la naissance de Marie, laissant seuls en Bretagne son épouse et leurs deux jeunes enfants. Il y eut bien une expédition dans cette période sous le commandement d’Aubert du Petit-Thouars qui part de Brest en décembre 1841 et prend possession en mars 1842 de l’archipel des Marquises, lequel est alors intégré aux Établissements français de l’Océanie. Mais il reste encore à prouver la participation de Quivoron à cette entreprise. Sur l’un des navires, « La Reine blanche », est embarqué le jeune Max Radiguet originaire de Landerneau qui fait le récit du voyage dans ses « Souvenirs ». En 1862 Radiguet est de retour à Paris après un bref retour dans sa famille bretonne. Visiteur assidu des salons de peinture parisiens, Radiguet envoie ses comptes rendus à deux journaux brestois. Dans ses lettres sur le salon de 1875, il ne fait mention d’aucune femme et donc ignore Marie Bracquemond.Première partie – L’arrivée et l’installation. Dans les derniers jours du mois de mars 1842, la frégate la Reine-Blanche, l’aile ouverte aux brises alizées, quittait Valparaiso et se dirigeait vers le couchant. Elle avait à son bord un brave amiral que ses goûts et ses antécédents préparaient à toutes les entreprises glorieuses, deux capitaines de frégate, une compagnie supplémentaire de marins, le matériel et les ustensiles indispensables à un corps de troupes destiné à tenir campagne. L’intention d’occuper un pays était donc manifeste. Quel était ce pays ? C’est ce que nous ignorions encore en perdant de vue les côtes du Chili, bien que nos conjectures ne se fussent point égarées. Un soir, enfin, trois jours après le départ, le tambour rassembla sur le pont le nombreux personnel de la frégate, et la lecture d’un ordre du jour confirma nos suppositions : nous allions planter le drapeau de la France sur les îles Marquises de Mendoça. Souvenirs de Max Radiguet.Lequel des deux époux est à l’origine de la séparation, difficile d’en savoir réellement quelque chose. Alors que son époux navigue sur les mers lointaines, la destinée d’Aline Pasquiou croise celle d’un jeune homme de Rennes dont le parcours est particulier. Emile Langlois tout juste âgé de dix-huit ans, épouse en 1840 une femme de trente-sept ans son aînée, veuve depuis peu. Elisabeth Prigent de Keraudren a cinquante-cinq ans et vit à Rennes où elle est née le 20 octobre 1785 mais son père Jean Yves Alexis Prigent, Franc-maçon, avocat au Parlement de Bretagne, puis procureur au Présidial de Rennes était originaire de Lannion où il était né le 23 février 1758. Fille unique, elle a dû hériter de biens dans cette ville. Serait-ce en visitant les multiples cousins ou les propriétés de son épouse qu’Emile rencontra Aline Pasquiou-Quivoron et que l’amour vint bouleverser leurs vies? C’est tout à fait plausible. Suivant les souvenirs familiaux ce serait à l’occasion d’une fête familiale rassemblant le ban et l’arrière ban des cousins à la mode de Bretagne. Aline aurait été logée dans l’Hôtel de « Ker Ugien » sans doute Crech’ Ugien. Le seul mariage important à Lannion que j’ai relevé dans ces années est celui Le manoir de ville ou Hôtel de Ker Ugien appartient à la famille de Boisboissel et ceci interroge sur les liens entre Aline et cette famille. Hyacinthe (1778- 26 mars ou mai 1848) est l’époux de damoiselle Anne-Marie-Julie de Saisy Kerampuil, (1797- 29 mai 1861). Il est d’ingénieur-vérificateur et géomètre en chef du cadastre dans les départements de la Loire puis du Tarn à Albi. Or c’est le nom de cette ville qui est donné pour lieu de naissance de Marie dans certains catalogues. Ceci est intrigant!
Marc-Marie-Frédéric de Boisboissel (1824-1886), né à Alby le 20 août 1824. Porte le titre de comte comme son frère Anne-Marie-Hyacinthe. Médecin, il vécut à Lannion, au manoir de Crec’h Ugien et fut maire de Trébeurden. Il meurt au manoir de Crec’h Ugien à Lannion le 15 novembre 1886.La piste de la famille de Boisboissel est à donc creuser pour Lannion et Albi. Autre hypothèse: La biographie du graveur Rodolphe Bresdin né en Loire-Atlantique en 1835 donne aussi un séjour à Albi, un autre en Corrèze au Nord de Tulle puis à Bordeaux et il termine sa vie à Sèvres en 1885. Félix Bracquemond le fréquente depuis leur jeunesse parisienne et est au nombre des rares personnes qui l’accompagnent jusqu’à la fosse commune du cimetière avec Léon Cladel, Aglaüs Bouvenne et Husson dit Champfleury. Une piste de réseau amical d’Aline Pasquiou? En tout cas les deux jeunes gens décident de vivre leur amour et d’abandonner leurs foyers respectifs pour devenir des parias de la société. Ils s’enfuient donc selon le roman familial dans le Jura puis en Suisse. Pourquoi ces destinations? A ce jour aucune hypothèse ne surgit pour le comprendre. Le fils d’Aline, Ernest, reste en Bretagne élevé par sa tante Quivoron épouse Puluhen devenue veuve après le décès en mer de son époux mais qu’en fut-il du déchirement de sa mère d’abandonner son petit garçon et se revirent-ils tous les deux? A son retour en Bretagne Théodore Quivoron vend sa maison de Landunvez à sa nièce et s’installe à Lannion. La petite Marie, quant à elle, suit le couple de sa mère et de son compagnon que par facilité je nommerai parfois « beau-père » bien qu’il n’eut nul droit de porter ce titre. Sources: A propos des racines bretonnes de Marie et les personnes qui ont tracé la route de sa biographie :
- article du Sémaphore en 2003 et travaux de madame Massicot dans la revue de généalogie Le Lien en 2008
- http://archives.haute-vienne.fr/_depot_ad87/ 105 J Fonds Nicole Marić-Haviland (1872-2012) Répertoire numérique détaillé des archives de Paul Burty Haviland, Suzanne Lalique, Nicole Marić-Haviland, et des familles Haviland et Lalique par Anne Gérardot conservatrice du patrimoine Limoges 2016. Julie Margaret Dannat née aux Etats-unis en 1852.
Emile Langlois 1822-18 ??
Le grand-père d’Emile, Louis Gabriel Langlois naît à Soissons en 1750 puis devient marchand à Reims avec son épouse Marie Louise Clément. Ensuite après les guerres napoléoniennes, Gabriel s’installe à Rennes. En 1814 sur son acte de décès daté du 11 décembre, il est mentionné « employé à la surveillance et la conduite des mécaniques du dépôt de mendicité » de la ville. La grand-mère, Marie Louise Clément, exerce seule l’activité de marchande à Reims où elle demeure loin de son époux et de son fils Théophile. De ce côté maternel, des parents Clément sont en lien avec la bourgeoisie parisienne.
Le père d’Emile, Joseph Théophile est né à Reims le 19 brumaire an 3 (1794) où poursuivant la lignée familiale il devient marchand. Il rejoint ensuite son père en Bretagne et il se marie le 23 décembre 1817 avec Marie Michel, une jeune femme originaire de Bruz aux environs de Rennes. Les témoins sont des acteurs influents de la ville: Guillaume Le Graverend avocat, député et bien sûr franc-maçon, à l’époque professeur de Droit civil puis avocat général à la Cour impériale. Un dénommé Marc Langlois, un autre Langlois ainsi que deux femmes, Jeanne Françoise Boussard(?) Legraverend et Françoise Chomalus-Duchêne signent aussi le registre. Lors de son mariage Théophile Langlois est pharmacien aux salles d’humanité de l’hospice puis pour la naissance de ses fils il est dit « épicier », les deux professions étant proches à l’époque Emile naît à Rennes le 31 août 1822. Il a deux frères aînés, Félix Amand né le 24 juin 1819 et Jules Théophile Constant né le 25 avril 1818. Jules Théophile se pique de poésie et est membre du groupe de jeunes bourgeois accueillis chez l’horloger Edouard Alix. Il y croise Victor Lemonnier (1815-1875), dessinateur et poète.Si les poèmes de Victor Lemonnier ont peu marqué son époque, ses dessins et gravures font preuve de caractère et d’originalité. Ainsi n’hésite-t-il pas à employer le gillotage, fameux procédé de dessin sur papier préparé au blanc de céruse apparu dans les années 1850 et permettant, après prise de vue, une gravure industrielle.Ce frère reste célibataire mais a pour ami un peintre connu, Alexis Auguste Dumoulin dit Darcy-Dumoulin qui signe comme témoin lors de son décès en 1856. Il est né à Noyon. Cette ville est également un point commun avec le père de Flore Vasseur épouse de Dumoulin qui s’installe à Lesneven pour sa carrière professionnelle. Les guerres napoléoniennes puis la mise en place de l’organisation de la France ont brassé énormément de personnes et créé des réseaux peu évidents à mettre en valeur. Le monde artistique semble donc proche de cette famille de négociants épiciers et les frères Langlois croisent dans les cafés rennais fréquentés par les jeunes rennais, le futur poète Leconte Delisle et d’autres bourgeois tentés par les idées socialistes et en particulier le fouriérisme. Claude-Gabriel Simon futur directeur du journal nantais « Le Breton« , le poète Hippolyte Michel de La Morvonnais (11 mars 1802, Saint-Malo – 4 juillet 1853, Pleudihen-sur-Rance) sont au nombre de ceux-là tout comme le peintre Félix Armand Jobbé Duval qui revenait fréquemment dans sa famille avant de gagner la capitale. Emile Langlois est restée dans l’anonymat le plus grand mais en s’attachant à diverses biographies et en faisant des recoupements il apparaît que les théories fouriéristes pourraient être un lien qui unit ces jeunes gens et seront à compter dans l’entourage de Marie Quivoron avant même sa rencontre avec Félix Bracquemond. Il faudrait aussi questionner d’éventuelles appartenances à la franc-maçonnerie dont nous savons l’importance des réseaux. Félix Jobbé-Duval était maçon.
Emile Langlois, un homme particulier
Encore mineur, Emile épouse le 21 octobre 1840 (AM 3E 49 vue 127) Rennes une femme de cinquante-cinq ans (née le 20 octobre 1785). Trente sept ans d’écart d’âge entre les conjoints! Son père est présent et donne son accord pour cette union pour le moins étrange. Sa mère, née Michel, était morte deux ans auparavant en 1838. Seul son frère Jules Théophile signe le registre lors du mariage et du second, Félix Amand, ( un mariage en Angleterre,) nous n’avons pas connaissance ni de son devenir ni d’une éventuelle influence dans la vie d’Emile. Mais pourquoi à dix-huit ans à peine révolus Emile Langlois se marie t’il avec Elisabeth Prigent de Keraudren, une femme veuve depuis un an et de dix ans plus âgée que son propre père? L’amour? Un arrangement financier qui lui permettra de profiter de la dot de son épouse? La réparation imposée par son père d’avoir déshonoré cette femme veuve? Difficile d’imaginer autre chose! En tout cas, le divorce n’étant plus possible, il reste lié par les liens du mariage jusqu’en 1866 date de son veuvage et ne pourra reconnaître les deux enfants qu’il aura eu avec Aline Pasquiou, elle aussi de son côté toujours mariée à Quivoron Le couple Pasquiou/Langlois Deux ans environ après la naissance de Marie, Aline Pasquiou voit sa route croiser celle du jeune rennais et tous deux rompent les amarres pour vivre ensemble. Cependant ils ne peuvent rester vivre leur amour illégal en pays connu et quittent alors la Bretagne pour se réfugier à l’autre bout de la France, dans le Jura et en Suisse selon le roman familial. Mais aucune trace concrète de ce séjour dans l’Est ne vient étayer ces dires. Un petit garçon naît en 1844 ou 1845 et est prénommé Emile comme son père qui ne peut officiellement le reconnaître étant, tout comme sa compagne, toujours marié et l’enfant doit porter le patronyme de Quivoron. Nulle évocation de cet enfant autre que sa présence lors du passage de l’agent recenseur à Étampes en 1861. Pas de naissance à Lannion, ni Rennes, ni Saint Fréjoux, ni Cîteaux, ni Besançon ni Albi pas plus qu’à Paris….rien sur son décès non plus ce qui expliquerait qu’il n’apparaisse jamais dans les biographies de l’artiste. Marie a exposé en 1859 un tableau de sa famille et si nous avions connaissance de celui-ci sans doute aurions-nous l’occasion de mettre un visage sur ce demi-frère ! Nous retrouvons Emile Langlois en 1848 en Corrèze où il vit non loin d’Ussel dans un petit village appelé Saint Fréjoux. En mars il se rend acquéreur sur adjudication à la bougie pour 90.000f du domaine de Bonnaigue appartenant à madame Anne Hersilie Bourlin épouse Séravalle, L’exploitation est importante et comporte une ancienne abbaye avec des terres, des bois, plusieurs moulins, une filature de laine, une scierie mécanique, une forge… Aurait-il eu l’intention d’y établir une entreprise sur le modèle fouriériste du phalanstère comme à Cîteaux quelques années auparavant? En tout cas il dispose d’une aisance financière importante pour réaliser cet investissement! Nous nous sommes interrogée sur son séjour dans l’Est et une possible formation à l’école de Roville dirigée par Dombasle qui lui aurait permis de diriger une exploitation agricole comme celle de Bonnaigue mais en définitive le patronyme « Langlois » n’apparaît pas dans les anciens de Roville. A Rennes un ancien étudiant de Dombasle, Jean-Jules Bodin qui fut le fondateur de la ferme-école des Trois-Croix a pu influencer le choix de Langlois de s’orienter vers l’agriculture mais pour l’heure rien ne vient confirmer cette hypothèse. Selon une femme qui a fréquenté la famille vers 1960, une filature aurait été installée dans l’ancien couvent.
Anne Hersilie Bourlin est née à Bonnaigue et sa mère y meurt en 1837. En 1841, le 10 février elle épouse Joseph François Jules de qui avait été nommé à Ussel à la fin de l’année 1840 et ils ont un fils né en 1841 puis une fille, Antoinette Aglaé Louise née le 26/4/1843. Son père, Raymond Bourlin qui a hérité de Bonnaigue ne peut honorer les nombreuses dettes qu’il a contractées et à son décès en novembre 1846, Anne et son époux ne disposent pas de moyens suffisants pour les régler et se voient dans l’obligation de mettre en vente le domaine. Lorsque Langlois en fait l’acquisition il est spécifié sur l’acte qu’il est « sans profession actuellement » et demeure déjà à Bonnaigue ce qui laisse à penser qu’il s’y est installé en 1847.
Joseph François de Serravalle et sa famille quittent Ussel pour Paris en 1850. Leur fille Antoinette a tout comme Marie des talents en dessin et peinture et elle aussi exposera au Salon en 1868 deux portraits, une peinture et un dessin.
ALLEVARRES (Jules), anagramme du nom de Joseph François Jules de SERRAVALLE, ancien professeur, sous-chef au ministère de l’instruction publique, né à Mont-de-Marsan (Landes), en 1821. –Auteur de « Caritas », pièce qui a remporté le premier prix de poésie française proposé par la Société d’émulation de Cambrai. se édition. In-8°. 1861. Belin. – « Le Secret du docteur », drame en trois actes, envers. 2 ème édition. In-16.188.5. Lévy frères. 1 fr. 50 c. La 3ème édition est de 1863. M. J. de Serravalle a encore signé du même pseudonyme une traduction de l’italien en vers français de : « Judith », tragédie de Paolo Giacometti. In Catalogue général de la Librairie française 1867 Lorenz
Chez les Langlois, une petite Louise Marie Mathilde naît le 12 octobre 1849 à St Fréjoux. Elle est déclarée comme fille de Langlois et son épouse Aline Pasquioux. Le baptême a lieu le 14 au milieu d’une assemblée nombreuse d’amis de familles notables de la région et l’acte de baptême laisse à voir que le couple d’Emile Langlois et Aline Pasquiou vivait comme un couple marié et non illégitime et que pour garder leur façade d’honorabilité ils ont triché sur leur état civil. Madame de Serravalle ancienne propriétaire de Bonnaigue est au nombre des invités et signe l’acte de baptême de Louise. L’année suivante elle quitte la région avec son époux nommé à Paris au ministère de l’instruction publique mais Aline Pasquiou et elle ont peut-être noué une amitié que la jeune bretonne aura réactivée lors de son arrivée à Paris quelques années plus tard. Trois ans après le couple des bretons se sépare et pour Marie c’est la fin d’une période heureuse et insouciante selon ses propos rapportés dans les Mémoires de son fils. Par contre la vérité était peut-être différente pour Aline confrontée à un homme qui sous une facette de séduction devait se montrer bien compliqué et lui offrir une vie dont elle n’avait sans doute pas rêvée.
Un grand-oncle Bourlin avait été au 18e siècle un goguettier réputé puis ensuite était devenu organisateur de spectacles en province.
Par quel biais Emile Langlois vient-il s’installer en Corrèze? Serait-il arrivé là par l’intermédiaire de Pierre Lachambaudie (1806-1872). Cette piste m’est apparue en analysant la liste des signatures lors du baptême de Louise qui comporte plusieurs patronymes « D’Amarzit » famille dont le château du Bazaneix jouxte le domaine de Bonnaigue. La mère de Pierre Lachambaudie est une demoiselle D’Amarzit ou D’Amarzid propriétaires en St Fréjoux.
Pierre Casimir Hippolyte Lachambaudie, poète socialiste d’origine corrézienne 1806-1872
Ce poète goguettier qui connut la célébrité a eu son ouvrage « Fables » préfacé par le breton Emile Souvestre (1806-1854) lui aussi littérateur reconnu à l’époque qui fréquentait les salons où il côtoyait hommes de lettres, artistes peintres et hommes politiques de tendance républicaine. Le poète Béranger n’est pas loin non plus. Pour une édition postérieure les Fables de Lachambaudie seront préfacées par le socialiste Pierre Leroux ami du nantais d’adoption Ange Guépin. Saint-simonien dans sa jeunesse comme Souvestre, Lachambaudie bifurque ensuite vers le fouriérisme. Egalement franc-maçon de la loge de «La Rose du parfait silence », il prend part aux manifestations maçonniques en faveur de la Commune et signe l’appel du 5 mai 1871.
Après la guerre contre les prussiens et la Commune, Lachambaudie est tout comme de nombreux proches des Bracquemond membre des « Zutistes » , groupe de d’artistes qui se retrouvent au Quartier latin dans l’entresol de l’Hôtel des Etrangers[1].
Nous nous sommes interrogée sur son séjour dans l’Est et une possible formation à l’école de Roville dirigée par Dombasle qui lui aurait permis de diriger une exploitation agricole comme celle de Bonnaigue mais en définitive le patronyme « Langlois » n’apparaît pas dans les anciens de Roville. A Rennes un ancien étudiant de Dombasle, Jean-Jules Bodin qui fut le fondateur de la ferme-école des Trois-Croix a pu influencer le choix de Langlois de s’orienter vers l’agriculture mais pour l’heure rien ne vient confirmer cette hypothèse. Selon une femme qui a fréquenté la famille vers 1960, une filature aurait été installée dans l’ancien couvent.
Anne Hersilie Bourlin est née à Bonnaigue et sa mère y meurt en 1837. En 1841, le 10 février elle épouse Joseph François Jules de qui avait été nommé à Ussel à la fin de l’année 1840 et ils ont un fils né en 1841 puis une fille, Antoinette Aglaé Louise née le 26/4/1843. Son père, Raymond Bourlin qui a hérité de Bonnaigue ne peut honorer les nombreuses dettes qu’il a contractées et à son décès en novembre 1846, Anne et son époux ne disposent pas de moyens suffisants pour les régler et se voient dans l’obligation de mettre en vente le domaine. Lorsque Langlois en fait l’acquisition il est spécifié sur l’acte qu’il est « sans profession actuellement » et demeure déjà à Bonnaigue ce qui laisse à penser qu’il s’y est installé en 1847.
Joseph François de Serravalle et sa famille quittent Ussel pour Paris en 1850. Leur fille Antoinette a tout comme Marie des talents en dessin et peinture et elle aussi exposera au Salon en 1868 deux portraits, une peinture et un dessin.
ALLEVARRES (Jules), anagramme du nom de Joseph François Jules de SERRAVALLE, ancien professeur, sous-chef au ministère de l’instruction publique, né à Mont-de-Marsan (Landes), en 1821. –Auteur de « Caritas », pièce qui a remporté le premier prix de poésie française proposé par la Société d’émulation de Cambrai. se édition. In-8°. 1861. Belin. – « Le Secret du docteur », drame en trois actes, envers. 2 ème édition. In-16.188.5. Lévy frères. 1 fr. 50 c. La 3ème édition est de 1863. M. J. de Serravalle a encore signé du même pseudonyme une traduction de l’italien en vers français de : « Judith », tragédie de Paolo Giacometti. In Catalogue général de la Librairie française 1867 Lorenz
Chez les Langlois, une petite Louise Marie Mathilde naît le 12 octobre 1849 à St Fréjoux. Elle est déclarée comme fille de Langlois et son épouse Aline Pasquioux. Le baptême a lieu le 14 au milieu d’une assemblée nombreuse d’amis de familles notables de la région et l’acte de baptême laisse à voir que le couple d’Emile Langlois et Aline Pasquiou vivait comme un couple marié et non illégitime et que pour garder leur façade d’honorabilité ils ont triché sur leur état civil. Madame de Serravalle ancienne propriétaire de Bonnaigue est au nombre des invités et signe l’acte de baptême de Louise. L’année suivante elle quitte la région avec son époux nommé à Paris au ministère de l’instruction publique mais Aline Pasquiou et elle ont peut-être noué une amitié que la jeune bretonne aura réactivée lors de son arrivée à Paris quelques années plus tard. Trois ans après le couple des bretons se sépare et pour Marie c’est la fin d’une période heureuse et insouciante selon ses propos rapportés dans les Mémoires de son fils. Par contre la vérité était peut-être différente pour Aline confrontée à un homme qui sous une facette de séduction devait se montrer bien compliqué et lui offrir une vie dont elle n’avait sans doute pas rêvée.
Un grand-oncle Bourlin avait été au 18e siècle un goguettier réputé puis ensuite était devenu organisateur de spectacles en province.
Par quel biais Emile Langlois vient-il s’installer en Corrèze? Serait-il arrivé là par l’intermédiaire de Pierre Lachambaudie (1806-1872). Cette piste m’est apparue en analysant la liste des signatures lors du baptême de Louise qui comporte plusieurs patronymes « D’Amarzit » famille dont le château du Bazaneix jouxte le domaine de Bonnaigue. La mère de Pierre Lachambaudie est une demoiselle D’Amarzit ou D’Amarzid propriétaires en St Fréjoux.
Pierre Casimir Hippolyte Lachambaudie, poète socialiste d’origine corrézienne 1806-1872
Ce poète goguettier qui connut la célébrité a eu son ouvrage « Fables » préfacé par le breton Emile Souvestre (1806-1854) lui aussi littérateur reconnu à l’époque qui fréquentait les salons où il côtoyait hommes de lettres, artistes peintres et hommes politiques de tendance républicaine. Le poète Béranger n’est pas loin non plus. Pour une édition postérieure les Fables de Lachambaudie seront préfacées par le socialiste Pierre Leroux ami du nantais d’adoption Ange Guépin. Saint-simonien dans sa jeunesse comme Souvestre, Lachambaudie bifurque ensuite vers le fouriérisme. Egalement franc-maçon de la loge de «La Rose du parfait silence », il prend part aux manifestations maçonniques en faveur de la Commune et signe l’appel du 5 mai 1871.
Après la guerre contre les prussiens et la Commune, Lachambaudie est tout comme de nombreux proches des Bracquemond membre des « Zutistes » , groupe de d’artistes qui se retrouvent au Quartier latin dans l’entresol de l’Hôtel des Etrangers[1].
Au lendemain de la défaite française face à la Prusse et peu après l’écrasement de la Commune de Paris, un groupe de bohèmes se retrouve au Quartier latin, dans l’entresol de l’Hôtel des Étrangers : Charles Cros, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, parmi une vingtaine d’autres. Ils y composent un Album zutique ouvert aux moqueries, à l’expérimentation poétique ainsi qu’à la caricature potache. Ce défouloir n’était pas destiné à la publication, il n’en assemble pas moins des merveilles d’audace et d’ingéniosité. Longtemps perdu de vue, puis édité comme une « curiosité », il est ici publié dans son intégralité, accompagné d’un autre album collectif, Dixains réalistes. Quelques Zutistes et leurs amis, sollicités par Charles Cros, ont collaboré à ce dernier, qui fut imprimé en petit nombre : P. Bourget – E. Cabaner – E. Carjat – Auguste de Châtillon – François Coppée – P. Corneille – Antoine Cros – Charles Cros – Alphonse Daudet – Léon Dierx – Dupanloup – Hector L’Estraz – Charles Frémine – A. Gill – José Maria de Heredia – Jean Keck – Lachambeaudie – Leconte de Lisle – Eugène Manuel – Albert Mérat – H. Mercier – Albert Millaud – Alfred de Musset – Germain Nouveau – Camille Pelletan – R. Ponchon – G. Pradelle – Louis Ratisbonne – Louis-Xavier de Ricard – Jean Richepin – Arthur Rimbaud – Maurice Rollinat – Armand Silvestre – Charles de Sivry – Léon Valade – Paul Verlaine – Nina de Villard.La seule femme du groupe, Nina de Villard est l’épouse d’Hector de Callias dont la mère, Benigne Melzer, fille d’un peintre d’histoire est elle-même peintre sur faïence et professeur de dessin de la ville de Paris dans les écoles pour jeunes filles. Nina est la jeune femme qui servit de modèle à Edouard Manet pour son tableau « La femme au divan ». L’analyse des réseaux de fréquentations de Lachambaudie fait donc ressortir plusieurs fouriéristes et nous posons l’hypothèse que ce serait là le lien qui unit la Bretagne et la Corrèze. Toujours dans l’exploration du réseau corrézien mes recherches ont mis en valeur la famille D’amarzit avec la femme peintre Hélène de Sahuguet d’Amarzit D’Espagnac(1841-1911) issue d’une branche qui s’installa à Reims et Paris sans que nous sachions si elle avait gardé un lien avec Saint-Fréjoux où l’autre branche D’Amarzit possédait le château du Bazaneix. La ville de Reims où vivait sa grand-mère paternelle serait-elle le lien expliquant la venue de Langlois en Corrèze ? Avant d’épouser en 1876 le peintre nantais Evariste Vital-Luminais veuf depuis 1874, Hélène d’Amarzit était mariée avec Charles Auguste Durand dit de Neuville également peintre mais sur lequel nous n’avons pas trouvé beaucoup de renseignements biographiques sur internet. De ce mariage elle a un fils et une fille et elle affirme dès cette époque sa profession d’artiste peintre dans les actes d’at civil. Le peintre Désirée François Laugée, ami de Marie Bracquemond est également un proche de cette femme car il est témoin en 1865 pour son mariage avec Durand de Neuville et pour la naissance de leur second enfant, Marthe Clémence le 23 juillet 1869. Se seraient-elles croisées comme élèves de F. D. Laugée dans son atelier ouvert aux jeunes femmes? L’épouse depuis 1850 de D. Laugée , Marie Célestine Malézieux est issue d’une famille de peintres et peut-être avait-elle aussi cette pratique artistique ? Ce réseau est à creuser pour la participation possible d’Hélène d’Espagnac au premier salon dit des « impressionnistes ». Laugée était également proche de l’école de Barbizon dont faisaient partie des amis de Marie Quivoron-Pasquiou comme Besnus par exemple. Egalement je m’interroge sur la participation d’une femme peintre mentionnée comme ayant participé à la première exposition dite des Impressionnistes en 1874 hors catalogue (L’Artiste 1er mai 1874) avec un tableau intitulé « Lieutenant de Lanciers » et dénommée « la comtesse de Luchaire ». Son identité n’a pas été révélée et mes recherches m’ont orientée vers la piste d’Hélène Sahuguet d’Amarzit d’Espagnac. Elle aurait selon l’un des deux critiques l’ayant mentionnée, exposé antérieurement à Londres. Son tableau pourrait être un hommage à son époux décédé en 1870 à la bataille de Sedan. Quelques années plus tard, une revue locale normande, La Plage, feuille trouvillaise du huit septembre 1878, informe ses lecteurs de la présence à l’hôtel Rivoli de madame « la comtesse de Luchaire et mademoiselle, de Paris ». Ce pourrait être Hélène d’Espagnac et sa fille! Elle aurait gardé l’habitude d’user de son pseudonyme.
Evariste-Vital Luminais est très peu connu des habitants de l’Indre. Ce peintre de renommée internationale, qui exposa entre 1843 et 1896 soixante-neuf tableaux au Salon des artistes français, a pourtant vécu et travaillé en Brenne. Né à Nantes, en 1821, au sein d’une famille de parlementaires et d’hommes de loi, il se signalait très tôt par ses talents artistiques. A 18 ans, il intégrait les cours d’un maître parisien, premier Grand Prix de Rome, Auguste Debay, avant de fréquenter les ateliers de Léon Cogniet et Constant Troyon où il se consacrait aux portraits, aux paysages et aux animaux. Après le décès de sa première épouse, en 1874, il se remariait deux ans plus tard avec une de ses élèves, Hélène Victoire, Charlotte, de Sahuguet d’Amarzit d’Espagnac, veuve de guerre de trente ans sa cadette née le 9 mars 1841 à Paris. Décédée le 28 février 1911, 63 Boulevard de Montmorency – Paris, à l’âge de 69 ansLe premier mari d’Hélène Sahuguet était l’artiste peintre Charles Auguste Durand dit Durand de Neuville, né le 12 juillet 1829 à Paris. Décédé le 15 septembre 1870 (jeudi) – Bataille de Sedan – Balan, 08200, Ardennes, Champagne-Ardenne, à l’âge de 41 ans. Il s’avère qu’Hélène Sahuguet d’Amarzit d’Espagnac a des liens très étroits avec la Bretagne. Sa mère est la sœur du contre-amiral Edmond Pâris qui fit ses études à Pontivy avec Emile Souvestre et Guépin entre autres. Leur père Aimable Sahuguet d’Amarzit d’Espagnac épouse en seconde noces Anne Hélène Pâris, fille de Pierre Théodore Pâris et de Françoise Virginie Bersolle fille de négociants brestois anticléricaux. Virginie Bersolle fut selon le roman familial élève du peintre David d’Angers et se révèle une excellente portraitiste. Née en 1778 elle meurt très âgée en 1870 et a pu donner à sa petite fille Hélène ses premiers cours de dessin. Le couple Sahuguet/Pâris a deux filles nées avant leur mariage le 22 septembre 1841.
- Marie Honorine Hélène née le 11 mars 1837;
- Hélène Victorine Charlotte née le 9 mars 1841.
- Un garçon Charles Honoré nait ensuite en 1842. Il vit et meurt en Italie où il est enterré à Sassuolo dans la province de Modène.
Marie, la fille d’Edmond Pâris, la cousine germaine d’Hélène Sahuguet épouse le 9 juillet 1877 le professeur de Droit Emile Jobbé-Duval parent du peintre fouriériste Félix Jobbé-Duval. Léon le frère de Marie qui avait lui aussi quelques talents de dessinateur, sombre dans la maladie psychiatrique après le décès de leur frère aîné Armand en 1873 et est placé par sa famille dans la clinique du docteur Blanche à Passy. (in Itinéraire d’un marin par Géraldine Barron-Fortier 2015 HAL).Toutes ces données montrent à la fois l’importance du réseau breton à Paris et celui des fouriéristes. Lors de cette première exposition dite des Impressionnistes nous relevons plusieurs sympathisants fouriéristes comme les OTTIN père et fils….. Voir site Charles Fourier notices biographiques. En 1855, Langlois fait mentionner sur l’acte d’état civil de sa fille Louise qu’étant marié lors de la naissance de cette dernière et l’étant encore il ne peut la reconnaître. De fait ses deux enfants, Emile et Louise, ne seront jamais reconnus et porteront donc le patronyme de Quivoron bien que n’ayant rien à voir avec l’époux de leur mère Aline Pasquiou à moins qu’Emile n’ait reçu que des prénoms dans la ville où il est né ce qui était habituel en cas de naissance illégitime. Ensuite, selon le Bulletin de la société scientifique et d’archéologie du Limousin 1911 p.626 (Gallica), L’abbaye de Bonnaigue est vendue le 23 juin 1860 devant le tribunal d’Ussel. Outre les établissements manufacturiers, le domaine comportait 150 ha de forêts de chênes, 100 ha de prés, pâtures, terres et étangs d’un revenu de 6 à 7000 francs sans y comprendre les usines. Aujourd’hui le couvent sert de grange et d’habitation pour les fermiers et métayers, la vaste église sert d’étable aux bestiaux. Les archives départementales ne donnent pas de transaction pour cette date. Ce serait après 1855 qu’Aline Pasquiou Quivoron s’installe à Étampes avec ses trois enfants dans la suite d’une étape parisienne de deux ou trois ans. Pour quel projet ou quel motif Emile Langlois s’est-il séparé de sa propriété ? Sur le document de 1855, il est aussi précisé une adresse « militaire » en Algérie: « camp de Mahelma près d’Alger ». Si Langlois était un républicain engagé activement, il fut peut-être au nombre des proscrits après le coup d’Etat de décembre 1851 et transporté en Algérie? Certains transportés furent autorisés vers 1855 à revenir en France régler leurs affaires et cela pourrait correspondre aux rares données que nous avons mais son nom n’apparaît pas dans les listes de transportés corréziens. Quelques temps après, en février 1856, le domaine de Bonnaigue est donné à bail par Langlois pour la somme de 13.500F et pour une durée de neuf années consécutives à un dénommé Jean-Baptiste Chiroux, marchand à Ussel. Selon les renseignements fournis par l’actuelle propriétaire de Bonnaigue et grâce à l’aide de M. Larrieu qui s’est rendu aux Archives de Corrèze nous en savons un peu plus sur le devenir de l’exploitation de Bonnaigue. Le domaine fut vendu le 17 mai 1862 sur « folles enchères » à M. Pierre Moncourrier-Beauregard, notaire à Ussel et la transaction enregistrée au bureau des hypothèques d’Ussel le 22 juillet 1862(vol 157, n°37) et des quittances versées chez maître Dayras notaire jusqu’en 1872. En effet Langlois n’a pu régler les remboursements dus à Hersilie Bourlin et des hypothèques grevaient le domaine ; or il a fait un échange en 1857[1], alors qu’il résidait à Mahelma en Algérie, avec un dénommé Sagot(sic Sagaud) qui lui cédait en contrepartie le domaine de Saïdia sur la commune de Deroua mais sans l’informer des hypothèques pesant sur Bonnaigue. Le Journal des Lois d’Alger[2] rend compte du conflit qui oppose les deux partis et l’abus de faiblesse commis par Langlois sur Sagot alors âgé et malade. Madame Serravalle n’ayant reçu aucun règlement ni de l’un ni de l’autre des protagonistes a donc remis en vente le domaine. Nos recherches sur le site ANOM et les lieux cités n’ont rien donné sur la suite de l’histoire et la vie de Langlois. Quel devenir pour Emile LANGLOIS ? Dans quel projet s’est-il lancé ? Dernière trace, il serait vivant en 1866, le 9 août, lors du décès à Rennes de son épouse Elisabeth Prigent à quatre-vingts ans passés, décès déclaré par le père d’Emile, Joseph Théophile, 72 ans qui demeure rue St Georges. Elle est dite « épouse d’Emile Langlois ». Selon son acte de naissance, Emile a en réalité 43 ans, 11 mois et 22 jours. Ils auront été mariés vingt-six ans! Moins d’un an après, le 24 juin 1867, le père d’Emile décède à son tour à Rennes. Âgé de 73 ans, Il est veuf de Marie Michel et ne s’est donc pas remarié. Il demeure 3 rue du Vau St Germain. Emile n’est pas présent et rien ne nous indique si le père et le fils avaient gardé des contacts. Emile est héritier de son épouse pour une modique somme puis de son père l’année suivante pour environ 38.000F plus environ 1100F de rapport sur des immeubles. Emile n’apparait pas aux Tables décennales des décès de 1873 à 1882 à Rennes et n’est donc pas revenu vivre en Bretagne. [1] Archives départementales de Corrèze, 3P/204/2 [2] P.197 Arrêt de la cour d’Alger du 25 juin 1860 [1] Note de présentation de l’éditeur de l’album
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La famille de Marie
Louise Quivoron, sa demi-sœur
 Sans doute premier portrait de Louise qui porte encore les cheveux libres et est encore châtain clair ne les ayant pas décolorés avec une décoction de camomille. Elle pourrait avoir environ entre douze et quatorze ans ce qui donnerait pour date d’exécution du tableau 1871/1873 ?
Sans doute premier portrait de Louise qui porte encore les cheveux libres et est encore châtain clair ne les ayant pas décolorés avec une décoction de camomille. Elle pourrait avoir environ entre douze et quatorze ans ce qui donnerait pour date d’exécution du tableau 1871/1873 ?
Louise vient au monde en Corrèze en octobre 1849 où ses parents sont installés depuis quelques mois dans la propriété de Bonnaigue en Saint-Fréjoux à quelques kilomètres d’Ussel. La famille y passe quelques années mais ensuite, peut-être suite au coup d’état de décembre 1851, ce séjour prend fin sans que nous en connaissions la date exacte ni la raison. Il se peut aussi que tout simplement le couple ait éclaté et que chacun ait poursuivi sa voie. Marie et sa famille arrivent alors à Paris avant de vivre quelques années à Étampes. Nous retrouvons trace d’Emile Langlois en Algérie où il a fait l’acquisition d’un domaine mais le site ANOM ne donne aucune indication de décès ni de remariage dans ce pays et son devenir reste donc dans le flou absolu pour l’instant
Louise est âgée d’une douzaine d’années lorsque Marie expose pour la première fois une peinture au salon des Beaux-arts. Par la suite, adolescente puis jeune femme, elle sert à plusieurs reprises de modèle à sa sœur. Elle a assurément un problème de vision et une ptose de la paupière droite qui semble apparaître postérieurement au tableau où Marie la représente adolescente d’environ seize ans aux longs cheveux dénoués dans le tableau « Au jardin », vêtue d’une robe blanche un bouquet de violettes à la ceinture .
 Le Goûter ou peut-être La Tasse de thé ou La tasse de café …?
Dans le fond à gauche les anciens bâtiments de la faïencerie de Sèvres.
Pour le tableau « Le Trio » elle a des bésicles. Elle porte maintenant chapeau et chignon.
Le Goûter ou peut-être La Tasse de thé ou La tasse de café …?
Dans le fond à gauche les anciens bâtiments de la faïencerie de Sèvres.
Pour le tableau « Le Trio » elle a des bésicles. Elle porte maintenant chapeau et chignon.
 Louise aurait posé pour les deux personnages féminins.
Louise aurait posé pour les deux personnages féminins.
Nous ne savons quasiment rien de la vie de Louise, de son instruction, de ses goûts ou pratiques artistiques, de ses amitiés ou de ses amours.
Elle reste célibataire et hérite en 1894 au décès d’un ami de la génération de son père, du château de la Chabanne en Saint-Fréjoux, domaine qui jouxte celui de Bonnaigue où elle vit le jour.
Le 23 juillet 1882, Jean Antoine Edouard Monloys, ancien avoué, propriétaire du château de la Chabanne en St Fréjoux, demeuré célibataire, établit un testament en faveur de Louise qui reçoit donc en janvier 1894 la Chabanne au décès de cet homme de la génération de son propre père Emile Langlois. Ancien suppléant au juge de Paix du canton d’Ussel, il avait été révoqué en 1877 (mais pour quel motif? politique?). Nous ne savons rien des liens qui ont abouti à ce legs. [1] https://www.lasocietenouvelle.net/ [2] https://www.lasocietenouvelle.net/Plusieurs aquarelles de Marie représentent les jardins de la Chabanne et devraient donc être datés comme postérieures à 1894 à moins que Louise n’ait vécu près de cet homme antérieurement et ait invité sa sœur et son beau-frère bien que selon les biographes de Marie elle n’ait pas apprécié Félix.
Est-ce sa demi-sœur Louise la Femme en deuil croquée à l’aquarelle par Marie? Peut-être à l’époque du décès de son protecteur Edouard Monloys qui lui lègue son château de la Chabanne domaine dont elle prend possession à l’âge de quarante-cinq ans. La mode des manches «gigot » marque cette décennie et correspondrait à cette datation.
Le couple Bracquemond a-t-il été invité après 1894 par Louise en Corrèze dans le pays de jeunesse de Marie qui aurait peint une toile de l’intérieur du château de la Chabanne après avoir comme à son habitude réalisé une (au moins) aquarelle préparatrice? Est-ce l’aquarelle sur laquelle nous pouvons voir au premier plan un fauteuil et en fond le grand tableau œuvre majeure de Marie «La Dame en blanc»? Ce n’est pas sûr car certains mentionnent que l’on peut découvrir « sur la cheminée des faïences réalisées par Marie ou Félix » non visibles ici.
Marie peint également à l’aquarelle des vues du jardin. Félix réalise de son côté des gravures de sous-bois de la région.
Peut-être à l’époque du décès de son protecteur Edouard Monloys qui lui lègue son château de la Chabanne domaine dont elle prend possession à l’âge de quarante-cinq ans. La mode des manches «gigot » marque cette décennie et correspondrait à cette datation.
Le couple Bracquemond a-t-il été invité après 1894 par Louise en Corrèze dans le pays de jeunesse de Marie qui aurait peint une toile de l’intérieur du château de la Chabanne après avoir comme à son habitude réalisé une (au moins) aquarelle préparatrice? Est-ce l’aquarelle sur laquelle nous pouvons voir au premier plan un fauteuil et en fond le grand tableau œuvre majeure de Marie «La Dame en blanc»? Ce n’est pas sûr car certains mentionnent que l’on peut découvrir « sur la cheminée des faïences réalisées par Marie ou Félix » non visibles ici.
Marie peint également à l’aquarelle des vues du jardin. Félix réalise de son côté des gravures de sous-bois de la région.
 Il se peut aussi que les Bracquemond aient fréquenté La Chabanne du vivant de Monlouÿs car nous ne savons rien de la nature de la relation qu’il avait avec Louise ni de ses liens avec Marie et Félix.
Il se peut aussi que les Bracquemond aient fréquenté La Chabanne du vivant de Monlouÿs car nous ne savons rien de la nature de la relation qu’il avait avec Louise ni de ses liens avec Marie et Félix.
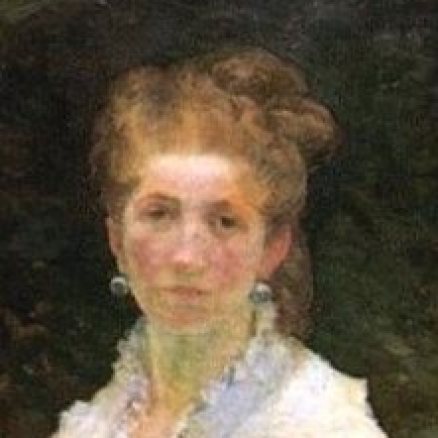 La Dame en blanc, détail
Louise a servi à de nombreuses reprises de modèle à Marie. Restée célibataire, les quelques rares données que nous avons trouvées évoquent un « caractère particulier » et des relations tendues avec son beau-frère Félix. Par contre Louise a entouré son unique neveu Pierre de beaucoup d’affection et il est devenu son héritier et le nouveau propriétaire de La Chabanne qui passe ensuite aux mains de sa fille Marthe et de sa descendance.
L’estampe de Félix Bracquemond représentant Louise posant pour sa sœur sur la terrasse de Sèvres serait datée de décembre 1876 le tirage et donc le dessin antérieur à la réalisation gravée.
La Dame en blanc, détail
Louise a servi à de nombreuses reprises de modèle à Marie. Restée célibataire, les quelques rares données que nous avons trouvées évoquent un « caractère particulier » et des relations tendues avec son beau-frère Félix. Par contre Louise a entouré son unique neveu Pierre de beaucoup d’affection et il est devenu son héritier et le nouveau propriétaire de La Chabanne qui passe ensuite aux mains de sa fille Marthe et de sa descendance.
L’estampe de Félix Bracquemond représentant Louise posant pour sa sœur sur la terrasse de Sèvres serait datée de décembre 1876 le tirage et donc le dessin antérieur à la réalisation gravée. Nous voyons donc que Louise qui a autour de vingt-cinq abs et est alors coiffée d’un lourd chignon avec une raie sur le côté. Nous rapprocherions ce portrait de celui de la Dame en blanc pour une datation de ce tableau entre 1873 et 1876.
Nous voyons donc que Louise qui a autour de vingt-cinq abs et est alors coiffée d’un lourd chignon avec une raie sur le côté. Nous rapprocherions ce portrait de celui de la Dame en blanc pour une datation de ce tableau entre 1873 et 1876.
 L’estampe de Félix Bracquemond présente une jeune femme au regard perdu et a l’air triste. . Que s’est-il passé?
Marie est vêtue de noir sur le balcon et encore de noir mais avec une touche de couleur pour l’eau forte de Félix « Au jardin d’acclimatation ». Serait-ce deux manières de porter le deuil de leur mère ou bien pour le côté esthétique de la gravure?
L’estampe de Félix Bracquemond présente une jeune femme au regard perdu et a l’air triste. . Que s’est-il passé?
Marie est vêtue de noir sur le balcon et encore de noir mais avec une touche de couleur pour l’eau forte de Félix « Au jardin d’acclimatation ». Serait-ce deux manières de porter le deuil de leur mère ou bien pour le côté esthétique de la gravure?
 La Dame en blanc
La Dame en blanc
1886 Louise et Pierre son neveu au jardin
 Ce tableau de Louise et son neveu baigne dans une lumière crue d’un jour d’été et les couleurs sont saturées. Louise gracile a l’air d’une adolescente proche en âge de Pierre.
Ce tableau de Louise et son neveu baigne dans une lumière crue d’un jour d’été et les couleurs sont saturées. Louise gracile a l’air d’une adolescente proche en âge de Pierre.
 Dans ce portrait, le style de Marie est plus vigoureux, les couleurs plus affirmées et pourtant sans plus de lien avec l’impressionnisme et la division des touches. Louise elle-même semble plus dynamique et presque souriante. Ceci est surprenant car lors du mariage de Pierre avec mademoiselle Barbedette en 1897, Marie signe l’acte d’une écriture très dégradée traduction d’un état maladif et dépressif. De plus, outre la question du graphisme, Marie utilise dans l’acte son patronyme originel « M Quivoron » faisant preuve d’une volonté de revendication par rapport à son époux Félix ? et pourtant ici le tableau est signé en bas à droite « Marie B ».
Ce serait là le dernier tableau achevé connu de Marie. Certains y ont voulu voir dans ce dernier portrait l’influence du peintre Latouche. Un article de La société nouvelle mentionne que Félix Bracquemond aurait orienté Latouche vers une peinture légère après ses déboires et échecs pour faire reconnaître une peinture plus sociale qui l’avaient amené à détruire les œuvres de cette période.
Dans ce portrait, le style de Marie est plus vigoureux, les couleurs plus affirmées et pourtant sans plus de lien avec l’impressionnisme et la division des touches. Louise elle-même semble plus dynamique et presque souriante. Ceci est surprenant car lors du mariage de Pierre avec mademoiselle Barbedette en 1897, Marie signe l’acte d’une écriture très dégradée traduction d’un état maladif et dépressif. De plus, outre la question du graphisme, Marie utilise dans l’acte son patronyme originel « M Quivoron » faisant preuve d’une volonté de revendication par rapport à son époux Félix ? et pourtant ici le tableau est signé en bas à droite « Marie B ».
Ce serait là le dernier tableau achevé connu de Marie. Certains y ont voulu voir dans ce dernier portrait l’influence du peintre Latouche. Un article de La société nouvelle mentionne que Félix Bracquemond aurait orienté Latouche vers une peinture légère après ses déboires et échecs pour faire reconnaître une peinture plus sociale qui l’avaient amené à détruire les œuvres de cette période.
Vers 1890, sur les conseils de Bracquemond, il (Gaston Latouche) prend une direction opposée et se tourne vers une peinture à la manière de Watteau. Sa palette s’éclaircit, il adopte une manière floue et vaporeuse qui plaît à un large public. Cette peinture, souvent qualifiée de « facile » voir d’artificielle illustre des parcs animés (Versailles et Saint-Cloud), de scènes galantes, de fêtes et concerts nocturnes (Féerie de nuit, 1906), promenades en gondole à Venise, soupers aux chandelles, de petites scènes intimistes contemporaines (Jalousie ou Le Singe, Musée d’Orsay). Les femmes sont aussi pour lui un sujet de prédilection. Son style clair aux touches papillotantes « impressionnistes », aux reflets dansants dans des décors de plaisir, séduit également l’Etat qui lui commande des panneaux décoratifs pour l’Elysées (La Fête de nuit, 1906[2]), le ministère de la Justice (Le Sculpteur, Le Poète, Le Peintre, Le Musicien, 1910), le ministère de l’Agriculture (Le Désir de Plaire, La Bonté d’Ame, La Tendresse du Cœur, l’Amour Maternel, 1907, depuis retirés[3]), la mairie de Saint-Cloud (les Quatre saisons, 1895) et pour l’Union française de Constantinople (Jardins de Versailles, 1898)[1].Ce tableau de Louise entourée de fleurs n’est pas sans m’évoquer le panneau décoratif peint par Albert Besnard pour la villa La Sapinière à Evian, tant par la palette utilisée par l’artiste que par le style. Une plus grande connaissance de la vie menée par la sœur de Marie dont il est dit, à tort selon nous, qu’elle partagea celle du couple Bracquemond, nous éclairerait sur ses liens amicaux. Albert Besnard tout comme G. Latouche faisait lui aussi partie de « La nouvelle société de peintres et de sculpteurs ».
Wikipedia: La «Société Nouvelle de peintres et de sculpteurs» rassemblait un groupe hétérogène dont les membres œuvraient tous autour de l’impression d' »intimité« . L’association créée en 1900 par le critique d’art et poète Gabriel Mourey, dans le Paris de la Belle Epoque, rassembla pendant près de quinze ans, des artistes, amis de longue date, à la Galerie Georges Petit. Cette société qui bénéficiait du soutien de l’Etat, des institutions et de la critique, est aujourd’hui méconnue et oubliée. La cinquantaine de membres qui la composait sont aussi bien des peintres comme La « Bande Noire » (Simon, Cottet, Ménard, Dauchez, Prinet), Le Sidaner, Martin Henri Martin, Blanche, Claus, Besnard…, que des sculpteurs comme Rodin, Meunier, Bartholomé, Desbois, Bourdelle, Maillol, les Schnegg, Dejean, Poupelet et Despiau[2].Par le catalogue de la vente Artcurial de 2024 nous pouvons maintenant être sûrs que le tableau est bien de la main de Marie qui commande une toile ovale pour la réalisation du portrait de sa sœur. Toujours grâce aux tableaux et aquarelles conservées dans la famille nous constatons grâce à une aquarelle où elle figure chevauchant dans un paysage du Mont Dore aux côtés de son neveu Pierre que Louise avait un train de vie de « chatelaine » et possédait des chevaux que, pour le peu que je m’y connaisse, je qualifierais d’alezans ou purs sangs. Elle monte le sien en amazone. Les journaux de l’époque qui retracent les déplacements des familles titrées ou de la haute bourgeoisie font mention des allées et venues de Louise Quivoron entre Paris et la Corrèze. Il semblerait selon certains documents conservés aux archives de Corrèze que Louise avait pris le nom d’usage de Langlois celui de son père accolé à celui de Quivoron mais quels pouvaient être ses revenus et moyens de subsistance avant de recevoir l’héritage de Montloÿs nous l’ignorons. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pierre, son fils
Né en juin 1870 au cœur des affrontements de la guerre contre les prussiens et de la Commune, il sera l’unique enfant du couple.Son père avait conçu avant sa naissance du mobilier pour la chambre du futur bébé. Marie Bracquemond voulait comme nombre de leurs connaissances quitter la capitale pendant la guerre et la Commune mais cela ne semble pas s’être fait alors que sa propre mère et sa sœur Louise se sont réfugiées en province.
Félix fait deux dessins de son fils l’un dans les bras de Marie l’autre un peu plus tardif représente un gros poupon joufflu coiffé d’un béguin.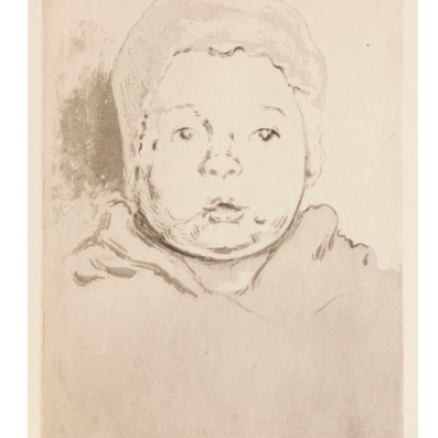
Nous ne connaissons pas de dessin ou de portrait de Pierre par sa mère avant ses six/sept ans (1876 ou 1877 environ) pourtant des amis de la famille ayant séjourné à La Chabanne vers 1950/1960 disent avoir vu aux murs plusieurs toiles représentant Pierre. Marie le peint en chemise blanche sur un fond très clair, l’air sérieux et en 1972 l’historien J-P. Bouillon donne l’âge de 8 ans car le tableau est daté 1878 mais selon nous l’enfant est plus jeune.
« Portrait de Pierre en chemise blanche », Huile sur toile Signé : NS ; daté : 1878 « on it’s old cartouche » in Women impressionists
Le portrait à l’huile peint deux ou trois ans plus tard en 1881 est totalement différent. Comme pour les femmes en robes blanches, Marie a imposé à son fils une pose complexe, sorte de torsion qui produit un effet artificiel. Accoudé à sa table de travail, Pierre se tourne vers nous mais le reste de son corps ne donne pas une impression d’ancrage au sol. Souvenir de Corot une tache de rouge avec les chaussettes de l’enfant vient animer par la couleur un tableau plutôt sombre malgré quelques effets de lumière. En arrière plan la fenêtre ouvre sur de la végétation baignée de soleil et au sol, sous la chaise une tache de lumière réchauffe l’ambiance. Ce procédé de tache de lumière au sol est également présent dans le tableau des « Joueuses de jacquet » et celui dit des « Trois Grâces ».
Sans doute de la même époque ou juste un peu plus tard, une eau-forte nous montre le jeune garçon en costume de collégien allongé sur une chaise longue et s’occupant à lire pendant sa convalescence.
La formation de Pierre
Au sein de sa famille Pierre a bénéficié de sa première initiation au dessin et à la peinture mais nous ne savons pas où il a poursuivi sa scolarité générale avant de se consacrer entièrement à l’art. Son amitié avec Pierre Loüys qui avait fréquenté l’Ecole alsacienne laisse à penser que ce fut le cas également pour Pierre ce qui, de plus, s’accorde avec les valeurs républicaines de ses parents.

Les amis de ses parents l’influencent et tout particulièrement Henry Cros, familier aussi de la famille Burty et avec lequel il s’initie à la peinture à la cire selon les méthodes anciennes.
Peinture à l’encaustique / panneau,61 x 54 cm, 1902, signé et daté en haut à gauche et conservée au musée des Beaux-arts de la Rochelle.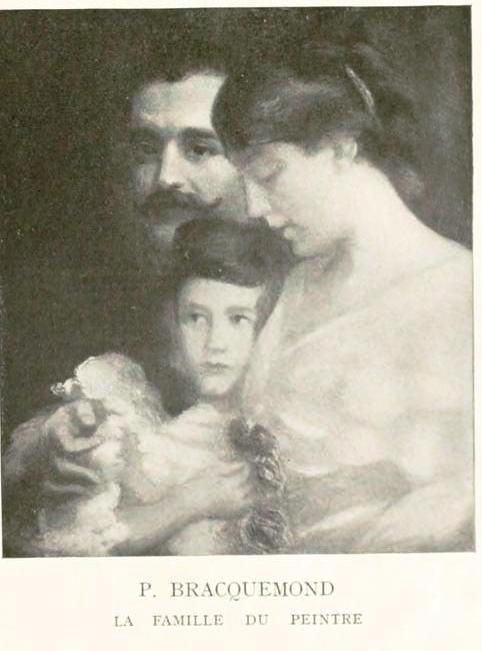
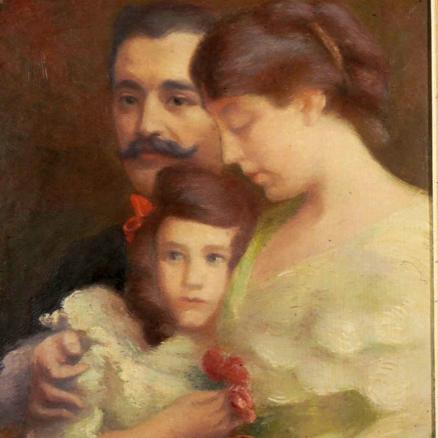
 Marie aurait alors trouvé un second souffle de créativité comme pour le dernier tableau de Louise qui lui est attribué. En effet en ce début du XXème siècle Marie est bien âgée et ses dernières productions semblent être restées à l’état d’ébauches du fait de problèmes psychologiques, d’angoisses l’empêchant d’effectuer des choix.
Marie aurait alors trouvé un second souffle de créativité comme pour le dernier tableau de Louise qui lui est attribué. En effet en ce début du XXème siècle Marie est bien âgée et ses dernières productions semblent être restées à l’état d’ébauches du fait de problèmes psychologiques, d’angoisses l’empêchant d’effectuer des choix.
Le 27 février 1909 le Bulletin de l’art ancien et moderne n° 413, annonce le succès remporté par la vingtaine d’œuvres exposées par Pierre Bracquemond à la galerie Mac Lean de Londres.
Pierre s’est fait le biographe de ses parents et il semblerait qu’il ait eu à souffrir du caractère de son père à la fois sévère, exigeant, ne supportant pas la contradiction. Elevé dans la bourgeoisie du 19ème siècle qui réserve à la femme une place de gardienne du foyer se devant d’être modeste et sans ambitions, Pierre se fait apparemment le défenseur de sa mère mais du coup la pose en victime face à son époux Félix qui l’aurait critiquée dans ses choix stylistiques, empêchée d’utiliser son atelier, puis la tenant recluse à Sèvres. Pierre a des propos très forts, estimant que la conduite de son père avait quelque chose de « stupide et cruel ». C’est cette image négative de Félix Bracquemond qui est véhiculée un peu à l’infini sans que nous ayons quantité d’autres éclairages sur leurs relations. Seul Geffroy reconnait à Marie le talent de calmer les emportements de son époux de quelques paroles apaisantes.
Félix s’est-il conduit en tyran domestique envers son épouse et son fils? Ce dernier en tout cas en donne un portrait plutôt négatif laissant à entendre que les liens avec son père ont souvent été tendus. Mais à la décharge de Bracquemond, remarquons qu’il a laissé Marie peindre et exposer sans lui imposer de ne pratiquer la peinture qu’en activité de loisirs et qu’il l’aurait plutôt soutenue et admirée.
Grand ami de Pierre Louÿs et son épouse, le jeune couple Bracquemond les rejoint à Arcachon en août et septembre 1911 pour un temps de vacances entre amis et quelques temps plus tard un article de Louÿs parait dans la presse:
Le Figaro du 20 mai 1912 LA VIE DE PARIS PIERRE BRACQUEMOND : Mr Pierre» Louys. l’éminent écrivain, nous adresse l’article- suivant sur M. Pierre Bracquemond, à l’occasion de l’exposition de ses œuvres (pas du tout mention de sa mère comme artiste ayant participé à sa formation! alors qu’elle est encore en vie!)Oui, le génie est une longue patience et tout nous désabuse de croire à je ne sais quelle maîtrise innée qui expliquerait les grands talents ainsi que les dons au berceau illuminent les contes de fées.Pierre illustre de 42 dessins originaux l’ouvrage Albertus pour Théophile Gautier. Sa fille Marthe partage avec Judith Gautier l’amour de la musique. Sur commande de l’Etat, Pierre effectuera pendant la guerre des tableaux vantant l’industrie française. sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssLe domaine de l’art n’est pas une terre fortunée qu’il suffise de conquérir pour trouver à portée de la main les pommes solaires des Hespérides. Il y faut pousser le soc et talonner la bêche. Il faut surtout avoir dans l’âme cette foi d’un caractère vraiment religieux, cette foi qui ne demande en retour aucune récompense présente et qui entreprend avec joie trente années de labeur silencieux, sachant qu’il faudra consommer la moitié d’une vie humaine avant que fleurisse l’arbre du beau, qui donne des fruits éternels. Pierre Bracquemond dont l’œuvre exposée est depuis, quelques jours une révélation et un enchantement avait reçu en naissant un nom déjà illustre et ces dons si mystérieux auxquels le public attribue le miracle du talent. Mais le glorieux artiste qui est son père ne lui dispensa pas seulement le sang de sa race et l’enseignement de son école. Il lui donna une doctrine sévère, une discipline esthétique, et lui apprit à son exemple comment le plaisir de plaire est indigne de s’unir à la joie de créer. Pendant, un quart de siècle, Pierre Bracquemond travailla presque dans l’ombre et comme s’il n’était qu’un élève c’est là l’histoire de tous les maîtres.
Il apprit plusieurs métiers de peintre, soit qu’il cherchât d’abord sa voie, soit qu’il voulût ensuite éprouver tour à tour toutes les émotions de ce que Théophile Gautier appelait fortement la lutte avec la forme rebelle. C’est ainsi que longtemps il se passionna pour la peinture à la cire, par les procédés antiques dont Henry Cros venait de retrouver le secret, mais que lui, Bracquemond, ressuscita. Cette période de sa vie nous valut d’importantes compositions parmi lesquelles l’admirable nu qui figurait cet hiver à la Centennale de l’Art Français organisée par le comité de Saint-Pétersbourg.
Cependant le peintre exposait peu, travaillait sans relâche et ne voulait considérer se tableaux que comme les étapes oubliées d’une longue et patiente campagne vers un but fixé par le choix de sa volonté réfléchie.
A quarante ans, il s’arrête et, pour la première fois, il consent à montrer, non pas toute son oeuvre (il s’en faut de beaucoup), mais soixante morceaux dont le plus ancien n’a pas trois ans de date et qui, malgré la diversité de leurs procédés, composent enfin le plus brillant, le plus harmonieux ensemble.
Ce sont d’abord des intérieurs dont les physionomies complexes et profondes sont composées comme des portraits. Une claire église vénitienne dont l’âme est un rayon de soleil une pièce qui s’enfonce et qui s’obscurcit autour d’un tapis éclairé la bibliothèque d’un château anglais; les hautes glaces d’un palais italien, toutes baignées de reflets et de transparences; les vitrines d’une collection extrême-orientale où chaque touche de couleur est un joyau sombre qui absorbe ou qui mire en un point stellaire l’épanchement calme du jour.
Voici des nus qui, par la grâce de l’allure et la liberté du geste, éveillent comme des Fragonard, un sourire de surprise charmée. Dans l’étroit décor d’une chambre, ou dans le frémissement des feuillages, une jeune fille parait, s’élance, tourne sur elle-même, se pose, reprend sa course, et pour elle ce nu, dont on a pu dire que c’était sans doute le costume le plus difficile à porter, devient une robe intime qui ne décèle rien, sinon « la grande innocence » d’une Mélisande consolée.Pierre Bracquemond a pris au pastel toute sa délicatesse pour traiter ces petits sujets dont le nu harmonieux et doux se rehausse volontiers d’un ton violent plaqué dans le paysage ou la tapisserie. Son pastel est bien à lui. Dans sa main, le bâton de couleur ne s’affadit pas en nuances poussiéreuses. La figure peu frottée, peu retouchée du doigt, est striée de hachures nettes qui gardent la pureté du ton, assurent la justesse du modelé, s’opposent et brillent et s’irritent côte à côte par ces dissonances toutes proches, d’où, en peinture comme en musique, la vibration prend naissance.
̃ Le ton pur, le bleu natif, le jaune issu de la lumière, avec quelle ardeur. Pierre Bracquemond les cherche-t-il dans la nature pour se donner la joie de les peindre tels qu’ils sont! Il a passé tout un été à Morgat, près des grottes qu’une mer sauvage, durant dix mois de l’année, rend inaccessibles. Dans ces gouffres toujours ruisselants d’eau marine, sans poussière, sans brume, sans oiseaux, dans un air immuablement pur, il a vu le soir et l’aurore allumer les flammes des algues, et les pierreries des stalactites.
C’est avec le couteau qu’il a peint sur la toile, après les églises vénitiennes, ces basiliques de l’Océan, ces Saint-Marc de la roche antique où la tempête et la lumière se répercutent l’une après l’autre et du flot jusqu’à la voûte.
Il y a là des morceaux de maître parmi ceux que Bracquemond rapporta de Morgat: tel cet antre à deux arches que reproduit le catalogue et qui s’élève sous nos yeux comme l’Arc de Triomphe du couchant telle encore cette falaise à peine entrevue sous le soleil qui monte, derrière la palpitation d’une atmosphère éblouissante.
Enfin, revenu de Bretagne, toujours plus épris de son procédé net et franc, l’artiste vient d’achever les cinq natures mortes qui couronnent son exposition et qui, en sont peut-être les chefs-d’œuvre. Par l’aisance magistrale de l’interprétation, par la somptuosité de la matière et l’heureux groupement des valeurs, ces toiles s’imposent à nous comme des pièces de musée. Pierre Bracquemond est désormais en pleine possession de lui-même. Il manie son instrument avec cette sûreté tranquille qui prend droit à l’admiration quand nous la savons légitime et laborieusement acquise. A ce point de dextérité, la trace de l’acier dans la pâte assimile presque la peinture au modelage; et devant ces Glycines, devant ce Lophophore, nous croyons suivre un ébauchoir sur l’argile d’un bas-relief, quand la pointe courbe du couteau tournant sur la matière docile arrondit un pétale, une plume. ̃ Pierre Louys
- Site intéressant en particulier pour l’iconographie de Hans Weevers sur l’impressionnisme et Marie Bracquemond : http://: https://www.impressionism.nl/bracquemond-marie/ .
![Pasquiou Quivoron Les_Salons_dessins_autographes_1868__[...]Pothey_Alexandre le rêve de Cervantès _bpt6k55274506 - Copie](https://ellesaussi.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/01/pasquiou-quivoron-les_salons_dessins_autographes_1868__...pothey_alexandre-le-rc3aave-de-cervantc3a8s-_bpt6k55274506-copie.jpeg)