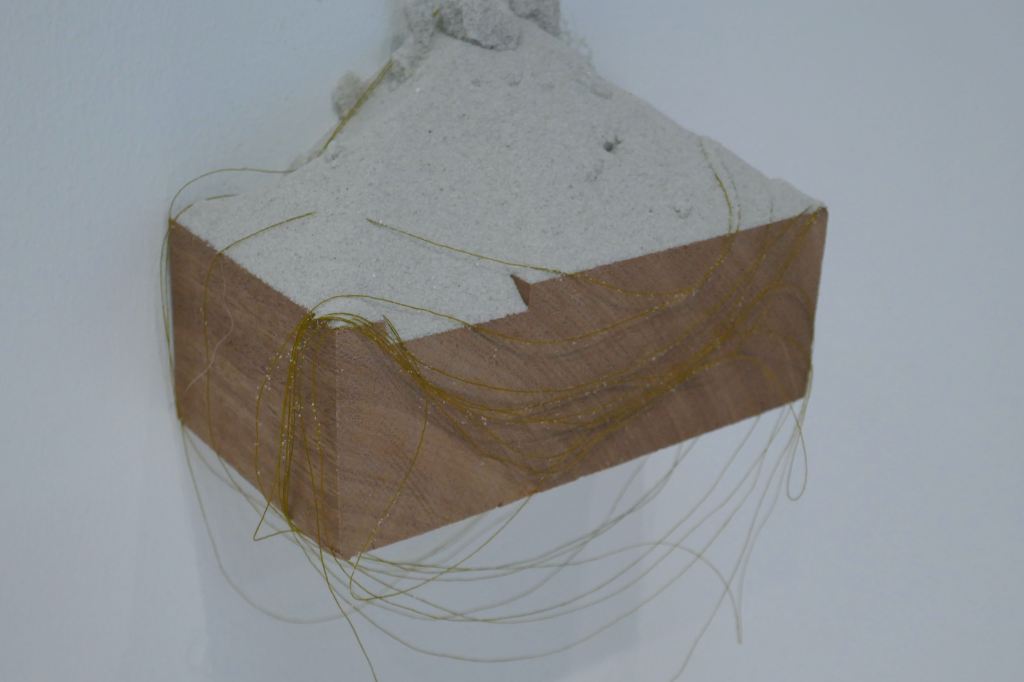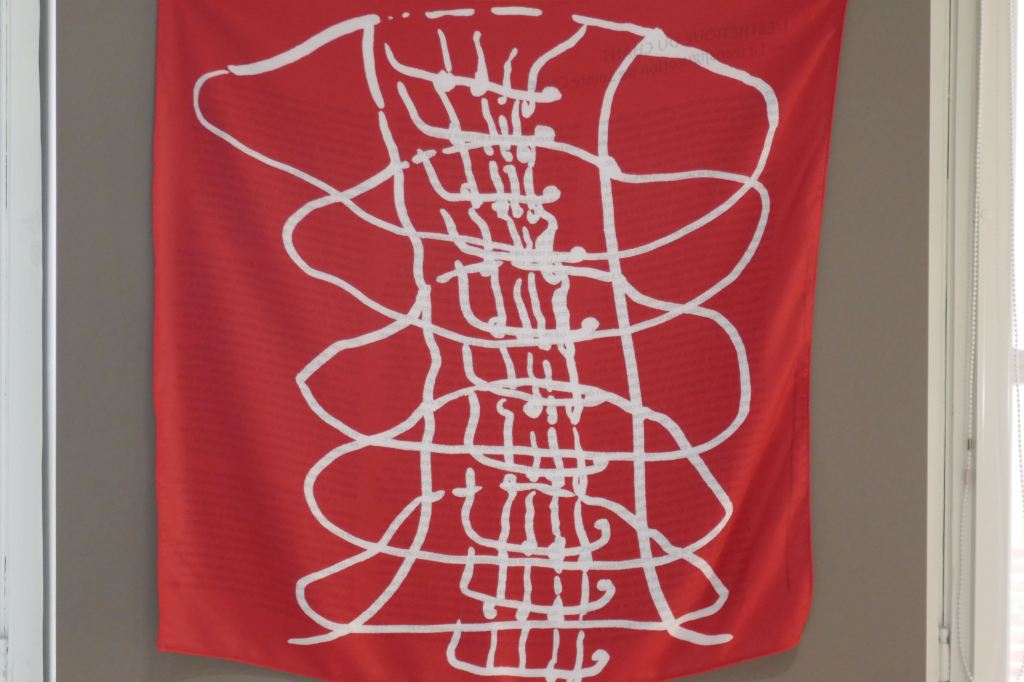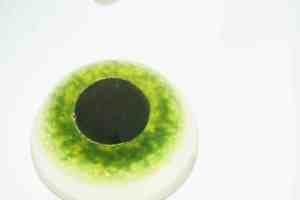Préalable narratif :
Si le monde est de plus en plus couturé de conflits, marmite prête à exploser, le découragement et les forces déclinantes l’éloignent de ses combats directs… Mais dans sa retraite, des rages le reprennent, voire en pleine nuit, et c’est le retour des insomnies, comme au bon vieux temps… Il ne peut s’empêcher par exemple, régulièrement, d’en revenir à une entreprise qui durant de longues années lui a pourri la vie de promeneur, colonisant de plus en plus une série de paysages familiers… Pairi Daiza, un zoo, avec un marketing d’enfer axé sur la défense de la nature, carrément, un marchandising dingue, notamment de tout ce qui touche de près ou de loin le panda, à croire qu’ils l’avaient inventé, le panda… Ce genre de fleuron capitaliste qui, une fois dans votre décor, ne vous lâche plus, vous bouffe le crâne… Dès qu’il se souvenait de la manière dont, au fil des années, ils avaient envahi et bousillé toute une région, la colère revenait, des mots, des phrases, des images, des arguments, un réquisitoire, des projets de lettres, d’articles, destinés à la poubelle dès le lever du soleil, car à quoi bon… mais quand même…

« Il y a longtemps, je me promenais régulièrement au parc de Cambron-Casteau, désuet, hors du temps, réconfortant. Une enceinte, un reste d’abbaye, des pelouses, un étang, une tour presque en ruines, quelques arbres magnifiques, le tout niché dans une région de pâtures et de champs traversés par la Dendre, de bosquets, petits vallons préfigurant la région des Collines, aux frontières picardes, pas loin des Hauts de France.. Puis est venu Paradisio. C’était dommage, une irruption inquiétante, mais au moins le projet s’était avéré bien dimensionné, relativement respectueux du site. Il semblait tenir compte des existants locaux, humains, non-humains. Mais aujourd’hui ? Je suis toujours promeneur régulier dans cette région et Pairi Daiza est une agression permanente, physique et psychique, comme de se sentir expulsé d’un paysage ou dépossédé des rêveries que l’on y a cultivées.
Que produit réellement Pairi Daiza ? Manifestement, à première vue, en son centre une artificialisation impérialiste du vivant (un camp) et, tout autour, des hectares dévitalisés, morts, une prolifération de surfaces zombies. Et là, c‘est l’emballement, ce qui s’érige est effarant. L’extension jadis mesurée, prudente, avance sans vergogne, à visage découvert. Décomplexée. Une architecture monumentale achève de dénaturer le site historique, phagocyté. C’est tellement démesuré, laid, énorme, vain, dérisoire que l’on se demande comment est-il possible d’obtenir un permis de construire pour pareille monstruosité. Ca n’encourage pas à faire confiance à nos institutions. Surtout que cela se passe en pleine conscience de ce que signifie l’anthropocène. Alors que se multiplient les appels pour réinventer de toute urgence les relations entre humains et non-humains, on laisse s’édifier là une usine de marchandisation outrancière de la nature où une faune de plus en plus exotique est exploitée pour gonfler les plus-values de quelques actionnaires. Il barre l’horizon, on ne voit plus que lui, insolent, un temple à la gloire de l’écocide, violent et aveugle à son anachronisme.
En effet, cette construction pharaonique a toutes les caractéristiques de ce que les auteurs du manifeste « Héritage et fermeture » appelle des technologies obsolètes à peine nées, mortifères. Dans le sens où elles sont tellement en désaccord avec les enjeux climatiques et environnementaux auxquels nous devons faire face, qu’il faut quasiment déjà programmer leur déconstruction. Devant un tel faste absurde, insensé, à contre-courant de ce qu’il conviendrait de construire dans le cadre d‘un devenir sobre de l’humanité, on ne peut que penser devant ce qu’assemblent ces grues et machines : mais comment feront-ils pour démonter tout ça, bientôt ? Et d’être gagné par le sentiment d’un énorme gaspillage révoltant, cynique, bafouillant toute idée de commun et d’esprit civique.


une diplomatie digne de l’ancien monde
Le plus étonnant est que, selon les articles qui en rendent compte, les débats concernant l’irrésistible extension de cet empire, singulièrement la création d’une nouvelle route, s’inscrivent toujours dans une logique antérieure à l’anthropocène. Une logique de vieux monde. Comme si les rapport du GIEC n’avaient toujours pas été publiés. Rien n’a changé, le capitalisme est la référence et doit naturellement triompher, parce qu’il est le principe de base de notre système économique actuel. C’est marche ou crève. Tout au plus convient-il que des concessions soient faites aux collectifs défenseurs de l’écologie, pour calmer les esprits et désarmer l’opposition. Le philosophe Grégoire Chamayou a très bien décrit, dans son livre « La société ingouvernable » les principes de cette stratégie définie dans les années 70 par les grandes multinationales désemparées par les premiers boycott d’activistes environnementaux. C’était simple : il suffisait de parler avec eux, de faire quelques petites concessions et au final, de faire quand même ce qui était prévu. Cela est établi par l’analyse scientifique des nombreuses archives d’entreprises, courriers, procès-verbaux de conseil d’administration, etc. Et entretemps, grâce à cette « diplomatie » jamais remise en question, le capitalisme garde le cap, avance et poursuit son œuvre néfaste de destruction de l’environnement, en prônant un soi-disant « dialogue ».
Pourtant, il semble que depuis lors, l’urgence de changer de politique à l’égard de l’environnement s’est drôlement manifestée ! La destruction de la biosphère, la perte de biodiversité, la crise climatique ont cessé d’être des menaces abstraites, ou d’être couvertes par le vacarme des climato-sceptiques, et que l’on s’accorde, au moins eu niveau des mots, sur la nécessité de préserver la nature, de cesser le saccage et, pour ce faire, de changer de système économique. Il semble que les dernières catastrophes naturelles, les canicules, les dérèglements concrets ont convaincu le plus grand nombre. Pourtant, les expert-e-s sont de plus en plus désespérés par l’inactivité politique. Comme le révèle un article récent du Monde, de plus en plus de scientifiques en appellent à la désobéissance civile. A l’instar de la biogéochimiste américaine Rose Abrammoff, 35 ans : « Devenue relectrice du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), en 2019, elle a pris conscience de l’ampleur de la catastrophe écologique : le maintien « politiquement impossible » du réchauffement climatique à 1,5 °C, les points de bascule « de plus en plus probables », la dégradation des écosystèmes. « Ce fut un choc », se souvient-elle. » (Le Monde, 28/01/23) Il semblerait que du côté des responsables de Pari Daizai et de leurs interlocuteurs politiques, le choc ne se soit pas encore produit.
Pire, étant donné le principe même du zoo – exploiter le vivant dans tous les sens du terme : le non-humain que l’on enferme, l’humain dont on trompe la sensibilité et le besoin d’émotion -, on peut considérer que les investissements effectués pour étendre sans cesse la zone d’influence, augmenter continûment l’audience et les adeptes, ont une fonction de prosélytisme au service de l’ontologie naturaliste telle que définie par Philippe Descola afin que se perpétue sa domination au nom de la modernité , conçue comme ce qui a légitimé et orchestré la destruction systématique de notre lieu de vie : « J’ai appelé naturalisme cette façon d’inférer des qualités dans les choses car elle a d’abord pour effet de nettement dissocier dans l’architecture du monde entre ce qui relève de la nature, un domaine de régularités physiques prévisibles puisque gouvernés par des principes universels, et ce qui relève de la société et de la culture, soit les conventions humaines dans toute leur diversité instituée. Il en résulte une dissociation entre la sphère des humains, seuls capables de discernement rationnel, d’activité symbolique et de vie sociale, et la foule immense des non-humains voués à une existence machinale et non réflexive, dissociation inouïe qu’aucune autre civilisation n’avait envisager de systématiser de la sorte. »
A noter aussi que le montant nécessaire à construire une nouvelle route – dans un pays où il n’en manque pas, de routes- fait débat. C’est peut-être même le seul aspect vraiment mis en question, sur lequel obtenir des concessions, des aménagements, la décision de tracer un nouvel accès étant implicitement jugé incontournable. Au final il s’agira d’argent public – « nos impôts » – investi pour permettre à top manager, à une équipe de marketing et à quelques actionnaires avides d’atteindre leurs objectifs de rentabilité exponentielle. Un classique du néolibéralisme : affaiblir la puissance publique mais en profiter. On pourrait imaginer que ce modèle ne soit plus acceptable pour le politique, une fois bien intégrée la nécessité d’adapter nos modes d’existence à l’urgence climatique. Bien sûr, ce n’est pas simple de rompre avec les vieilles habitudes. Et il faudrait que soient prises des initiatives structurelles, systémiques pour modifier le marché de l’emploi, ses finalités, ses ressources, afin de ne plus à subir le chantage à l’emploi de pareilles entreprises cyniques, destructrices de biodiversité. Finalement ce sont elles qui définissent la « valeur travail » !
Pourquoi en effet faut-il s’écraser parce que Pairi Daiza a décidé d’atteindre trois millions de visiteurs. Pourquoi en déduire qu’évidemment, alors, cela justifie une nouvelle route, pensons-la pour nuire le moins possible aux riverains, pour intégrer quelques ajustements et réflexions des bourgmestres et collectifs opposés. Bien entendu, le parcours actuel occasionne des nuisances importantes pour les habitant-e-s des entités traversées par le charroi. Mais ajouter un contournement, un autre tracé, ne va pas supprimer les décibels des files de voiture ni éliminer la pollution atmosphère des gaz d’échappement. Sans compter que les nuisances évoquées ne concernent pas que les villages proches (Gages…) mais tous ceux que traversent la route Nimy-Ath, Jurbise, Lens… Il serait préférable de changer radicalement de logique.
Il est temps d’avoir le courage politique et de considérer qu’au nom des intérêts d’un privé, il n’est plus admissible qu’un bien commun – un paysage, un patrimoine rural – subisse la pression d’une marchandisation maximale. Pourquoi accepter cette ambition de trois millions de visiteurs qui viendront essentiellement- on le sait – en voitures, générant une empreinte carbone monstrueuse, bien en phase avec cet esprit de l’exploitation du vivant caractéristique du zoo. Et les innombrables panneaux solaires ne changeront rien à cette empreinte carbone désastreuse. Pourquoi, en bonne gestion écologique, ne pas limiter le nombre de visiteurs, en établissant un seuil de soutenabilité du milieu naturel concerné. Pourquoi est-il impossible d’indiquer à une entreprise privée que son projet et ses ambitions doivent être dimensionnés aux impératifs écologiques du lieu où elle vient pratiquer un extractivisme sans scrupule au profit de ses actionnaires ? Cela semble pourtant relever du bon sens, d’une gestion en bon père/bonne mère de famille : consciente du tournant climatique, soucieuse de prendre les mesures qui préservent la biosphère, espérant léguer quelque chose de vivable aux générations futures…
Alors que notre époque voit se multiplier l’attribution du statut personne morale à des entités naturelles – fleuve, montagne, plaine, forêt -, on peut « admirer » dans le chantier colonial de Pari Daiza les bonnes vieilles habitudes de dénier au vivant tout droit à la parole. Ce qui correspond bien, encore une fois, à la vocation même du zoo. Pourtant, heureusement, comme partout où frappe ce délire capitaliste, il y a des collectifs qui se forment, contribuent à inventer une diplomatie originale, en représenta tant les humains que les non-humains qui forment le paysage agressé (Mouvement pays vert et collines). Bien entendu, les rôles étant prédéterminés, souvent, ils font office de David (en plus, au pays d’Ath…). Que peut-on rêver de mieux pour Pairi Daiza ? Que l’on donne autant de millions à ce collectif que pour construire une route de plus : cela leur permettra de mener une occupation de terrain réellement écologique, respectueuse. Que l’on offre à Extinction Rebellion quelques abonnements à Pari Daiza. Que l’on puisse rêver à une zad qui encerclerait le « parc animalier » et contribuerait enfin à un réel basculement vers un autre imaginaire, une autre économie, une réinvention des relations humains et non-humains. Et cela attirerait du monde, donnerait lieu à une activité citoyenne d’initiation à vivre autrement, mais sans avoir besoin d’attirer des millions de personnes (le modèle économique étant tout autre), sans avoir besoin de bétonner des hectares, d’ajouter une route parmi tant d’autres. Investir dans un plan culturelle ambitieux serait judicieux aussi, en mobilisant tant les associations d’éducation permanente que les organisations naturalistes, des écologues pédagogues, des guides nature : son objectif serait de rendre une vraie rencontre avec la nature plus désirable, pour le plus grand nombre, que les représentations artificielles orchestrées par des zoos. Du coup, on élargirait la possibilité d’un boycott efficace des manifestations ludiques de l’économie écocide, tout bénéfice pour les objectifs de « nouvelle société », adaptée au dérèglement climatique, décarbonée… »
Pierre Hemptinne
Références :
Grégoire Chamayou, « La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire » La fabrique éditions, 2018
Emmanuel Bonnet, Diego Landivar, Alexandre Monnin, « Héritage et fermeture. Une écologie du démantèlement », éditions divergences, 2021
Philippe Descola, « Les formes du visible », Seuil, 2021