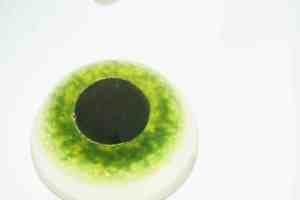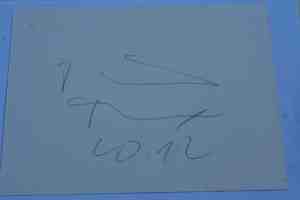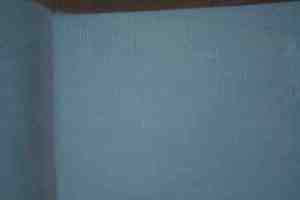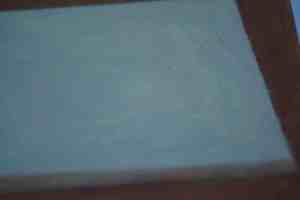Fil narratif de médiation culturelle à partir de : Des Lignes de désir, Félicités 2023 des Beaux-Arts de Paris (Sofia Salazar Rosales, Victor Pus-Perchaud, Élise Nguyen Quoc, Gabrielle Simonpietri, Pierre Mérigot , Nina Jayasuriya , Louise Le Pape ) – A partir d’elle, Le BAL – Rebekka Deubner, Strip, Le BAL – Ulla von Brandenburg, la fenêtre s’ouvre comme une orange, Fondation d’entreprise Pernod Ricard – jour de naissance – flâneries parisiennes – Daniel S. Milo, La survie des médiocres. Critique du darwinisme et du capitalisme. Gallimard 2024 – Le Riesling d’Olivier, Les Vins Pirouettes – ergonomie cycliste – (…) –

L’appel de la grande ville. Signal de migration, remonter le temps. Chimérique espoir d’aller modifier le passé, revenir sur le déroulé de sa vie, agir rétrospectivement sur le futur. Repenser sa naissance au monde.
Quelle aventure, s’extraire de sa terrasse, de la colline, du hameau où il s’est enchâssé! Pour « remonter » vers Paris, ça le prend impérieusement, à la manière du signal qui déclenche l’exode rituel des espèces migratrices. C’est l’approche du jour de sa naissance qui, confusément, impulse cet appel d’un voyage dans le temps, revenir en arrière, dans les plis matriciels du destin, essayer d’en modifier certains traits, agir a posteriori sur les choix effectués autrefois, à l’aveugle. Ou plus simplement, en se rapprochant des strates anciennes, en retrouver le sens, de plus en plus évaporé. Renouer avec un lieu fantasmé, très tôt, dès l’adolescence, investi de multiples rêves et projections, ensuite arpenté tant de fois, jungle de sollicitations culturelles, intellectuelles, sensuelles, formatrices. Durant des années, territoire de flâneries régulières et d’économie buissonnière délibérée, forcenée même, qui a modélisé sa cartographie sensible, forgé son attention aux symboliques ambiantes. Lieu d’espérance, de possibles diffus, de hasards et de bifurcations qu’il n’imaginait pas se produire ailleurs que dans cette grande trame parisienne, dense, décor idéal d’errance solitaire dans la foule, ressasser dans le bruit continu, murmurer dans l’agitation permanente, gamberger, monologuer les multiples hypothèses de son futur, profiler projet après projet, tirage de plans sur la comète, aiguiser le désir de les communiquer, épuiser les ressorts rhétoriques, traquer sa propre pédagogie du changement perpétuel, triomphant, sans cesse « se projeter dans ce qui n’existe pas » encore.
Et allez, ouste, il s’extirpe de la stase cévenole, les premiers gestes sont les plus âpres, contre sa nature ! Rassembler un bagage sommaire, se représenter mentalement les différentes étapes du processus de déplacement, l’enchaînement des mouvements auquel s’astreindre, une fois mis en branle, hop, c’est parti, cahin-caha, un peu zombie, à vélo jusqu’au village, ranger la bécane chez le garagiste du coin, désœuvré, rejoindre au bistrot la permacultrice qui descend vendre ses légumes au marché de la ville, après un petit noir au comptoir, se caler entre les cageots, puis, en bas, sur un quai périphérique, près des grandes surfaces, poireauter à l’aubette du bus, et ensuite enchaîner, avec persévérance, bus, train. Voyage de nuit. Dans le train, entouré de personnes mi-éveillées, mi-endormies, absorbées dans leurs écrans ou leurs casques de réalité virtuelle. En ce qui le concerne, somnolence bercée par quelques rengaines-squelettes de Roscoe Mitchell, réécoutées quelques jours plus tôt, devenues obsédantes, sorte de mantra elliptique favorisant le retournement temporel progressif, par infimes rotations.
Félicité-e-s des Beaux-Arts de Paris. Technologie immersive vs médiation, contagion. Seul dans les salles. Plasticité inattendue de matériaux de récupération, frontière floue entre animé et inanomé. Des intérieurs, des intimités, des chambres à soi, illuminés par l’aube du Tout-Monde.
Une fois débarqué, traîner, revoir les rues connues, humer, épars, ce qu’il a été, ici. Mais, à sa grande surprise, fendre la foule téléguidée par ses écrans ou longer les terrasses des cafés remplie de gens quasiment tous équipés de leur casque de réalité virtuelle, « ah ouais, quand même, ça ne s’est pas arrangé ». Il parvient à la Seine et s’engouffre dans l’exposition de jeunes diplômés-e-s des Beaux-Arts. Dans le hall de l’accueil, immense, de nombreux sofas et tables basses, la plupart des visiteurs sont attroupés là, affairés, silencieux, agités de gestes somnambules. Il lui faut du temps pour comprendre : ils-elles n’entreront pas physiquement dans l’espace d’exposition, ça ne semble plus l’usage, tous sont équipés de casques, ils-elles vont à la rencontre des œuvres virtuellement, via l’immersion technologique. C’est ce qu’est devenue la médiation culturelle. Incroyable. Effrayant. Il sera quasiment seul dans les salles à se présenter devant les œuvres nues, à l’ancienne ! En guise d’amorce, à la manière de ces sculptures monumentales placées sur des ronds-points, il admire l’expression d’une plasticité autonome, animale, que des matériaux de construction, d’une souplesse inattendue dans leur torsion, ont gagné et détournée au contact de l’humain, modifiant ainsi les frontières entre animé et inanimé (sculptures de Sofia Salazar Rosales). Dans un recoin, face aux peintures de Victor Pus-Perchaud, explorant la timidité face l’immensité, à travers la solitude dans un meublé miroitant, assoupi mais palpitant de ses fenêtres, objets patinés et jeux vidéos, il y a la reconstitution d’un espace intérieur – on dirait un coin squatté par quelqu’un vivant réellement dans l’expo –, savates et hauts-talons (en céramique) éparpillés, sofa où se recroqueviller, traversé de grandes aiguilles tatouant l’intime de différents héritages culturels, esquisse domestique d’un Tout-Monde épidermique, version poétique de la chambre à soi comme matrice de sacralisation du banal, de rêve terrestre revitalisé (Nina Jayasuriya).
Félicité-e-s des Beaux-Arts de Paris. Frottis au Bic dans la matrice de l’informel. Membranes d’images passées, entre visible et invisible. Raconter ce qui n’est pas soi. Organologie associant rebuts, technologies détournées, déchets végétaux. Une chapelle où boivent les oiseaux.
Traquant dans sa production personnelle de photos, ou dans le trop-plein visuel qui défile, ce qui y apparaît comme « hors image », sans identité, manifestation de l’informe et de l’innommable que les photographes ne voient pas venir dans leur objectif, Elise Nguyen Quoc autopsie ces volumes et ces lignes sans signification, vagues, et pourtant indispensables au sens général de l’image. Alors qu’en général le cerveau guide la main qui dessine pour l’aider à copier ce qui est vu, elle déjoue ce mécanisme, ne cherche pas à mimer l’informe tel que révélé, mais demande à la main de débusquer la manière dont cette fibre brute surgit dans le psychisme, de nulle part, elle effectue des gestes et des manipulations qu’elle imagine correspondre à la cristallisation de ces rebuts iconiques, détails, superflus, angles morts du visuel. Elle se met à la place de l’informel, reflue vers un point de vue qui précède toute interprétation, fausse compagnie au réflexe de plaquer une signification préconçue sur tout ce que l’on voit et entend. Elle grave Bic sur bois, comme grattant une couche de cire sous laquelle devrait apparaître un message, un visage, un paysage, un plan, une trame explosive. Rien de prévisible. Calligraphie à l’arrache au fond d’une caverne aveugle. « De cette façon, alors peut-être, je pourrais rencontrer quelque chose qui n’est absolument pas moi ». Mais en elle. Ce qui souligne une tournure d’esprit tournant le dos aux priorités données à ce que l’on connaît déjà, au même que soi, à tout ce qui relève d’un « chez soi » bien séparé du différent.
Gabrielle Simonpietri récupère des écrans de sérigraphie usagés, abîmés. L’écran de sérigraphie, c’est un cadre et un tissu tendu, autrefois de la soie, à travers lequel transite la couleur qui va former l’image. C’est la membrane à travers laquelle l’image passe de l’invisible au visible, membrane accoucheuse. Elle récupère ces fantômes témoignant du trajet de l’image à travers le filtre qui les révèle, les assemble en patchwork, vaste rideau qui évoque des cabanes de toiles, fragiles, la cabane comme métaphore d’un imaginaire qui assemble et désassemble arbitrairement des canevas usagés, de passages. « De cette façon, alors peut-être, je pourrais rencontrer quelque chose qui n’est absolument pas moi ». Quelque chose d’antérieur au formatage de l’image. Pierre Mérigot confronte science et art, à la manière des insectes fabriquant leur milieu, il « orchestre un processus aller-retour entre le dessin, la nature, l’organique, le numérique et la machine, invitant à repenser notre interdépendance dans un monde où nous sommes autant cellule que rouage. » Il compose des tableaux à partir de déchets urbains, industriels, de rebuts végétaux, autant de « vestiges d’habitats » disparates et les agence sous forme de réseaux, archéologie d’organisations refoulées entre humains et non-humains, bifurcations pour réinvestir l’histoire des techniques vers des futurs autres que capitalistes.
Il rêve et se recueille longtemps – il lui semble être là proche d’un nouveau point de migration – dans la pénombre où Louise Le Pape a déposé, taillés dans la pierre, des abreuvoirs à oiseaux, vides, accompagnés de runes gravées attestant d’une civilisation ornithologique effacée, tandis que l’espace est envahi, strié, tissé de sons d’écholocation de chauve-souris, chapelle où retrouver le sens d’une orientation, juste et interspéciste, au sein du vivant. De tout cela, parmi d’autres œuvres tout autant stimulantes, lui vient un puissant enthousiasme pour l’amplification du soin apporté au peu visible par la jeunesse artiste. Il se défoule alors sur les cordes de harpe tendues dans l’installation de bois flottés de Marc Lohner, symbole d’une forêt échouée dont les troncs et les branches résonnent des prosodies de tous les naufrages, passés, présents et à venir, rappelant qu’une société qui réprime les flux migratoires n’a rien compris à la vie sur terre et court à sa perte.
Il ressort de là, ragaillardi, rajeuni par la tonicité de la nouvelle génération, de ces nouveaux parcours qui démarrent, autant de pistes à suivre dans les années qui viennent. Pour lui, ça éveille plusieurs attentes, voir comment ces artistes vont évoluer, projection matricielle de lignes de désir, à venir. Par contre, accablé, effrayé, par le spectacle du public encasqué dans leur technologie d’immersion esthétique. Il s’éloigne en outre avec le sentiment d’un rituel accompli, fouillant sa mémoire : « quand était-ce, ma première fois voir les Félicités ? C’était Laurent Busine, curateur. » Peine perdue, il n’est plus copain avec les dates. Par contre, il y a toujours repéré des noms qu’il n’a cessé ensuite de suivre, Bertille Bak, par exemple, dont chaque nouvelle expo le réjouit.
Flâneries. La digestion lente d’une exposition. Lumière des jasmins. Rencontre avec un vin Pirouette. Immersion en cuisine. L’ivresse emporte tout.
Il traîne la patte et s’en va déposer ses affaires à l’hôtel où, ayant acquis une prime de fidélité tout au long des années fastes, on lui réserve pour trois fois rien un cagibi avec un fauteuil-relax où étendre son sac de couchage, un évier, une toilette, sous les combles. Il aime revoir et papoter avec les préposé-es à la réception, le personnel d’entretien, toute l’équipe qui le reconnaît, est contente de sa visite. Ensuite, il repart dans les rues, à la recherche d’une enclave hors du temps, un méandre oublié, substituer la stase parisienne à la stase cévenole. Il s’enfonce entre vieilles maisons, logements sociaux, boutiques à l’abandon, ateliers marginaux d’industries créatives, infrastructures collectives, culturelles ou sportives, populaires. A un embranchement, il s’arrête, regard happé par des émulsions citron dans le gris, au loin, jaillissant des parois d’une cité grise. C’est le panache jaune de deux trois jasmins, lumineux, tellement encastrés dans l’artificialisation urbaine qu’ils semblent eux-mêmes postiches, plastiques. Il constate alors qu’il est au pied d’un arbre, toujours dénudé par l’hiver, où deux ouvriers sarclent la terre rare entre les racines, et où chante un merle, si fort qu’il le croirait amplifié, si archétypique qu’il ne l’avait pas capté (trop beau pour être vrai). Ah, toujours le merle ! Qui le resitue dans son lointain jardin, et dans plusieurs tissus textuels, dont le très beau « En invité » de Peter Kurzeck, où le narrateur ponctue le récit de ses cheminements francfortois en signalant, en cette période de mars, chaque merle rencontré. « Et donc les merles comme si nous étions présents avec eux quand ils sont arrivés chez les hommes. » (p361) Il suit l’envolée du merle et son regard s’arrête, en face, sur la devanture d’un vieux bistrot, tout à fait engageant. Allez, hop, il est temps de s’attabler, s’hydrater. Déjà, le voici épaté, réjoui, face au fameux blanc d’Alsace, plutôt orange, blanc de macération, Pirouettes, qui porte bien son nom. Retrouvailles inopinées, espérées, dans Pirouette se reflète de lointaines et bienfaisantes libations. Servi au fût, c’est l’impression d’une source inépuisable, en direct de la vigne. C’est frais, d’une couleur mélancolique, un peu trouble, légers arômes prunes et cannelles, raisin un peu fumé, complexe et franc à la fois, ça coule avec du corps et quelques cabrioles. Une ivresse ambrée le submerge lentement mais sûrement. Il largue les amarres. Plus de mots, plus de langage raisonné dans la tête, il sirote, feuillette le catalogue de l’exposition, confronte photos et textes à ce qu’il a vu, ressenti, enregistré. Il décante, digère l‘expérience esthétique. Ce qu’il a vu et retenu lentement se décompose, glisse dans les profondeurs, s’agrège au souvenir d’autres œuvres qui s’y trouvent déjà transformées en humus de l’imaginaire. Une couche de plus en plus épaisse. Vague, de plus en plus vague, il goûte le bien-être dans le rien, son regard plane autour d’une jeune américaine cambrée avec ostentation, seins nus pointés sous une maille transparente. Le temps passe, l’ambiance change autour de lui. Une équipe de jeunes cuistots et serveuses s’active à la préparation du dîner. Une tension joyeuse monte. La cuisine étant exigüe, ils-elles travaillent à même les tables du bistrot. Ca ressemble à un atelier participatif. Il entend que manque une petite main, malade. Des envies le prennent. De verre en verre, de fil en aiguille, il en vient à proposer ses services. Hésitation. Palabres. Allez, juste un peu, essayons. Il se retrouve à couper en fine mirepoix courges, panais, carottes, céleris. Hilare, dopé par Pirouette, pas bavard, concentré, juste des onomatopées, fondus dans l’atmosphère et les énergies centripètes de toute l’équipe. On lui demande de goûter, il se retrouve avec une assiette de légume en tempura à grignoter. Il assiste, dans un coin, au lancement du service, les premières tables. Pendant le coup de feu, il donne un coup de main pour débarrasser, plonger. Pirouette toujours, Pirouette après Pirouette. Il ne sait plus comment il regagne l’hôtel.
Jour de naissance. Adoration des vélos-fusées. Pourtant, le capitalisme pourrit tout avec l’invention pour l’invention, la nouveauté pour la nouveauté, toujours plus, sans autre fin que de produire et faire consommer, épuiser l’environnement. Mais, avec un vélo-fusée, on peut s’échapper !?
Il se réveille, ça y est, le jour de naissance. Il a hâte d’être dehors, de vivre cette journée en se laissant porter, curieux de tout, perméable, ouvert à tout. Tiens, voilà une boutique de vélos où il venait mater les derniers modèles et acheter des équipements. Il entre admirer les mécaniques rutilantes. Aux cimaises, des machines sidérantes. Déjà, à l’époque, « de son temps », avec son dernier vélo de pro, il lui semblait que l’aérodynamisme avait atteint ses limites. Et là, il constate que ça n’a cessé de se perfectionner, d’aller toujours plus loin, reflétant le délire incessant de la performance, exprimé dans le design. L’aliénation qui oblige à produire toujours du neuf, du « plus ». Ca confine quasiment au débile. Tyrannie de la nouveauté, de l’invention dernier cri, levure chimique du marché, consumériste. « L’innovation pour l’innovation est très prisée, et de nombreuses idées futiles sont écologiquement onéreuses. » Le capitalise justifie cette course à l’innovation par l’obligation de s’adapter à l’environnement changeant, par les mécanismes de la sélection naturelle. Il serait plus juste d’inverser cette logique mortifère : « si notre environnement change perpétuellement, c’est surtout à cause de la ferveur innovatrice » et de ses impacts destructeurs. Mais, il le reconnaît, même contrit, ça accouche de vélos magnifiques (pour lui), qui l’épatent, presque irréels, immatériels, épures ultimes. Ah, comme il aimerait s’affûter sur cette machine, faire corps avec une telle fusée, il se dit qu’il pourrait encore filer, limite immortel, défier le temps, infiltrer une autre dimension. Ces ergonomies semblent à même de propulser le corps qui s’y confie en d’insoupçonnées régénérescences.
Le BAL, célébration de celle d’où tout est parti. Roland Barthes rêve d’elle. Anri Sala, étudiant, filme-enquête sur la jeunesse idéaliste de sa mère, le désir de faire des enfants pour changer le monde.
Le soleil bouscule la fin d’hiver, et le voici devant la porte du BAL, regardant l’affiche de et lisant avec émotion le titre de l’exposition en cours « à partir d’elle ». Ca tombe bien. Lors de ce jour particulier, où chaque cellule se remémore d’où elle vient, il cherche toujours à rejoindre sa mère le matin où elle lui donna naissance, à imaginer comment elle passa les premières heures avec lui, son père avec elle, ses grands frères et sœur. C’est une expo qui avive les souvenirs d’être un né un jour de quelqu’un, qui déplient et racontent la naissance toujours continuée, non pas un jour et heure précise, mais quelque chose qui ne cesse de se produire, à travers le flux relationnel de celle qui enfante. C’est un ensemble de travaux d’artistes explorant la relation à leur mère, organisés en toile hétérogène autour des phrases de Roland Barthes dans « La chambre claire ». « « Car je rêve souvent d’elle (je ne rêve que d’elle), mais ce n’est jamais tout à fait elle : elle a parfois, dans le rêve, quelque chose d’un peu déplacé, d’excessif : par exemple, enjouée, ou désinvolte – ce qu’elle n’était jamais ; ou encore, je sais que c’est elle, mais je ne vois pas ses traits (mais voit-on, en rêve, ou sait-on ?) : je rêve d’elle, je ne la rêve pas. » (Catalogue d’exposition) Il est vite happé par la vidéo d’Anri Sala. Encore étudiant, et à partir de films d’archives sans son où il découvre sa mère, il enquête sur son engagement au sein de la Jeunesse Albanaises, vouant un culte au dictateur, il reconstitue le contexte, confronte sa mère à cette scène d’un vaste congrès où on la voit prendre la parole. (Il s’acharne un peu sur la dimension « compromission » de la jeunesse passée, lui qui aujourd’hui n’a aucun état d’âme à investir la Bourse de commerce !) C’est un film touchant sur le choc, un peu universel, entre cynisme d’un régime et pureté idéaliste d’une adolescente. Mais lui, il rêve devant le film, à la magie de revoir sa propre mère, jeune, éclatante, animée du même désir, diffus, non militant, de faire advenir un monde meilleur pour tous et toutes. Ce désir de faire des enfants, transmettre le rêve d’un monde meilleur à une nouvelle génération. Comme il aimerait avoir les moyens de s’engager dans un film-enquête sur la jeunesse de sa mère, telle qu’elle était à vingt ans, rêveuse, amoureuse, habitée des ondes positives qu’elle avait envie de transmettre.
Le BAL, « à partir d’elle ». Rebekka Deubner, les vêtements de sa mère, vues aériennes de l’arrière-pays maternel. Présence de la morte. Forêt de tissus. Larmes.
Il est surtout bouleversé par les photomontages de Rebekka Deubner. Son jeu de passe-passe, cache-cache, avec les vêtements de sa mère défunte, manipulations tendres, à l’affût du frisson sacré, effets de revenance, manipulations bousculant le non-dit de l’absence. L’ensemble est intitulé « strip », strip d’elle s’habillant et se déshabillant de sa mère, mais où le mot « strip » en évoque un autre, « spirit ». Les vêtements portent la marque du corps qu’ils ont habillé, une usure raffinée qui semble un ajout plutôt qu’une perte de substance, l’empreinte de l’âme, une buée encore tiède dans les fibres textiles. Une patine trouble des teintures et des trames. En touchant ces habits, elle frôle la disparue, elle palpe ce qui l’attachait à elle et qui correspond à l’incommensurable de la mère, tout ce qu’on ne saura jamais sur sa mère et en assure le rayonnement surnaturel. Ces vêtements, elle les pose sur du papier sensible. Ils sont pliés ou dépliés, panoramiques ou détaillés, mis en scène, de manière à faire ressortir les caractéristiques qui font qu’ils sont encrés dans la mémoire. Une encolure, une échancrure, des boutonnières, des manches, des poignets, un cordon, une agrafe, un liséré, des bretelles, une épaule, une jambe, une couture, une ligne brodée, des motifs parsemés comme fines fleurs de champs ou de rares labours géométriques, des gazes translucides, des façons de voler autour ou d’épouser les formes au plus près. Toute une syntaxe poétique de l’absence et de la présence. Elle manipule les reliques avec des gestes de réanimation, qui ramènent l’inerte à la vie. Ensuite, elle les balaie de lumière comme pour les scanner, les passer au rayon X, voir ce qu’ils cachent, activer, débusquer les particules fantomatiques qui y prolifèrent. Cela donne autant de « saint suaire » parcellaires, de parties corporelles réincarnées dans de l’aérien, différentes strates géologiques de l’immatérialité maternelle. Autant d’images spectrales qui cartographient en icônes l’attachement cosmologique à sa mère. Cela évoque des matières oniriques, contours d’organes imaginaires, hybrides, où se joignent l’entité mère et l’entité fille. Un nuancier enchanté d’un au-delà apaisant, commun. La traduction graphique de ce qui s’imprime en elle chaque fois que ses mains touchent plongent dans ces étoffes intimes, la cherchant. C’est une collection de vues aériennes de l’arrière-pays maternel, là, soudain, si réel, réellement révélé, et décidément radicalement inaccessible. Cette inaccessibilité frustrante qui pousse d’autre part l’artiste à la performance filmée où elle enfile un à un, effectuant une infinité de gestes rituels, de réincarnation, les vêtements maternels, couche sur couche, où elle s’enfouit sous leur accumulation, terrier de pelures parfumées, habitées, amoncellement de doudous, sculpture matricielle. Dans la publication reprenant la série des photogrammes, ces mots magnifiques de Juliette Rousseau : « La mort est absence, l’étoffe est présence. La mort est présence, l’étoffe de la mort est absence. Au carrefour de tes étoffes mon corps sait ce qu’il sent, sent qu’il sait : tes vêtements disent que tu n’es plus là mais que tu l’as été, mon corps dit que tu n’es plus là mais que tu l’es encore. La matière de tes tissus fait forêt.»
Tout au long de l’exposition, les œuvres l’aident à imaginer ce qu’aurait pu être sa relation avec sa mère si elle avait vécu, si il avait eu le temps de la connaître. Cela l’apaise et en même temps, exacerbe sa mélancolie, à la limite du supportable et des larmes. Elles montèrent devant les grands portraits en lévitation, tenus à rien, ondulant faiblement au gré d’une respiration de plus en plus ténue, vielle dame paisible assoupie, regardée et photographiée par son fils, Paul Graham, sidéré et recueilli, plein d’amour, face au glissement inéluctable, progressif, dans le dernier sommeil, l’adieu.
Retrouvailles avec les voiles peintes d’Ulla von Brandeburg. Venues des étoiles, une yourte enchantée, posée dans le vide. Un vide qui travaille, où fermente de l’espoir.
Les yeux brouillés, sans âge, vieux mais toujours gamin près de sa mère, il s’éloigne dans la rue d’Amsterdam, aveuglante de soleil, c’est aller sans voir vers quoi il marche, vers un point où tout est fusion. Marcher sans se rendre compte qu’il marche. Léviter. N’est-ce pas dans cette rue qu’a habité Jacques Roubaud ? Il arrive à la Fondation Ricard, mon dieu, encore un bâtiment amiral, ostentatoire, plein de fric. Pas écrasant, pourtant, reconnaît-il, une certaine légèreté, une façade même pleine de fraîcheur ! N’empêche, ces théâtres du pouvoir du fric, dans leur rôle de temple de l’art contemporain, prive celui-ci de toute force subversive, de toute chance de peser sur un changement d’imaginaire sociétal Il vient y voir une nouvelle installation d’Ulla von Brandenburg. C’est aussi rituel. Il a toujours essayé de voir ses nouveautés depuis la découverte qu’il en fit en 2009 au Frac/Ile de France (« Name of number »). Jusqu’à l’exposition incroyable confinée en 2020 au Palais de Tokyo. Depuis, il y a du « ulla von brandeburg » en lui, la façon dont, avec ses toiles peintes, elle métamorphose le vide en poumon vital, délimite un espace où, des coulisses du néant, se trame « quelque chose » de palpable, est intégré à ses modes de sentir et de penser. Il retourne voir la continuation du récit de la scène vacante, flottante entre les toiles du possible, non pas en attente de quelque chose de neuf, de nouveau, mais pour la continuation, la constance et la permanence, pour entretenir « l’organe ulla von brandeburg » désormais enchâssé dans son métabolisme, en aiguiser les facultés divinatoires face au passé, au futur. Dans sa pulsion monologuiste, tenace, à se dire toutes les formes désirées du futur, comme il égrènerait un chapelet, le mode opératoire de ces voilages peints, intériorisé, est pour lui fondamentale. Une théâtralisation de la page blanche, une scénographie de l’apparition, qui organise la circulation entre différents chambres vierges où accoucher ce qui vient, réécrire ce qui a eu lieu, réviser sa mémoire, trier. Les toiles peintes et leurs cordages, ménageant passages et fermetures, invitant à se faufiler entre les membranes, installent une envie d’appareiller en toute intériorité. Le dédale matriciel des rideaux colorés métaphorise un vers d’Apollinaire, « la fenêtre s’ouvre comme une orange ». Il y déambule dans cette fenêtre épluchée, dans ce flot de vitamine, dans cette orange juteuse. A l’intérieur, différentes petites scènes remontent de l’abîme, s’animent sur des écrans. Des scénettes jouées en boucle. Pour l’éternité. Des chorégraphies infimes qui font tenir l’ensemble. Des personnages circassiens effectuent des tours de magie. Ils ont ces affectations d’êtres capables de maîtriser disparition et réapparition, de s’éclipser et de revenir, identiques ou métamorphosés. En montrant tout, bien qu’escamotant le « truc ». Ils jouent avec les voilages d’Ulla von Brandenburg. Ils en font ressortir la dimension hypnotique, la faculté de bouleverser nos relations aux formes et couleurs, de faire vaciller vers d’autres dimensions du vivre, de rendre visible ou invisible. Ou ils s’échangent sans fin une série d’objets symboliques, orchestrant une circulation de valeurs occultes, oniriques, révélant au cœur des choses, une économie de l’immatériel, du non rationnel, en lieu et place de l’économie marchande et de la mathématisation absolue du vivant. Ils révèlent l’arbitraire de tout arcane économique, monde d’illusion dont on peut s’éveiller. Ces vidéos, pourtant réalisées par l’artiste, donnent l’impression d’être des archives très anciennes, exhumées par hasard, transmettant par le visuel suggestif, une série de savoirs reniés, censurés par la modernité et dont le besoin se fait cruellement sentir face à l’inhabitabilité croissante de la planète. L’organisation des vastes toiles peinturlurées, en une géométrie cabalistique, facilite le cheminement et les retrouvailles avec ces savoirs intuitifs, ancestraux, et qui soignent, brillent comme l’étoile du berger, indique à chacun-e des routes salutaires à inventer, tracer selon sa sensibilité. Des chapelles nomades – air de famille avec des entrailles de yourtes – radieuses d’espoir interstitiel.
Déstabilisé par toutes les émotions esthétiques. Attendre que le corps les absorbe. Tête de veau et rouge de Loire. Brasserie pleine de fantômes du XIXème. Matrice continue de ses lectures de jeunesse qui continuent à déterminer son appareil sensible.
Il est comble. Il a fait le plein d’émotions esthétiques, de nouvelles images. Il trottine fourbu, longuement, s’assied sur un banc dans un square. Écoute, regarde, vague. Ne pense à rien. Il digère. Somnole. Le jour décline déjà. Il repart fourbu, lent. Il a sorti un vieux plan de Paris, en papier. Alors que les milliers de touristes s’orientent autour de lui grâce à leur casque connecté. Il multiplie les pauses café noir. Se reconstitue, remonte la pente. Le soir tombe. Il échoue finalement dans une vieille brasserie, décor inchangé depuis 1854, 11 ans avant la mort de Baudelaire. Bien assis sur la banquette, il s’abîme dans la contemplation de la vaisselle sans âge, de la serviette blanche épaisse, des couverts en argent, aux confins du paysage et du monochrome, blason figuratif sous la neige, horizon qui lui procure un bien-être fou, la sensation d’un confort immense. Un foyer. Un centre. Sa soif de vin rouge de Loire est immense, tyrannique, le sommelier, prévenant, le comprend à merveille, il a tout ce qu’il faut. Alors, il s’abandonne aux substrats littéraires qui hantent sa mémoire (et même ce qu’il y a en dessous de celle-ci, l’innommable, l’informe tel que le gratte au BIC la jeune Félicitée Nguyen Quoc), en pagaille, vestiges des auteurs du XIXème qu’il dévorait inlassablement dans sa jeunesse, des plus connus aux plus obscurs (ce qui, bien plus tard, lui permit de comprendre plus facilement la notion de « champ littéraire » de Bourdieu). Un autre aspect de la matrice qui l’enfante, toujours, jour après jour, dieu sait combien de ses synapses se sont établies en fonction de ces lectures (au gré des empathies ou aversion pour les personnages, les situations, les spécificités stylistiques, au fil des efforts produits pour saisir le monde décrit, exploré, les règles de vie d’une autre époque) !? Il se plaît à en imaginer auteurs et protagonistes évoluer dans le décor où il se trouve, se livrant à de vagues pratiques spirites, attendant avec une impatience douce l’arrivée de la cocotte noire au fumet venu tout droit de la cuisine lointaine de sa grand-mère, une tête de veau, cervelle comprise, plat traditionnel inspirant de nombreuses confréries, évoqué par Flaubert dans L’Éducation sentimentale, dont Alexandre Dumas consigna une grande variété de préparations. Ca y est, il touche au but, son jour de naissance n’a plus de fin, se perd dans la nuit, ses lustres, ses miroirs, il patauge avec bonheur dans l’indistinction de ce qui fut, de ce qui vient, de ce qui est, « s’efforçant juste de persévérer dans son être », comme disait l’autre.
Pierre Hemptinne