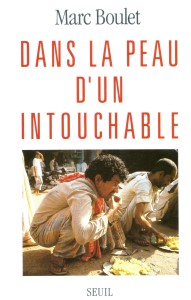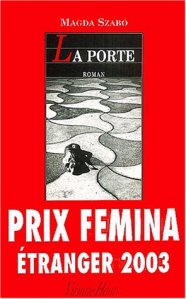Maryse Vuillermet
Maryse Vuillermet
Frontaliers pendulaires, les ouvriers du temps
La rumeur libre – 2016
L’Eldorado est un mythe. Un lieu inaccessible. Un rêve de réussite ou de fortune ; les évolutions du langage et des ambitions individuelles y intègrent une multitude d’autres désirs, aujourd’hui. Mais seulement un rêve.
Comment le définit Maryse Vuillermet ?
On vous a dit que la Suisse, c’est l’Eldorado, la terre promise, mais ça n’a rien à voir, l’Eldorado, ça suppose un grand voyage, tout quitter, tout laisser, le saut dans l’inconnu, le bagage minimum, la peur au ventre, comme le grand-père, un balluchon, à pied dans la neige, vous, l’Eldorado, il est juste de l’autre côté, au pied de la montagne. Vous y allez en voiture, et le soir vous êtes à nouveau dans votre lit, votre maison, votre village.
Vous l’avez peut-être compris à travers cette définition et le titre de l’ouvrage, Frontaliers pendulaires, les ouvriers du temps est un essai documentaire sur les travailleurs qui habitent en France et travaillent en Suisse. Le matin en France, la journée en Suisse, le soir de retour chez eux. Oh, ils ne mettent pas plus de temps que nombre d’autres salariés pour se rendre au turbin. Trois-quarts d’heure, pour certains, pas plus. Ils ont même le temps d’aller chercher les enfants chez la nounou. Et ils gagnent plein d’argent. Ils mettent des sous de côté pour une maison plus grande, pour les études des enfants, pour leur retraite.
C’est donc bien d’un Eldorado, qu’il s’agit. Mais le microscope de Maryse Vuillermet montre aussi l’envers du décor. L’engrenage, l’Audi dans laquelle il faut investir et l’augmentation du niveau de vie qui empêche tout retour en arrière. La perte de repère ici et le racisme là-bas, à l’égard des frontaliers. L’impossibilité de faire autrement, car de notre côté des montagnes, Jura ou Alpes, il n’y a pas de travail.
Ici, là-bas. Matin, soir. Tic, tac. Qui connait un peu le tissu économique suisse sait sans doute que de l’autre côté de la frontière, l’industrie de la montre de luxe est florissante. Ça n’a pas toujours été le cas, mais c’est la manne des ouvriers frontaliers d’aujourd’hui. Pas que des horlogers, d’ailleurs : autour de cette industrie de luxe gravitent les activités connexes indispensables : écoles privées, chantiers de construction… Des enseignants comme Betty, des super-assistantes administratives comme Sarah ou des conducteurs de travaux hyperspécialisés comme Bastien profitent aussi du système. Mais il y a aussi Marie, qui assemble à la chaîne des montres de 500 à 600 euros pièce. Ou Philippe, le grand Philippe, qui travaille parfois une année entière sur une seule montre, pour le compte d’un émir du Qatar ou d’une star de Hollywood.
Fin mai, Philippe est à son établi, dans l’atelier des horlogers, beau soleil dehors, la montagne commence à devenir vert fluo, vert vif, vert éclatant, les vaches sont ressorties, leurs grosses cloches calmes l’ont aidé à terminer, les derniers réglages sont les plus délicats, il sue, il a passé des journées entières à régler les aiguilles, mais c’est fini, il attend son client, il va venir, on va le lui présenter. Le client d’une Grande Complication veut voir l’horloger, il veut voir ses mains et ses yeux, c’est un Japonais, il est collectionneur, il a déjà plusieurs montres de chez LeCoultre et deux de chez Dufour.
L’ingénieure en moi s’est régalée aux descriptifs narratifs des conditions de travail de chacun des Français frontaliers dont Maryse Vuillermet se veut la gardienne des mots. De la salle des professeurs d’une froideur aseptisée à l’atelier d’horlogerie aux complexités sans nom, cette Jurassienne professeur de lettres a tout retranscrit, avec une précision de vocabulaire qui laisse deviner les subtils arcanes des différents métiers qu’elle décrit.
Ce récit est une merveille. La poésie des mots se marie parfaitement avec le tiraillement des travailleurs (d’un côté à l’autre de la frontière) et le cliquetis des aiguilles (pas de quartz, s’il vous plait, la Suisse est le pays des traditions). Dans Qui se souvient des hommes (Robert Laffont, 1986), Jean Raspail rythmait déjà son texte au gré des premiers nés de chaque génération Alakaluf de Terre de feu. Lafko, Taw, Lafko, Taw. Maryse Vuillermet utilise le même procédé pour évoquer une journée type de ces travailleurs, les yeux rivés sur les différentes horloges, de celle qui leur donne le top départ de la journée à celle qui, dans le sens retour, les fera retrouver leur famille et leur routine française, en passant par celle qu’ils assemblent et qui remplit leur porte-monnaie. Tic, tac, tic, tac. La vie des frontaliers n’est pas plus paisible que celle des Alakalufs après la découverte par Magellan du détroit qui porte son nom. L’autrice le souligne, à travers les difficultés sociales, familiales et professionnelles que traversent ces femmes et ces hommes dont elle dresse un portrait admirable. L’Eldorado est un piège terrible, presque une malédiction.
Vous l’avez compris, je me suis régalée avec ce récit. Je ne regarderai plus jamais passer les voitures, à l’occasion de mes week-ends jurassiens, avec des yeux indifférents.
=> Quelques mots sur l’autrice Maryse Vuillermet